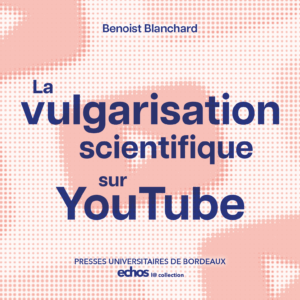UN@ est une plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine
Auteur : Benoist Blanchard

MICA : Bâtiment MSH de Bordeaux
10 Esplanade des Antilles
33607 PESSAC cedex
benoist.blanchard@u-bordeaux-montaigne.fr
0009-0003-7649-9688
Benoist Blanchard
10 Esplanade des Antilles
33607 PESSAC cedex
benoist.blanchard@u-bordeaux-montaigne.fr
0009-0003-7649-9688
Benoist Blanchard
Benoist Blanchard est docteur en sciences de l’information et de la communication depuis 2025. Il a étudié la vulgarisation scientifique francophone et pro-amateur sur YouTube, cherchant à comprendre les mécanismes communicationnels spécifiques à ce mode de transmission des savoirs scientifiques. Son analyse couvre plusieurs aspects : les parcours des vidéastes et l’établissement de leur légitimité, les adaptations nécessaires au format YouTube, ainsi que la réception et l’appropriation des contenus par le grand public.
Avant de commencer sa thèse, de 2014 à 2020, Benoist Blanchard a travaillé comme coordinateur puis chargé de mission pour des projets de politiques publiques sociales, au sein de réseaux associatifs et de collectivités territoriales, en France et au Canada.
De 2021 à 2025, en parallèle de ses recherches doctorales, il a également développé un projet visant à valoriser la recherche menée par les doctorant·es de l’Université Bordeaux Montaigne. Ce projet a pris la forme d’ateliers pour le grand public, s’inspirant des méthodes de l’éducation populaire.
Bibliographie
- Aïn, A., Blanchard, B., C. Forthoffer, M. Sarraute-Armantia (2023). Les sciences humaines et sociales ont le droit de cité : retour sur une recherche-création. Arts·SIC·Culture 2023, 4ᵉ Édition, Recueil des textes de médiation. Éditions de la SFSIC [en ligne], 2024, p. 52-58. https://www.sfsic.org/wp-inside/uploads/2024/11/asc-recueil-congres-2023.pdf
- Blanchard, B. (2024). Le rôle des vidéastes francophones amateurs dans la circulation du savoir scientifique sur YouTube. Actes des Doctorales 2024 de la SFSIC. Éditions de la SFSIC [en ligne], 2024, p. 489-497. https://www.sfsic.org/wp-inside/uploads/2024/12/actes-doctorales-sfsic-2024.pdf
- Blanchard, B. (2025). Vulgarisation scientifique 2.0. Stratégies des vidéastes pro-amateurs
et réception du savoir scientifique sur YouTube. [Thèse de doctorat]. Université Bordeaux Montaigne. https://theses.fr/s296234 - Blanchard, B. (2025). La médiatisation des vulgarisateurs scientifiques sur YouTube : figures et légitimation de pratiques en voie de professionnalisation. Les Enjeux de l’Information et de la Communication, « Médiations scientifiques et usages sociaux des savoirs », Suppléments. À paraître juillet 2025.
Contenus additionnels
Finaliste régional de « Ma thèse en 180 secondes », avril 2022.
Chercheur invité à l’émission « Sciences à l’Antenne », Médiation Scientifique – 04/01/23.
Podcasts des ateliers de valorisation de la recherche : « La recherche en SHS : comment o̶n̶ ̶f̶a̶i̶t̶ vous faites ».
Mots clés
Dispositifs sociaux-techniques, Vulgarisation scientifique, Figures médiatiques, Web-affectif, Accessibilité numérique, Oppressions structurelles et inégalités sociales, Recherche participative
Sur YouTube, la science s’adapte : des contenus divertissants, des vidéastes à l’aise, un algorithme qui pousse au clic… avec à la clé plusieurs milliers, voire millions, de vues. Pourtant, une question s’impose : comment concilier la rigueur scientifique avec les codes d’une plateforme pensée pour divertir ?
Merci à Valentine Delattre, Clément Hartmann, Viviane Lalande, Rodolphe Meyer et Allessandro Roussel pour m’avoir autorisé à utiliser librement des images de leurs vidéos.
À travers cet ouvrage, j’ai essayé de dresser un portrait de la vulgarisation scientifique sur You-Tube en expliquant en quoi elle se distingue des autres formats de communication scientifique. Son recours aux émotions permet de débloquer cer-tains « verrous » culturels dans la circulation du savoir scientifique. Cependant, il ne faut pas oublier que la vulgarisation peut, malgré ses bonnes inten-tions, créer de nouvelles formes d’exclusion. En choisissant certains mots, certaines références, en mettant en avant certaines figures ou certaines ma-nières de parler, elle peut donner plus de valeur à certains savoirs qu’à d’autres, ou encore à incarner la science selon certains standards sociaux. Une vulgarisation plus juste serait celle qui adopte plu-sieurs points de vue, plusieurs figures incarnantes, qui respectent différents types de savoirs et qui cherchent à inclure au lieu de trier. Enfin, si les émotions peuvent rapprocher la science du public, il convient d’ouvrir un véritable espace d’écoute et de découverte, pour tous et toutes, sans distinction et non un simple spectacle pour un public « par défaut » qui suit le modèle standard de l’homme occidental, acculturé à la science, etc. Vulgariser, c’est peut-être cela : faire sentir que la science n’est pas seulement un ensemble de faits, mais une ma-nière de voir, de comprendre et de ressentir le monde, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons.
La communication scientifique a longtemps été perçue comme un domaine réservé aux échanges d’informations factuelles et objectives, souvent dépourvues d’émotions. Cependant, avec l’avènement des plateformes numériques comme YouTube, cette perception évolue.
Dans la première partie, nous avons vu que le format de vidéo sur YouTube s’est progressivement construit de manière à mettre en avant une figure, c’est-à-dire une personne incarnant des valeurs, une culture, une manière d’être au monde.
Mais qu’est-ce que vulgariser au juste ? Ce n’est pas traduire mot à mot un article de recherche en mots plus faciles, ni discuter de science entre spécialistes et ce n’est pas non plus promouvoir la science comme nous vendrions un produit de consommation. La vulgarisation est un acte de communication unilatérale entre au moins deux personnes, ou groupes de personnes : l’une explique, l’autre écoute.