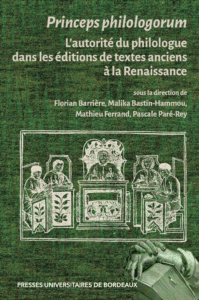UN@ est une plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine
Auteur : Pascale Paré-Rey

Université Lyon 3
Faculté des Humanités, Lettres et Sociétés
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 LYON Cédex 08
pascale.pare-rey@univ-lyon3.fr
0000-0002-4170-8254
Faculté des Humanités, Lettres et Sociétés
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 LYON Cédex 08
pascale.pare-rey@univ-lyon3.fr
0000-0002-4170-8254
Pascale Paré-Rey est Maître de conférences à l’Université Lyon 3 depuis 2006 et habilitée à Diriger des Recherches depuis 2019. Elle a auparavant occupé les fonctions d’ATER à l’Université de Rennes 2 en 2005-2006 et d’allocataire Monitrice Normalienne à l’Université Toulouse 2 en 2002-2005.
Agrégée de Lettres classiques en 1999, elle est élève Professeur Stagiaire à l’ENS Fontenay Saint-Cloud entre 1997 et 2002.
Bibliographie
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture (sélection)
- « Le travail de la mémoire sur la scène sénéquienne », dans « Mémoire des lieux, espaces de mémoire », Eruditio Antiqua, 15, 2023, p. 57-86 : https://www.eruditio-antiqua.mom.fr/
- « Aux origines du théâtre à Rome : l’excursus livien », Emerita, LXXXVII 2, 2019, p. 203-225 : http://emerita.revistas.csic.es/index.php/emerita/issue/view/97
- « Le rôle de la lecture des auteurs dans le chapitre X de l’Institution Oratoire de Quintilien », B. Goldlust, P. Paré-Rey, BAGB 17/2, novembre 2017, p. 114-160.
- « À propos de quatre éditions françaises contemporaines de la Médée de Sénèque : choix de formes et effets de sens », Pan, 5, Rivista di Filologia latina, Palermo, 2016, p. 135-151 (consultable avec son dossier iconographique sur https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01445520v1 et sur https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/riviste/pan/Pan.-Rivista-di-Filologia-Latina-5-n.s.-2016/)
- « Les innovations de Sénèque dans sa Médée», Pan, 4, Rivista di Filologia latina, Palermo, 2015, p. 35-47.
- « D’un exil l’autre : espace et temporalité tragiques dans la Médée d’Euripide et la Médée de Sénèque», Chr. Mauduit, Paré-Rey, BAGB, 2, 2013, p. 19-81.
- « Le personnage d’Œdipe (Œdipe, Sénèque) à la lumière de son modèle grec (Œdipe Roi, Sophocle) », VL 187-188, juin 2013, p. 178-199.
- « La mer dans le Rudens de Plaute », PULM, Cahiers du GITA, 18, 2011, p. 169-182.
- « Signa amoris et pignus sceleris. Comment (se) dire dans une tragédie sénéquienne ? », Paideia, LXI, 2006, p. 545-564.
Communications avec actes dans un congrès international (sélection)
- « The contribution of humanist editors to the history of Seneca’s tragedies : texts and peritexts », panel 6 « Senecan Theatre : Topography, (Un)Stageability, Humanist Editions », Colloque « Seneca 2022 », Lisbonne, 17-20 octobre 2022, https://hal.science/hal-04347131, à paraître en 2024.
- « Virilité et virginité dans la Médée de Sénèque, dans quelques traductions et illustrations modernes », Actes du colloque « Seneca tragicvs : vir, vis, violentia, virtus, virago. La virilité et ses déclinaisons dans le théâtre de Sénèque et chez ses émules de Mussato à nos jours », organisé en mars 2019 par AMU, Presses Universitaires de Provence, collection « Textuelles Théâtre », 2023, p. 59-82 – invitation. URL : https://presses-universitaires.univ-amu.fr/catalogue?search_api_views_fulltext=virilit%C3%A9 ; identifiant : hal-04343989
- « Performance et mimèsis des formes hymniques dans les tragédies de Sénèque », Actes du Colloque « Performance et mimèsis. Variations sur la lyrique cultuelle de la Grèce archaïque au Haut-Empire romain », Kernos, 2022, p. 51-74.
- « Prendre le bouillon », actes du colloque « Dévorer, dépenser dans le monde hellénistique et romain », Ausonius Éditions (CNRS-Bordeaux), Scripta antiqua, n° 143, Bordeaux, 2020, p. 187-200.
- « L’Homère de Quintilien : summus et primus auctor», dans Homère Rhétorique. Études de réception antique, textes réunis et édités par Sandrine Dubel, Anne-Marie Favreau-Linder, Estelle Oudot, Turnhout, Brepols, « Recherches sur les Rhétoriques Religieuses », 28, 2019, p. 195-213.
- « El desenlace de Medea: exhibición de artimañas o ars dramaturgica ? (Séneca, Medea, v. 982-1027) », dans R. López Gregoris (éd.) Drama y dramaturgia en la escena romana. Tercero encuentro internacional de teatro latino, Madrid, Libros Pórtico, 2019, 53-72.
- « Destin d’une sentence… sur le destin », dans Stratégies et pouvoirs de la forme brève, Élisabeth Gavoille et Philippe Chardin éd., Paris, Kimè, 2017, p. 53-66.
- « Les passions, les hommes et les dieux sur la scène tragique sénéquienne », L’homme et ses passions, Actes du XVIIème Congrès de l’Association Guillaume Budé, organisé à Lyon du 26 au 30 août 2013, textes réunis par Isabelle Boehm, Jean-Louis Ferrary et Sylvie Franchet d’Espèrey, Paris, Les Belles Lettres, 2016, p. 417-433.
- « Présence de la déclamation dans les tragédies de Sénèque », Colloque International Présence de la déclamation antique (suasoires et controverses grecques et latines), Ier volet, Clermont-Ferrand (17-18 novembre 2011), Présence de la déclamation, Caesarodunum XLVI-XLVII bis, Clermont-Ferrand, 2015, p. 193-213.
- « […] maius parat / Medea monstrum : portraits et autoportrait de Médée dans la tragédie de Sénèque », dans Anne Queyrel Bottineau (dir.) La représentation négative de l’autre dans l’Antiquité. Hostilité, réprobation, dépréciation, Éditions Universitaires de Dijon, collection Histoires, 2014, p. 505-519.
- « Les tragédies de Sénèque sont-elles spectaculaires ? – Réflexions sur quelques principes de composition », dans J.-P. Aygon (dir.) Un philosophe homme de théâtre ? Débats et controverses autour des tragédies de Sénèque, Pallas 95, 2014, p. 33-57. URL : http://pallas.revues.org/1659 DOI : 10.4000/pallas.1659.
- « Narration et description dans le Rudens de Plaute et dans les Troyennes de Sénèque », dans M. Briand (ed.), La trame et le tableau. Poétiques et rhétoriques du récit et de la description dans l’Antiquité grecque et latine, La Licorne, 101, PUR, 2012, p. 281-295.
- « Du demonstrare au uincere. L’enthymème tragique entre logique et rhétorique », Actes du colloque international Voir et faire voir : formes de la démonstration à Rome, organisé par le CRATA, Toulouse – Le Mirail, 18-20 novembre 2004, Pallas, 69, 2005, p. 413-426.
- « Un telum tragique : la sententia. Sénèque ou les masques de la polémique », dans Luce Marchal-Albert et Loïc Nicolas (éd.), Polémique et rhétorique de l’Antiquité à nos jours, Bruxelles, De Boeck, Champs linguistiques, 2010, p. 89-103.
Communications avec actes dans un congrès national (sélection)
- « Qui va à la chasse perd sa place. Le personnage de Thésée dans Hercule Furieux et Phèdre de Sénèque », Autour des mythes de Thésée et de Perséphone : tradition, transferts, transmissions (Antiquité-xviie), CTA, n. s. 4, 2021, p. 199-220.
Directions d’ouvrage ou de revues (sélection)
- Collectif : M. Bastin-Hammou, Pascale Paré-Rey, Sarah Gaucher (éd.) L’invention du théâtre antique. Une anthologie de paratextes humanistes au théâtre antique, Bruxelles, Latomus, sous-série « Textes médio- et néo-latins », à paraître en 2024.
- Collectif : M. Bastin-Hammou et Paré-Rey (éd.), « La réception du théâtre antique dans les travaux savants de l’Europe de la première modernité », Actes du panel organisé les 20 et 21 juillet 2017 à Montréal, Universités de Montréal et Mc Gill, (résumés des interventions parus dans le BSL 2018, fascicolo 1, p. 220-224, que j’ai rassemblés et présentés :
http://www.compitum.fr/publications/11576-giovanni-cupaiuolo-bollettino-di-studi-latini-482018fasc-i); Anabases, 29, 2019, introduction p. 89-91 https://journals.openedition.org/anabases/8623 https://doi.org/10.4000/anabases.8623 et dossier “Traditions du Patrimoine antique” p. 91-192.
- Collectif : Bastin-Hammou, F. Fonio, P. Paré-Rey (éd.) « Fabula agitur. Pratiques théâtrales et artistiques, oralité et apprentissage des langues et cultures de l’Antiquité. Histoire, esthétique, didactique », Actes de la journée d’étude du 11 juin 2014 (Lyon) et du colloque international des 28-30 janvier 2015 (Grenoble), UGA Éditions, 2019.
- Collectif : L’aparté dans le théâtre antique. Un procédé dramatique à redécouvrir, Actes des journées d’études organisées par P. Paré-Rey les 12 et 13 janvier 2012 à Lyon (UJML3), Presses Universitaires de Vincennes, Collection « Théâtres du Monde », 2015, 360 p.
- Collectif : B. Delignon, S. Luciani, Paré-Rey (éd.), « Une journée à Cyrène : lecture du Rudens de Plaute », PULM, Cahiers du GITA, 18, 2011, 205 p.
- Collectif : Mauduit et P. Paré-Rey (éd.), Les maximes théâtrales en Grèce et à Rome : transferts, réécritures, remplois, Actes du colloque international organisé par le CEROR, Lyon 3 – ENS LSH, Lyon, 11-13 juin 2009, collection du CEROR, diffusion De Boccard, 2011, 459 p.
Ouvrages (sélection)
- Histoire culturelle des éditions latines des tragédies de Sénèque, 1478-1878, Paris, Classiques Garnier, « Histoire culturelle » 20, 2023 ; https://classiques-garnier-com.acces.bibliotheque-diderot.fr/histoire-culturelle-des-editions-latines-des-tragedies-de-seneque-1478-1878.html
- Flores et acumina. Les sententiae dans les tragédies de Sénèque, CEROR, diffusion De Boccard, 2012, 432 p. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02289498.
Chapitres d’ouvrage (sélection)
- Notice sur « Le pied » dans le Dictionnaire des Images du Poétique, co-rédigée avec J.-P. Guez et F. Klein, Classiques Garnier, à paraître, p. xxx.
- Silves Latines 2013-2014. Sénèque, Œdipe, Neuilly, Éditions Atlande, Collection « Clefs Concours », 2013, p. 6-119.
Articles
- « L’œuvre tragique de Sénèque au XVIIIème siècle : lectures, relectures et controverses », Anabases, numéro 33 consacré à « La tragédie de Sénèque (XVIIIe-XIXe siècles) : éclipse et résistance d’un modèle théâtral » S. Humbert-Mougin éd., Anabases, 33, 2021, p. 55-75.
Publications de vulgarisation
- « Et si vous lisiez Sénèque! », Actualités des études anciennes, ISSN format électronique : 2492.864X, 11/12/2019, https://reainfo.hypotheses.org/18855.
- Notice « Les éditions des tragédies de Sénèque conservées à la Bibliothèque nationale de France (xve-xixe) » sur le blog « L’Antiquité à la BnF » : https://antiquitebnf.hypotheses.org/1643,12 janvier 2018.
Mots clés
Théâtre, Sénèque, stylistique, sentences, réception, éditions, paratextes
Au terme de ce parcours, il semble désormais clair que le philologue, à la Renaissance, est une figure en construction. Les termes employés dans les contributions en témoignent : on y parle de doctes, de literati, d’humanistes, d’éditeurs.
Le philologue soucieux de construire sa propre autorité et l’autorité du texte qu’il édite n’est jamais seul. Son travail s’inscrit en effet dans un réseau de relations souvent très denses, dont témoignent surtout les épîtres et poèmes liminaires.
Le philologue, tout autorisé qu’il soit par son savoir, doit à chaque nouvel ouvrage (re)construire son autorité, puisque la qualité de son travail n’est pas une donnée garantie a priori.
Les éditions de textes anciens sont l’occasion pour les philologues de mettre en lumière leur travail.
« Princeps philologorum » : l’expression permit, au XIXe siècle notamment, de qualifier de grandes figures de la philologie moderne ;le présent volume se propose d’envisager dans quelle mesure elle peut s’appliquer aussi aux premiers savants qui ont contribué à l’invention de cette science, éditant et commentant les textes de l’Antiquité au seuil de l’époque moderne.
Bibliographie de Princeps philologorum. L’autorité du philologue dans les éditions de textes anciens à la Renaissance
Index nominum