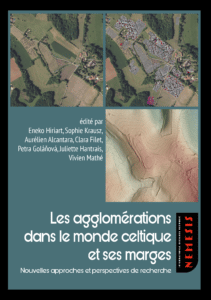UN@ est une plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine
Catégorie : Archéologie
La partie orientale des Pyrénées est une zone où la richesse minière est abondante et a suscité une activité sidérurgique intense à la période moderne et aux XIXe et XXe siècles.
Les Pyrénées ariègeoises recèlent également de nombreuses traces d’activité minière et les exploitations récentes, postérieures au XVIIIe siècle, y sont nombreuses.
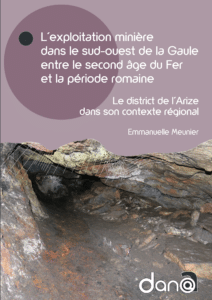
De nombreux sites miniers et métallurgiques sont connus dans le Pays basque (fig. 13). Les recherches en archéologie minière sur ce secteur ont réellement démarré dans les années 1990, à la suite de premiers repérages par des spéléologues (Parent 2006, 272 ; Parent 2010, 9).
Les ressources minières de notre zone d’étude sont situées principalement dans des massifs du domaine pyrénéen (Pyrénées et Corbières) et dans l’extrémité méridionale du Massif central (Montagne noire). Il s’agit de zones dont la géologie est complexe ; nous les présenterons simplement dans les grandes lignes.
L’exploitation des ressources minières, une activité aux implications multiples, apparaît comme un dénominateur commun du sud-ouest de la Gaule, entendu ici comme l’espace qui s’étend entre l’océan Atlantique, le versant nord des Pyrénées, la côte méditerranéenne languedocienne et l’axe Aude-Garonne, incluant la Montagne noire qui le borde (fig. 1).
Ce livre est une version remaniée de ma thèse de doctorat, soutenue en 2018 à l’université de Toulouse 2 Jean Jaurès, sous la direction de Jean-Paul Métailié et Béatrice Cauuet.
In temperate Europe, the rise of the urban phenomenon comes later than in the Mediterranean world and follows different dynamics. The oppida, developed from the end of the 2nd century BC, were long considered the first cities in temperate Europe.
La géophysique est utilisée en archéologie depuis plusieurs dizaines années et les exemples illustrant l’apport de ces techniques sont maintenant assez courants. Les sites de l’âge du Fer, qu’ils soient funéraires ou d’habitat, du Premier ou du Second âge du Fer ne font pas exception à la règle.
Depuis une cinquantaine d’années, l’archéologie cherche à développer des méthodes permettant la reconnaissance extensive des sites complexes et/ou de grande étendue. La fouille ne pouvant répondre seule à toutes les interrogations des chercheurs sur ce type de sites, l’utilisation de prospections non destructives prend alors tout son sens.
par Réjane Roure
La pluralité des langues est une réalité qui existe dans de nombreuses sociétés, et qui s’exprime de façon particulièrement forte lorsque des cultures différentes entrent en contact.
par Ivan Guermeur
Pouvoir nommer les choses est le sens premier du langage, c’est ce qui permet de classer, ordonner, décrire, s’approprier le monde. Comme Ferdinand de Saussure ne manque pas de le rappeler : “Si nous pouvions embrasser la somme des images verbales emmagasinées chez tous les individus, nous toucherions le lien social qui constitue la langue.
par Emmanuel Dupraz
À Banassac (Lozère, France) ont été retrouvés les vestiges d’un important atelier producteur de céramique sigillée, actif selon une datation récente entre les années 90 à 120 et la seconde moitié du IIe siècle p.C.