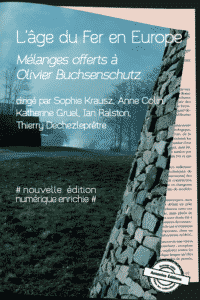UN@ est une plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine
Lieu d'édition : Pessac
L’Occident n’a cessé de se référer, depuis le Moyen Âge, à l’Antiquité grecque et romaine, de se construire par rapport à elle au point même de rêver de la ressusciter, comme ce fut exemplairement le cas à la Renaissance et, d’une autre façon, à l’époque néoclassique.
Cet ouvrage est issu de ma thèse de doctorat soutenue à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour en décembre 2021.
par Renaud Robert
Les spécialistes des mondes anciens ont toujours plaisir à apprendre des nouvelles de leurs contemporains. Surtout lorsque ces nouvelles leur enseignent que les dits « mondes anciens » continuent à être présents dans le travail des artistes vivants.
par Léo Caillard
En tant qu’artiste explorant la relation permanente que nous entretenons avec l’Antiquité, je suis très heureux de pouvoir introduire le livre issu de la thèse de doctorat de Tiphaine Annabelle Besnard.
Cet ouvrage a été publié en 2013 dans la collection Mémoires des éditions Ausonius : son succès fut immédiat et les 800 exemplaires produits furent vendus. 9 ans plus tard, les éditeurs scientifiques ainsi qu’Olivier Buchsenschutz lui-même ont souhaité offrir à un lectorat renouvelé ces textes clés dans une version numérique, enrichie et ouverte.
par Alain Schnapp
Les chercheurs de notre génération ont eu la chance de vivre, à compter des années soixante-dix, un changement complet des pratiques de l’archéologie en France.
par Stéphane Verger
On eut pu craindre que le laboratoire d’archéologie de l’École normale supérieure ne s’intéressât qu’aux vestiges les plus glorieux de l’Antiquité classique, l’Athènes de Périclès, l’Alexandrie ptolémaïque, la Rome d’Auguste.
par Laurent Bourgeau
Certains archéologues méritent qu’on leur écrive des livres, comme un écho à tous les livres qu’ils ont eux-mêmes écrits.
C’est dans le plus grand secret que nous avons préparé les MOB pendant quatre années. Quatre années de chuchotements, de rencontres discrètes, de préparatifs clandestins, de complicité avec la famille et les amis. MOB : tous les courriels envoyés aux auteurs commençaient par ces trois petites lettres pour annoncer un message confidentiel, elles nous ont servi de code dans toute l’Europe pour ne pas être découverts. Nous avons choisi le secret pour que ce livre soit une belle surprise pour Olivier, et tout le monde a joué le jeu. Nous étions 5 au départ de cette aventure et nous sommes 110 à l’arrivée ! Beaucoup d’autres auraient voulu participer et offrir un cadeau amical à Olivier, mais les aléas de la vie ne leur ont pas permis de parvenir au terme de ce voyage avec nous.
par Michel Tarpin
Comme on le sait, il y a ceux qui font l’histoire et ceux qui l’écrivent. César est de ceux qui l’on faite, à la
pointe de son épée et par son action politique, mais il est aussi de ceux qui l’ont brillamment écrite, figeant
ainsi pour des millénaires la mémoire de son temps.
par Alain Deyber
Cette courte étude est l’aboutissement particulier d’un projet lancé il y a quarante trois ans sur les problèmes de la
guerre en Gaule à l’époque de La Tène, qui a tiré profit de toutes les recherches historiques et archéologiques de ces quatre
décennies.