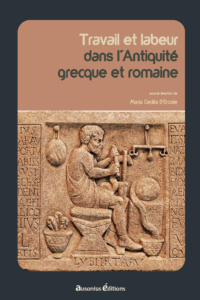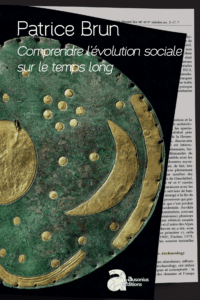UN@ est une plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine
Type de document : Chapitre de livre
par Aldo Schiavone
Je suis persuadé que les changements historiographiques – une vraie rupture – corrélés, entre le XXe et le XXIe siècle, à l’étude du travail humain dans les sociétés de l’Occident antique sont un exemple parfait de la manière dont, dans toute recherche historique, c’est toujours le présent qui conditionne de façon déterminante notre approche du passé.
par Arnaldo Marcone
Comme Michel Foucault l’observait, le préjugé dominant dans le monde antique à l’égard de la technique résulte de la distance entre le “seuil d’apparition” et le “seuil de formalisation”, la première désignant la mention fortuite d’un objet et la seconde son entrée à part entière dans le discours culturel.
par Simone Ciambelli
Le collegium est l’un des corps intermédiaires les plus caractéristiques et les mieux représentés dans les villes romaines de l’époque républicaine et impériale.
par Virginie Mathé
Dans l’historiographie du travail en Grèce ancienne, les chantiers de construction constituent un des cas d’étude privilégiés. La situation documentaire l’explique. Certes, les renseignements que livrent les textes littéraires sont rares et liés principalement à des chantiers exceptionnels.
Le travail libre est un sujet essentiel pour décrypter et comprendre les articulations sociales de l’Antiquité. Certes, plus que de “travail libre”, il serait opportun de parler du “travail des personnes libres”, en faisant référence au statut de l’individu plus qu’à ses choix
par Emanuele Stolfi
Je commencerai par quelques remarques préliminaires sur les spécificités du travail durant la période abordée, à savoir l’Antiquité (et plus spécifiquement l’Antiquité romaine) et le Moyen Âge.
Entre la fin du IIe s. et le Ier s. a.C., la cité de Priène se décrit elle-même à plusieurs reprises dans des textes officiels comme un ensemble de groupes hiérarchisés et différenciés
par Raymond Descat
Le travail et la cité grecque ne font pas bon ménage dans l’historiographie. La tradition érudite s’est nourrie, génération après génération, des thèmes du dédain du travail manuel, de la servitude du travailleur, de la célébration du loisir intellectuel et du détachement profond face aux choses économiques.
Peu de sujets, autant que le travail, investissent tous les domaines de la vie collective et individuelle, sociale et économique, symbolique et matérielle.
par Patrice Brun
Lancée il y a une quarantaine d’années, l’enquête archéologique menée par Patrice Brun se caractérise par une hausse plus élevée que prévue de l’échelle spatiale et temporelle du champ documentaire envisagé au départ.
par Patrice Brun
The Iron Age (730-125 BC) in France is of particular interest for examining the issue of inequality because societies evolved over these seven centuries through a nonlinear process of nonlinear complexity, from simple chiefdoms to archaic States.
par Patrice Brun
L’archéologie nous permet de découvrir non seulement les objets que fabriquaient les membres de ces sociétés sans écriture, mais aussi les habitations qu’ils construisaient et les aménagements agropastoraux, routiers, portuaires, défensifs qu’ils élaboraient.