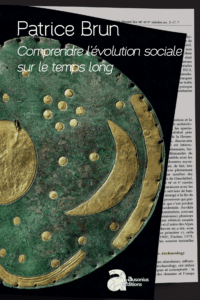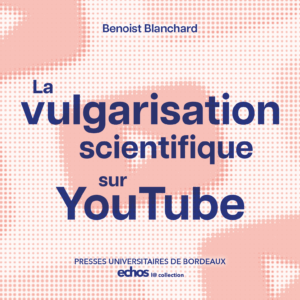UN@ est une plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine
Type de document : Chapitre de livre
par Patrice Brun
L’évolution en dents de scie de l’échelle d’intégration territoriale durant la protohistoire européenne se conforme à ce qui s’est produit partout à travers le monde.
par Patrice Brun
Le concept de “culture des Champs d’Urnes” charrie de nombreuses ambiguïtés, d’une façon générale, mais peut-être plus particulièrement encore sur les marges nord-occidentales de la zone qu’elle est censée recouvrir. Le propos est ici d’en préciser la définition.
par Patrice Brun
The Armorican barrow at Melrand, in the Morbihan, Brittany, today still has the impressive volume of almost 5ooo m3, somewhat larger than the otherwise more famous barrow at Leubingen, estimated to be 4178 m3.
par Patrice Brun
L’État représente la forme d’organisation politique la plus élevée sur l’échelle de la complexité sociale. Cette forme de gouvernement, qui a fini par supplanter toutes les autres, engendra souvent misère et asservissement pour le plus grand nombre.
Sur YouTube, la science s’adapte : des contenus divertissants, des vidéastes à l’aise, un algorithme qui pousse au clic… avec à la clé plusieurs milliers, voire millions, de vues. Pourtant, une question s’impose : comment concilier la rigueur scientifique avec les codes d’une plateforme pensée pour divertir ?
par Patrice Brun
State-level organization emerged in the Celtic world during the second and first centuries BC as the end result of an evolutionary process of increasing social complexity.
par Patrice Brun
Oppida were fortified sites covering a large surface area, often over 20 ha, and enclosing a permanent and relatively densely occupied settlement where various specialist, craft and commercial activities took place.
par Patrice Brun
En archéologie, le courant postmoderniste a été qualifié de postprocessual. Il s’agissait pour les tenants de la postmodernité archéologique de clore l’épisode de domination de la New Archaeology, à savoir la pensée “moderniste” avec ses approches méthodologiques et théoriques scientifiquement plus rigoureuses que celles qui les avaient précédées.
par Patrice Brun
On retiendra que l’examen systématique des données réunies à l’occasion de notre table ronde, où la question posée était de savoir si l’on pouvait mesurer la complexité sociale à l’aune du niveau de spécialisation artisanale, a permis de reconnaître une certaine corrélation globale derrière la variabilité des situations.
par Patrice Brun
Les sites archéologiques de diverses périodes, dont les vestiges suggèrent l’existence de potentats, ont souvent été qualifiés de “princiers”. Toutefois, les notions de “tombes princières” et de “résidences princières” ont surtout été utilisées par les chercheurs travaillant sur les sites majeurs des VIe et Ve s. a.C.
par Patrice Brun
En France, comme ailleurs en Europe, les dépôts d’objets métalliques montrent une corrélation certaine avec les positions frontalières. Ces dépôts sont de deux types : les accumulations d’objets jetés dans certaines sections de lits fluviaux et les collections d’objets installés dans une fosse.
par Patrice Brun
L’essai de modélisation présenté ici part de l’hypothèse selon laquelle l’âge du Fer européen, comme tout espace-temps, ne constitue ni un bloc intangible, ni même une suite d’états d’équilibre, mais un changement permanent rythmé de bifurcations avec lesquelles s’opèrent des choix d’organisation sociale qui demeurent imprévisibles.