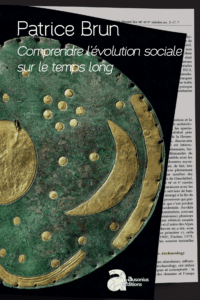UN@ est une plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine
Type de document : Chapitre de livre
par Patrice Brun
The archaeological study of funerary practices has advanced greatly in recent years. Protocols for on-site recording and observation techniques capturing fine detail in the laboratory have lifted the veil on practices whose variability was often unforeseen.
par Patrice Brun
Entre 1998 et 2002, le CNRA avait fait des propositions visant à intégrer l’archéologie préventive dans une perspective orientée plus résolument vers la recherche. La loi de 2003 a toutefois soumis cette activité à une logique largement marchande, rendant cette option impossible.
par Patrice Brun
La plupart des sociétés ont évolué en dents de scie et selon des rythmes différents d’une région à une autre. Cette variabilité apparemment désordonnée a longtemps permis aux courants dominants de la recherche en sciences humaines de nier le fait que la tendance lourde de l’évolution sociale allait dans le sens de formes d’organisation globalement plus complexes.
par Patrice Brun
Contrairement à une idée répandue, les méthodes d’élaboration des chronologies relatives ne permettent pas seulement de pallier les insuffisances des techniques de datations absolues. Elles peuvent aussi servir à mesurer les rythmes du changement et à hiérarchiser l’importance relative des ruptures évolutives.
par Patrice Brun
The nomenclature of typo-chronological systems was founded on technological evolution. Major technological and typological changes were often interpreted as resulting from population movements.
par Patrice Brun
La notion de réseau est devenue familière au grand public grâce à l’internet qui a mis en connexion des millions de personnes dans le monde entier. Elle est pourtant très ancienne, comme le montrent les définitions qui en ont été proposées par les dictionnaires.
par Patrice Brun
L’archéologie, comme d’autres sciences humaines, tente de saisir les modalités d’organisation des sociétés, notamment à travers la façon dont elles ont occupé l’espace. Dans cette perspective, la notion de territoire occupe une position privilégiée.
par Patrice Brun
De nombreuses données permettent aujourd’hui d’esquisser les formes d’organisation sociales du Ier mill. a.C., en Europe, surtout en Celtique nord-alpine et en Ibérie.
par Patrice Brun
La question de l’origine des Celtes a fait couler beaucoup d’encre. Comme toutes les questions identitaires, elle suscite, en effet, un intérêt souvent passionnel ; au point que les chercheurs professionnels ont très majoritairement adopté à son sujet une stratégie d’évitement.
par Patrice Brun
Le propos est de montrer que la période courant de la fin du IVe au début du IIe s. a.C. fut une période transitoire majeure de la protohistoire européenne. Elle articule en effet deux volets, qui représentent deux paliers de l’accentuation et de la généralisation de la division sociale en Europe tempérée humide
par Patrice Brun
Pendant l’âge du Bronze, d’évidentes affinités typologiques lient les îles britanniques et les régions occidentales de la péninsule Ibérique, de la France et du Benelux. Cette constatation a très logiquement généré l’idée d’une communauté culturelle atlantique
par Émilie Louesdon
Les enjeux d’une approche technologique en céramologie s’inscrivent dans une démarche engagée il y a maintenant une cinquantaine d’années et ont fait l’objet de nombreux travaux sur le territoire national comme au-delà de nos frontières.