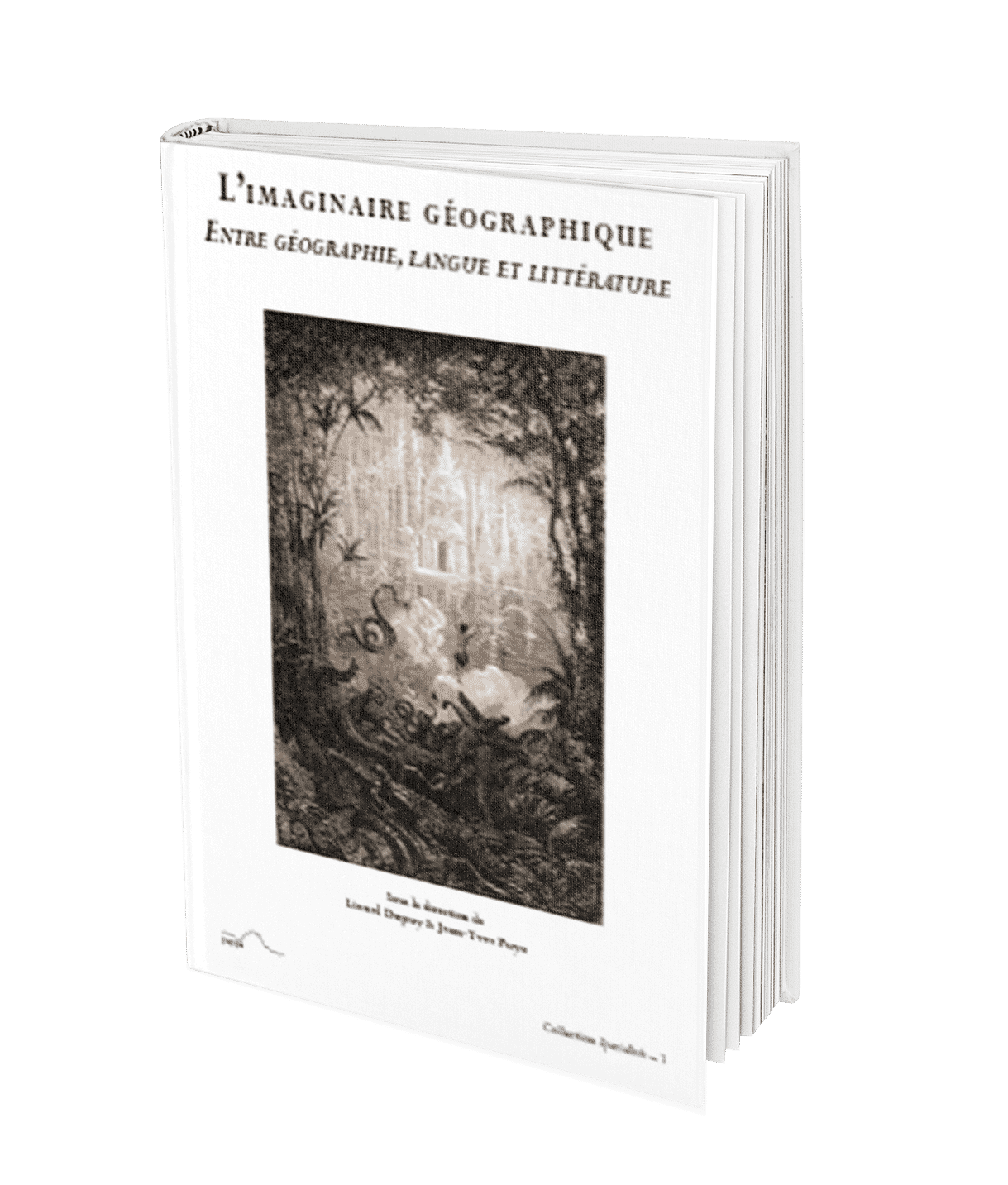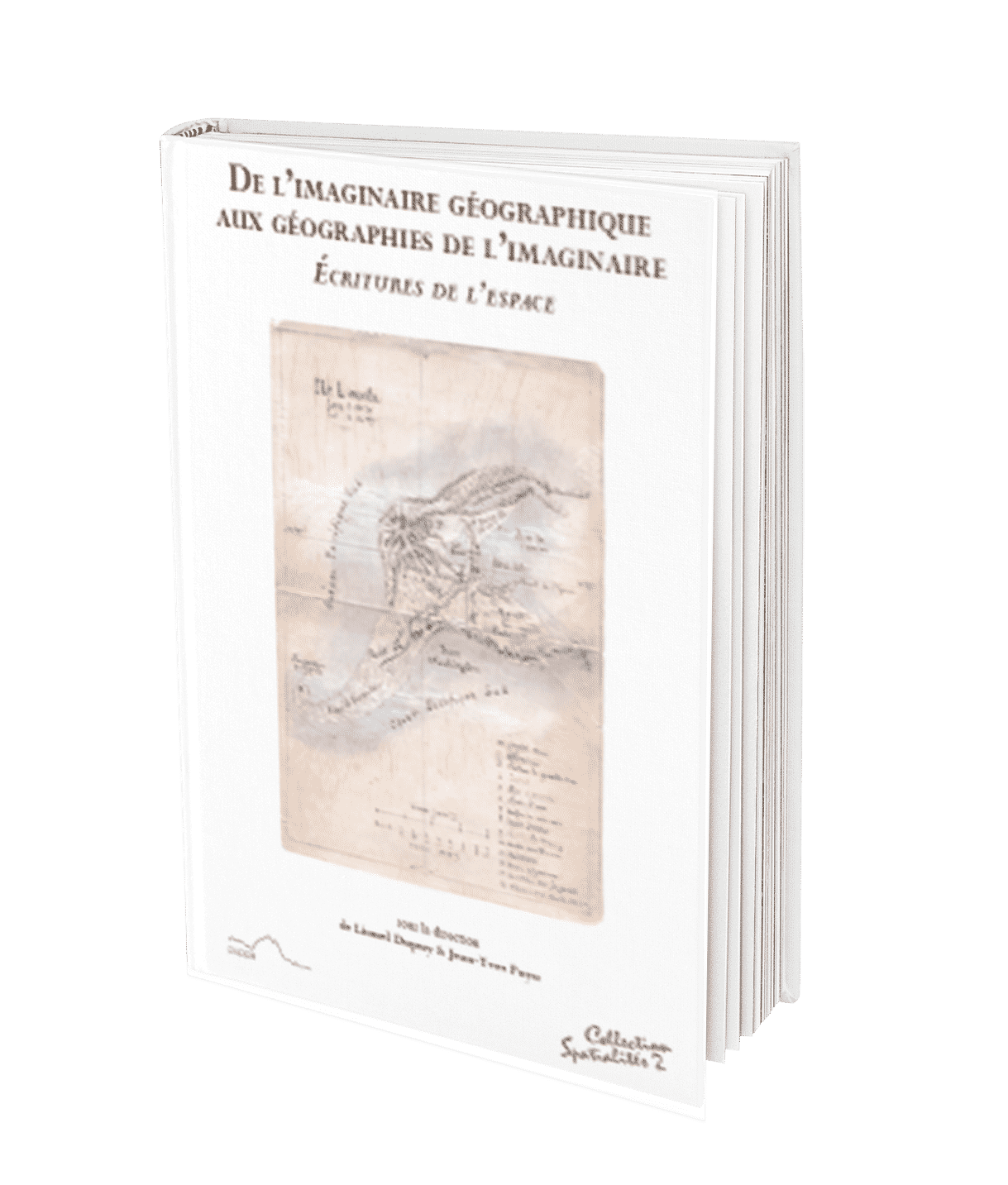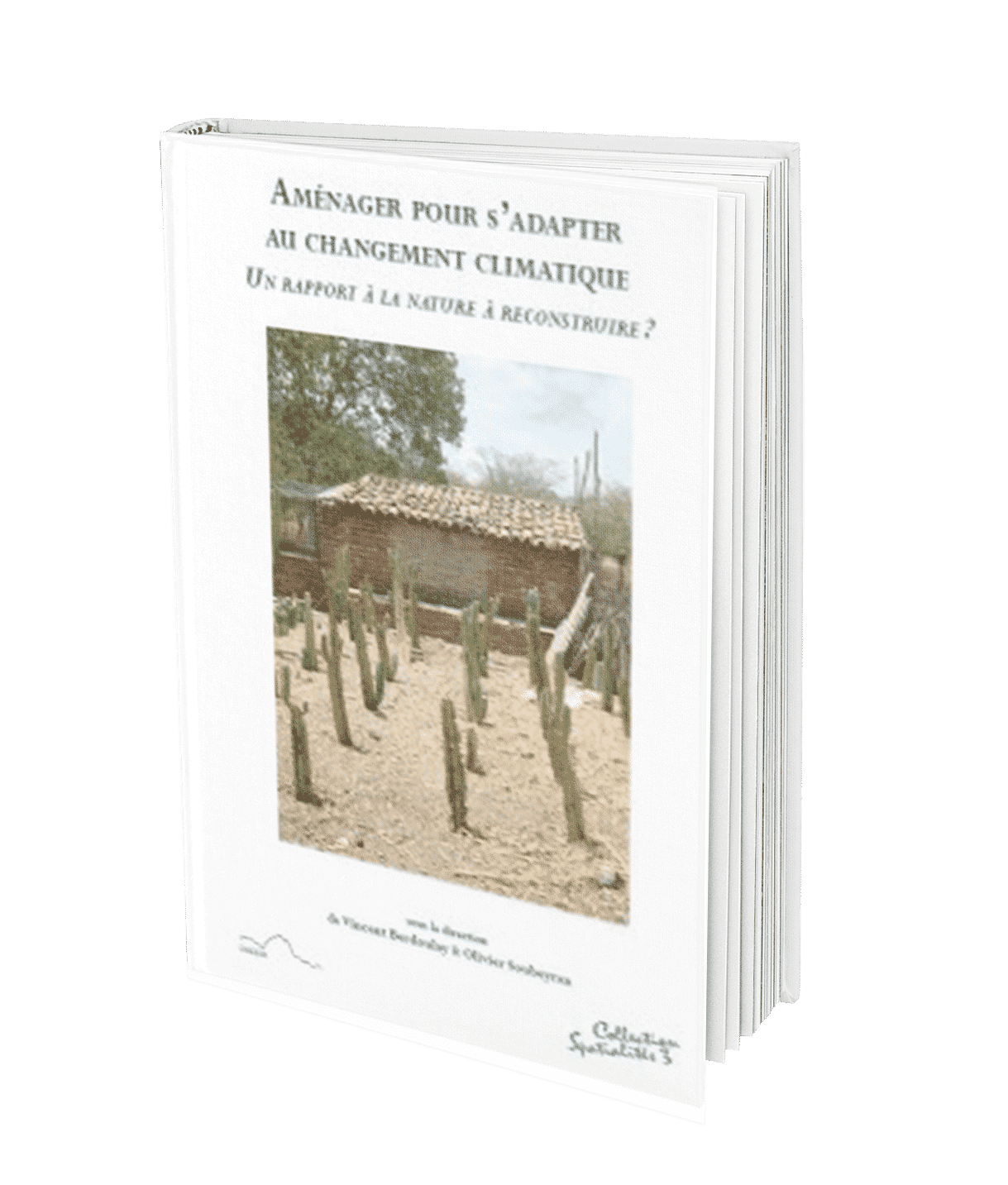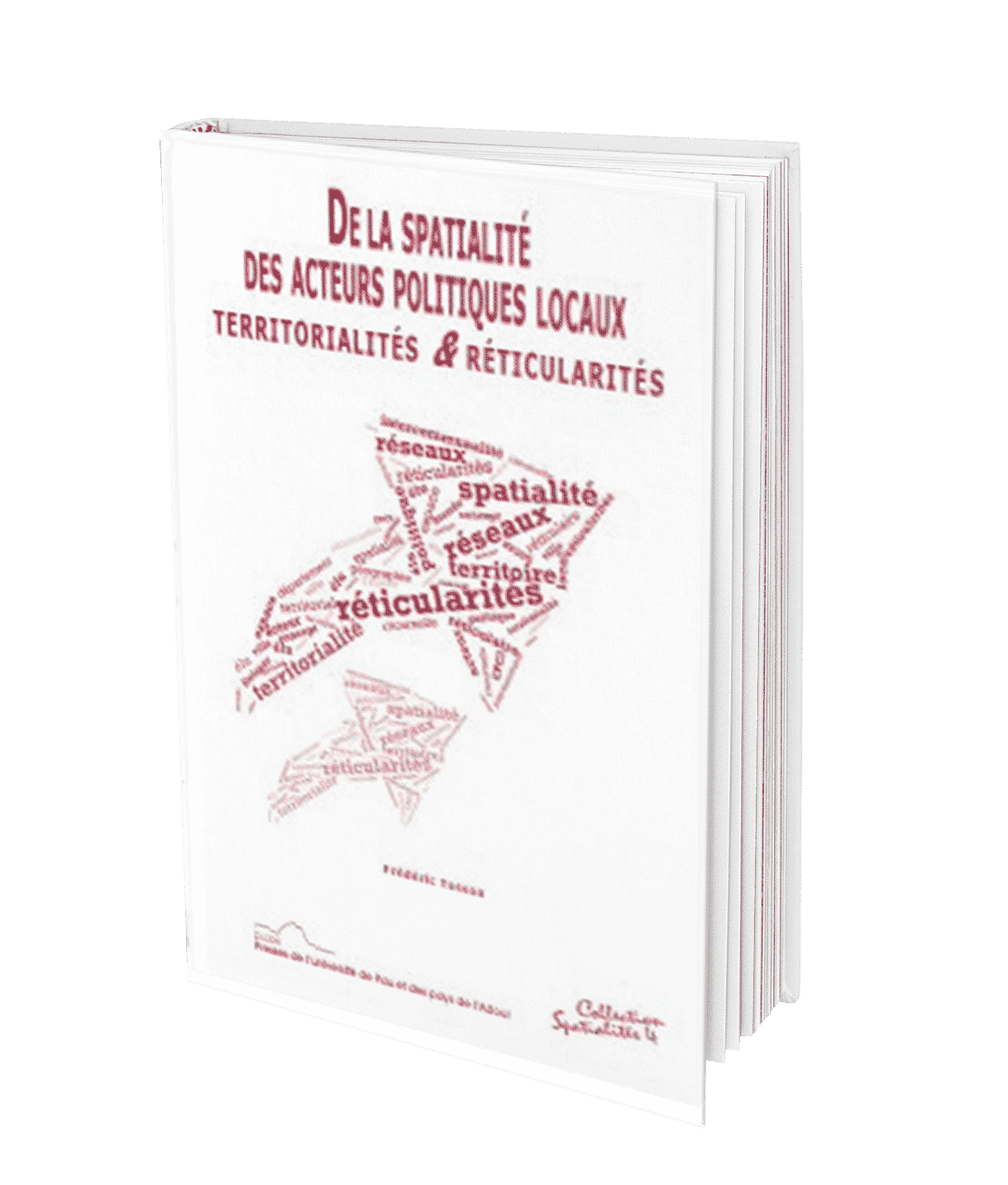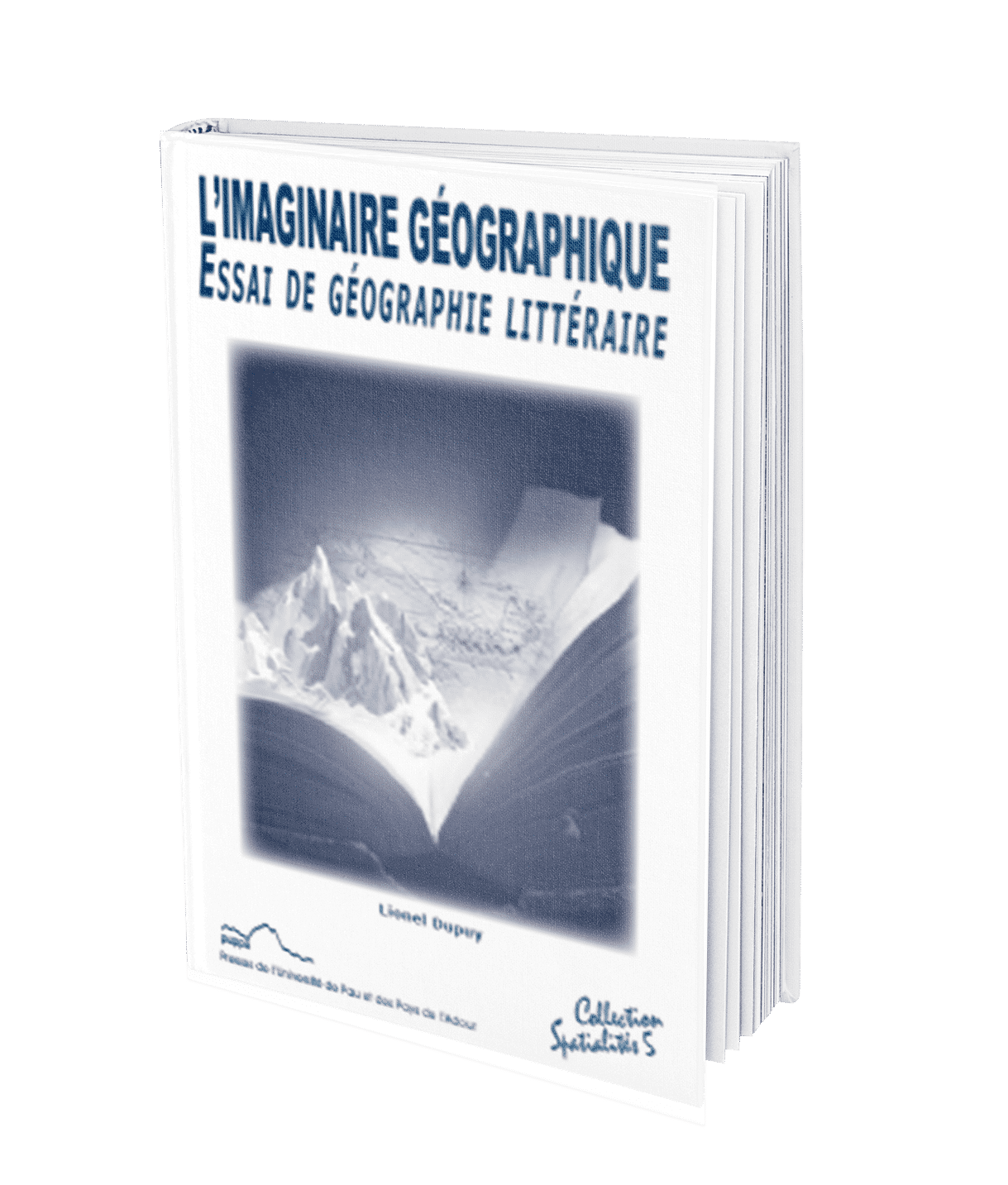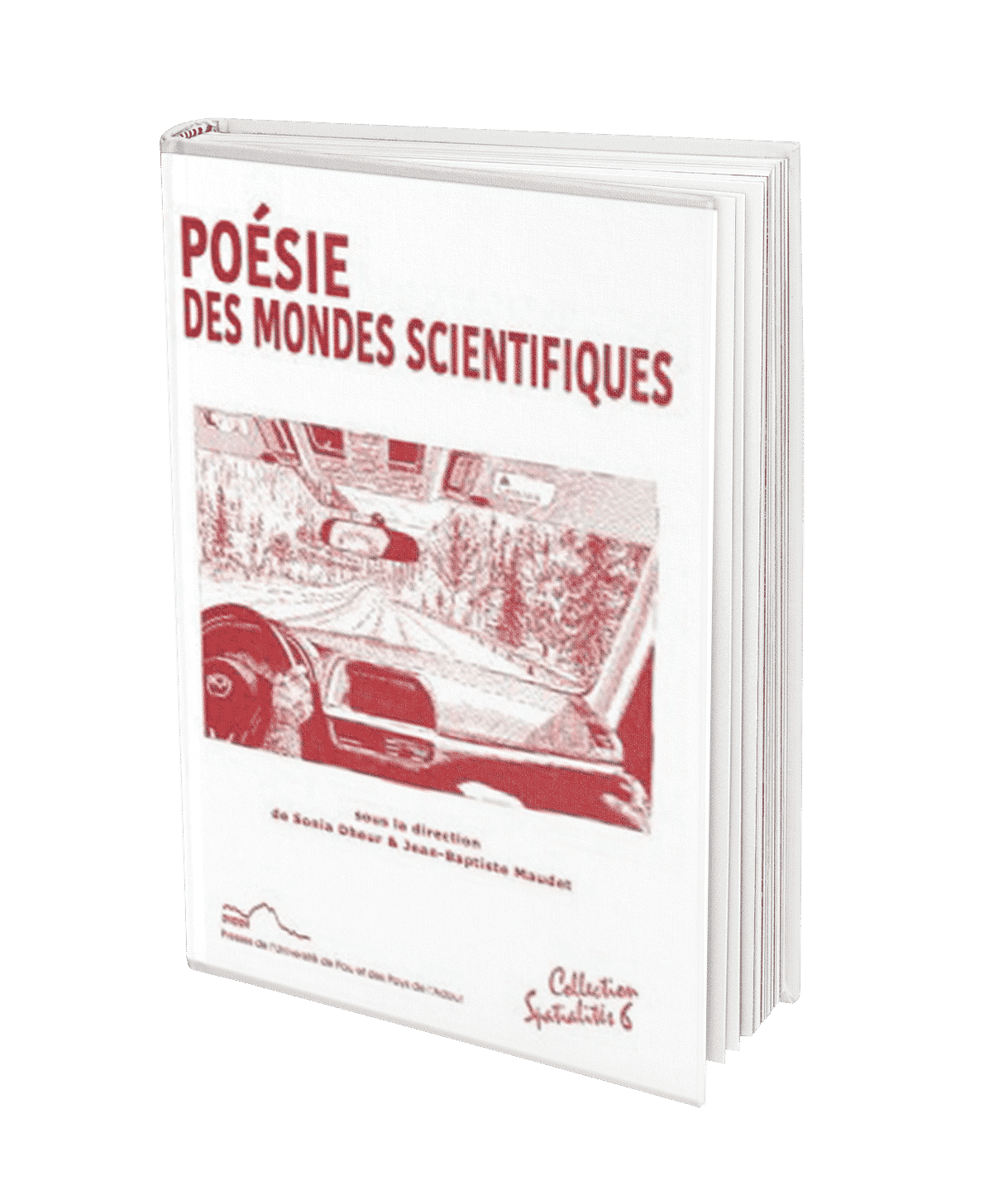Il y a quarante ans, une lacune existait dans les études sur l’histoire de la géographie en France : des travaux couvraient la Renaissance, l’âge classique et le XVIIIe siècle ; d’autres, de plus en plus nombreux, retraçaient l’affirmation progressive de la discipline dans les dernières décennies du XIXe siècle et ses succès, ses crises et ses mutations au XXe. Un trou existait entre ces deux ensembles.
Après une formation d’historienne à l’Université McGill à Montréal, la canadienne Anne Godlewska devient spécialiste de l’évolution de la cartographie en travaillant dans l’équipe qui réalise, à l’Université du Wisconsin, la monumentale histoire de la cartographie dont la publication vient de s’achever. Elle se transforme ainsi en géographe et étudie le travail cartographique réalisé durant l’expédition menée par Bonaparte en Égypte de 1798 à 1801. Elle se lance alors dans l’analyse en profondeur de l’histoire de la géographie en France à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Certains des collègues français auxquels elle demande conseil tentent de la décourager en lui expliquant que la discipline n’existe pas dans la France de cette époque. Elle passe outre, s’installe trois ans à Paris et y explore systématiquement bibliothèques et archives ; à son retour en Amérique du Nord, elle met plusieurs années à exploiter cette masse d’informations. Elle en tire une thèse publiée en 1998 par les Presses de l’Université de Chicago sous le titre Geography Unbound.
L’ouvrage me séduit. Je décide de le traduire, mais ne donne pas une suite immédiate à ce projet. Je le reprends vingt et quelques années plus tard. Entre temps, des historiens et des géographes avaient travaillé et publié sur cette période de la géographie française, mais sans que cela enlève quoi que ce soit à la spécificité de l’apport d’Anne Godlewska : il convient de le rendre accessible au public français.
Anne Godlewska prend vite conscience des traits singuliers de la géographie française à l’époque qu’elle a retenue. La discipline ne cherche pas à expliquer : elle se contente de décrire la surface de la terre par le texte et par la carte. Jusque fort avant dans le XVIIIe siècle, ceux qui se considèrent comme géographes jouissent du prestige des cartes dont ils fournissent les données ou qu’ils réalisent. C’est pour eux une activité essentielle. Dans les dernières décennies du XVIIe siècle s’est constituée à Paris une communauté de géographes-cartographes capables de collecter toute l’information dont on dispose alors sur les coordonnées géographiques du plus grand nombre possible de points dans tel ou tel pays pour en tirer des représentations d’une qualité unanimement reconnue. Dans le même temps, l’astronome italien Dominique Cassini, nommé à la tête de l’Observatoire de Paris, procède à la détermination de la longitude d’un nombre croissant de lieux en France grâce aux tables, qu’il a établies à l’observatoire de Bologne, des mouvements des satellites de Jupiter découverts par Galilée. Il mobilise parallèlement les techniques de triangulation, dont la mise au point, au XVIe siècle, avait révolutionné les levers de terrain, pour concevoir une couverture de l’ensemble du pays par une carte précise et à grande échelle. Cette réalisation, que mettent en œuvre au XVIIIe siècle ses fils, petit-fils et arrière-petit-fils, Cassini II, III et IV, est alors unique au monde.
La confrontation des disciplines à laquelle conduisent les réformes révolutionnaires de l’enseignement et de la recherche montre que cette époque faste est terminée : ce que produisent les géographes n’est plus conforme aux critères d’une science qui est en train de se transformer.
La discipline subit une crise profonde qui appelle une redéfinition de ses buts et de ses structures. Anne Godlewska suit le mouvement général des recherches d’histoire des sciences et des systèmes de pensée : les travaux de Michel Foucault sur les épistémès et les formations discursives la passionnent. Ne détectent-ils pas dans l’ensemble de la pensée occidentale de la même époque une mutation similaire à celle qu’elle met en évidence en géographie ? Dans le succès de nombre de disciplines, les travaux sur l’histoire des sciences ne soulignent-ils pas le rôle tenu par les États en train de se moderniser ? Dans l’introduction de son livre, Anne Godlewska souligne la convergence entre ses résultats et ceux de Foucault. L’épistémè classique, née au XVIIe siècle et qui domine au XVIIIe, cherche à mettre en évidence les catégories qui caractérisent le réel et font comprendre l’ordre qui préside à l’organisation du monde. Celle qui se met ensuite en place et caractérise la science moderne ne se soucie plus de la représentation ; elle explique le monde en explorant les processus qui se déroulent en son sein. À l’origine de la mutation, on trouve des chercheurs conscients des faiblesses de la science passée et qui comprennent comment les dépasser. La géographie souffre de n’avoir pas de tels guides.
La discipline qu’Anne Godlewska découvre dans la première partie de l’ouvrage, au XVIIIe siècle, s’inscrit parfaitement dans l’épistémè classique : elle se veut description textuelle ou cartographique du monde, mais ne cherche absolument pas à retracer la genèse de celui-ci et à l’expliquer. Cette façon de concevoir la géographie est remise en cause dès la fin du XVIIIe siècle parce qu’elle est incapable d’éclairer les processus à l’origine des paysages et des distributions que l’on note à la surface de la terre. Aux alentours de 1800, les géographes font face à des critiques qu’ils ne peuvent pas ignorer ; la plupart s’efforcent malheureusement de les désarmer en privilégiant des orientations dépassées, ce qui les mène à l’échec. Les contours de la nouvelle épistémè se dessinent sur les marges : chez les géographes militaires, appelés à faire comprendre les pays qu’ils cartographient et analysent pour préparer les manœuvres des armées ou gérer un pays occupé, et chez des hommes que leur formation et leur vie ont ouvert à des préoccupations inédites au contact des sciences naturelles ou de la statistique et de leurs modes de raisonnement, comme Volney ou Alexandre de Humboldt, ou en relation avec l’archéologie et l’étude des inscriptions, comme Letronne.
Le travail d’Anne Godlewska ne fait-il qu’appliquer, dans le cadre de la géographie, des méthodes d’approche et des modes d’interprétation nés dans d’autres disciplines et qui sont devenus à la mode ? Ce n’est pas le cas. Sa démarche pose des questions analogues à celles de Foucault, mais on ne trouve nulle part chez elle de spéculation abstraite sur les formations discursives et sur le rôle qu’y tient l’énoncé. Sa méthode tient beaucoup à sa formation d’historienne : elle s’appuie sur la reconstitution des trajectoires intellectuelles de ceux qui, à l’époque qu’elle étudie, s’identifient comme géographes, se reconnaissent comme membres d’une communauté de géographes, comme de ceux qui ne sont pas considérés comme tels, mais le seraient selon les critères actuels.
Anne Godlewska rebâtit ainsi les itinéraires de nombre de géographes, grands ou petits ; ils ont laissé leur nom dans l’histoire de la discipline ou ont sombré dans l’oubli. Elle parle de leurs succès comme de leurs échecs – et ces derniers sont nombreux à une époque où l’on manque de critères unanimement reconnus (de paradigmes, pourrait-on dire, mais Anne Godlewska n’emploie jamais ce terme) pour guider l’activité et choisir les thèmes de recherche.
Pour présenter une image d’ensemble de ce qu’apporte cette démarche, Anne Godlewska n’essaie pas de croiser les multiples cas qu’elle étudie pour en tirer des moyennes et en dresser des typologies. Elle sélectionne deux ou trois trajectoires individuelles pour chacune des tendances et des époques qu’elle voit se dessiner. C’est à travers les biographies intellectuelles d’une vingtaine de géographes que sont évoqués l’époque, ses institutions, ses courants et ses évolutions. Cela rend le texte vivant – mais appelle une critique facile : pourquoi parler d’Edme Jomard et négliger Ramond de Carbonières, pour ne citer qu’un exemple ? Peut-être son choix reflète-t-il le rôle des cercles de connaissance d’abord ancrés autour de l’expédition d’Égypte, dans lesquels les géographes ont joué un rôle majeur.
Anne s’attache profondément à chacun de ceux qu’elle analyse. Elle ne cherche pas le pittoresque ou le sensationnel. Elle s’en tient à un propos clair : analyser les destinées intellectuelles de ceux qui sont alors géographes. Elle analyse leurs études et présente ceux qui les conseillent, les guident ou les influencent, comme les relations qu’ils nouent. Elle parle des méandres de leurs carrières, des contraintes qu’ils rencontrent et de la manière dont sont perçues leurs recherches. Elle détaille leurs travaux et insiste tout autant sur leurs succès que sur les choix infructueux qu’ils font ou sur les impasses dans lesquelles ils s’engagent. La tonalité de la première et de la seconde partie de l’ouvrage s’en trouve assombrie, car les échecs se multiplient avec la crise que subit la communauté des géographes. L’atmosphère de la troisième partie est plus tonique car la situation commence à s’améliorer, mais grâce à des hommes qui ne sont généralement pas considérés alors comme des géographes.
Le récit de la destinée intellectuelle de chacun est mené avec sensibilité et restitue son caractère : casanier chez Barbié du Bocage, aventureux pour Bory de Saint-Vincent, d’une inventivité multiple et débordante, mais parfois mal contrôlée, chez Humboldt, dilettante dans le cas de Walckenaer, intellectuellement droit, moralement généreux et admirablement imaginatif chez Letronne. Anne Godlewska laisse transparaître ses préférences, mais accorde autant d’attention à l’obstination dans l’erreur d’un Jomard qu’à l’énergie créatrice d’un Volney ou d’un Humboldt. Dans les destins qu’elle retrace, elle souligne le poids des conditions sociales, de leur bouleversement à la suite de la Révolution et d’un démarrage économique devenu sensible sous la Restauration.
En filigrane, on voit se dessiner le rôle des institutions : sous l’Ancien Régime la géographie se loge dans les collèges jésuites, oratoriens ou militaires, à l’Académie des sciences et à celle des inscriptions et belles lettres ; pour les géographes indépendants, elle dépend du patronage royal. La Révolution bouleverse la structure de l’enseignement et de la recherche avec la création de l’École normale, des Écoles centrales et de l’École polytechnique. Le Directoire, le Consulat et l’Empire ressuscitent et réorganisent les Académies et les réunissent au sein de l’Institut. Napoléon surveille celui-ci comme en témoigne la fermeture, dès 1802, de sa classe des sciences morales et politiques, jugée subversive car dominée par les Idéologues. Le rôle de l’armée, le poids des états-majors, l’importance accrue des officiers qui y servent ou de ceux en charge du renseignement et de la logistique, ont un impact considérable sur la recherche géographique. La croissance du rôle de l’État entraîne un besoin grandissant d’informations précises : sur les populations, la santé et l’instruction ; sur l’activité économique, l’agriculture, les manufactures, le commerce et les transports ; sur les langues et sur les religions. On voit évoluer les formes de l’emprise de l’État et de son intensité : davantage axées sur le prestige, l’attachement personnel ou le don sous l’Ancien Régime ; plus directement liées au contrôle collectif et au débat public sous la Révolution ; plus hiérarchisées et centralisées sous l’Empire ; plus sensibles aux jeux de l’information et aux impératifs économiques à partir de la Restauration.
L’évolution des conceptions du savoir se dessine à l’arrière-plan. Les sciences sont largement dominées par les mathématiques, l’astronomie et la physique durant la première moitié du XVIIIe siècle ; la botanique, la zoologie, la minéralogie, la géologie, la physique de la terre et la climatologie se dessinent ou s’affirment ensuite. La curiosité pour l’homme s’approfondit et se transforme. Avec les Lumières, elle repose sur une conviction simple : il suffit de mettre en évidence les injustices et dysfonctionnements de la société pour que leur correction s’impose. Cette curiosité s’exprime aussi par un immense intérêt pour les formes exotiques de l’humanité, parées de la considération que l’on a alors pour le bon sauvage. La Révolution conduit à un constat : les mots ne suffisent pas à réformer les sociétés : organismes complexes, leurs mécanismes sociaux, économiques et intellectuels doivent être décrits – la statistique s’y emploie – analysés et interprétés.
L’accent mis par Anne Godlewska sur les trajectoires intellectuelles des individus la conduit ainsi à une approche en quelque sorte impressionniste de l’histoire des disciplines scientifiques : sa démarche possède la vivacité de ce qui part des hommes (les femmes n’accédant guère à la géographie) et dessine, par touches successives, des perspectives sur leur environnement social, sur les institutions, sur la vie économique et sur les courants de pensée.
On pourrait craindre qu’une telle démarche mène à une appréhension pointilliste du domaine et à une juxtaposition de positions dont ne ressorte aucune ligne directrice. Ce n’est pas le cas. La forme narrative adoptée par Anne Godlewska ne doit pas tromper : elle ne traduit nullement une appréhension naïve de la réalité. Le choix, comme outil de présentation, de l’itinéraire intellectuel est fait pour appréhender concrètement l’histoire des formations de la recherche et le contexte dans lequel celles-ci naissent, se structurent et se diffusent. Il fournit des données sur la géographie, sur ses fondements, sa structure, ses réalisations et ses errements, et sur tout ce qui explique les dynamiques observées. Cela donne au travail une portée qui déborde largement du cadre où il paraît s’inscrire.
Selon Anne Godlewska, le mouvement qui anime la géographie française se déroule en trois séquences : (i) une perte initiale de pertinence, (ii) des essais malheureux pour donner un nouveau dynamisme à la géographie, (iii) des innovations qui annoncent la transformation espérée, mais sur les marges.
(i) La première phase souligne combien la géographie d’alors diffère de celle qui se pratique aujourd’hui : quoiqu’elle se veuille descriptive, son but n’est pas de saisir la diversité du monde. L’objet qu’elle se donne n’est pas la réalité brute, mais une image réduite à une espèce de géométrie de la surface terrestre. Que la présentation du monde qu’elle propose ainsi prenne une forme textuelle ou graphique, c’est toujours l’image simplifiée de la pellicule terrestre – une sorte de carte – qui en ressort. En dehors des cartes, les productions essentielles des géographes de l’époque sont des géographies universelles, c’est-à-dire la version écrite de mappemondes.
La carte repose sur la détermination des coordonnées d’un nombre suffisant de points et sur le lever, par arpentage ou triangulation, de la topographie des espaces qui les entourent et les relient. Depuis l’Antiquité, c’est aux astronomes qu’incombe, dans la mesure du possible, la détermination des coordonnées sphériques indispensables pour situer les lieux sur un globe. C’est à des arpenteurs et plus tard, à des spécialistes du lever à la planchette ou (forme plus raffinée) de la triangulation que revient le travail de terrain. Comme l’astronomie a de la peine à mesurer les latitudes et se montre totalement incapable d’en faire autant des longitudes, il faut mener une évaluation critique des distances relatées par les voyageurs ou consignées sur les livres de bord des navires pour déterminer les coordonnées. C’est la tâche à laquelle se consacrent la plupart des géographes, ce qui signifie que ce sont alors des hommes de cabinet. On les voit à l’action dans le premier chapitre de l’ouvrage : ces fouineurs de manuscrits ou de mappemondes dessinent et font graver (ou gravent) les cartes que les données qu’ils ont collationnées permettent de dresser. Ils essaient de vivre de leur vente. La qualité de leurs productions dépend de leur érudition, qui est souvent admirable.
L’entreprise des Cassini remet en cause l’art traditionnel de la cartographie : rendue possible par le progrès de la mesure astronomique des longitudes, elle permet enfin la détermination précises des coordonnées terrestres (que facilite encore, à partir des années 1750, le chronomètre de marine) et par la triangulation, le lever des espaces intermédiaires. Des topographes – que l’on nomme dans un premier temps géographes – se confrontent au terrain. Qualifiés d’ingénieurs-géographes puis d’officiers topographes dans l’armée, leur formation combine dans une première phase les modes traditionnels d’évaluation des distances et l’utilisation des instruments de visée astronomiques ou terrestres. En un demi-siècle, la première partie de leur formation devient inutile. La cartographie moderne tue la vieille géographie de cabinet.
Au milieu du XVIIIe siècle, la cartographie fondée sur l’astronomie et la triangulation jouit d’une faveur d’autant plus grande, qu’elle offre, pensent certains, le moyen de vérifier – ou de controuver – l’hypothèse de Newton sur l’aplatissement de la terre aux hautes latitudes et au-delà, la validité de la loi de la gravitation universelle avec laquelle naît la recherche scientifique moderne : débat essentiel de l’époque. La France y participe en faisant mesurer un arc d’un degré de latitude en Laponie et au Pérou, c’est-à-dire à l’Équateur ou près du pôle. Newton paraît triompher, mais les résultats de ces levers de terrain n’emportent pas la conviction de tous. La physique du globe et les mesures de l’intensité de la gravité à laquelle procède cette nouvelle discipline arrivent, elles, à un résultat sans appel. Comme le souligne Anne Godlewska, le lever de terrain perd du coup l’aura scientifique qu’il devait à sa participation au grand débat sur la physique newtonienne. La vieille géographie de cabinet ne sert plus à rien maintenant que les coordonnées et les relevés topographiques reposent sur les techniques rigoureuses. Nommée géodésie, cette partie de la géographie devient une technologie autonome. Ainsi s’explique la perte catastrophique de prestige que connaît ce qui reste de la communauté de géographes.
(ii) Les géographes sont désorientés et cherchent à réagir. Cette seconde phase est faite de l’échec plus ou moins marqué des trois tentatives de renouvellement qu’ils imaginent alors. La première essaie de systématiser et d’améliorer la contribution des géographes à la cartographie en accentuant la démarche critique qu’avait illustrée Bourguignon d’Anville et en pariant sur l’outil de découverte que constitue la carte. C’est le choix fait par l’un des ingénieurs géographes qui ont participé à l’expédition d’Égypte, Edme Jomard : pour lui, c’est en cartographiant le pays, en levant des plans de plus en plus précis de ses monuments et en transcrivant les inscriptions qu’ils portent que l’on éclairera la civilisation de l’ancienne Égypte et que l’on déchiffrera ses hiéroglyphes. Sa démarche ne conduit à rien : c’est Champollion – et indépendamment, Thomas Young – qui résolvent le problème grâce à la pierre de Rosette.
La pensée géographique des Grecs anciens avait deux facettes : elle apprenait à repérer la position de tous les points à la surface de la terre, dans le sillage d’Ératosthène, d’Hipparque et de Ptolémée ; à la suite de Strabon, elle ajoutait à la détermination des coordonnées la description de la division régionale de l’œcoumène, du monde habité. La tradition des géographies universelles était née de cette seconde orientation. Malte-Brun décide de la rénover, mais ne met en œuvre, pour y parvenir, qu’une démarche littéraire : rendre la description plus vivante, plus colorée. Il n’a pas compris que la description ne devient vraiment intéressante que lorsqu’elle donne de l’épaisseur à la surface terrestre, la peuple de plantes, d’animaux et d’êtres humains et appréhende les processus qui y sont à l’œuvre. C’est ce qu’avait en partie compris Strabon, pour qui l’écoumène était un monde de vie, d’activités et de forces, un monde politique – c’est à l’intention d’Auguste qu’il écrivait sa Géographie –, et un monde de culture aussi, puisqu’habiter le monde, c’était essayer de s’y accomplir. Pour appuyer sa recherche, il manquait à Strabon l’appui de sciences de la nature et de la société déjà structurées. Celui-ci devient disponible à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, mais Malte-Brun le refuse en condamnant tout recours à la théorie – et en fait, à l’explication scientifique. La géographie universelle de Malte-Brun rate ainsi l’approche régionale que le progrès scientifique rendait possible : une lecture des paysages qui s’attache aux mécanismes qui les façonnent au lieu de se borner à les décrire – ce qu’un Giraud-Soulavie ou un Humboldt sont en train de découvrir. La géographie universelle aurait pu sauver la géographie traditionnelle, mais à la condition que celle-ci ne se contente plus d’appréhender le terrain et le paysage comme de simples cadres à décrire, mais comme des environnements à analyser pour en saisir le fonctionnement.
La troisième piste de renouveau est ouverte par l’État. La Révolution et l’Empire accroissent son rôle dans une société française qu’il ne s’agit plus seulement d’encadrer, mais de transformer pour respecter les droits qui reviennent désormais aux citoyens, pour contribuer à leur prospérité, mais aussi pour assurer leur sécurité et les défendre. L’État d’Ancien Régime était parfaitement conscient de ce qu’il pouvait attendre de la géographie et qui se situait presque exclusivement du côté de la cartographie : une connaissance plus précise du territoire où s’exerçait sa souveraineté grâce aux cartes, une défense plus efficace de celui-ci grâce aux plans de ses frontières et de ses rivages, une navigation plus sûre sur toutes les mers du monde grâce à de bonnes cartes marines. L’État issu de la Révolution a d’autres soucis : établir un cadastre pour asseoir l’impôt foncier sur une base objective, ce qui est essentiel pour des raisons de justice ; créer des institutions qui permettent aux citoyens de jouir de leurs droits, d’être éduqués, de rester en bonne santé et d’être libres de s’installer et de travailler où ils veulent. À une époque où les frontières des États sont menacées par les nouvelles idées, il convient plus que jamais d’assurer la défense de la collectivité nationale.
Pour assumer ces nouvelles responsabilités, l’État a besoin de plus d’informations, qu’il demande à la statistique. Pour rendre plus efficace sa défense, il renforce et réforme l’armée. Prise dans une suite ininterrompue de conflits, la France lève, pour la première fois en Europe, des armées de plus d’un million de soldats. De telles masses impliquent un commandement mieux préparé, des transports plus efficaces, des renseignements plus précis. Des officiers sont formés aux fonctions d’état-major et de renseignement. Ils sont instruits par le Dépôt de la Guerre sur une base résolument géographique qui les initie à la fois à la topographie, à la carte et au travail d’intelligence, au sens anglais du terme : la collecte et l’exploitation du renseignement. Les cadres ainsi préparés sont beaucoup plus ouverts que les géographes de cabinet aux informations que fournissent l’observation systématique et la statistique. Cela donne à des cadets de Gascogne issus de famille peu argentées, comme André de Férussac et Bory de Saint-Vincent, l’opportunité de mener une carrière brillante, de développer des recherches scientifiques originales – à la limite de la zoologie et de la gestion de l’information pour le premier, de la botanique et de la géographie régionale pour le second. L’État et l’armée ne se soucient toutefois pas encore du suivi de la recherche, si bien que l’impulsion qu’elle fournit à la géographie est souvent discontinue et variable. Les conditions de carrière des militaires bousculent sans cesse leurs projets et les imprègnent souvent d’une idéologie impérialiste.
(iii) À travers essais et erreurs, une nouvelle géographie s’esquisse peu à peu dans les premières décennies du XIXe siècle. Elle le doit à l’attention nouvelle portée aux dimensions naturelles et sociales des environnements terrestres, et au rôle du temps dans leur dynamique.
Comme exemple de l’attention nouvelle portée à la dimension humaine des répartitions, Anne Godlewska retient Volney, Chabrol de Volvic et Letronne. Aucun des trois ne se considère comme géographe, sinon pour de brèves périodes ou certaines publications, mais les trois développent des approches déjà modernes. La première originalité de Volney est d’être un homme de terrain : il nous parle de la Syrie et de l’Égypte, de la Corse et des États-Unis où il a voyagé longuement, observé la végétation, le climat, les coutumes, les modes de vie et le système politique. Il y saisit l’originalité des milieux, forêts, prairies, steppes ou montagnes, mesure le poids des contraintes naturelles sur la vie des Bédouins qu’il partage un temps, mais aussi celui des systèmes politiques. Chabrol de Volvic sort de la nouvelle École Polytechnique et participe à l’expédition d’Égypte, où Bonaparte le remarque, ce qui lui ouvre une carrière préfectorale de Pontivy, à Montenotte – en Italie annexée – puis à Paris. Il y pratique une géographie appliquée à l’urbanisme et à l’aménagement en dirigeant la construction de Napoléonville (Pontivy), en stimulant l’économie d’un département taillé dans la Ligurie et le Piémont, puis en mettant en place les instruments modernes de connaissance des populations et des flux dans l’agglomération parisienne – et préparant ainsi l’action de Haussmann.
Plus encore que Volney, Humboldt est un homme de terrain un peu partout en Europe, en Amérique latine, avant de parcourir la Russie et la Sibérie. Sa formation lui permet d’embrasser à la fois la physique, la géologie, la minéralogie (il est ingénieur des mines) et la botanique : c’est un physicien et un naturaliste. Il connaît également l’économie et la statistique au sens où le caméralisme allemand les concevait. Féru de science expérimentale, il détermine les minéraux, les roches, les plantes et les animaux des milieux qu’il étudie, y mesure températures, pressions, altitudes et champ magnétique, y décrit la flore et la faune, y analyse les activités des hommes, les marques qu’ils impriment sur les paysages et les monuments qu’ils ont dressés. Il croise toutes ces données et s’ingénie à rendre aisément compréhensibles les résultats qu’il obtient. Il fait progresser de manière décisive leur expression graphique et leur cartographie thématique. Il invente la géographie des plantes, contribue à la compréhension des milieux et souligne le rôle des mouvements de masse d’eau et des masses d’air dans la distribution des climats : il façonne ainsi la géographie naturelle moderne, même si la géognosie qu’il essaie de construire est une impasse. La philosophie de la nature qui se développe en Allemagne au tournant des XVIIIe et XIXe siècles lui fait concevoir le cosmos et la terre comme des systèmes, des totalités, et attire son attention sur le rôle de l’esprit et de la sensibilité dans l’aperception du monde.
Les instruments sur lesquels s’appuient la géographie humaine et la géographie physique modernes sont ainsi mis au point et testés. Certains résultats importants sont obtenus. C’est en se consacrant à l’étude des processus naturels et sociaux que la géographie se modernise. La nouvelle discipline donne une place centrale au changement, aux évolutions, au jeu du temps. On voit s’y dessiner des curiosités jusqu’alors ignorées et s’y développer des formes innovantes d’imagination géographique – c’est un point qui fascine Anne Godlewska. Les pistes ainsi ouvertes offrent des possibilités de reconversion aux géographes de cabinet, ce dont ils profitent dans les premières décennies du XIXe siècle. Certains restent trop proches des modèles anciens, comme Barbié du Bocage. Quelques-uns, comme Gosselin, se lancent dans une interprétation sans base solide des anciens systèmes de mesure. Walckenaer fait montre d’une curiosité plus ouverte, mais souffre d’un certain dilettantisme. L’érudition foisonnante de Humboldt gâte l’interprétation qu’il propose des Grandes Découvertes. La subtilité et la rigueur de Letronne font surgir d’inscriptions, de papyrus, de vieilles monnaies et de récits de voyages anciens tout un pan jusque-là ignoré d’histoire et de géographie, celui de l’Égypte grecque puis romaine – mais sans que les géographes en tirent profit.
L’ouvrage d’Anne Godlewska appréhende une phase de transition essentielle dans l’histoire de la géographie. Signe du passage de l’épistémè classique des identités à celle, modernes, des explications, comme le veut Michel Foucault ? En un sens, oui. Mais mutation plus profonde : celle par laquelle la géographie, qui souffrait depuis l’Antiquité de l’impossibilité de mettre en pratique son premier apport scientifique essentiel, le repérage des lieux sur la sphère terrestre par des coordonnées scientifiquement mesurées, se libère du carcan où cela la maintenait enfermée et commence à devenir une discipline moderne.