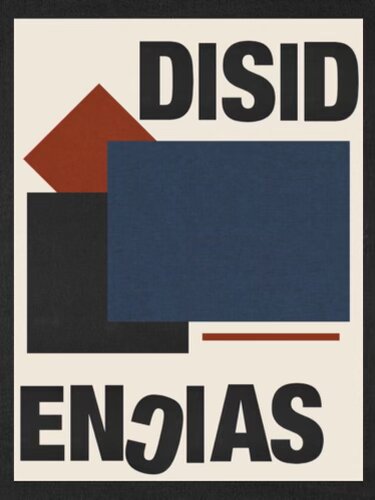Traduit par Thierry Capmartin.
Faire taire la différence. Prélude grec
1.
Une conception un peu fruste du matérialisme historique veut que les changements culturels et idéologiques ne soient considérés que comme des épiphénomènes des procès technologiques et économiques qui les sous-tendent. Conformément à cette approche, tout changement dans l’ordre superstructurel des idées se borne à refléter ou à enregistrer – comme le ferait un sismographe – une modification déterminée au niveau infrastructurel des forces productives ou des rapports de production. Si bien que le rapport entre les deux niveaux doit être conçu comme un rapport unidirectionnel : c’est la base économique qui influe sur la superstructure idéologique, la réciproque n’étant pas vraie.
Personne aujourd’hui ne souscrirait complètement à cette approche méthodologique, peut-être même qu’aucune forme intéressante de marxisme n’y a jamais souscrit d’ailleurs. On sait aujourd’hui que les idées influencent aussi les procès économiques et que les changements culturels sont décisifs dans l’évolution des sociétés. Et cette question n’intéresse pas seulement la méthodologie des sciences sociales, mais elle s’avère aussi pertinente d’un point de vue pratique et politique sur une chose dont notre époque a une conscience aiguë : de plus en plus nombreux sont en effet ceux qui pensent que le mode de vie des sociétés développées n’est pas soutenable à moyen ou long terme, et ce pour diverses raisons, le plus souvent écologiques. Or il semble évident que tout changement social d’importance appellera à son tour des changements culturels et même un certain changement éthique, c’est-à-dire une modification dans notre façon d’appréhender nos rapports avec les autres, avec nous-mêmes et l’environnement naturel que nous habitons. C’est pourquoi il n’est pas sans intérêt de procéder à l’analyse des moteurs culturels qui produisent les changements sociaux, ainsi qu’à celle du tissu de valeurs, d’idées d’ordre éthique et de visions du monde qui ont influencé l’évolution de notre société et qui continue de la déterminer dans un sens dont nous – les acteurs sociaux – ne sommes pas toujours conscients.
Voilà ce que ces pages entreprennent de thématiser. Notre intention étant de confronter ici, quoique brièvement, les idées de Max Weber (déjà classiques et bien connues) sur l’ethos du premier capitalisme aux thèses du sociologue allemand Hartmud Rosa, au sujet du moteur culturel de l’accélération sociale, caractéristique de nos sociétés contemporaines. Cette confrontation permettra d’établir un parallèle entre la société capitaliste naissante et la nôtre : car si le besoin de certitude concernant le salut de nos âmes fut déterminant pour consolider le mode de vie capitaliste à ses origines, le moteur culturel d’accélération sociale le plus important aujourd’hui pourrait bien être un équivalent fonctionnel sécularisé de cette vieille motivation religieuse.
2.
Dans son étude classique L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, publiée entre 1904 et 1905, Max Weber enquête sur l’ethos du premier capitalisme à partir de documents anglais et américains du XVII et XVIIIe s. La figure de Benjamin Franklin (1706-1790) y prend un relief tout particulier, car dans les essais économiques et moraux de cet auteur, Weber repère deux traits caractéristiques de la mentalité capitaliste dont la combinaison se révèle paradoxale. Franklin présente d’une part l’activité économique et l’enrichissement comme une obligation éthique, à tel point que trop dépenser ou laisser échapper l’opportunité d’un gain possible sont non seulement des actions irrationnelles et stupides, mais aussi immorales. Mais d’autre part, la mentalité que dépeint Franklin se caractérise par l’interdit de la jouissance pour celui qui profiterait de la richesse accumulée. Pour les pionniers du capitalisme, l’activité économique n’était donc pas au service du bonheur individuel, c’est l’individu en revanche qui se trouvait subordonné à l’augmentation constante de la richesse :
Le summum bonum peut s’exprimer ainsi : gagner de l’argent, toujours plus d’argent, tout en se gardant strictement des jouissances spontanées de la vie. […] Le gain est devenu la fin que l’homme se propose ; il ne lui est plus subordonné comme moyen de satisfaire ses besoins matériels.1
Dès l’origine, le capitalisme apparaît comme « conduite où l’homme existe en fonction de son entreprise et non l’inverse2 ». Weber souligne la nouveauté historique que représente cet « esprit ». Nul doute que la cupidité ou l’appât du gain ont existé de tout temps, mais pour la mentalité traditionnelle, prémoderne ou précapitaliste, l’objectif de l’activité économique a toujours été de bien vivre ou de vivre mieux. Le plaisir et le bonheur de l’individu continuaient d’être l’horizon de toute activité lucrative. Au contraire, le paradoxe de la nouvelle mentalité capitaliste forgée à partir du XVIe s. repose sur le rejet de la jouissance et la dévaluation du bonheur. Pour expliquer cette mentalité insolite et apparemment irrationnelle3, Weber formule ainsi son hypothèse fameuse : l’ethos capitaliste a une origine religieuse, et répondait concrètement à la doctrine de la prédestination, centrale dans la théologie de Jean Calvin et, partant, au sein des sectes puritaines où s’est implanté le mode de vie capitaliste dans l’Angleterre du XVIIe s.
La doctrine de la prédestination (qui n’est au fond qu’une radicalisation de quelques idées de Luther) soutient que l’omnipotence divine est incompatible avec la liberté humaine et que par conséquent il faut penser le salut ou la condamnation de l’âme des individus comme ayant été décidés par Dieu de toute éternité. L’homme ne peut donc pas influer sur son propre salut, car s’il pouvait le faire, la toute-puissance divine en ferait les frais. Mais au-delà des considérations métaphysiques que cette doctrine fait peser sur le libre-arbitre, elle n’est pas sans avoir d’importantes implications théologiques : elle oblige le croyant à admettre la totale arbitrariété de la grâce. Dans la théologie calviniste certains sont sauvés tandis que d’autres sont condamnés, sans que cela ne dépende en rien des actions individuelles, puisque l’omnipotence divine prive de toute efficace les possibilités de salut qu’offrent d’autres variantes du christianisme, telles que la foi ou les œuvres. Très révélatrice est dans ce sens la Confession de Westminster (1647), document que Weber cite largement et qui rassemble les principes du calvinisme tels que les professaient les sectes puritaines anglaises. On peut par exemple y lire ceci :
« Chapitre IX (Du libre arbitre), n° 3. – Par sa chute dans l’état de péché, l’homme a complètement perdu la capacité de vouloir un quelconque bien spirituel lié à son salut. De sorte qu’un homme naturel étant entièrement détourné de ce Bien, et condamné au péché, ne saurait de son propre fait se convertir ni même se préparer à la conversion.
Chapitre III (Des décrets éternels de Dieu), n° 3. – Par décret de Dieu, et pour la manifestation de Sa gloire, tels hommes […] sont prédestinés à la vie éternelle, tels autres voués à la mort éternelle.
N° 5. – Ceux parmi les hommes qui sont prédestinés à la vie, Dieu les a élus dès avant d’établir les fondements du monde, conformément à Son dessein immuable de toute éternité ainsi qu’à Sa volonté intime et à Son bon plaisir. Il les a élus dans le Christ et pour leur gloire éternelle, de par Sa seule grâce et Son seul amour librement prodigués, en dehors de toute prescience tant de leur foi ou de leurs bonnes œuvres que de leur persévérance en celles-ci ou en celle-là, en dehors aussi de toute autre condition ou cause déterminante propre à la créature [élue] ; et tout cela à la louange de Sa grâce et de Sa gloire. »4
Autant de choses qui semblent bien éloignées de nous. Mais si l’on se transporte dans les mentalités de l’époque en tâchant de comprendre ce qui est en jeu – rien moins que la condamnation éternelle –, on comprendra aussi ce que cette doctrine de la prédestination pouvait avoir d’insupportable « à une époque où l’au-delà était non seulement chose plus importante, mais à bien des égards plus certaine de surcroît que tous les intérêts de la vie d’ici-bas5 ». Pour la rendre plus supportable, le puritanisme a ourdi une stratégie consistant à stimuler cet ascétisme intramondain du premier capitalisme, c’est-à-dire cette combinaison paradoxale de travail incessant et d’interdiction de la jouissance. Et de fait, dans ces communautés puritaines la réussite dans les affaires et l’austérité personnelle étaient interprétées comme des indices subjectifs ou des signes extérieurs d’appartenance au groupe des élus de Dieu – comme indices mais jamais comme moyens du salut, ce dernier ne dépendant en aucune façon de l’action des hommes. À la lumière de cet arrière-plan théologique et de la profonde angoisse que suscitait le décret arbitraire d’un Deus absconditus, on comprend mieux cet ethos combinant à la fois le devoir de s’enrichir et l’exigence d’une vie parfaitement austère.
Pour Weber cet ascétisme intramondain a eu d’importantes conséquences économiques : il a favorisé l’épargne et l’accumulation de capital, pas tant comme mode de vie mais comme mode de production6. Plus tard, la sécularisation7 de la culture et de la société (favorisée à son tour par le capitalisme lui-même) a fini de saper les fondements religieux de cette forme de vie, mais pas la forme de vie elle-même : profession, travail et activité laborieuse ont cessé d’être des obligations religieuses pour devenir des devoirs moraux et constituer le cœur de l’ « ethos […] bourgeois de la besogne8 » déjà présent dans les écrits de Benjamin Franklin, et qui après les capitalistes s’est étendu au salariat tout entier. Notons que de nos jours cet ethos perdure sous la forme d’une compulsion au travail qui « hante désormais notre vie, tel le spectre de croyances religieuses disparues9 ». Déjà à l’époque de Weber, mais encore aujourd’hui donc, nous reproduisons cette compulsion typiquement puritaine et bourgeoise du travail incessant et du culte de l’activité professionnelle, même si après l’éclipse de sa justification religieuse cet abandon au travail obéit désormais aux contraintes structurelles d’une société organisée autour du principe de rendement. À la différence de ce qui se passait au temps de Benjamin Franklin, le travail incessant est compensé aujourd’hui par un hédonisme non moins compulsif occupant notre temps libre. Et le résultat de ces deux traits d’époque nous renvoie la sombre image de la condition humaine dont Weber fait le portrait dans des pages fameuses à la fin de son étude : « Pour les “derniers hommes” de ce développement de la civilisation, ces mots pourraient se tourner en vérité – “Spécialistes sans vision et voluptueux sans cœur – ce néant s’imagine avoir gravi un degré de l’humanité jamais atteint jusque-là.”10 »
Dans la perspective qui est la nôtre, on peut passer sous silence le détail de l’évolution longue et complexe de nos sociétés modernes conduisant finalement à cette sombre image wébérienne. Il s’agit simplement ici de ramener au premier plan la question éthique qui est en jeu : le mode de vie capitaliste plonge ses racines dans un fonds religieux en rapport avec la condamnation éternelle et donc également avec une certaine préoccupation pour la mort. Cela vaut-il également pour nous ? Est-ce que cela dit quelque chose de notre propre mode de vie en permettant de mieux le comprendre ?
3.
C’est nous qui nous trouvons à l’autre extrémité de cette histoire du capitalisme. Nos modes de vie actuels ne sont plus marqués par l’ascétisme intramondain de ces austères communautés calvinistes, mais par un phénomène que le sociologue allemand Hartmut Rosa a brillamment analysé : l’accélération sociale. Ce phénomène peut être défini comme augmentation de la quantité d’activité (d’un processus, d’une expérience) par unité de temps, et s’observe un peu partout :
Les athlètes semblent courir et nager de plus en plus vite ; les fast-foods, le speed-dating, les siestes éclairs et les drive-through funerals semblent témoigner de notre détermination à accélérer le rythme de nos actions quotidiennes, les ordinateurs sont de plus en plus rapides, les transports et la communication demandent seulement une fraction du temps nécessaire il y a un siècle, les gens paraissent dormir de moins en moins […], et même nos voisins semblent emménager et déménager de plus en plus fréquemment.11
Afin d’analyser plus précisément les principaux aspects de ce phénomène, Rosa distingue trois catégories ou dimensions de l’accélération qui s’auto-entretiennent : l’accélération technique, l’accélération du changement social et l’accélération du rythme de vie. Examinons-les successivement :
1.) L’accélération technique consiste en une augmentation de la vitesse des procès de production, des transports et des communications. Elle correspond donc à l’ensemble des innovations qui permettent de produire toujours plus vite (plus de quantité en moins de temps), de transporter des objets ou de voyager plus vite (de parcourir des distances plus longues en des temps plus courts), de communiquer plus rapidement (tel l’envoi de mails comparé au temps que prend celui d’une lettre).
2.) L’accélération du changement social concerne une constellation de phénomènes que Rosa caractérise de façon un peu diffuse comme « formes de la pratique et orientations de l’action, d’une part, et formes du lien social et modèles relationnels de l’autre12 ». On saisira d’autant mieux cette dimension d’accélération si on considère son effet (et son indice) le plus intéressant, à savoir : la contraction du présent. Sociologiquement, le “présent” peut se définir en fonction de l’intervalle de temps où coïncident espaces d’expérience et horizons d’attente, de telle sorte qu’on puisse tirer du passé des conclusions valides pour envisager l’avenir. Autrement dit, le présent c’est l’intervalle où l’expérience passée sert à nous orienter vers l’avenir et où ce que l’on attend du futur présente une certaine fiabilité. Or, dans nos sociétés actuelles (passablement accélérées), le présent tend à se contracter, à obéir à un temps court, ce qui se traduit par une perte de confiance toujours plus rapide elle aussi, et sur le plan des expériences, et sur celui des attentes : les premières sont vite périmées tandis que les secondes sont forcément déçues face à un avenir de plus en plus imprévisible.
Cette caducité touche tous les secteurs de la société : les modes, les styles artistiques, les produits technologiques, l’actualité politique, les connaissances et la qualification professionnelle. Mais Rosa met l’accent sur deux indicateurs empiriques de la contraction du présent : les changements au sein de la cellule familiale et dans la sphère du travail. Dans ces deux domaines, d’abord intergénérationnel (à l’époque prémoderne ou dans la première modernité) le rythme des changements est passé au stade générationnel (durant la période de la modernité classique, entre 1850 et 1970 environ), puis finalement intragénérationnel (à l’époque postmoderne ou « modernité tardive13[13] », comme préfère écrire Rosa). De fait, les structures familiales dans les sociétés agraires prémodernes demeuraient stables pendant des générations, indépendamment de la succession des membres qui les composaient. Pendant la modernité classique la vie de famille s’organisait autour de l’unité la plus petite possible : le mariage indissoluble. La société moderne tardive ou postmoderne laisse apercevoir des cycles familiaux beaucoup plus courts : le nombre de séparations et de divorces va croissant, et les individus multiplient le nombre de partenaires tout au long de la vie. L’accélération du changement social dans la sphère du travail obéit à un modèle similaire : si dans la société prémoderne le fils héritait du métier du père et ainsi de suite de génération en génération, et que dans la modernité classique le choix individuel d’un métier durait toute une vie, notre époque se caractérise en revanche par la fragmentation de la vie professionnelle, la succession d’emplois différents, le recyclage constant, etc14. Nos vies personnelles et professionnelles sont donc des indicateurs fiables de l’impétueuse accélération du changement social qui traverse notre époque.
3.) Finalement, l’accélération du rythme de vie suit une tendance qui consiste à faire ou à expérimenter plus de choses par unité de temps donnée. Mouvement où, consciemment ou inconsciemment, nous sommes tous embarqués, et dans lequel nous nous engageons au moyen de stratégies aussi variées que la réduction du temps consacré à réaliser des actions quotidiennes (manger ou dormir, par exemple15), la réalisation de tâches simultanées (déambuler dans la rue tout en traitant par téléphone d’affaires professionnelles, ou travailler sur son ordinateur portable tout en voyageant en train) ou la réduction du nombre de pauses entre les différentes tâches ou les périodes d’activité professionnelle. Or l’aspect le plus intéressant – ou inquiétant – de cette accélération du rythme de la vie c’est que l’on en ressort avec l’impression de ne pas être plus efficaces dans le traitement des tâches qui nous incombent : on accélère, mais on n’avance jamais assez vite ! C’est la résultante d’un paradoxe dans la gestion de notre temps : l’accélération technique, qui devrait libérer du temps libre, favorise en même temps l’accroissement exponentiel de tâches qui nous volent du temps. Un exemple tiré du quotidien : envoyer un mail est bien plus rapide que d’écrire une lettre, de la mettre dans une enveloppe, d’acheter un timbre et de le poster dans une boîte aux lettres ; mais de nos jours on envoie jusqu’à dix, vingt ou trente courriers électroniques par jour. Les tâches s’en trouvent démultipliées du fait de l’accélération technique et de celle du changement social, avec pour corollaire ce sentiment permanent d’« être débordé » qui « hante désormais nos vies tel [un] spectre », pour reprendre l’expression déjà mentionnée de Max Weber.
En comparant quelques métaphores employées par la sociologie, on se donnera un aperçu plus synthétique et intuitif de la question à partir des observations que l’on vient de faire. Alors que Max Weber utilisait l’image célèbre de la « cage de fer » pour décrire nos sociétés modernes, Hartmut Rosa lui préfère, pour caractériser la société de la modernité tardive, celle de la roue du hamster, de la pente glissante ou de l’escalator que l’on remonte à contre-sens :
Les acteurs évoluent dans le cadre d’un changement multidimensionnel constant qui interdit l’immobilité par absence d’action ou de décision. Quiconque ne s’adapte pas en permanence aux conditions de l’action qui se transforment constamment (ou ne réactualise pas en permanence hardware et software, au sens propre et au sens figuré) se ferme toute possibilité de rester connecté à son époque et d’affronter l’avenir16.
Pour notre propos, nous pouvons nous limiter à un seul aspect de cette théorie de l’accélération sociale : la question de ses moteurs. Qu’est-ce qui met en branle ce cycle complexe d’accélération qui relie entre eux technique, changement social et vie quotidienne. Pourquoi donc vivons-nous à toute allure ? À l’évidence, le premier moteur est économique et joue tout particulièrement au niveau de l’accélération technique dans les procès impliqués par la production, la distribution et les communications. Le capitalisme s’avère être en effet un grand accélérateur social du fait d’un trait structurel déterminant de ce mode de production, dont Marx a fait l’analyse et que Rosa appelle la « stabilisation dynamique »17. Le fait que les sociétés capitalistes ne puissent se stabiliser que dynamiquement signifie qu’elles doivent accélérer et croître constamment pour se maintenir et ne pas s’effondrer ; étant entendu que dans un système économique à concurrence généralisée, celui qui ne se développe pas est condamné à couler. Cette contrainte systémique pousse à l’accélération, quels que soient les acteurs sociaux qui servent de point de référence : individus, entreprises ou Etats. Les entreprises en concurrence au sein d’une économie de marché se voient forcées d’innover en permanence pour ne pas être éliminées de la compétition. Ce qui n’est pas très différent de ce qui se passe chez les individus, ces derniers étant eux aussi en situation de concurrence à l’intérieur des différents champs d’interaction sociale, tout particulièrement celui du travail. Mais dans la mesure où les États se financent en s’appuyant sur l’activité économique, leur propre stabilité dépend également du succès de la stabilisation dynamique du système économique18. Pour Rosa, cette forme dynamique de stabilisation constitue le trait déterminant du capitalisme actuel. Bien plus déterminant par exemple que la structure de classes antagoniques (bourgeoisie vs. prolétariat), que la très complexe et opaque stratification des sociétés modernes tardives a rendu moins significative19.
Il insiste néanmoins sur le fait que l’économie n’est pas le seul moteur de l’accélération sociale. Il existe également un moteur spécifiquement culturel, dont l’analyse nous éloigne de Marx mais permet de renouer en revanche avec l’approche wébérienne. Puisqu’en effet l’accélération sociale actuelle a à voir avec certaines valeurs, une certaine vision du monde, un ethos et même – comme c’était déjà le cas dans le premier capitalisme – avec notre préoccupation pour la mort. En cette modernité tardive, presque entièrement sécularisée, nous sommes certainement plus conscients que jamais de notre mortalité, ne serait-ce que pour cette raison que, contrairement aux calvinistes du XVIIe s., nous ne croyons plus en une vie après la mort. Cette conscience aigüe du fait que le temps de notre vie est notre unique temps disponible, qu’il n’y aura pas de suite ni de prolongations, pouvait recevoir de multiples réponses et fonder différentes formes de vie. Mais les sociétés modernes tardives ont choisi de donner le primat à ce qu’on pourrait appeler un ethos accumulatif, c’est-à-dire qu’elles ont décidé de définir la « vie bonne » (une vie qui a valu la peine d’être vécue au moment où elle prend fin) dans ces termes : « profiter à un rythme accéléré des diverses opportunités du monde20 ». Notre conception de la vie bonne est celle d’une vie au cours de laquelle nous épuisons tous les possibles qu’offre le monde, et où nous multiplions et intensifions les expériences par unité de temps, quelle que soit l’unité de temps choisie : un week-end, une période de vacances, une année et finalement une vie. Mais ce qui est intéressant dans cette conception accumulative de la vie bonne, c’est qu’elle conduit d’elle-même à une accélération du rythme de la vie de tous les jours, au motif qu’« il est possible de réaliser d’autant plus de possibilités que l’on brûle les étapes, que l’on en traverse rapidement les épisodes ou les événements individuels21 ». Si nous accélérions indéfiniment le rythme de nos existences, nous serions forts d’une infinité d’expériences accumulées dans le temps fini de nos vies, ce qui de fait signifierait que nous aurions triomphé de la mort. En d’autres termes : pour quiconque se rendrait infiniment rapide dans l’accumulation d’actions et d’expériences en tout genre (lectures, films, expériences sexuelles, relations sentimentales, voyages, réalisations diverses, réussites professionnelles, etc.) « la mort, comme annihilation des options, ne [serait] plus à craindre22 ». L’impératif éthique postmoderne pourrait donc s’énoncer à peu près comme suit : deviens infiniment rapide et tu seras immortel.
4.
On s’aperçoit que l’accélération du rythme de vie dans nos sociétés actuelles n’obéit pas uniquement à une explication économique. À en croire Hartmut Rosa, elle est aussi la réponse spécifique de la modernité tardive ou de la postmodernité « au problème de la finitude et de la mort », à telle enseigne qu’on peut y voir « un équivalent fonctionnel à la promesse (religieuse) de vie éternelle23 ». Il est évident que cet impératif éthique (ou cette stratégie inconsciente) d’effacement de notre mortalité à travers l’accélération du rythme de vie est condamné à échouer. Non seulement parce que nous mourrons tôt ou tard, mais aussi parce – comme on l’a indiqué – l’accélération technique et celle du changement social démultiplient les possibilités de se saisir d’options vitales en même temps qu’augmentent de façon exponentielle la quantité d’options à saisir (d’expériences à thésauriser, d’endroits où voyager, de gastronomies à découvrir ou de partenaires sexuels à rencontrer, etc.). C’est pourquoi nous vivons constamment avec le sentiment que nous n’embrassons pas tout le champ des possibles, que « nous n’y arrivons pas », c’est-à-dire que nous n’accédons pas à toutes les expériences que nous serions en droit de faire par unité de temps : avant la fin de la semaine, la fin de l’été ou de l’année, avant nos quarante ou nos cinquante ans, et in fine avant de mourir.
Mais ce qui compte pour notre démonstration c’est moins l’échec inévitable de cet impératif que l’impression d’étrangeté que laissent cette éthique et sa conception accumulative et accélérée de la vie bonne. D’où provient-elle ? Et pourquoi la société postmoderne a choisi cette orientation éthique ? En comparant les idées de Hartmut Rosa avec celle de Max Weber, on a tracé quelques pistes permettant de répondre à ces questions.
Peut-être que ce qui est jeu c’est que nous ne nous sommes pas complètement affranchis de la vieille éthique protestante. L’« ascétisme intramondain » paradoxal du XVIIe s. qui exigeait d’accumuler de la richesse et simultanément interdisait de jouir était une réponse à l’angoisse de la perspective d’une condamnation éternelle. Au XXe s., notre compulsion à accumuler des expériences de façon accélérée est une réponse à l’angoisse que provoque en nous la certitude de la mort. Si on admet ce parallèle, on peut en conclure que Calvin n’est pas aussi loin de nous que nous le croyons ou que nous aimerions le croire ; et peut-être nos vies sont-elles encore régies par cet étrange et paradoxal calvinisme de la jouissance accumulative et accélérée des options vitales.
Si nous revenons au point de départ de nos développements, nous disions que parmi les changements culturels dont on a besoin pour favoriser un changement social profond (dont on a aussi besoin), un certain nombre de choses touchent à l’éthique. Parmi elles, il faudrait inclure ce besoin d’envisager à nouveaux frais notre rapport à ce que la philosophie a coutume d’appeler « finitude » et que nous devrions appeler par son nom sans user de tant d’euphémismes : la mort. Mais tous les philosophes qui ont réfléchi un tant soit peu sérieusement sur le sujet savent que parler de notre rapport à la mort revient à parler de notre rapport à la vie24. De sorte que ce dont nous avons le plus besoin, peut-être, c’est d’une conception de la vie bonne moins accélérée et moins compulsivement accumulative.
Références bibliographiques
- Crompton, R., 1993, Class and Stratification. An introduction to current debates, Cambridge, Polity Pres.
- Fanjul, S., 2022, “El increíble caso del superventas menguante”, El País, 3-05-2022, URL : https://elpais.com/cultura/2022-05-03/el-increible-caso-del-superventas-me guante.html
- Lipovetsky, G., 2004, Les Temps hypermodernes, Paris, Grasset.
- Marx, K., 1993, Le Capital, Livre i, Paris, PUF.
- Nietzsche, F., 2006, Ainsi parlait Zarathoustra, Paris, GF.
- Nietzsche, F., 2022, Par-delà le bien et le mal, Paris, GF.
- Rosa, H. 2010, Accélération. Une critique sociale du temps, Paris, La Découverte.
- Rosa, H. 2012, Aliénation et accélération, Paris, La Découverte.
- Rosa, H. 2018, Résonance, Paris, La Découverte. Éd. numérique Facompo.
- Sennett, R., 2000, Le Travail sans qualités. Les conséquences humaines de la flexibilité, Paris, Albin Michel.
- Tugendhat, E., 2001, « Über den Tod », Aufsätze 1992-2000, Francfort, Suhrkamp.
- Weber, M., 1964, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon. Ed. numérisée pour la collection « Les classiques des sciences sociales » de l’UQAC. URL : http://classiques.uqac.ca Weber, M., 2003, Le Savant et le politique, trad. Catherine Colliot-Thélène, Paris, La Découverte.
Notes
- Weber, 1964, p. 28. On indique la pagination de la traduction de 1964 numérisée en PDF et réalisée pour la collection « Les classiques des sciences sociales » de l’UQAC. URL : http://classiques.uqac.ca
- Ibid., p. 39.
- Cf. « Mais, surtout, cette éthique est entièrement dépouillée de tout caractère eudémoniste, voire hédoniste. Ici, le summum bonum peut s’exprimer ainsi : gagner de l’argent, toujours plus d’argent, tout en se gardant strictement des jouissances spontanées de la vie. L’argent est à ce point considéré́ comme une fin en soi qu’il apparaît entièrement transcendant et absolument irrationnel sous le rapport du « bonheur » de l’individu ou de l’« avantage » que celui-ci peut éprouver à en posséder. » Ibid, p. 28.
- Confession de Westminster, cité par Weber, 1964, p. 64-65.
- Ibid., p. 73-74.
- Cette explication de l’origine du capitalisme est complémentaire, mais non antagonique, de celle de Marx exposée au chapitre du Livre premier de Le Capital consacré à l’« accumulation initiale ». L’enclosure des terres communales au début de l’Époque moderne y est mise en rapport, comme on sait, avec la formation d’une classe prolétaire issue de l’ancienne paysannerie. Cf. Marx, 1993, Livre I, chap. XXIV.
- Weber parle en effet de « l’effet sécularisateur de la possession », cf. Weber, 1964, p. 136.
- Ibid., p. 140.
- Ibid., p. 141.
- Ibid., p. 142. L’expression « derniers hommes » fait référence aux idées exposées par Nietzsche au § 5 du Prologue de Ainsi parlait Zarathoustra : le « dernier homme » correspond au type anthropologique du monde moderne, depuis le bourgeois du XIXe s. jusqu’à nous. Il s’agit de l’homme qui refuse de se dépasser vers une figure supérieure (surhomme) et qui se laisse guider par ce que Nietzsche appelle les « idées modernes » (cf. par exemple dans Par-delà le bien et le mal, § 253 et tout le chapitre IX). C’est-à-dire par un certain idéal du progrès social, d’égalitarisme démocratique, la recherche individuelle des plaisirs, et finalement par la conception moderne du bonheur. L’incontestable filiation nietzschéenne de cette référence wébérienne trouve confirmation dans cet autre écrit important qu’est la conférence de 1917 intitulée « La profession et la vocation de savant » ; Weber y fait mention de « la critique dévastatrice que Nietzsche a faite de ces “derniers hommes” qui ont “inventé le bonheur” ». Cf. Weber, 2003, p. 89.
- Rosa, 2012, p. 17.
- Rosa, 2010, p. 98.
- Pour désigner notre époque, Hartmut Rosa emploie généralement le terme de « modernité tardive » (Spätmoderne) en lieu et place de « postmodernité ». Et ce, parce que notre époque par rapport à la modernité classique ne se caractériserait pas tant par l’irruption de structures sociales complètement nouvelles que par la radicalisation des structures déjà existantes. Sur cette décision terminologique : cf. Rosa, 2010, p. 28-36. Pour des raisons similaires, le sociologue français Gilles Lipovetsky préférait déjà le terme d’« hypermodernité » à celui de « postmodernité » dans Les Temps hypermodernes (2004).
- Richard Sennett analyse les conséquences de ces changements dans le monde du travail sur la vie personnelle dans son ouvrage, bien connu, Le Travail sans qualités. Les conséquences humaines de la flexibilité (2000).
- On peut trouver des données empiriques à l’appui de cette accélération de la vie quotidienne dans Rosa, 2010, chap. 6 « L’accélération du rythme de vie et les paradoxes de l’expérience du temps », p. 151-183. Outre les power nap, speed dating, speed reading, drive-through-funerals (pratiques dont la dénomination en anglais tient au fait que, d’après Rosa, les États-Unis restent les pionniers en termes d’accélération sociale), il faut ajouter à cette liste déjà longue la tendance à réduire la durée des symphonies et la représentation des œuvres théâtrales, ou celle des émissions de radio et de télévision, et même des annonces publicitaires dont la durée moyenne est passée de trente secondes dans la années 70 à cinq actuellement. Ces changements sont à mettre en rapport avec le temps d’attention toujours plus bref face à son téléviseur : certaines études montrent que l’on peut changer de chaînes toutes les trois secondes. Le temps de sommeil a connu lui aussi une réduction d’une trentaine de minutes depuis les années 70 et d’à peu près deux heures tout au long du XXe s., même si ce processus admet des explications d’un autre ordre, non liées à l’accélération du rythme de vie mais à la diminution du temps de travail physique intense dans les sociétés post-industrielles. Mentionnons pour finir ce curieux constat établi récemment dans la presse : en ce qui concerne les États-Unis à tout le moins, les best sellers voient eux aussi leur nombre de pages diminuer. Cf. Fanjul, S.,“El increíble caso del superventas menguante”, El País [en ligne], 3/05/2022.
- Rosa, 2010, p. 147-148. L’image de la « roue du hamster » apparaît par exemple dans Rosa, 2018, p. 40.
- Cf. « Les économies capitalistes dépendent structurellement du fait que le processus de circulation du capital, non seulement ne s’interrompt jamais, mais s’accélère sans cesse et alimente ainsi la spirale de croissance. ». Rosa, 2018, Partie iv, chap. 13. Marx avait déjà fait une observation similaire sur le capitalisme, même s’il isole sa contrainte fonctionnelle d’abord comme accumulation de capital plutôt que comme accélération du processus productif : « Le développement de la production capitaliste fait de l’accroissement constant du capital placé dans une entreprise industrielle une nécessité, et la concurrence impose à chaque capitaliste individuel de se soumettre à la contrainte extérieure des lois immanentes du mode de production capitaliste. Elle contraint à étendre sans cesse son capital pour le conserver, et il ne peut l’étendre qu’au moyen d’une accumulation progressive. » Marx, 1993, p. 663-664.
- Cf. « Le non-respect des impératifs d’accroissement entraîne des risques de perte d’emplois et de faillites d’entreprises qui vont de pair avec une baisse des recettes publiques (due à une diminution des revenus fiscaux) et une hausse des dépenses sociales (liée au chômage), lesquelles peuvent conduire à des crises du budget ou de la dette et, par effet de ricochet, à une crise du système politique. » Rosa, 2018, Partie IV, chap. 13.
- Sur la stratification des sociétés actuelles, cf. Crompton, 1993.
- Rosa, 2010, p. 223.
- Ibid., p. 224. Trad. légèrement modifiée.
- Ibid., p. 225.
- Rosa, 2012, p. 38-40.
- Tugendhat, 2001.