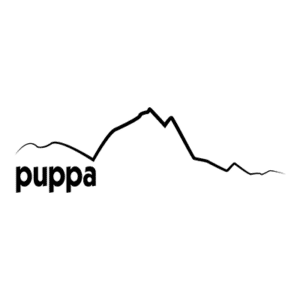Presses universitaires de Pau et des pays de l’Adour (PUPPA)
Les Presses Universitaires de Pau et des Pays de l’Adour (PUPPA) publient des travaux de haut niveau scientifique. Elles développent la production de livres de référence au sein du monde universitaire et participent au rayonnement scientifique et littéraire de l’Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA).