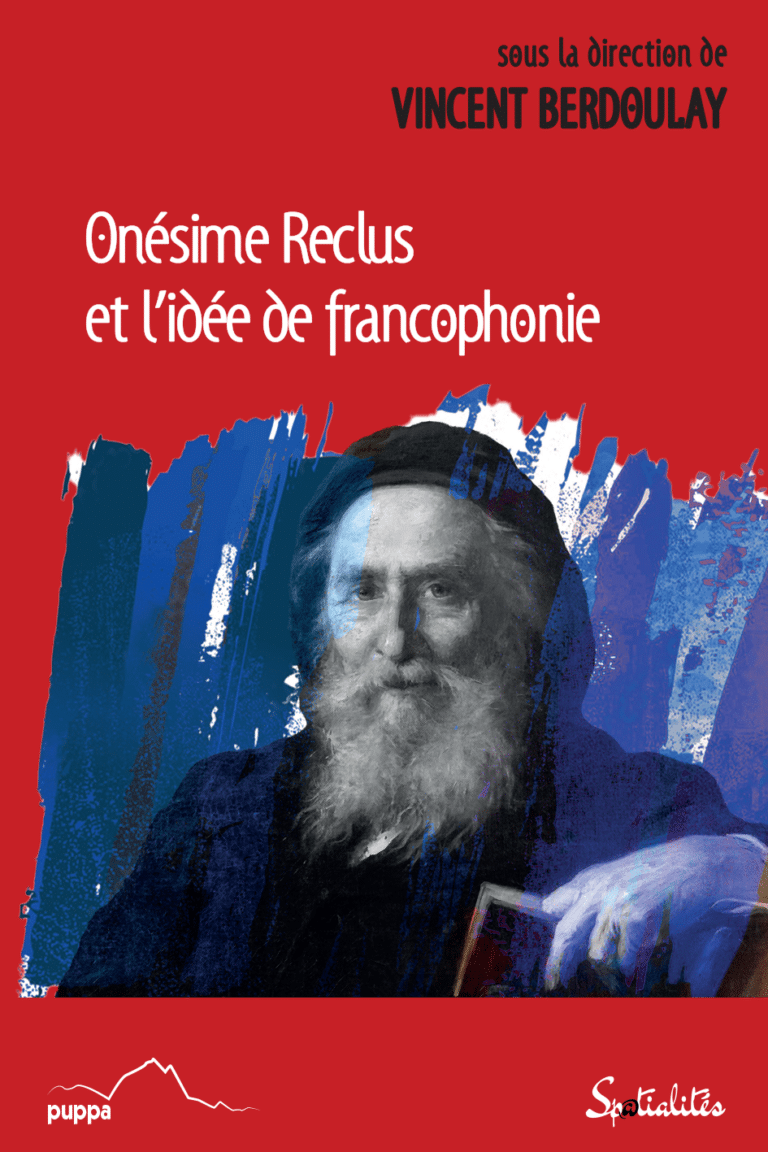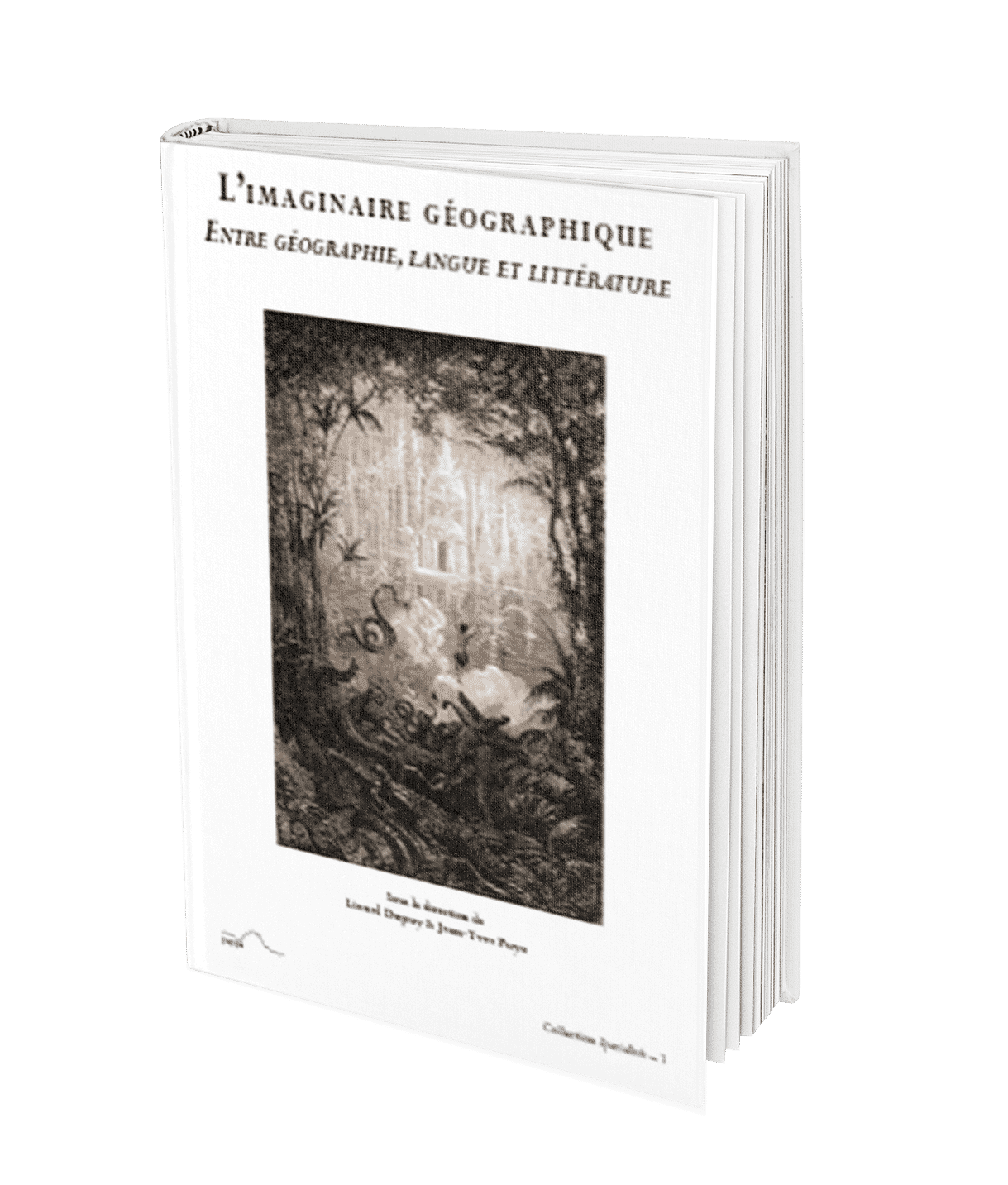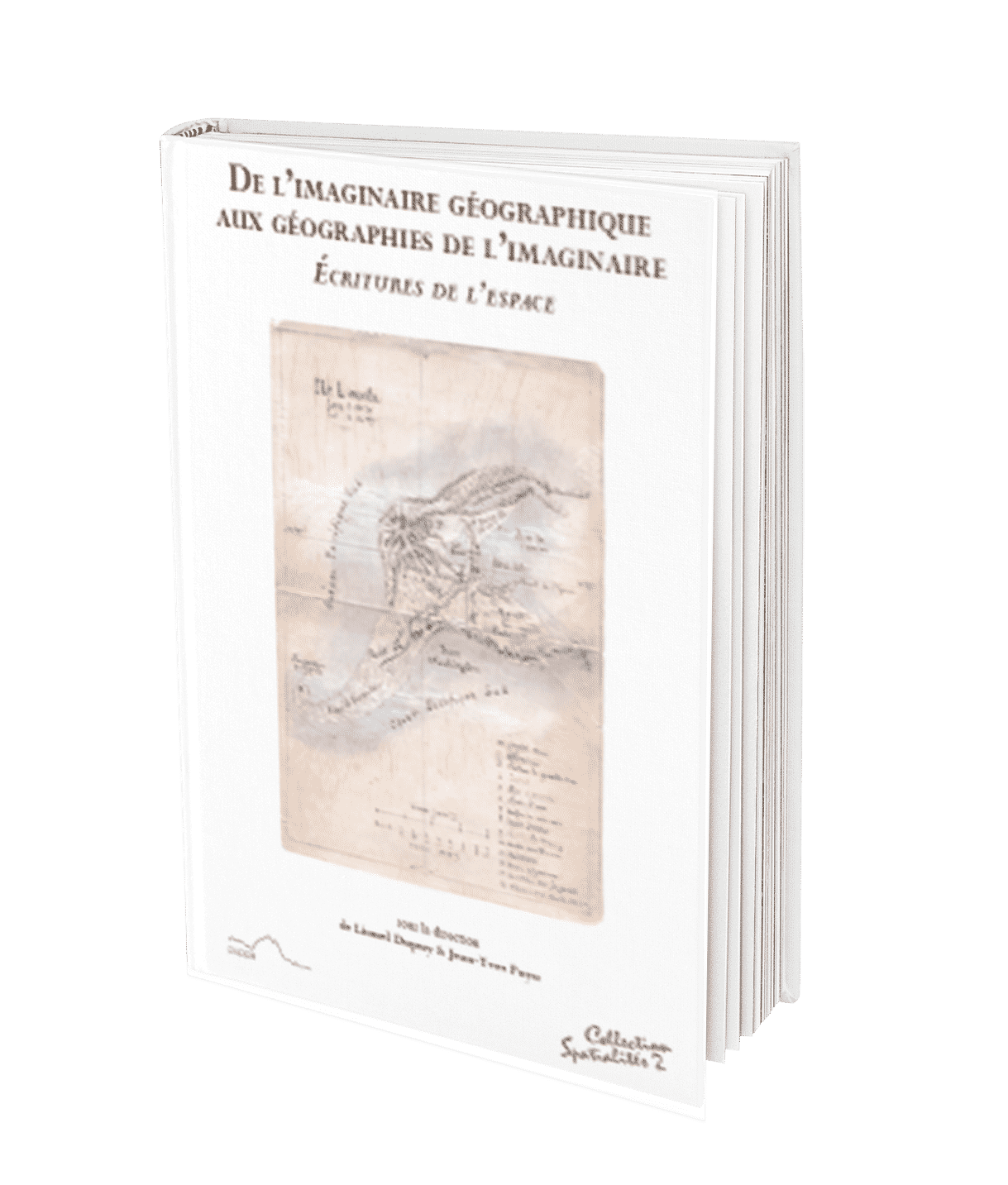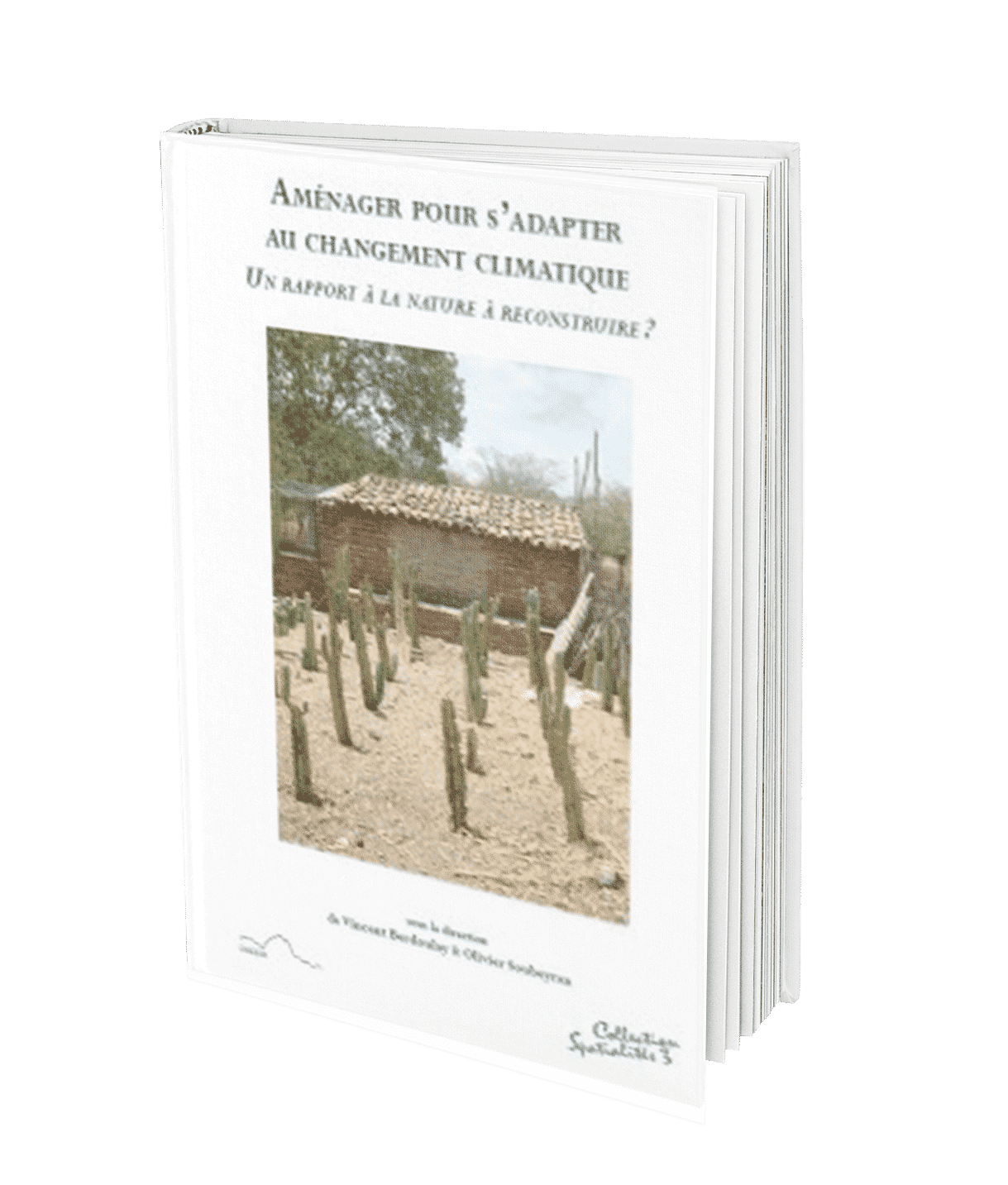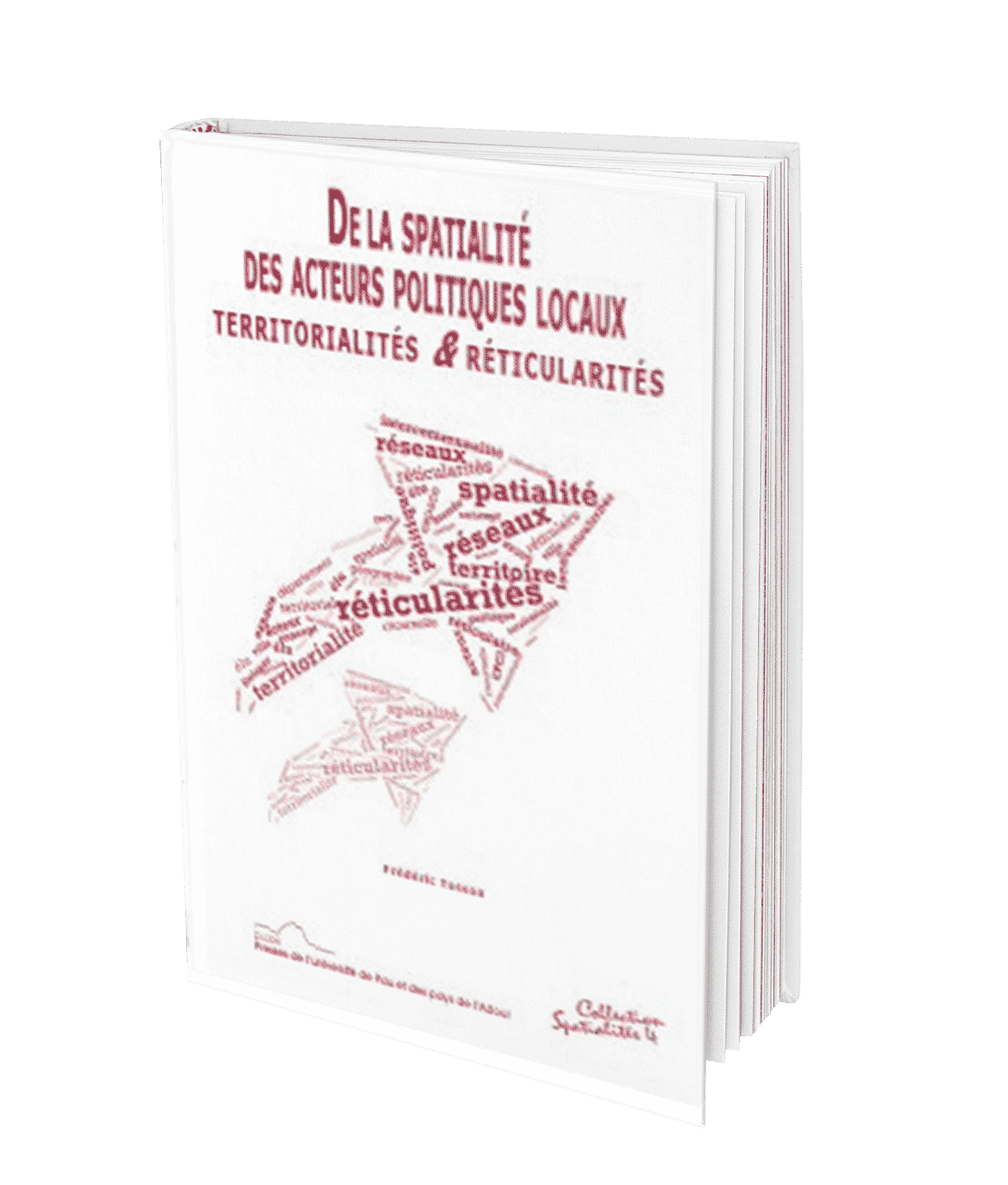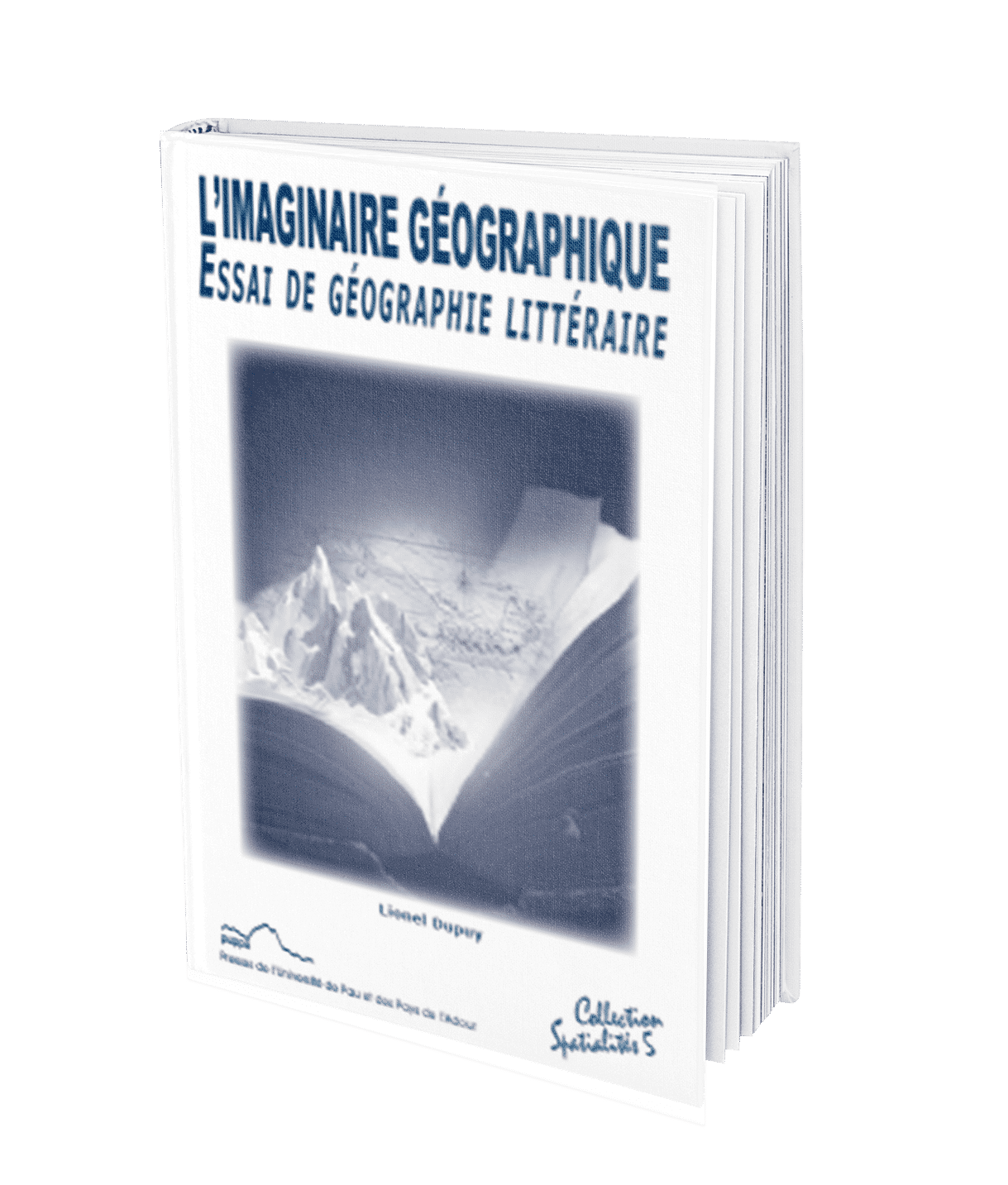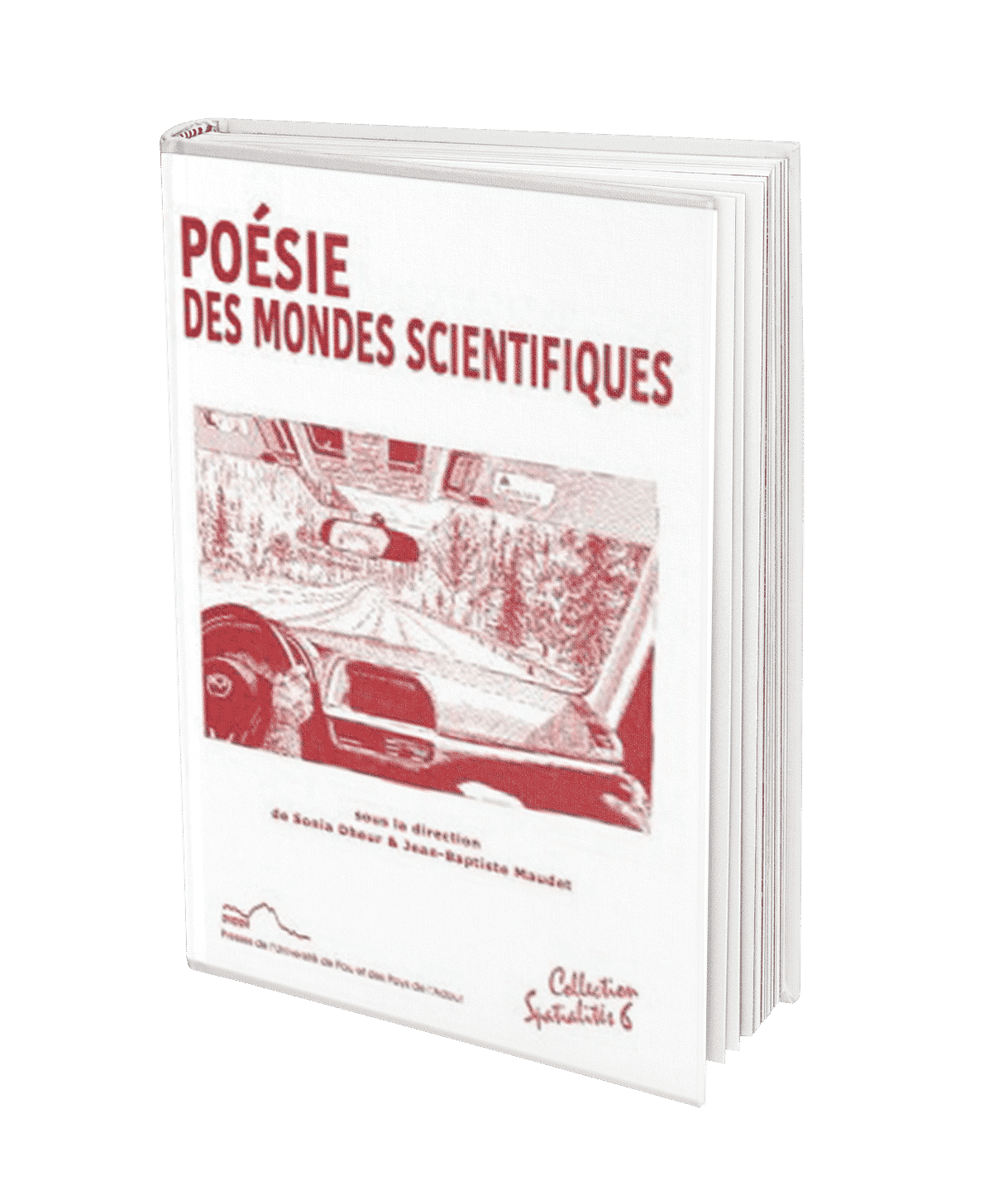Introduction
Onésime Reclus était un amoureux de la langue – et pas seulement du français –, ce qui le portait non seulement vers les œuvres littéraires dont il pouvait réciter par cœur de longs passages, mais aussi un goût irrépressible pour la création de néologismes. Ceux de francophone et francophonie ont en particulier connu le succès que l’on sait, ainsi que ceux concernant d’autres mondes linguistiques : hispanophone, lusophone, germanophone, etc. Ces termes ont d’ailleurs été importés dans d’autres langues où ils concurrencent partiellement d’autres dénominations, tel le mot anglophone plutôt que English-speaking en anglais. Mais les importations dans d’autres langues ne correspondent pas nécessairement à ce que francophone ou francophonie peuvent désigner ou connoter chez les divers utilisateurs de la langue française. En effet, les traits sémantiques de ces termes ont commencé à se dessiner dès sa création sous la plume d’Onésime Reclus.
Il faut se rendre compte que cette invention terminologique s’inscrit dans une préoccupation déjà existante. C’est que croissait alors l’inquiétude causée par la baisse de la natalité en France, remarquable exception parmi les grandes puissances de l’époque qui connaissaient, au contraire de ce pays, une croissance spectaculaire de leur population. Bénéficiant longtemps d’une supériorité démographique sur ses voisins, la France faisait ainsi figure de pays en déclin, sentiment partagé par une partie de ses habitants, face à des pays concurrents, voire menaçants. De plus, ceux-ci nourrissaient une importante migration vers les anciennes colonies européennes d’Amérique, qui pour l’essentiel n’étaient pas de langue française, appelées ainsi à accroître leur importance. Corrélativement, à mesure que les autres langues s’affirmaient, l’usage élitiste du français – ou du moins sa connaissance – hors de France se trouvait menacé et en déclin relatif. Ainsi, l’affaiblissement démographique affectant les locuteurs du français devenait-il un enjeu politique, économique et culturel. Mais il était aussi, bien évidemment, géographique, et notamment géopolitique.
C’est pourquoi la France, alors seul grand État à même de prendre en charge le défi ainsi posé, vit se créer plusieurs initiatives pour valoriser une langue dont la vitalité jusque-là semblait aller de soi. Le chapitre 1 montre l’émergence de l’idée de francophonie (sans que le terme ne soit mis en avant) comme projet à la fois national et international, afin de maintenir et développer la connaissance du français à l’étranger. L’Alliance française en est une illustration toujours bien connue, mais la politique d’influence par le moyen de la coopération universitaire l’est moins, alors que ce fut une innovation largement copiée depuis dans d’autres pays.
Ce qui est notable, c’est que cette politique française de développement de la francophonie ne s’est quasiment pas appuyée sur celui de la colonisation ultramarine. Pourtant, le mouvement colonial, auquel l’adhésion des Français fut longtemps minoritaire, faisait miroiter à ses partisans la possibilité d’accroître le nombre de locuteurs de leur langue. Cependant, l’expansion coloniale qui fut entreprise durant la seconde moitié du XIXe siècle s’inscrivait principalement dans une concurrence entre États pour se réserver des territoires d’influence là où cela leur paraissait encore possible. Le souhait de certains de favoriser dans ces territoires la connaissance du français à travers l’enseignement fut loin d’être exhaussé, et ce, malgré leur appel répété à aller en ce sens. Le caractère récent des colonies, la lente occupation et le faible encadrement des territoires négociés sur les cartes ont permis à ces partisans de garder espoir jusqu’à l’aube du XXe siècle, avant que les désillusions ne puissent l’emporter. C’est dans ces circonstances que la géographie demeure au cœur des enjeux, par les territoires et populations concernées, et par l’expertise développée par ses praticiens. Pierre Foncin, cofondateur et animateur de l’Alliance française, et grand partisan de la colonisation, était aussi un géographe reconnu, y compris en matière d’aménagement de l’espace national.
Cette dimension géographique apparaît aussi nettement chez Jules Verne, comme le montre le chapitre 2. Sa préoccupation pour la diversité des langues de France, et son regard globalement bienveillant à leur égard, dessinent une francophonie en creux. Elle témoigne bien d’un enjeu posé à la francophonie qui, en France, se déployait alors dans un contexte de multilinguisme, trop oublié aujourd’hui, et vis-à-vis duquel les attitudes pouvaient être très différentes. Cela attire aussi l’attention sur la définition d’un francophone, personne qui n’a pas nécessairement le français comme première langue apprise, voire d’usage quotidien. Le détour par la géographie de Jules Verne, réputé pour ses romans, rappelle combien la francophonie peut solliciter l’imaginaire par son ouverture au monde, ce sur quoi reviendra la Partie II. Et ce, d’autant plus que l’intérêt de Jules Verne pour la technique relevait plus de la fascination que de la foi dans les bienfaits qu’elle est censée apporter : on trouve aussi un écho de ce scepticisme chez Onésime Reclus.
Comment celui-ci s’est-il inséré dans l’écheveau des idées, des actions, des initiatives qui avaient alors cours ? C’est le but du chapitre 3 que de montrer la géographie de cette insertion, par le biais de la mise en évidence des lieux et des cercles d’affinité qui ont conditionné le développement de sa pensée. Celui-ci a abouti à établir un lien fortement argumenté entre diagnostic géographique et avenir de la francophonie. Ce chapitre est aussi l’occasion de prendre connaissance du style d’écriture d’Onésime Reclus qui aujourd’hui peut surprendre, voire choquer, tant il sacrifiait alors à la rhétorique du publiciste qui vivait de sa plume.