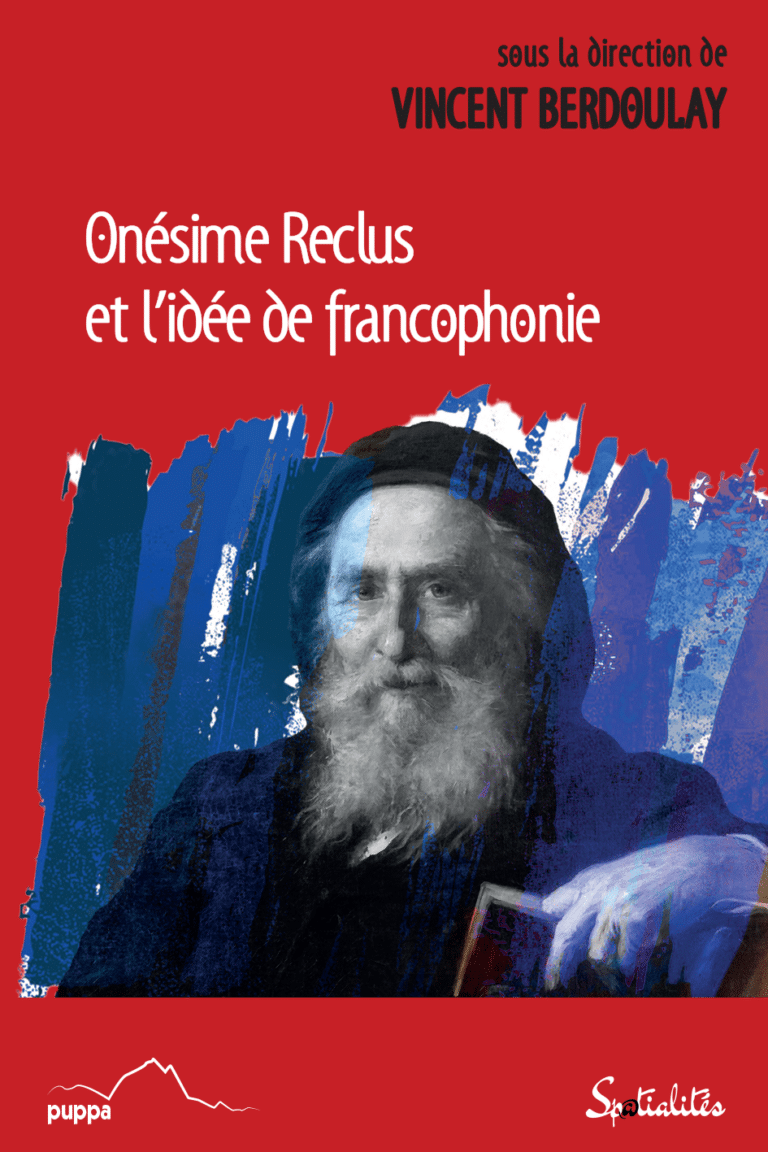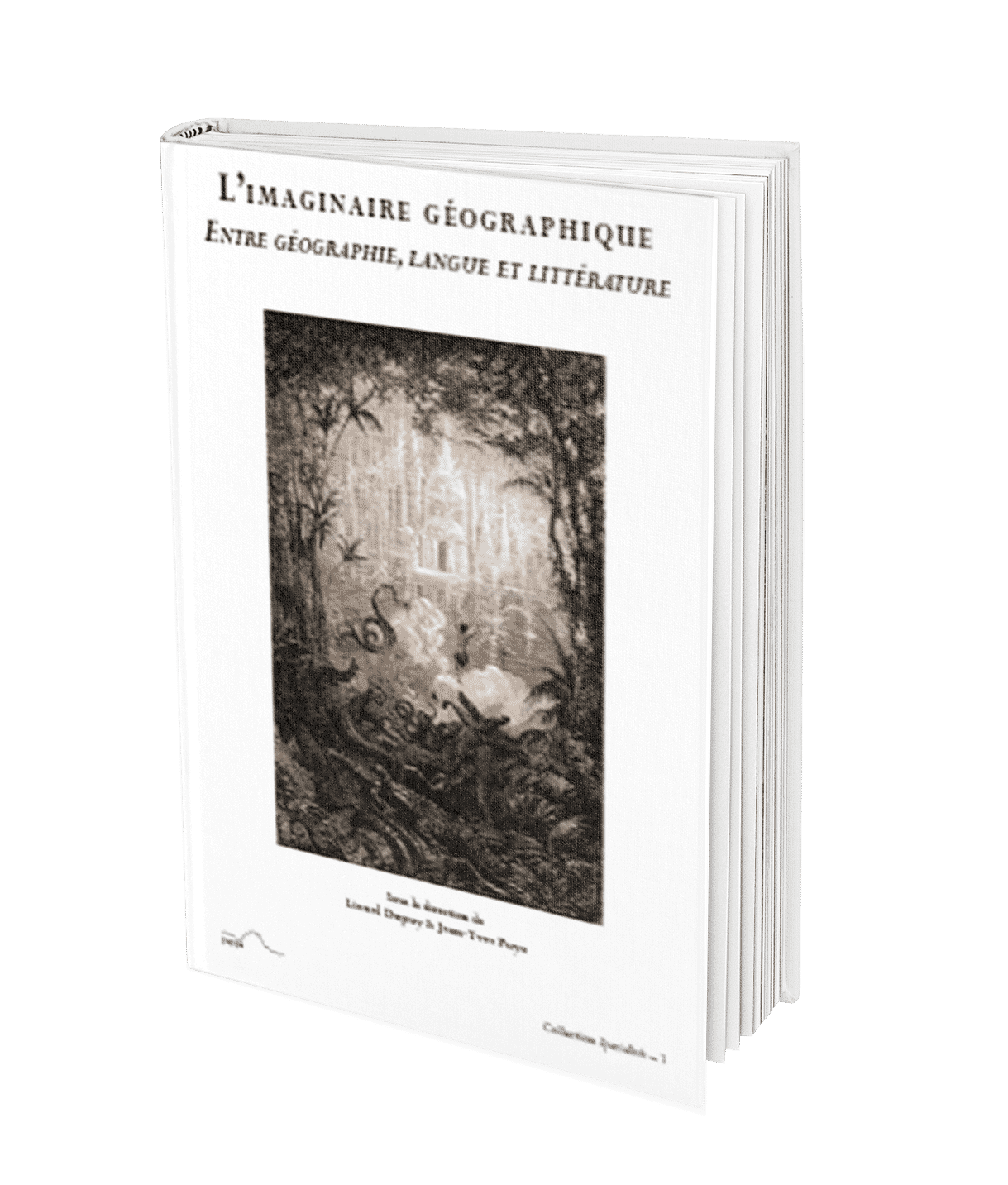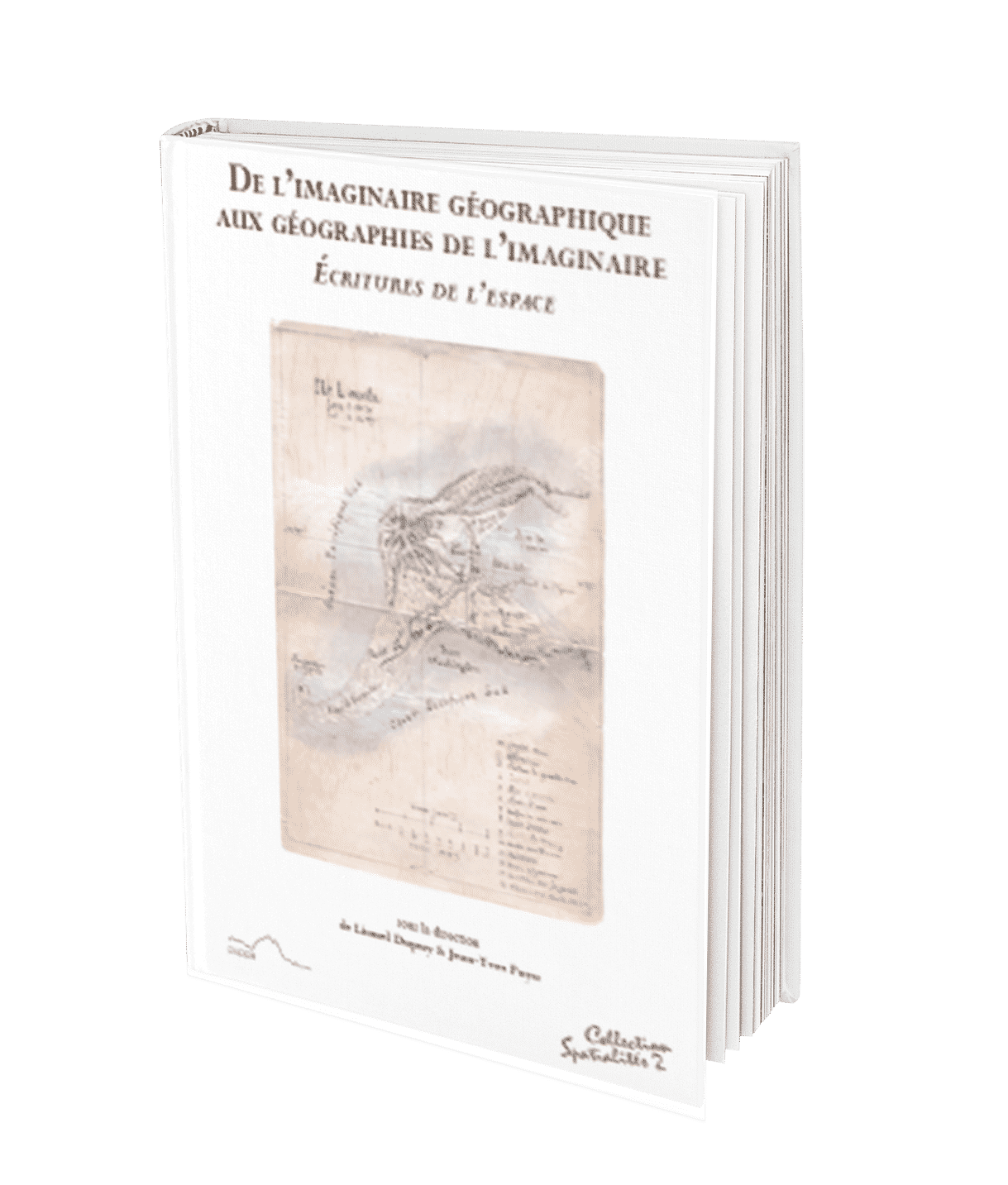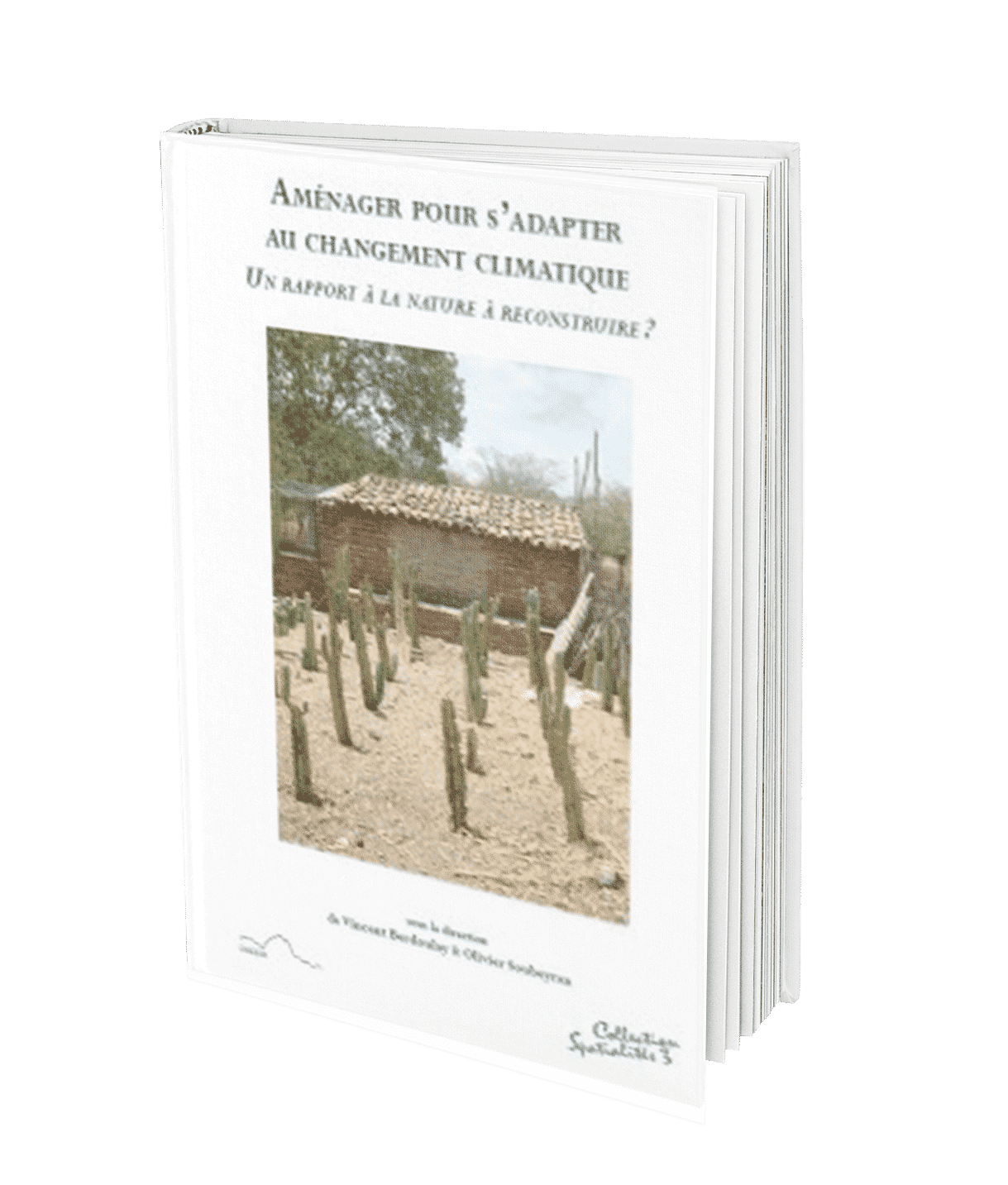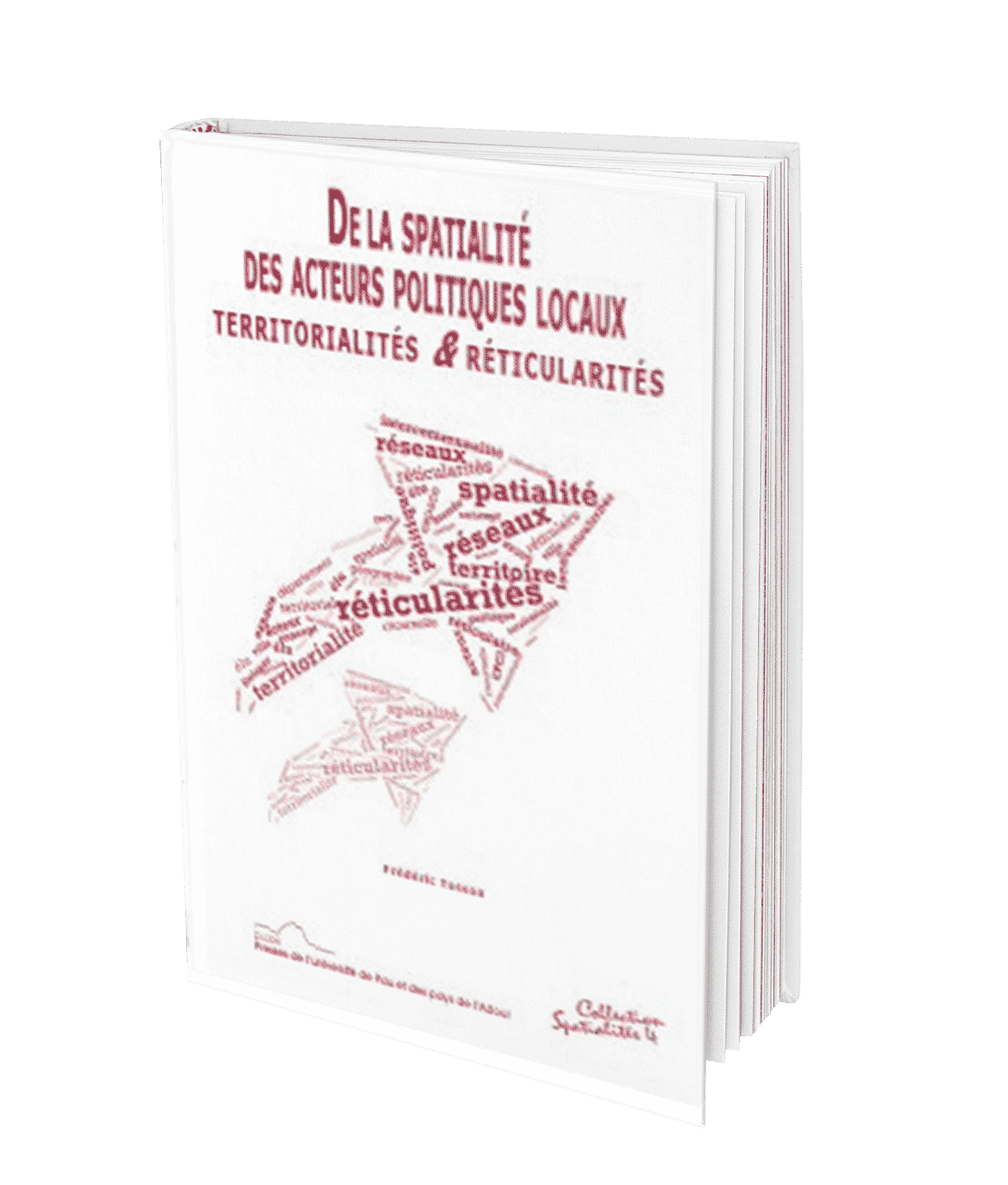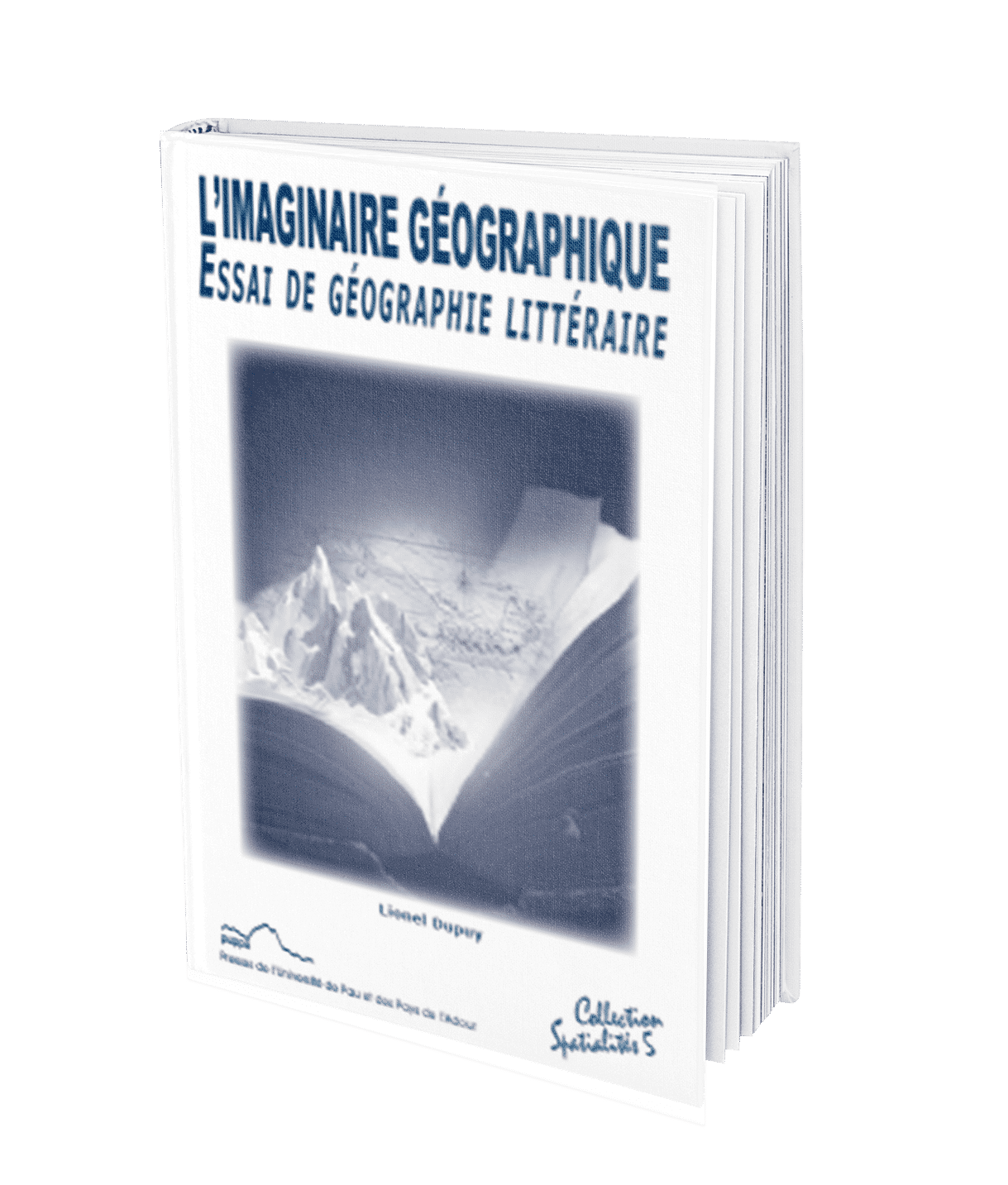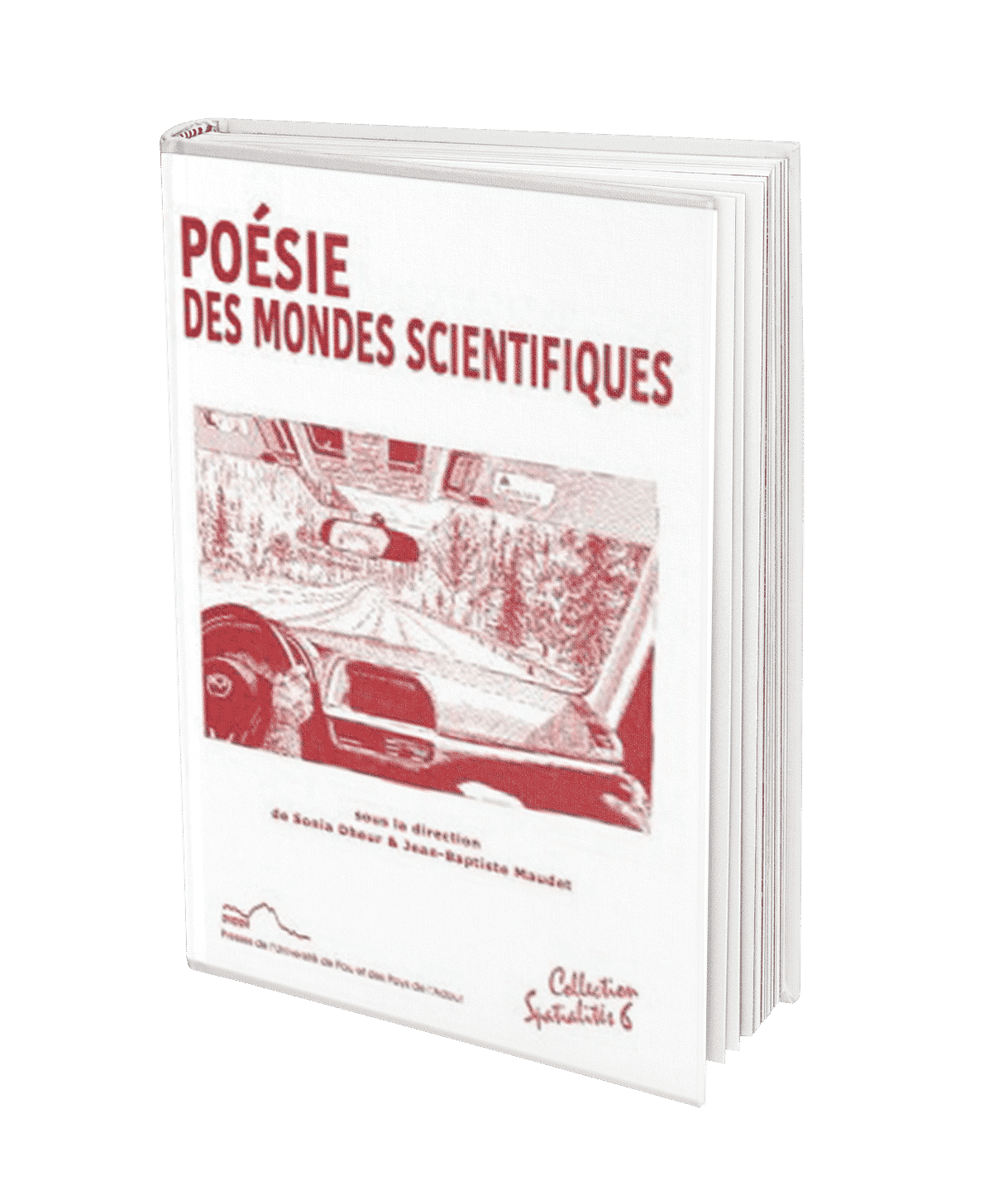Longtemps, l’origine du mot de francophonie fut attribuée à Léopold Sédar Senghor avec son article paru dans la revue Esprit en novembre 1962 – un dossier consacré à la langue et l’enseignement du français1. Alors, dans ce début des années 1960, la Francophonie devint, par l’entremise de certains leaders africains du moment (Habib Bourguiba, Barthélémy Boganda, Hamani Diori), la tentative d’une partie des élites de la nouvelle Afrique francophone afin de constituer une forme unité politico-culturelle désireuse de mieux négocier avec l’Europe. Pourtant, il faut remonter bien plus haut dans le temps, dans le dernier tiers du XIXe siècle, pour trouver les premiers linéaments sérieux de la réflexion sur la francophonie. Le publiciste Onésime Reclus, en 1880, dans son ouvrage France, Algérie et colonies, utilise le mot afin d’évoquer en effet, le projet d’un développement d’un espace francophone grâce à l’empire colonial à l’orée de sa pleine expansion. Plus largement, le projet de créer un espace culturel et linguistique francophone d’influence prend tout son sens sur un fond d’inquiétude quant au déclin progressif de la France et de sa langue. En 1868, Anatole Prévost-Paradol dans La France nouvelle, pronostiquait une montée inexorable du monde anglo-saxon (États-Unis et Australie) et la défaite de 1870 vint accroître ce sentiment de déclin. On entend alors une longue série de déplorations, plus ou moins justifiées, où sont dénoncées la faible émigration, la méconnaissance géographique du monde.
Or, les trente dernières années du XIXe siècle seront celles d’une expansion mondiale continue, qu’il s’agisse du renouveau de la conquête coloniale à partir de 1881 (Tunisie), d’une projection accrue des capitaux français à l’étranger (empires russe et ottoman) et d’une action résolue pour soutenir la langue et la culture française dans le monde de la part des élites culturelles. On le voit, le projet d’établir une nouvelle influence culturelle francophone (soft power) accompagne en parallèle la tentative de renforcer la puissance politique, économique et militaire française (hard power). Nous nous attacherons ici à reconstituer les principales lignes de cette mondialisation française de la fin du XIXe siècle à forte teneur culturelle, avec d’une part des entreprises d’ordre scientifique – l’expansion universitaire – et d’autre part d’ordre linguistique et culturel avec la création en 1883 d’une association culturelle, l’Alliance Française2.
Cet expansionnisme intellectuel déborde assez vite le strict espace colonial et acquiert une dimension mondiale quand l’Alliance française crée, en quelques années, des comités aussi bien en Australie et aux États-Unis qu’en Europe. La Francophonie, de coloniale, devint un projet mondialisé. On a pu décrire le XIXe siècle comme fondé sur une triangulation de trois éléments, l’intégration globale du capitalisme, l’approfondissement de l’État-nation, le culturalisme identitaire3. Avec cette francophonie culturelle et intellectuelle que nous allons évoquer, il faut donc ajouter un quatrième aspect, celui de « l’extraversion » qui est une façon de relier le capitalisme mondialisé, avec son nouveau culte de l’information et la conscience d’un monde global4, et le renforcement de l’État-nation, notamment sur le plan intellectuel. Les deux aspects, en effet, s’avèrent fondamentalement simultanés au XIXe siècle ainsi que l’observèrent aussi bien Marx que Max Weber.
La francophonie vers 1880
Dans le dernier tiers du XIXe siècle, l’espace francophone s’avère, d’une part, essentiellement méditerranéen et supporté surtout par les congrégations catholiques, et d’autre part, un peu américain par le biais d’élites culturellement francisées.
La Méditerranée orientale et la montée depuis 1840 d’un projet francophone5
Tout au long du XIXe siècle, l’espace est et sud-méditerranéen est l’objet d’une lutte entre plusieurs puissances européennes. La domination impérialiste est d’ordre économique parfois, politique et culturelle toujours. Ainsi la France exerce, depuis les années 18606 (après ses interventions militaires durant la guerre de Crimée et au Liban) une pression culturelle constante sur la partie est du bassin méditerranéen (Égypte, Syrie et Liban surtout) au sein de ce qui était alors l’empire turc. Jusqu’au deuxième tiers du XIXe siècle, la langue italienne avait joué le rôle de lingua franca depuis le XVIIe siècle, portée par les missions catholiques franciscaines venues d’Italie, et les communautés de commerçants italiens à Smyrne ou à Alexandrie. Puis, le basculement progressif se fit en faveur du français grâce à l’implantation continue de trois réseaux d’établissements scolaires (catholique, juif et laïc), différents dans leur inspiration morale certes, mais aidés par le gouvernement français de manière indifférenciée (« Œuvres d’Orient » du budget du ministère des Affaires étrangères). Cette domination culturelle francophone (à Istanbul, le principal journal allemand était rédigé aux 2/3 en français au début des années 1900) n’est pas forcément accompagnée d’une supériorité politique (l’Angleterre l’emporte en Égypte après 1882) ou commerciale (l’Allemagne est le principal partenaire économique et commercial dans l’empire turc à la veille de 1914). Et même sur le plan culturel, la concurrence se fit de plus en plus rude avec les Missions protestantes anglo-saxonnes, les Russes orthodoxes ou les congrégations catholiques italiennes. Toutefois, le cœur de cette prééminence du français au sein de la région reposait sur la présence de réseaux d’enseignement fort actifs.
On trouvait tout d’abord celui des congrégations enseignantes catholiques, masculines et féminines françaises, qui se développèrent essentiellement après 1860. La France disposait en effet à la fin du XIXe siècle des 2/3 des missionnaires catholiques dans le monde, soit 20 000 personnes (et non 50 000 comme l’affirmèrent longtemps les brochures et publications variées). Un deuxième réseau fut celui de l’Alliance israélite universelle, association créée en 1860 (5 écoles et 680 élèves en 1865 ; 183 écoles et 43 700 élèves en 1914) avec des points forts situés au Maroc, mais aussi à Salonique, Istanbul et Alexandrie. Par fascination du modèle de l’universalisme français, elle avait choisi d’utiliser le français pour scolariser ses publics du pourtour méditerranéen. Le troisième réseau scolaire reposait sur un pilier laïc incarné par une association, La Mission laïque, créée en France en 1902 et qui ouvrit son premier lycée à Salonique en 1906. Enfin, il faudrait citer le rôle de l’Alliance française qui ne possédait pas d’écoles propres, mais qui adressait des subventions aux écoles francophones, essentiellement celles tenues par les congrégations catholiques. Enfin, la reprise de l’élan colonial en Tunisie vint accélérer la présence culturelle et politique française dans l’espace méditerranéen. Le protectorat qui y fut imposé en 1881 se heurta à la présence d’une forte communauté italienne de 20 000 personnes (800 Français seulement se trouvaient là). Le recours au réseau de l’Alliance israélite universelle (avec une organisation originale en « comités » et « sous-comités » qui impressionne7) et à celui des congrégations enseignantes françaises sous la houlette du Cardinal Lavigerie fut mis en œuvre pour compenser la faible présence du français dans la société locale. Mais la nécessité d’un autre organisme culturel, plus neutre, se fit sentir ; elle engendra alors la fondation de l’Alliance Française en 1883.
Cette nouvelle association envoie des fonds pour aider divers établissements francophones tunisiens en même temps qu’elle commence à agir en Algérie. L’Alliance française se révèle en effet très liée à la cause coloniale ; son Secrétaire général, véritable dirigeant officieux de l’association, le géographe Pierre Foncin, l’un des acteurs centraux de l’institutionnalisation de la géographie universitaire après 18708, fut également l’un des acteurs importants du parti colonial, au titre de vice-président de l’École coloniale notamment.
Un autre acteur de l’Alliance, l’économiste Charles Gide, s’écrie en 1885 : « Arabes d’Afrique noire, Noirs du Niger et du Congo, races barbares, nous vous frapperons à notre image ». Foncin, Gide et Onésime Reclus, dans ce début des années 1880, se retrouvent donc très proches dans leur conviction d’une francophonie coloniale à créer.
Or, ce projet échoue totalement en Algérie où les colons s’opposent à la création d’écoles en faveur des populations musulmanes par l’Alliance française9. En 1883, alors qu’un décret décide l’application en Algérie des principes d’obligation et gratuité, y compris pour les jeunes indigènes (mais dans des écoles séparées), les colons s’y opposent immédiatement. Les journaux s’alarment que « 8 jeunes kabyles viennent d’être reçus au certificat d’étude ». Dès lors, les lois Ferry sont sabotées, notamment du fait du refus des municipalités de construire des écoles10. Devant un tel refus, et qui sera durable (1,7 % de scolarisés musulmans en 1892, 5,7 % en 1914, 15 % de scolarisés en 1957)11, l’Alliance a dû capituler. Quant aux autres régions conquises de l’Afrique noire, l’Alliance ne s’y aventure pas. Les congrégations catholiques françaises furent certes présentes par la suite en Afrique de l’Ouest ou en Afrique équatoriale mais, contrairement aux missions catholiques belges au Congo, elles choisirent de ne pas développer d’écoles. Cependant, dans diverses régions du monde existait aussi une francophonie élitiste, héritière de la forte domination du français à la fin du XVIIIe siècle.
Reste du monde : une francophonie des élites demeure
L’Europe des élites restait dans ces années 1880 fortement imprégnée de français, moins peut-être au sein des élites sociales les plus caractérisées (la noblesse russe par exemple), qu’au sein des élites culturelles et scientifiques : le français vers 1900 reste la langue la mieux partagée par les différents savants. Jusqu’aux années 1870-1880, le rôle culturel des gouvernantes/institutrices francophones (suisses parfois) dans toute l’Europe orientale reste une réalité. Mais on trouve aussi en Amérique latine, au Brésil ou en Argentine, une présence culturelle du français que viendra soutenir en 1907 le « Groupement des universités et grandes écoles pour les relations avec l’Amérique latine ». Surtout, dans la mesure où le français avait perdu l’appui automatique des sociétés nobiliaires européennes et puisque les jeunes nations émergentes, en Europe et dans le nouveau monde, avaient besoin de rattraper leur retard en termes de formation intellectuelle, d’autres mécanismes socio-intellectuels et d’autres acteurs pour faciliter l’acculturation au français devaient être mis en jeu. L’Université française et l’Alliance française sont au cœur du renouveau d’influence du français dans la fin du XIXe siècle.
Les nouveaux acteurs de la francophonie dans la fin du XIXe siècle et les nouvelles façons d’influencer autrui
On connaît l’entreprise de renouveau de l’université en France après 1870 afin de forger une Université moderne calquée sur le modèle germanique inventé en 1810 à Berlin : l’alliage de la recherche et de l’enseignement12. Mais il existe un autre volet de cette dynamique modernisatrice qui visait à valoriser auprès de publics étrangers l’excellence universitaire française. La francophonie qui s’invente alors au mitan du XIXe siècle fut aussi une affaire d’universitaires.
Diplomatie universitaire mondiale dans un contexte de mise en place d’un marché universitaire mondial
La mondialisation des échanges au XIXe siècle, l’accélération des échanges intellectuels et artistiques notamment, trouve l’un de ses points d’appui dans la dynamique universitaire du moment. Une logique « d’offre » caractérise les grands pays scientifiques (France et Allemagne au premier chef) et une logique de « demande », celle des plus petits pays. Il est symptomatique que dans cette période de première mondialisation universitaire, un premier classement (avant celui de Shanghai en 2003) des universités apparaît dès 1892 dans la revue allemande Minerva (il classe 147 universités). Au sein du ministère de l’Instruction publique, un petit nombre d’universitaires « modernisateurs » furent à la manœuvre dans le déploiement culturel à l’étranger de l’excellence intellectuelle française. Un premier moment de cette modernisation universitaire intervient à la fin des années 1860 avec le ministre Victor Duruy ; une seconde période se produit dans les années 1875-1880 avec la création en 1875 de la « Société de l’enseignement supérieur ».
Quatre aspects de cette projection mondiale fort bien analysée par la thèse de Guillaume Tronchet peuvent être distingués13. On trouve d’abord la projection d’établissements français à l’étranger (comme l’École française d’Athènes [1846]), puis la création des premiers Instituts français à l’étranger (Florence en 1908, Madrid en 1909, Saint-Pétersbourg en 1912, Londres en 1913) qui furent reliés initialement à une université française. Un deuxième mécanisme touchait l’élévation des compétences scientifiques internes par l’ouverture en direction des autres acteurs scientifiques étrangers – politique d’échange des thèses entre établissements universitaires ; en juillet 1882, 30 universités ont passé contrat avec la France et 40 en 1892 – et par une politique d’organisation de congrès scientifiques. Un troisième mécanisme concernait l’accueil d’étudiants étrangers, le facteur majeur de l’internationalisation universitaire de cette fin de XIXe siècle. En 1866-1867, seulement 500 étudiants étrangers se trouvaient en France. Toute une gamme de mesures intervint en effet pour mettre en place une politique dynamique de l’accueil, des bourses de voyages à l’équivalence de diplômes pour attirer des étudiants étrangers, de la création de diplômes pour étrangers (« Doctorat d’université » créé en 1897 et « Certificat d’études françaises ») à la création de comités d’accueil d’étudiants étrangers (surtout celui de Paris créé en 1890 en même temps que celui de Montpellier, et aussi celui de Grenoble ; il y a 13 comités en 1913) et à la création de cours de vacances (ceux de l’Alliance française en 1894, puis de Grenoble en 1898). Il en résulte une nette augmentation du nombre d’étudiants étrangers. Enfin, un dernier outil de la modernisation de l’université française met en avant l’échange de professeurs ou la réception/envoi de professeurs/lecteurs. En 1904, le ministère de l’Instruction publique signe divers accords pour l’envoi de lecteurs en Grande-Bretagne (1904), puis en Prusse (1905). La création en 1910 de l’Office national des universités et établissements français (ONUEF) permet de centraliser l’offre de postes pour professeurs français à l’étranger (30 personnes en 1913). Des conventions d’échange sont signées entre la Sorbonne et Columbia (1910), puis avec Harvard (1911), Chicago (1912) et Buenos Aires (1913). Or, à côté de l’acteur universitaire, un autre protagoniste de l’action culturelle extérieure rentre en jeu, l’Alliance française.
L’Alliance française, un projet mondial
Nous avons vu précédemment l’insertion initiale de l’Alliance française à l’intérieur du projet colonial « civilisateur », en Tunisie puis en Algérie, et l’échec de cette participation. Cependant, il existe bien un consensus au sein des élites françaises, de droite comme de gauche, afin de favoriser un projet d’expansion culturelle, concurremment au dessein d’expansion universitaire exposé ci-dessus. L’Alliance se réoriente assez aisément vers une action géographiquement beaucoup plus ambitieuse que le simple soutien au projet colonial. Mais les présupposés de cette diffusion mondiale du français et de sa culture sont peut-être les mêmes que ceux qui sous-tendent l’expansion coloniale chez un Onésime Reclus : le français peut être diffusé partout. Mais l’Alliance, par la plume d’Ernest Renan notamment, développe toute une rhétorique sur le « génie » de la langue française, sa clarté, sa simplicité, que tous pourraient potentiellement assimiler avec bonheur. Sans qu’on y prenne garde sans doute, le trait de génie de l’Alliance tient au choix d’un mode de fonctionnement qui repose sur la création, à l’étranger, de comités locaux de droit local (sur le modèle de ceux de l’Alliance israélite universelle). Juridiquement, les alliances dans le monde ne sont pas françaises mais seulement francophones… Nous terminerons cette évocation en faisant un bilan de cette francophonie à la veille de 1914.
Réalités francophones avant 1914
L’Alliance française et sa réussite
Le succès de cette association en une trentaine d’années tient à l’heureuse conjonction et complémentarité d’actions de diffusion du français et de sa culture. Pour la promotion de la langue, l’Alliance s’est appuyée sur les écoles francophones dans le monde (196 en 1912) qu’elle subventionnait, sur la création de sa propre école de langue à Paris (« cours de vacances ») en 1894, sur l’organisation de la première association de professeurs de français à l’étranger (aux États-Unis). Quant à la diffusion de la culture française, elle a eu recours à l’envoi de livres à destination, d’abord, de ses comités qui, parfois, disposaient de riches bibliothèques comme à Smyrne, Chicago (6000 livres) ou San Francisco (26 000). Elle organisa également, dans sa Fédération américaine, de façon pionnière, des tournées de conférenciers.
Au-delà de ces méthodes d’actions, reprises ensuite par le ministère des Affaires étrangères et aussi par la plupart des diplomaties culturelles européennes après 1918, on pourrait établir un bilan de cette francophonie mise en œuvre par l’Alliance française. Cinq points forts peuvent être distingués. Premièrement, l’Alliance personnifia l’unique présence francophone dans de nombreux pays ou régions ; après tout, on ne comptait que 60 Français en Suède et 200 en Bulgarie en 1913. Secondement, elle fut le refuge de minorités francophones plus ou moins actives. Troisièmement, ces minorités étrangères apportaient à la France un concours financier et humain gratuit en valorisant la culture française de façon plutôt dépolitisée. Mais, même si les alliances dans le monde ne font pas de politique, il n’en demeure pas moins que ces comités fonctionnent comme plate-forme centripète (dans les pays alliés de la France) ou centrifuge (dans les pays neutres ou plutôt hostiles à la France) pour l’action du Quai d’Orsay. Cette francophonie, en apparence apolitique, purement culturelle et intellectuelle, avance cachée en dissimulant ses arrière-plans politiques. On parle de « rayonnement » culturel et linguistique certes, mais la finalité de cette expansion culturelle consiste à appuyer le projet politique de la France. Quatrièmement, l’Alliance a offert, par ses subventions aux écoles francophones, une structure d’enseignement et de pratique du français alternative aux systèmes scolaires locaux. Parallèlement à cette entreprise culturelle, l’université française parachève ce mouvement de la francophonie par un brillant essor international à la veille de 1914.
L’essor universitaire international
Trois indicateurs permettent d’évaluer cette dynamique scientifique internationale de l’université française qui constitue l’autre élément de la francophonie. La France dispose en effet du premier réseau au monde d’instituts culturels à l’étranger. Ceux-ci mêlent à la fois des établissements scientifiques spécialisés (comme l’École d’Athènes ou celle de Rome) et de nouveaux établissements scientifiques et culturels (on y donne très vite des cours de langue, des conférences) sur le modèle de l’Institut français de Florence fondé en 1908. Le second point fort serait la forte présence d’étudiants étrangers sur son territoire puisqu’elle devint le premier pays d’accueil universitaire au monde au début des années 1900 en supplantant l’Allemagne. En 1914, on comptait 15 % d’étudiants étrangers sur la population étudiante totale en France, soit 6192 personnes (5015 en 1914 en Allemagne). Enfin, le troisième indice de cette internationalisation réussie de l’Université française serait la très forte capacité à organiser des congrès scientifiques internationaux sur son sol. Ceci explique, en partie, la présence du français comme langue de discussion informelle dans les coulisses des grands congrès scientifiques avant la Première Guerre mondiale et jusqu’en 1940.
Conclusion
L’expansion d’une francophonie universitaire et culturelle à l’échelle du monde dans le dernier tiers du XIXe siècle est l’un des grands traits de l’histoire française et de l’histoire transnationale. Elle contraste avec les propos pessimistes des années 1860-1875. Cette expansion, en parallèle de celle de la colonisation souhaitée par un Onésime Reclus, la déborde néanmoins assez largement, géographiquement et moralement. Ce qui serait, peut-être, commun aux deux projets, le colonial et le mondial, serait, malgré tout, un sentiment de supériorité qui animait les élites françaises, convaincues que leur modèle culturel était « civilisateur » par essence. Dans les deux cas, c’est une perspective « diffusionniste », unilatérale, qui préside à l’extraversion du modèle culturel français dans une époque où une pensée de la géopolitique culturelle est en train de s’affirmer. Aussi, précisément, l’autre point de convergence serait que la culture peut être mise au service d’un projet politique de puissance défini unilatéralement par un État. Les ressources de la puissance, en particulier les ressources culturelles, sont conçues comme de simples compléments à la force militaire et démographique ou au potentiel économique. La culture française que l’Alliance cherche à répandre n’est pas le moyen d’entrer dans une interaction véritable avec Autrui, mais bel et bien de proposer hiérarchiquement à celui-ci une relation linguistique. Évidemment, l’Alliance française doit se montrer prudente sur ce point, du moins les comités à l’étranger qui sont de droit local et ne peuvent donc pas, en tant que tel, entonner un pur péan en faveur des intérêts politiques de la France. Incontestablement si une nouvelle francophonie s’invente bel et bien dans ces années 1880-1914, il s’agissait d’une francophonie « relationnelle » entre l’Alliance et des pays divers, inscrite dans une relation bilatérale. Aujourd’hui, il semble plutôt que la francophonie soit devenue plus « systémique14 », engagée dans des interactions mondialisées plus respectueuses des acteurs qui la composent.
Notes
- Léopold Sédar Senghor, « Le français, langue de culture », Esprit, novembre 1962, p. 837-844 https://www.observatoireplurilinguisme.eu/les-fondamentaux/textes-de-reference/15536-le-français,-langue-de-culture,-léopold-sédar-senghor-revue-esprit,-novembre-1962.
- François Chaubet, La Politique culturelle française et la diplomatie de la langue. L’Alliance Française (1883-1940), Paris, L’Harmattan, 2006.
- Jean-François Bayart, Le Gouvernement du monde. Une critique politique de la globalisation, Paris, Fayard, 2004.
- Armand Mattelart, L’Invention de la communication, Paris, La Découverte, 1997 [1994].
- Vincent Cloarec, « La France du Levant ou la spécificité française au début du XXe siècle », Revue française d’histoire d’Outre-Mer, n° 313, 1996, p. 3-22.
- Même si les premiers crédits accordés à des établissements scolaires catholiques et francophones, au Liban, datent de 1842.
- Aron Rodrigue, De l’instruction à l’émancipation. Les enseignants de l’Alliance israélite universelle et les Juifs d’Orient 1860-1939, Paris, Calmann-Lévy, 1989.
- Cf. Vincent Berdoulay, La Formation de l’école française de géographie, Paris, Éd. CTHS, 1981, édition revue 2008.
- Pascale Barthélémy, « L’Enseignement dans l’empire colonial français : une vieille histoire », Histoire de l’éducation, 128, 2010, p. 5-28. Cette opposition se fait jour dès les années 1860 quand l’institutrice Eugénie Allix Luce qui avait ouvert, en 1847, la première école de filles arabo-française, est récusée dès 1867 par les autorités locales.
- Yves Lacoste, « Enjeux politiques et géopolitiques de la langue française en Algérie : contradictions coloniales et post coloniales », Hérodote, n° 126, 2007, p. 17-34.
- Ibid, p. 24.
- Christophe Charle, La République des universitaires (1870-1940), Paris, Le Seuil, 1994.
- Voir Guillaume Tronchet, Savoirs en diplomatie. Une histoire sociale et transnationale de la politique universitaire internationale de la France (années 1870-années 1930), Thèse de l’Université de Paris I, 2014.
- Cette opposition du « relationnel » et du « systémique » est empruntée à Bertrand Badie. Cf. Bertrand Badie, Les puissances mondialisées. Repenser la sécurité internationale, Paris, Odile Jacob, 2021.