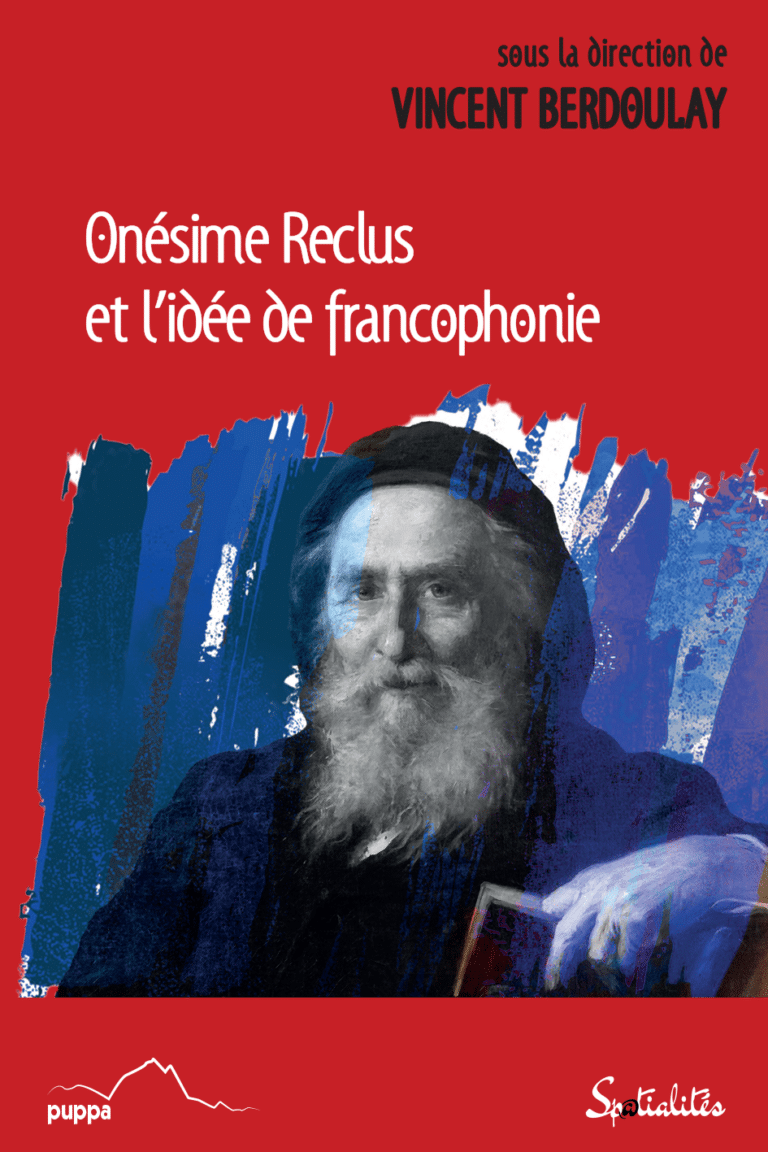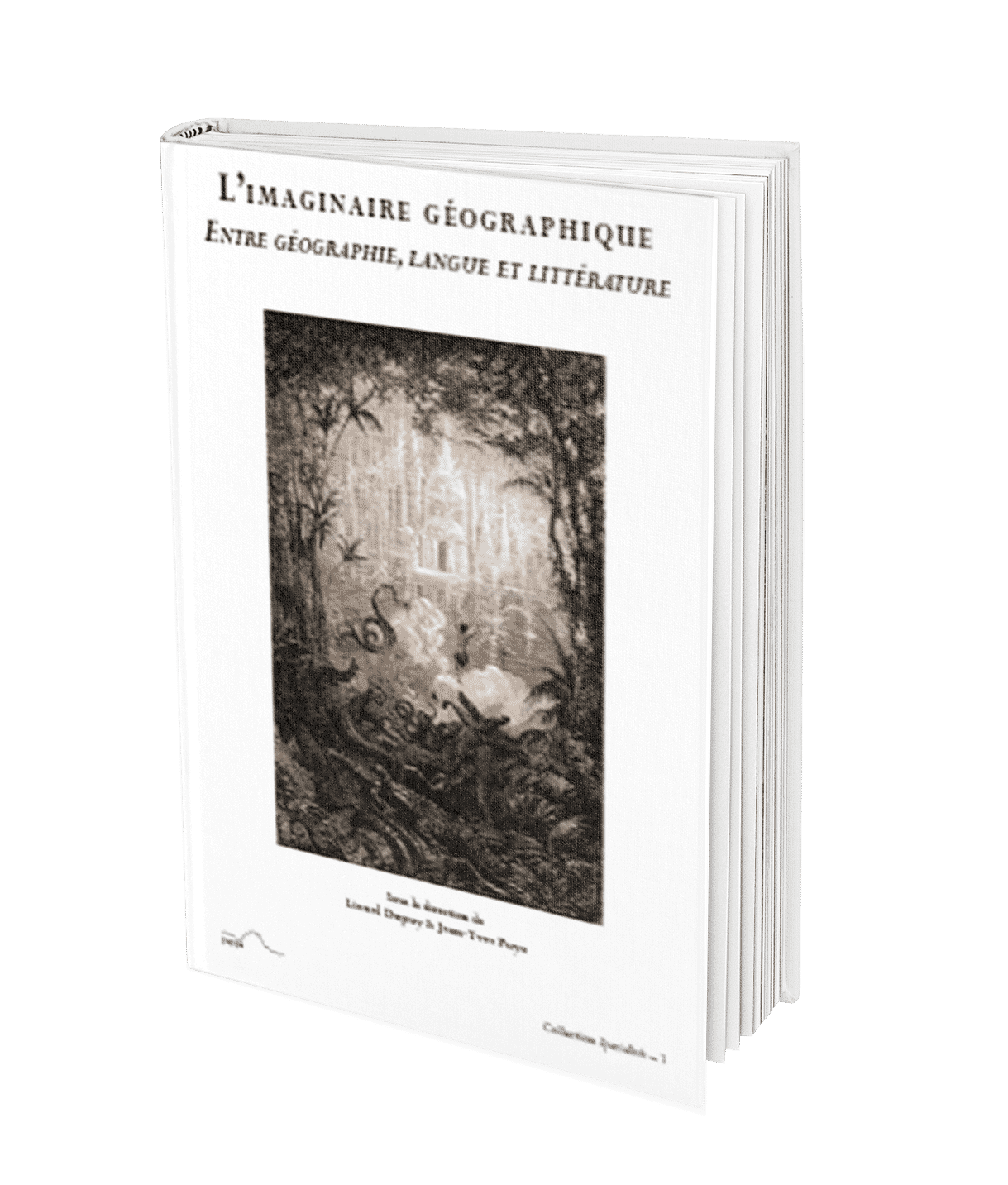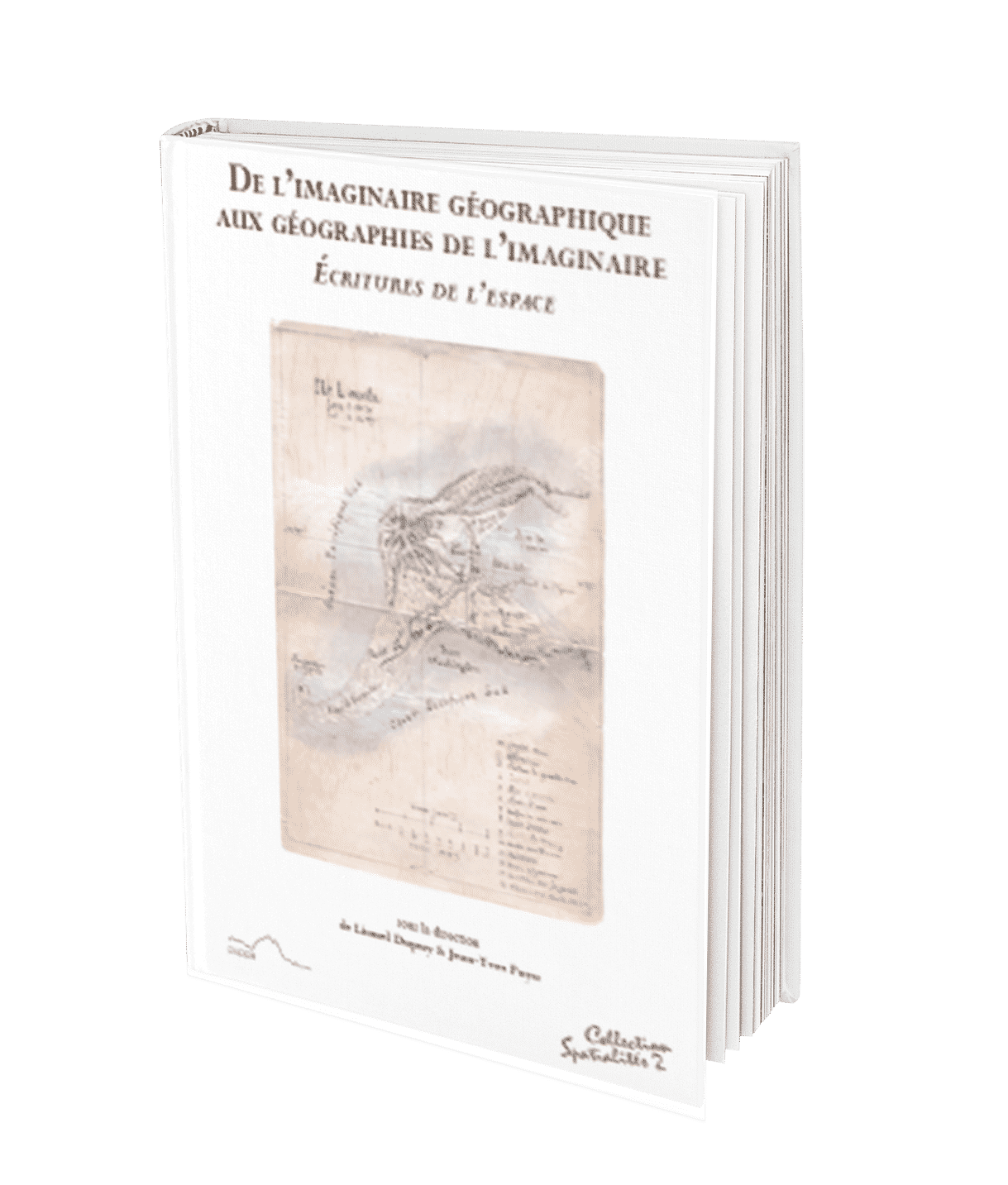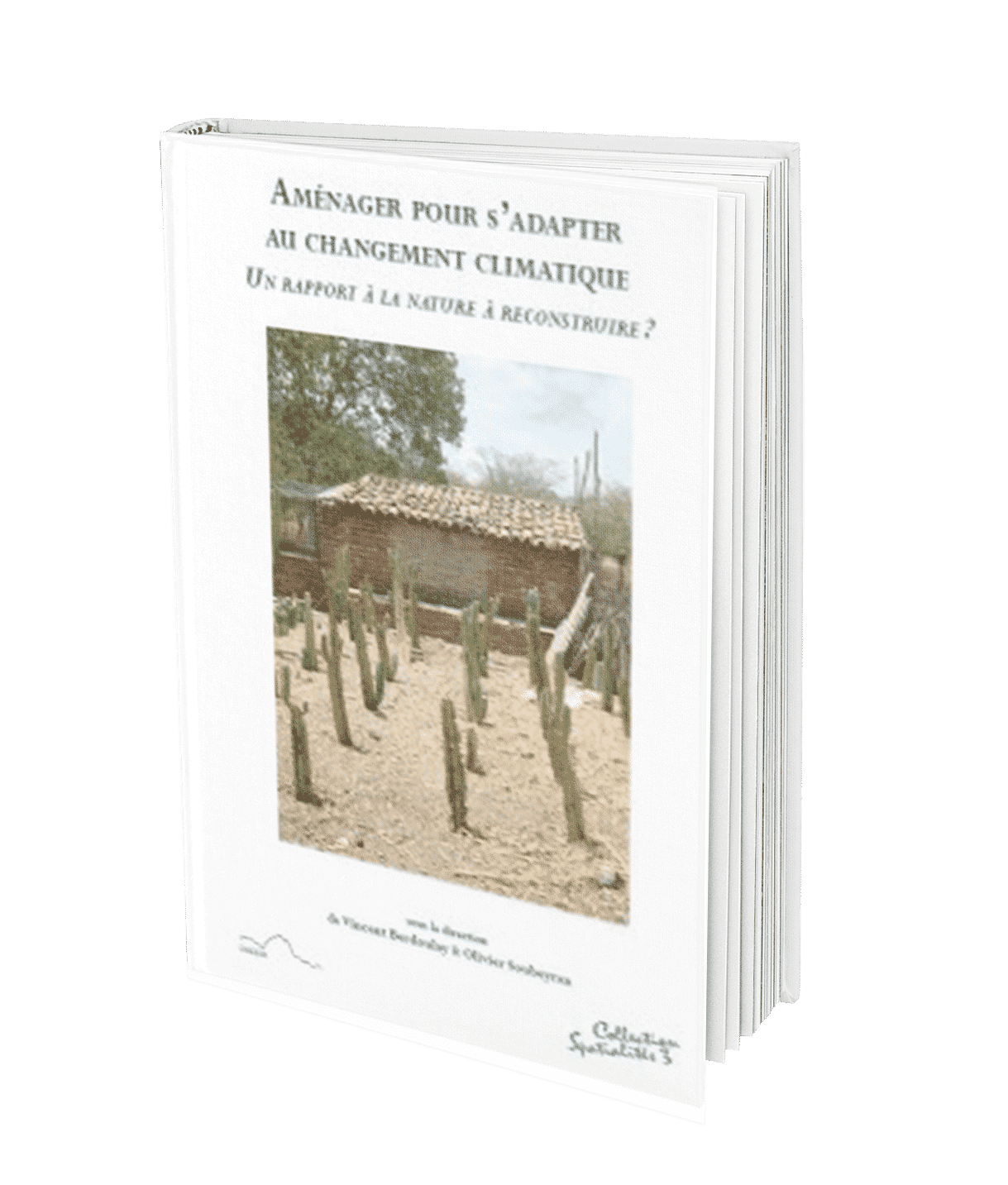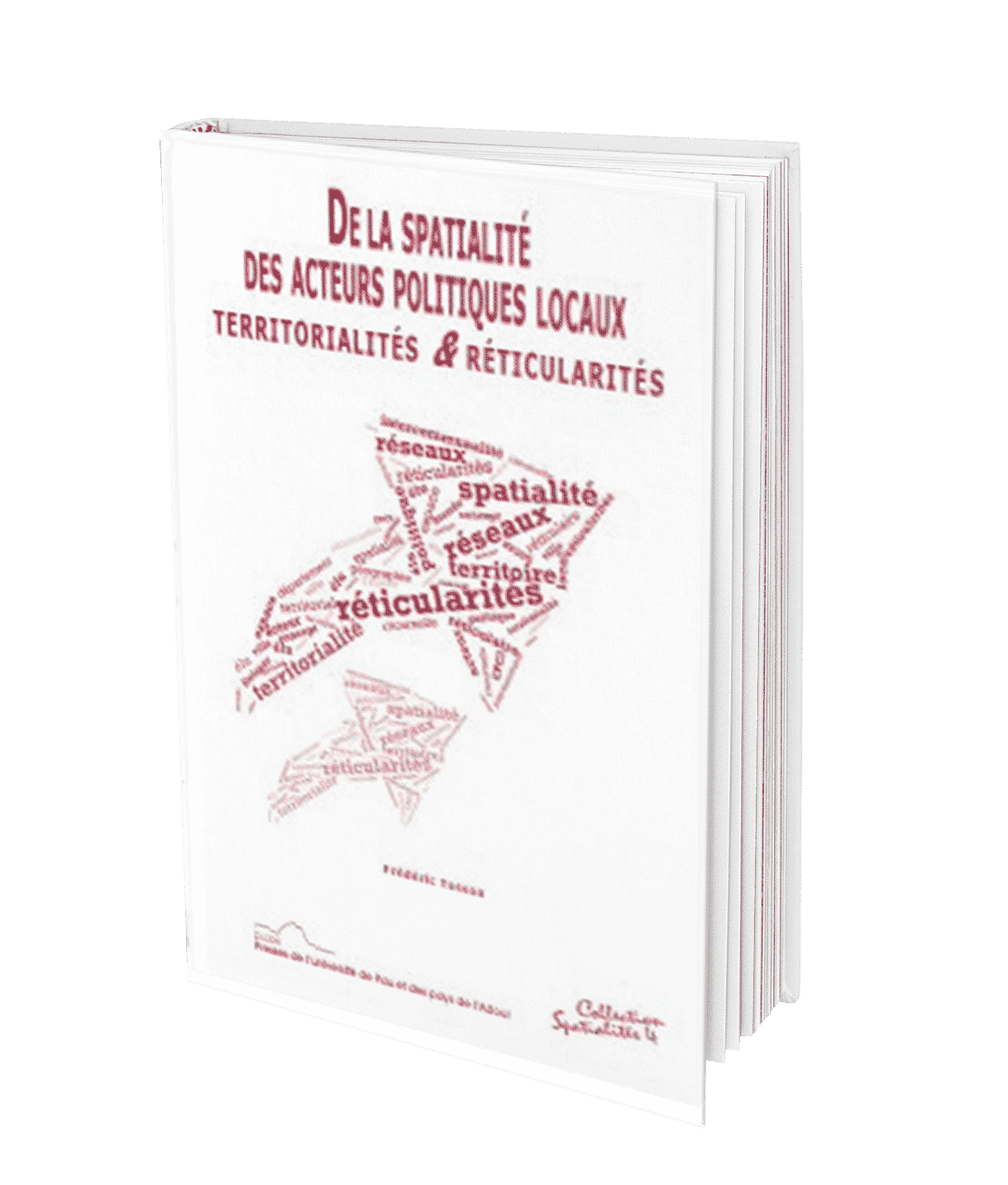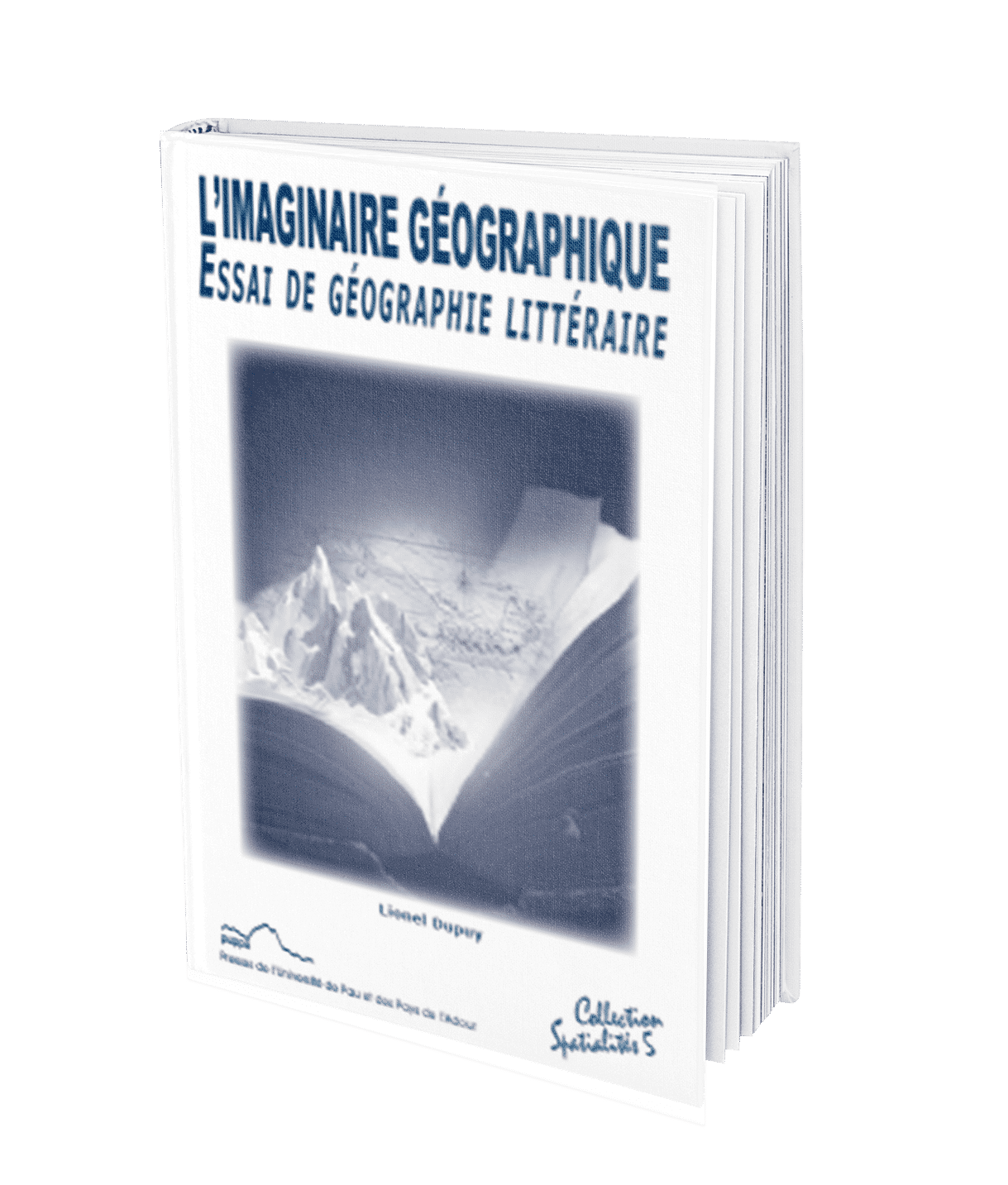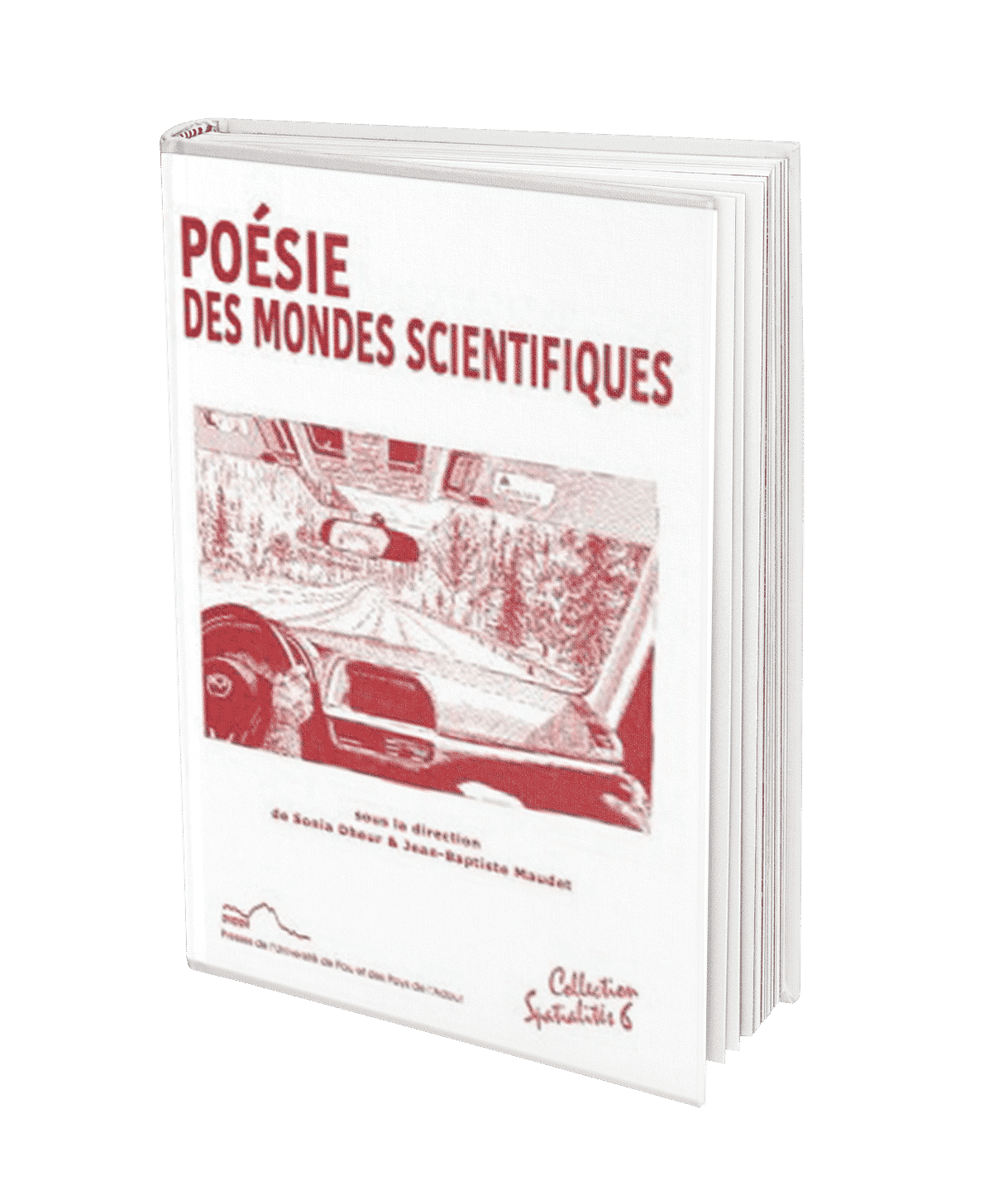Introduction
Plus d’un siècle nous sépare de la mort d’Onésime Reclus et d’une époque maintenant bien révolue. Pourtant, la francophonie, après bien des vicissitudes, continue à faire face à de nombreux défis. Il est remarquable qu’ils fassent encore écho, dans une certaine mesure, aux préoccupations énoncées par ce géographe autour de questions de démographie et de géopolitique. Ainsi, le relatif déclin de la masse des locuteurs du français a récemment été enrayé par l’irruption de populations qui en font grand usage en Afrique. En même temps, cela invite à repenser les relations entre pays se réclamant de la francophonie parce que le centre de gravité démographique s’est déplacé vers le sud. Dans une vaine reclusienne où la géopolitique conditionne le linguistique et le culturel, les chapitres qui suivent se concentreront sur des aspects de l’appropriation du français en Afrique et du nécessaire mais difficile décentrement de la francophonie littéraire.
C’est que la population francophone africaine est en pleine croissance. Il est assez vain de vouloir la chiffrer avec précision, car tout dépend de la définition du locuteur d’une langue, source de variations statistiques considérables. Par exemple, comment comptabiliser des locuteurs selon qu’ils sont monolingues, plurilingues, maternels, occasionnels, quotidiens, prioritaires etc., c’est-à-dire en tenant compte de la multitude des situations sociolinguistiques où s’entrecroisent habilités, affects, pratiques familiales, professionnelles et administratives. Il n’en reste pas moins que si l’on se base sur le nombre de personnes scolarisées entièrement ou en partie en français, l’immense majorité se trouve actuellement en Afrique1. Pour certains observateurs d’une situation en évolution rapide, fluctuante et très différenciée selon les pays et régions (Gervais Mendo Ze, Achille Mbembe, Pierre Essengué, Paul Zang Zang par exemple), le français n’est plus à être considéré comme une langue étrangère mais plutôt comme une langue d’Afrique avec ses caractéristiques propres.
Si la langue française a ainsi quelque avenir sur le plan démographique, c’est donc en Afrique que se joue ce futur. Toutefois, l’ancrage du français y est fort variable selon les pays, allant d’un usage très limité pour des fonctions purement administratives ou techniques à un emploi soutenu dans les multiples sphères de la vie de l’individu. La prospérité culturelle de la francophonie demeure ainsi liée au degré d’appropriation de la langue. C’est cet enjeu essentiel qu’aborde le chapitre 7 sous l’angle de l’appropriation institutionnelle, condition importante de l’emploi de la langue française dans la société – ses modalités d’appropriation induisant son évolution et la reconnaissance d’un français nouveau. C’est à une vision multipolaire qu’invite ce chapitre. Étant donné le renforcement de l’ancrage africain du français, il est significatif que ce chapitre se termine par la question géopolitique du siège de la Francophonie (OIF) : ne devrait-il pas logiquement se localiser en Afrique ? C’est bien en Afrique qu’est née la Francophonie et c’est là que se joue son avenir. Alors que le statut et les fonctions de la langue française en Europe et en France même sont actuellement très ébranlés, ne faudrait-il pas, comme l’auteur du chapitre l’a déclaré par ailleurs avec malice, que la France songe à rejoindre la Francophonie ?
Cet appel à un décentrement concerne, en fait, bien des aspects des relations culturelles au sein de la francophonie. Le chapitre 8 s’en fait l’écho à propos de la littérature. Cas exemplaire d’un décentrement souhaité – ne serait-ce qu’en France même – il constitue un défi difficile à relever en raison non seulement du poids des institutions en place, mais aussi de la conception même du rapport que les auteurs entretiennent avec l’international. Un clivage – qui n’existait pas dans l’esprit d’Onésime Reclus – a vite fait d’apparaitre entre français et francophone, posant la question récurrente du rapport à l’altérité au sein de la francophonie et tout particulièrement en France. En faisant une évaluation critique de l’idée militante d’une « littérature-monde », ce chapitre montre des tropismes à éviter même quand on partage l’objectif d’un décentrement de la création littéraire francophone. Le fait que celui-ci ait été pensé par des écrivains-voyageurs constitue un véritable clin d’œil, quoiqu’involontaire, au goût d’Onésime Reclus pour la géographie !
Notes
- Pour des statistiques et les approches suivies, consulter les sites de l’ODSEF : https://www.outils-odsef-fss.ulaval.ca/francoscope ou https://www.odsef.fss.ulaval.ca/centre-de-donnees, ou le rapport 2022 de l’OIF : https://www.francophonie.org/sites/default/files/2022-03/Synthese_La_langue_francaise_dans_le_monde_2022.pdf.