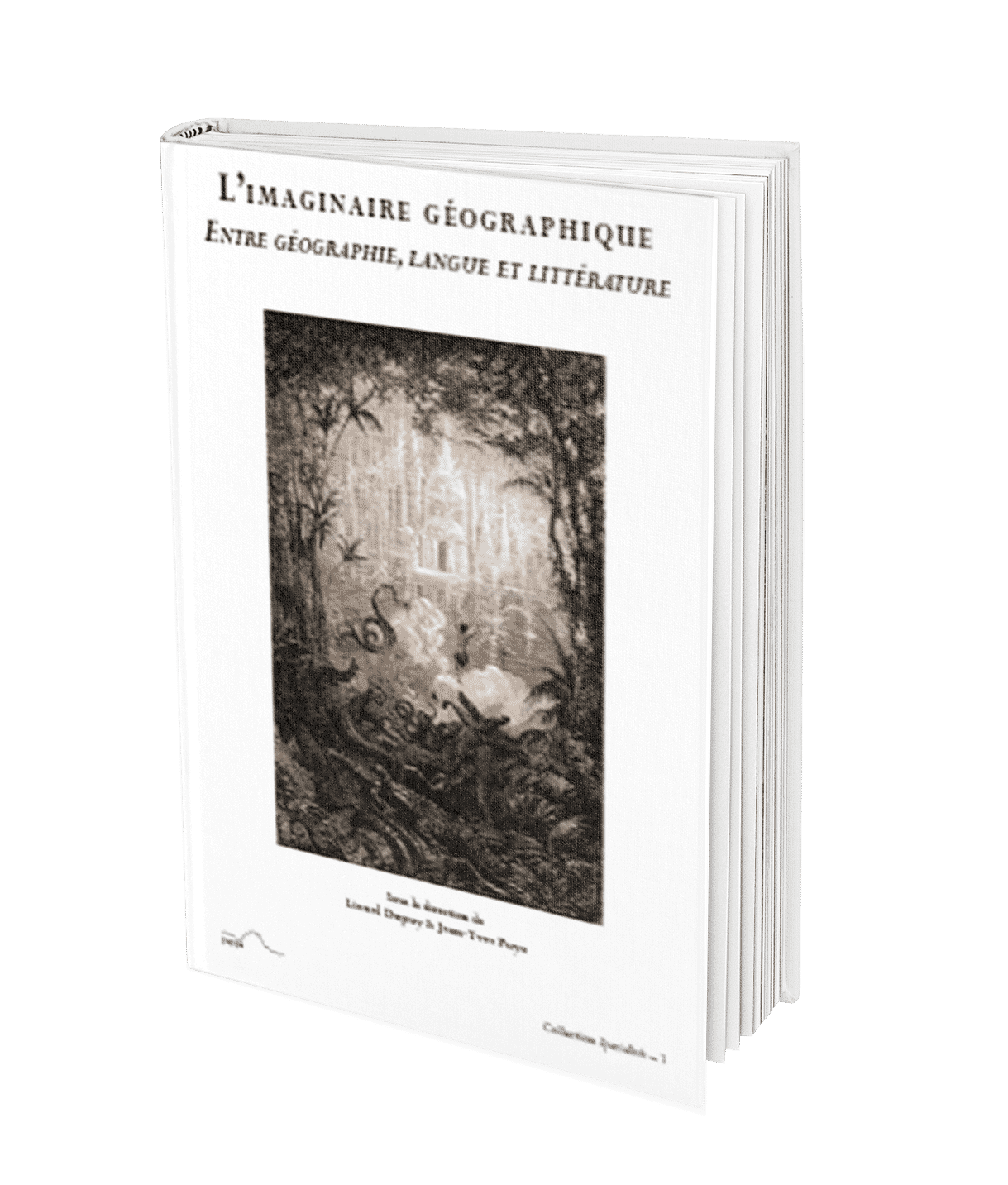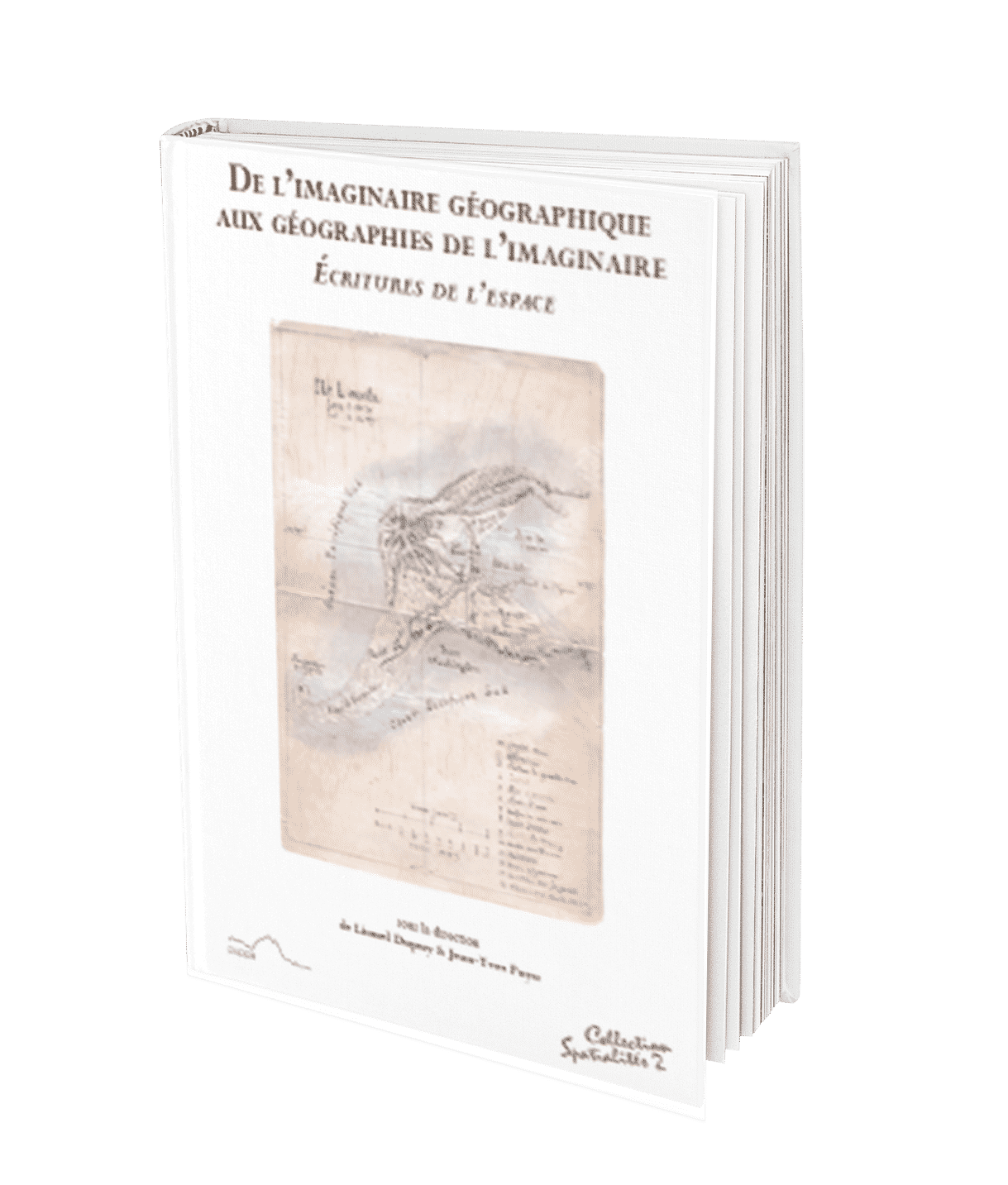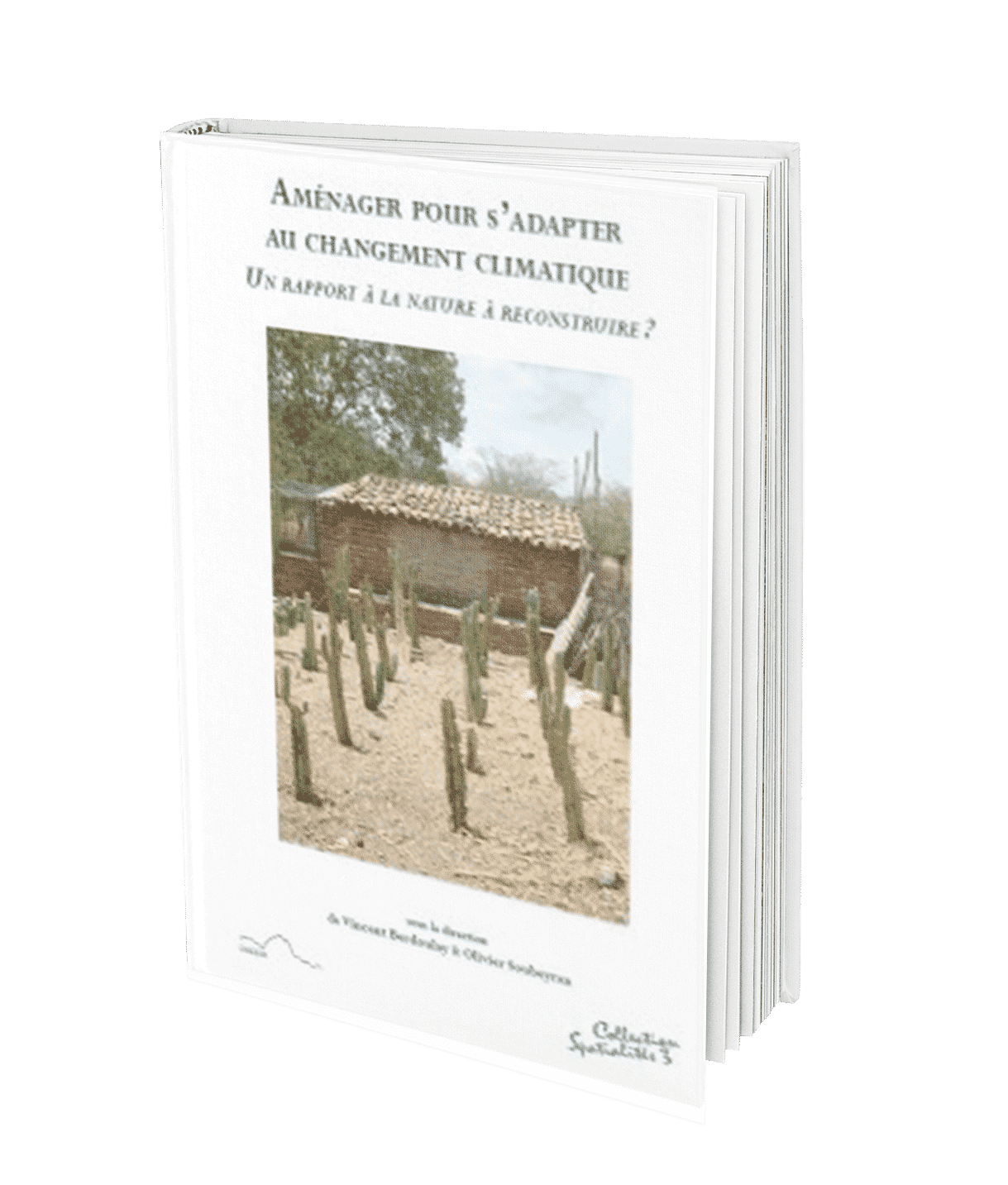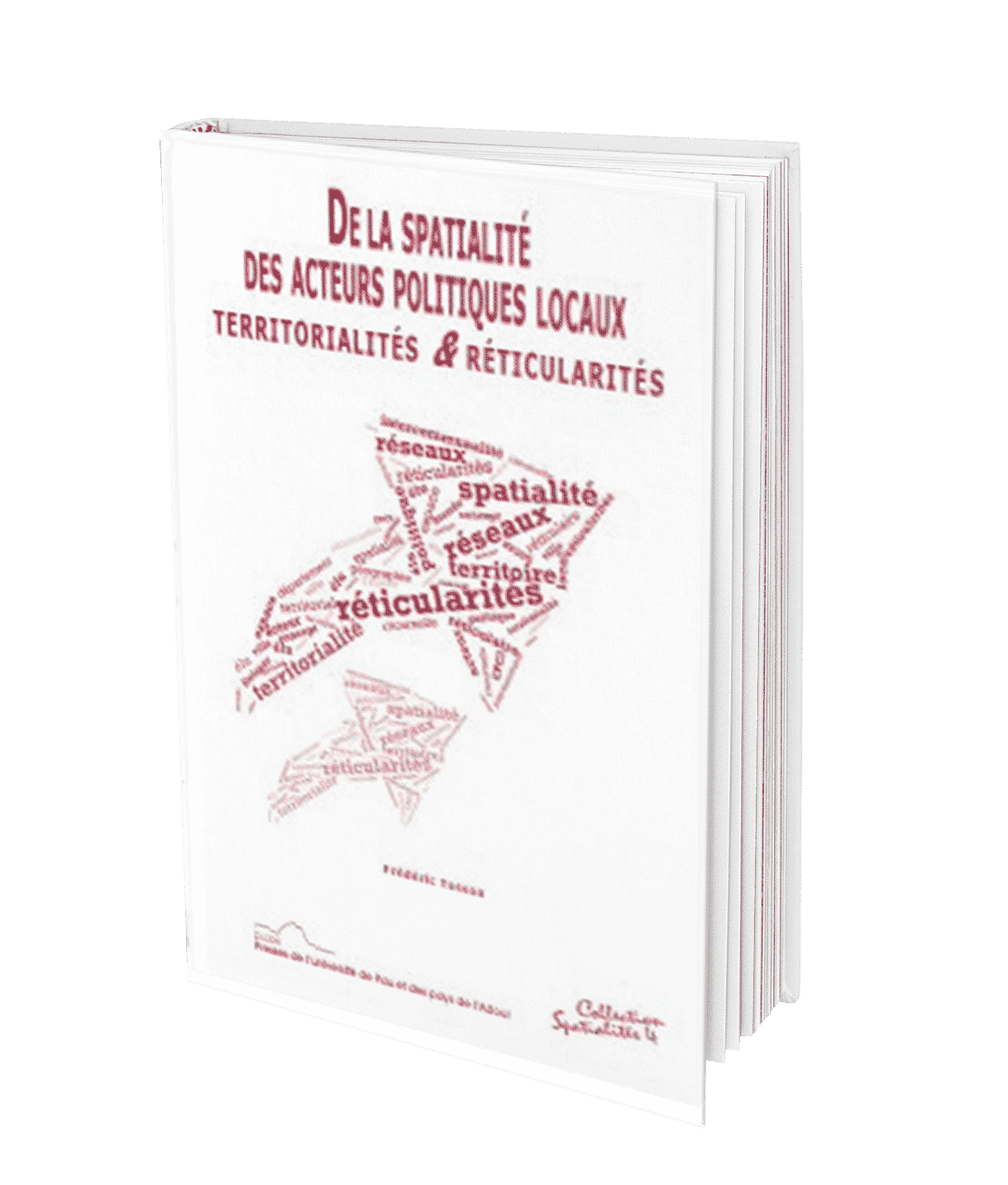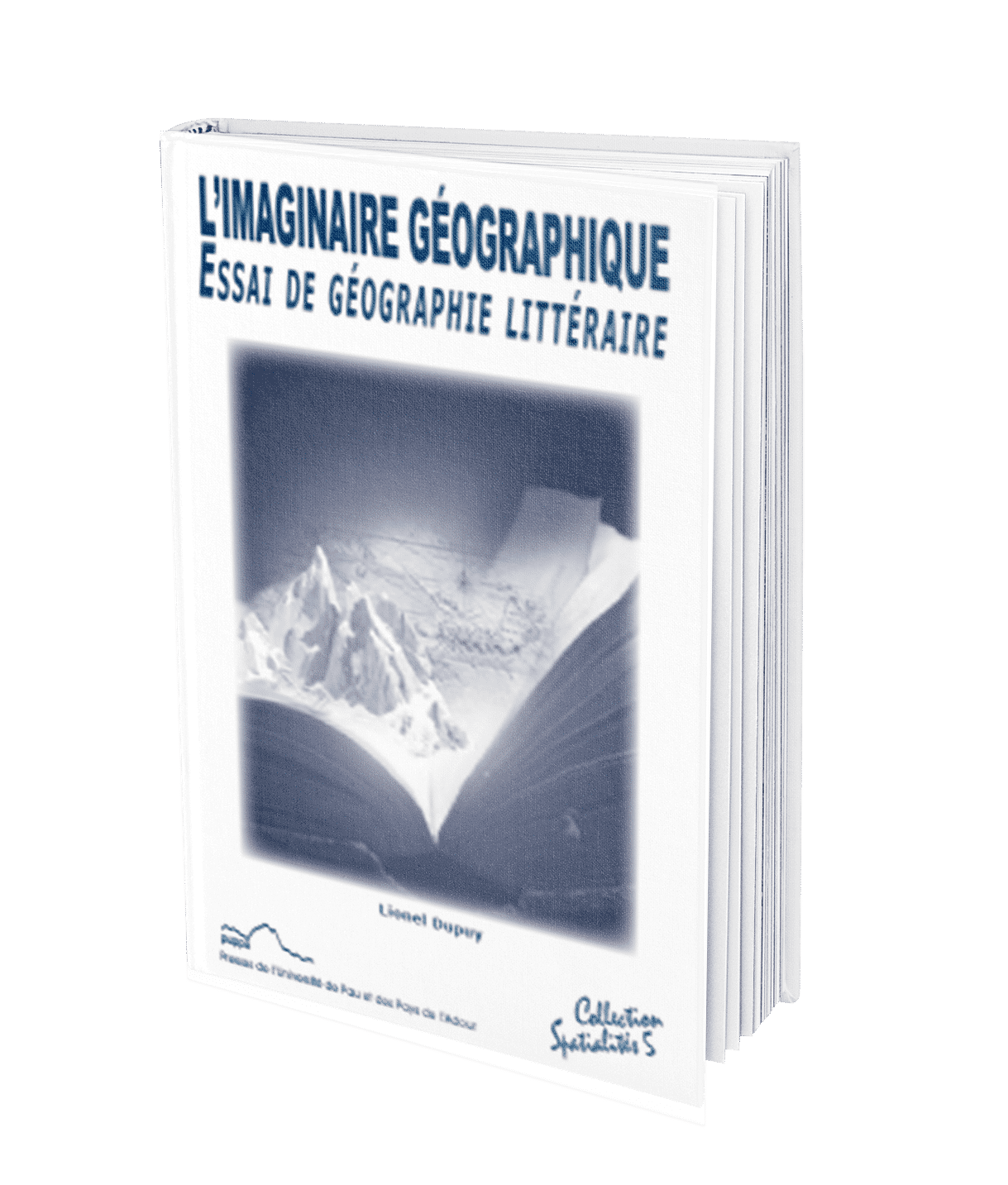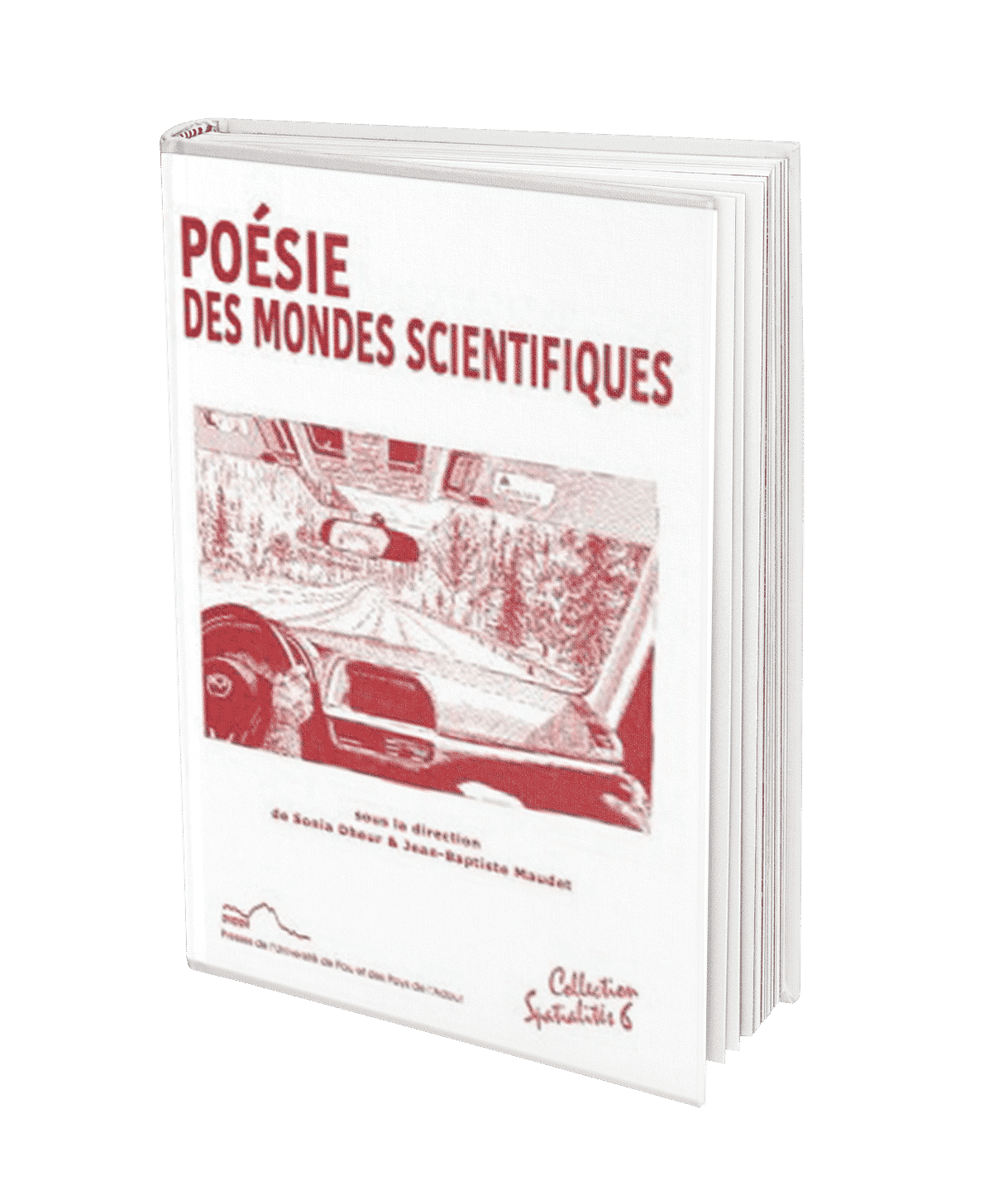En 2007, Michel le Bris, en compagnie de Jean Rouaud, rassemble autour de lui 25 écrivains francophones, pour publier aux éditions Gallimard1 un manifeste de 330 pages qu’il intitule Pour une littérature-monde2.
Si l’on regarde de près la part des contributeurs à ce volume, le mot de « francophonie » est étonnamment omniprésent, alors que l’objectif du volume n’est pas, de manière affichée, une analyse ou une ré-évaluation du concept de francophonie et de ses contours.
L’idée de Michel Le Bris et de Jean Rouaud est de mettre en valeur, voire de faire naitre le concept de littérature-monde « en français ». De cette proposition « en français », le volume glisse vers des prises de position parfois hostiles aux termes de « francophone » et « francophonie ». Il faut étudier attentivement ce glissement. Est-il dû uniquement au choix des contributeurs3 ? Parmi eux, certains utilisent la langue française par choix (Dai Sijie, écrivain chinois, par exemple), d’autres par organisation linguistique historique ou géographique (Michel Layaz est un écrivain de Suisse romande), d’autres encore par un héritage dû à l’émigration (Jacques Godbout est québécois, Nancy Huston est franco-canadienne) ou à la colonisation (Dany Laferrière est haïtien, Alain Mabanckou est franco-congolais, Ramahimanana est un écrivain malgache). Ce glissement du projet « défense d’une littérature-monde en français » vers une « critique de l’idée de francophonie » est-il volontaire ? Si oui, dans quelle mesure permet-il d’envisager un tournant dans l’histoire littéraire, et une avancée – autre que chronologique – par rapport aux propositions d’Onésime Reclus ?
Un texte militant
Michel Le Bris place son texte et l’ensemble des contributions dans un contexte militant. Il conçoit cette publication comme celle d’un manifeste, écrit pour rendre compte et profiter de ce qu’il appelle, en 2007, « un moment historique » : ces années au cours desquelles l’édition parisienne reconnait enfin – d’après lui – dans l’attribution des prix littéraires, qu’il existe des écritures en français qui ne sont pas issues de la métropole. Volontairement, Michel Le Bris et les contributeurs au volume lient « littérature-monde » au mot de « francophonie », et leurs attaques sont virulentes dès les premières pages du manifeste : « Anna Moï interpelle vivement le milieu littéraire, sur les raisons à tout le moins suspectes qui lui faisaient volontiers classer comme “français” : les auteurs blancs du Nord (Beckett, Kundera, Cioran) et comme “francophones” les auteurs du Sud à la peau noire, ou jaune. Waberi, toujours aussi vif, résume leur sentiment à tous : “adieu à la francophonie” » (LM, 24). Il s’agit, selon Michel Le Bris, d’enregistrer « l’acte de décès d’une certaine idée de la francophonie, perçue comme un espace sur lequel la France dispenserait ses lumières au bénéfice, il faut le supposer, de masses encore enténébrées » (LM, 24).
Ce militantisme revendiqué est assassin pour qui ne cautionne pas l’ouverture telle qu’elle est prônée par Michel Le Bris : « Car toute parole se fige, si l’on n’y prend pas garde, la littérature est toujours en péril de périr sous le poids des modes, des conventions, des formes rhétoriques, soumise qu’elle est au milieu littéraire jusqu’au point, parfois, de se réduire à n’être plus que simulacres, rituels de passage par lesquels des coteries se reconnaissent et se perpétuent » (LM, 29).
Cette bataille est donc menée sur deux fronts : d’un côté contre la différence qui est toujours faite par l’institution littéraire française entre les écrivains dits français et les écrivains dits francophones (« francophone » étant entendu comme « non métropolitain », voire comme non européen) ; de l’autre côté la littérature figée en « ronds de jambes, emphase, mauvaise littérature », qui obéirait, dit ailleurs Michel Le Bris, à « la Théorie Du Signe, qui se révèl[erait] pour ce qu’elle avait toujours été : un discours de prise de pouvoir » (LM, 26). C’est contre cette prise de pouvoir « des explications formelles et structurales » que Michel Le Bris entend porter le fer : « Me portait cette conviction qu’un monde nouveau était en train de naitre, inquiétant, fascinant, sans plus de cartes ni de repères pour nous guider […] Écrire, n’était-ce pas tenter de donner forme, visage à l’inconnu du monde ? » (LM, 27).
L’accusation d’Anna Moï est sans doute juste : Kundera – ou Cendrars, ou Apollinaire, ou Jean-Philippe Toussaint – sont considérés par les académies, les maisons d’édition, et par extension, les médias et les lecteurs français comme des auteurs français. Il est certain que, pour ces auteurs, cette nationalité, ou cette place donnée par une nationalité dans le champ littéraire français est une récupération sans beaucoup de vergogne des maisons d’édition et des institutions pour ramener vers un centre idéologique, national et politique ce qui pourrait se diluer dans des marges incertaines4. Nicolas Bouvier, voyageur et écrivain suisse n’ayant jamais renié ses origines, mais encensé par l’institution française à partir de ses premiers succès de poids (Le Poisson-Scorpion en particulier, publié en 1985 aux éditions Gallimard), n’est que l’un des nombreux exemples de cette perversion éditoriale et institutionnelle qui considère que sa littérature et sa langue se doivent d’être universelles.
Cette portée universelle est un idéal abstrait dont les institutions françaises envisagent faussement qu’il leur appartient de facto, dès lors que l’écrivain est reconnu. Depuis Bourdieu, on sait que la littérature, en particulier en France, pays d’une mémoire manipulée depuis des siècles pour être glorieuse, le champ littéraire est social et symbolique, et que l’idée même de création est fabriquée par les croyances et les institutions. Le champ littéraire met en place la position de chaque écrivain considéré comme appartenant à la culture française, à l’intérieur d’un champ de forces et d’interactions sociales et symboliques. Être vu comme écrivain français, pour Bouvier, Beckett, Cioran ou Cendrars ne pose pas problème parce que ce statut les inscrit dans des marges qui font partie du système de domination, et le justifient. Bouvier, Beckett ou Jaccottet ne revendiquent pas leur marginalisation géographique comme vecteur et bras armé d’une résistance au centre parisien, et aux principes admis de la littérature française : idées humanistes et travail du style. Ils n’en ont pas besoin. Écrire en français, pour un écrivain belge, irlandais ou suisse, n’est pas perçu comme l’acte de revendication d’une identité autre que celle d’écrivain. Beckett n’est pas un écrivain irlandais qui pourfendrait les règles du champ littéraire français. Cendrars et Bouvier non plus. Ils peuvent affirmer leur identité de sujet écrivant sans sortir de la cartographie de la littérature française : leur apport, aussi important soit-il, est un apport esthétique, qui reste dans les cadres de la langue et de la culture françaises héritées du Classicisme et des Lumières. Tout au plus font-ils partie, avec efficacité, de ce besoin cyclique de nouveauté, de cette nécessité d’une avant-garde ou d’une modernité qui sont des caractéristiques importantes de l’institution littéraire française. Ainsi, ni Beckett, ni Bouvier, ni Cendrars, ni Michaux et, plus près de nous ni Jaccottet5, ni Jean-Philippe Toussaint6 ni Antoine Wauters7 ne souhaitent ouvertement remettre en question les structures de la langue, ni celles de l’idéologie portée par cette langue : clarté, rigueur, valeurs de l’esprit occidental à son apogée. Ils appartiennent à cette territorialisation de la littérature française : ils peuvent marquer un déplacement sans que cela soit une frontière, une originalité qui n’est pas un métissage. Si l’on suit les analyses de Bourdieu, ils semblent appartenir de plein gré et sans violence, en obéissant aux règles du champ littéraire avec autant de bonne volonté que les auteurs admis dans l’histoire littéraire officielle. Ils mettent en place cette « action des dominés » analysée par Bourdieu8. Action qui, à partir de la marge, met le centre en valeur, parce qu’elle trouve son origine dans le centre lui-même.
Si nous suivons la réflexion d’Anna Moï dans Pour une Littérature-Monde, les écrivains qui ne sont pas reconnus comme français, et que les institutions s’obstinent à appeler « francophones » sont ceux qui viennent des anciennes colonies françaises. Des « pays dominés », comme le dit Chamoiseau9. Ceux à qui l’institution scolaire a imposé des références qui ne sont pas les leurs. Évidemment ni Beckett, ni Jaccottet, ni Bouvier n’ont eu à subir dès l’école primaire des références culturelles qui niaient leurs expériences, leurs ascendances, ou leur quotidien. Si ces écrivains se réclament d’une forme de culture et de tradition françaises, ils les ont librement choisies. Au contraire, les références raciniennes, voltairiennes, hugoliennes, flaubertiennes, ou balzaciennes ont été enseignées à des écrivains totalement extérieurs à elles dans leur vécu et leur expérience, comme Chamoiseau, Mabanckou, Abdourahman A. Waberi, Anne Moï, Boualem Sansal ou Raharimanana. Chez ces derniers, l’acte créateur fait alors partie de la revendication d’une lutte et d’un combat contre l’oppresseur et ses armes, et d’un acte libérateur. Or, la langue française fait partie de ces armes. Certes, cette idéologie du combat est efficace pour des revendications comme celle que porte Michel Le Bris, puisque ces écrivains, en toute légitimité, portent dans leur écriture la volonté d’une affirmation de soi contre des normes historiques, idéologiques, culturelles, politiques et linguistiques qui furent des oppressions totalitaires. Si le propos de Michel Le Bris, dans sa volonté de dénoncer une centralisation excessive des normes régissant la littérature française, est de porter le fer au centre névralgique des décisions politiques et symboliques, c’est fait.
Mais ce faisant, le manifeste souscrit aux normes établies par ce même centre. Ces écrivains publiant en français, et revendiquant leur richesse et leur différence, doivent-ils obligatoirement se définir en faisant référence à un ennemi contre lequel il faudrait se battre ? Ne se soumettent-ils pas involontairement, eux aussi, au champ des « actions de dominés », reconnaissant par leur lutte la puissance du centre dominant ? Ne possèdent-ils pas, en 2007, des identités claires, définitivement autres, qui pourraient, justement, s’ils ne mentionnaient pas l’ennemi comme constitutif de leur démarche, repenser entièrement la structure du champ littéraire non seulement français, mais mondial ? Montrant avec raison que le concept de francophonie peut contenir une charge oppressive, ne pourraient-ils pas organiser des lieux d’énonciations qui soient absolument autres ? Montrer un ennemi, et dire qu’on le combat, c’est encore le reconnaitre. Or, en 2007, il est peut-être d’autres priorités que cette inamovible reconnaissance du centre, pour tout écrivain de langue française. L’idée de littérature-monde se réclame des écrivains antillais Patrick Chamoiseau10 et Édouard Glissant11. Mais ceux-ci, bien avant 2007 et le manifeste, ont justement élargi leur espace de création loin en dehors du centre dominant contre lequel Michel le Bris veut lutter.
Que signifie exactement, dans le contexte du manifeste de la littérature-monde, le mot « francophonie », que fustigent les auteurs ? Il semble qu’il s’agisse au moins de deux réalités : l’utilisation par les locuteurs du monde d’une langue française qui sert de creuset à des créations nouvelles sur le plan syntaxique, morphologique et lexical, accueillant des éléments étrangers jusqu’à être totalement neuve. Mais le mot « francophonie » possède aussi pour les auteurs du manifeste une autre réalité : celle d’être indéfiniment la langue de l’oppresseur colonialiste. La francophonie serait alors l’ensemble des locuteurs mondiaux auxquels la langue française a été imposée par le processus de la colonisation. Ces auteurs vivent aujourd’hui la puissance symbolique du champ littéraire en France comme la continuation du processus colonial. Dans le manifeste, ils mêlent, volontairement ou non, ces deux significations de la francophonie : à la fois langue, et centre de pouvoir oppresseur.
Or, Patrick Chamoiseau construit depuis au moins quinze ans le concept de créolité dans la langue et dans l’imaginaire. Il montre dans ses romans et dans ses essais que la langue française est assez souple pour accepter ces apports étrangers12. Il affirme que la langue française est depuis toujours mêlée d’apports étrangers, et par conséquent toujours créole. Ses propositions montrent qu’il peut exister pour chaque écrivain en langue française, des lieux de création, des situations d’énonciations autres que la lutte contre le centre de pouvoir parisien ou contre les relents du colonialisme. Plus philosophiquement, et dans une très profonde et très féconde réflexion poétique, Édouard Glissant propose depuis longtemps une « littérature de la relation », et le principe d’une création « en archipel », selon laquelle aucune langue ni aucun territoire, réel ou symbolique, ne sauraient être en position de domination dans le champ de la création poétique.
C’est peut-être la faille du texte militant imaginé et mis en forme par Michel Le Bris et les participants au manifeste de 2007. À se rassembler contre un ennemi commun avec un mot d’ordre et un programme, les contributeurs et l’ensemble des textes gomment l’importance des recherches et des processus artistiques et philosophiques à l’œuvre depuis longtemps chez les pratiquants de la langue française, d’où qu’ils soient. Ces processus transforment la francophonie non pas en champ de bataille, mais en champ littéraire fécond. N’est-il pas temps, en 2007, de se détourner des combats frontaux contre un centre qui n’est plus, politiquement et symboliquement, le seul maître du pouvoir ? N’est-il pas temps de tourner le dos à ce centre, et de proposer une création réellement libre ? Le lecteur du manifeste finit par se demander si, paradoxalement, il ne s’agit pas, au moment de la publication du manifeste, d’une prise de pouvoir, dans le champ littéraire français, par un groupe d’écrivains se vivant comme une avant-garde, plutôt qu’une réflexion qui éloignerait enfin la notion de « francophonie » des ressentiments historiques pour pouvoir prendre en compte sa modernité. Significativement, si on ne prend que ce détail, qui n’en est pas un… : publier aux éditions Gallimard pour dénoncer l’étroitesse des normes établies par ces mêmes éditions, voilà qui peut poser question sur la volonté de changement et de renouvellement revendiquée par le manifeste. Remarquons également que ces écrivains rebelles sont justement, en 2007, publiés par des grandes maisons parisiennes, et qu’ils acceptent la reconnaissance très institutionnelle et hiérarchique que leur apportent les prix littéraires13. Le romancier Camille de Toledo, dans un essai publié en 200814, souligne malicieusement que
« les signataires [de ce manifeste] usaient pleinement de leur autorité. Parmi eux, en effet, tant de géants… On ne répond pas aux géants. On les célèbre comme il se doit, de peur d’être dévoré, […] les signataires rassemblaient tous les insignes du talent, de la culture, de l’éloignement… […] À la publication du manifeste de Saint-Malo, on s’en tint à la célébration d’une page qui se tourne… [dans leur manifeste], les voyageurs s’avançaient en vainqueurs » (VF, 11-12).
Plus littérairement, un écrivain comme Dany Laferrière (pourtant académicien, donc au centre des institutions parisiennes, on peut difficilement faire plus) garde son discours de militant pour le cadre politique et historique. Mais il regarde avec amusement ses romans célébrés grâce à une certaine forme de provocation et de revendication (Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, 1985), et il considère comme ses livres véritablement importants son autobiographie haïtienne (L’odeur du café, 1991 ; Pays sans chapeau, 1996 ; L’énigme du retour, 2009). L’important est donc bien de mettre en place un lieu d’énonciation et un sujet créateur qui soient totalement autres et libres, sans reconnaissance, même par la lutte, d’un centre de pouvoir.
Les écrivains qui, dans le manifeste, revendiquent haut et fort leur identité ont tout à fait raison de le faire. Mais, réduisant leur démarche créatrice d’une littérature-monde en français à un combat contre la francophonie conçue comme centre du pouvoir littéraire, symbolique et politique, ils opèrent un glissement de sens, et se trompent peut-être de combat. La littérature-monde n’existe pas – ou n’existera pas – parce qu’elle se constitue contre la francophonie et ses dérives politiques et institutionnelles. Affirmer la nécessaire existence d’une identité métisse et marginale contre un centre dominant pour légitimer une littérature-monde peut devenir un biais cognitif, qui peut même enfermer les créateurs dans la nécessité d’une identité de lutte, et non de création. La littérature-monde en français ne peut exister dans les seuls termes d’un combat. Il lui faut inventer d’autres origines et d’autres pratiques créatrices que le militantisme.
Quelle langue française pour une littérature-monde ?
Ce militantisme, dans le manifeste, appelle également à la lutte contre l’exigence d’une « pureté » de la langue française. Contre cette pureté, les écrivains revendiquent leur liberté : « Quelle langue pourrait survivre à la pureté ? La langue française ? Elle, bâtarde du latin et du grec ? La voici maintenant qui quitte les frontières de l’Hexagone ! Qui se livre sans vergogne à quantité de nègres et autres amalgames sans nom » (Raharimanana, LM, 311). L’acte militant quitte alors plus franchement encore les terres de la littérature-monde, pour discuter et détruire le terme de francophonie. Raharimanana, dans son texte, fait même référence à Onésime Reclus, pour le rejeter violemment : « Me revendiquer francophone d’un Reclus qui m’a voulu sous sa coupe, voulu inférieur, servant l’empire français, éternellement indigène, fermé dans les frontières et sous-cultures qu’il m’a assignées alors que lui s’octroie le monde à irradier ? Non, merci » (LM, 308).
Certes, il s’agit ici, de manière tout à fait légitime, de briser les effets destructeurs d’une France ayant cru apporter « la belle langue française » au reste de l’humanité. De manière tout à fait légitime également, il s’agit de revendiquer la multiplicité des langues incluses dans les langues contemporaines, dans les langages artistiques, et en l’occurrence la multiplicité des langues à inclure dans la langue française. Raharimanana termine d’ailleurs son intervention par un appel aux écrivains de langue française appartenant au monde de manière multiple sur le plan du temps comme de l’espace :
« Vous savez que [cette langue] a été à d’autres avant d’être à vous, elle aura été la langue de Voltaire, elle aura été la langue de Molière, elle aura été la langue de Verlaine, Baudelaire, de Breton, de Malcolm de Chazal, de Franketienne, de Césaire, de Le Clézio, de Villon, de Cendrars, de Ponge, de Rabearivelo, de Kourouma, de Labou Tansi, de Louise Labé, de Kateb Yacine. […] elle vient, vous la couchez sur la feuille et vous réinventez tout, en présence de toutes les langues qu’elle aime plus que tout. La langue, les langues qui se jouent des hommes, les langues qui se rient de nous » (LM, 314).
Mais ce combat, en 2007, n’est-il pas un peu un combat d’arrière-garde ? Il y a longtemps, en 2007, que des écrivains comme Yasmina Khadra, Ahmadou Kourouma, Michel Tremblay, voire, pour les aînés, Kateb Yacine, Césaire, Senghor, Gabrielle Roy, et Jean-Joseph Rabearivelo, sont reconnus pour leur immense apport non seulement à la langue française, la dégageant d’une pureté sans doute fantasmée depuis toujours, mais aussi à la littérature mondiale. Des écrivains comme Milan Kundera, qui est tchèque, et Vassilis Alexakis, qui est grec, rejoignent les écrivains de langue française en adoptant le français comme langue de l’exil : ils l’enrichissent de leur nostalgie, et de leur croyance farouche dans un outil linguistique qu’ils conçoivent et utilisent comme l’outil de leur liberté15. Ces écarts, ces sauts au sein d’une langue permettent, pour eux, des textes osant braver tous les interdits et exprimer toutes les sensibilités. Il ne s’agit plus, alors de lutter contre la pureté d’une langue, mais de vivre profondément, grâce à la langue française conçue comme simple outil, cette vérité de la création littéraire que défend Nancy Huston dans le manifeste : si l’on parle de littérature, toute création est nécessairement dans « une autre langue ». Nancy Huston cite Marina Tsvetaïeva : « Écrire c’est déjà traduire de sa langue maternelle dans une autre, peu importe qu’il s’agisse de français ou d’allemand. Aucune langue n’est maternelle. Écrire des poèmes, c’est écrire d’après » (LM, 151).
Cette référence utilisée par Nancy Huston souligne le biais francophone utilisé par les autres contributeurs. Pour Nancy Huston (mais rappelons que la langue française n’est pas forcément pour elle la langue de colonisateurs, ni celle de vainqueurs et d’oppresseurs), il ne s’agit pas tant de pureté, que d’un déplacement nécessaire de la familiarité avec une langue, inhérent à toute création littéraire. Dans tout processus de création artistique, l’idée même de pureté est absurde. Qui, en littérature, peut en effet se targuer de pureté ? Camille de Toledo pose la question : « Sans que l’on sache jamais qui ils [les écrivains du manifeste] dénonçaient chez “les maîtres-penseurs”, dans le vieux centre de la littérature “franco-française” […] Qui étaient ces maîtres-penseurs, ces linguistes, ces censeurs ? Dans le cas où on aurait osé nommer l’ennemi – Perec linguiste ? Beckett linguiste ? » (VF, 12). Wajdi Mouawad, qui parle pourtant dans son texte de « l’écriture comme champ de bataille », place le problème bien au-delà, et se réclame de Francis Ponge, dont on pourrait difficilement qualifier la poétique de « métissée ».
Grégoire Polet appelle, lui, à dépasser les « excès de prédétermination et préméditation zoliens » (LM, 132). Certes. Mais il semble que, au moins depuis Proust, cette prédétermination est largement oubliée et dépassée. Et, s’il faut parler de la langue et du projet de Zola, les travaux d’un critique comme Philippe Hamon sur la description ont montré depuis longtemps que la description du monde ou des personnages est justement le lieu de la création linguistique, stylistique, esthétique, dépassant largement le projet « scientifique » des romans16. L’idéologie du style que fustigent les contributeurs de la littérature-monde, semble curieusement remonter à une vision caricaturale des propositions du roman français du XIXe siècle.
Michel Le Bris initie ce combat, en le faisant glisser vers ce qu’il appelle une lutte contre « la langue-nation », appelant la littérature-monde à « libérer la langue de son pacte avec la nation » (LM, 46-47). Voilà qui était pertinent au moment où émergeaient les nations européennes, entre 1830 et 1880, et quand ces mêmes nations émergentes organisaient un véritable totalitarisme colonial basé sur les certitudes du colonisateur porteur de progrès et de liberté. Voilà qui était également pertinent au temps des luttes pour les indépendances, lorsque des écrivains comme Kateb Yacine en Algérie17, Léopold Sédar Senghor18, Cheikh Anta Diop19 au Sénégal, Aimé Césaire20 en Martinique réclamaient dans la construction de leur pensée et de leurs œuvres la libération du carcan idéologique européen. Mais en 2007, les nations se sont délitées, l’idée même de nation n’existe plus que très peu en littérature (sauf comme combat d’arrière-garde aux marges du politique, chez des écrivains comme Renaud Camus ou Richard Millet). Les œuvres d’Ahmadou Kourouma21 raillent à la fois les revendications nationales des pays africains qui voudraient suivre le modèle obsolète de la nation occidentale, et détruisent les structures de la langue française et de ses récits. Celles de Maryse Condé22, ou plus récemment celles de Marie N’Diaye23 ou de Fatou Diome24 se revendiquent d’une liberté de forme qui bouscule les cadres de la langue française. Michel Tremblay25, écrivain québécois, offre au français la plasticité d’une relation inattendue avec le joual, langue populaire du Québec.
Michel Le Bris et Grégoire Polet ne ferraillent-ils pas contre des fantômes ? À l’époque d’Onésime Reclus, l’idée de francophonie était synonyme de progrès. À l’époque de la littérature-monde, ce n’est plus le cas. Senghor, Césaire, Kateb Yacine ont fait exploser l’utopie fallacieuse. Michel Le Bris reproche aux tenants de ce qu’il appelle l’Empire du Signe26, de ne pas relever la force du sujet dans le poème. De n’y voir que des mots (LM, 47). Reprenant sans le dire et en le détournant le vocabulaire barthien, Michel Le Bris « croi[t] […] que tout romancier écrivant aujourd’hui dans une langue donnée le fait dans le bruissement27 autour de lui de toutes les langues du monde » (LM, 43).
Or, quelle est l’entreprise profonde initiée par ces sémioticiens autour de Roland Barthes ? Il ne s’agit pas, comme le dit Michel Le Bris, d’une « conception impérialiste de la langue » (LM, 35), ni d’une prise de pouvoir de « chapelles » parisiennes et absconses. Il s’agit, et les œuvres de Barthes en sont l’un des exemples les plus convaincants et les plus brillants, de ne plus se laisser prendre aux discours. De chercher, comme Barthes le fait dans Mythologies ou dans Fragments d’un discours amoureux, ce qui se cache derrière les mots et les phrases admis par tous. Ce faisant, Roland Barthes décrète certes la mort de l’auteur, mais c’est parce qu’il a vu et démontré que l’auteur est un ensemble de codes sociaux et de représentations construites qui se met en scène dans le texte et manipule le lecteur et le réel représenté. Barthes et les sémioticiens cherchent à comprendre comment se forge le langage, pour se débarrasser de la construction d’un langage unique, et interroger les évidences portées par les représentations et la pensée toutes faites. Ils revendiquent la liberté de la langue hors des codes et des symboles. L’écrivain a pour tâche de mettre en doute ces codes et ces symboles. Nancy Huston propose une définition féconde de ce travail d’écrivain, à la fois décrypteur du réel et force de proposition : « L’écrivain] écrit pour agrandir le monde, pour en repousser les frontières. Il écrit pour que le monde soit double, aéré, irrigué, interrogé, illuminé par un autre monde » (LM, 153). Trouver, donc, l’altérité, où qu’elle existe. Il s’agit, pour Roland Barthes, par exemple, de mettre en valeur un sujet qui porte la multiplicité au-dedans de lui-même. Rien de figé dans cette recherche. Peut-on dire que dans La Chambre Claire, Roland Barthes renie le sujet et le monde ? Ne cherche-t-il pas, plutôt, à révéler ce qu’il y a de plus intime et de plus universel (le visible, la trace, la vie, la mort), ce qui doit être raconté au-delà des signes ordinairement admis ?
Peut-on affirmer que Claude Simon, dans Les Géorgiques et La route des Flandres, refuse la langue chaotique qui dirait un monde chaotique ? Peut-on analyser les textes de Marguerite Duras dans le cycle dit « indochinois », ou même dans Un barrage contre le Pacifique, comme un discours de signes vides qui ne prend en compte ni la réalité du monde ni le sujet qui la perçoit ?
De fait, ce que tente de mettre en place l’entreprise structuraliste et sémiotique, c’est le doute sur une signification du texte qui serait non discutable. C’est la dictature d’une idéologie dont on ne pourrait discuter. Todorov explique parfaitement sa démarche biographique et ses engagements de chercheur, racontant comment l’analyse des signes et des structures lui a permis de contourner, puis de mettre en doute les diktats idéologiques de la Bulgarie soviétique28. Si la littérature, comme l’affirme Michel Le Bris, « implique à un moment ou à un autre de se rendre étranger à soi-même », si « écrire ne revient pas à exprimer une culture mais à nous en arracher » (LM, 56), existe-t-il un moyen plus fiable et plus efficace pour cet arrachement, que de guetter ce qui est trop familier dans notre culture, dans nos représentations et notre langue, afin de décaper le langage et en révéler les strates et les non-dits idéologiques ?
Ce qui semble le plus étonnant, c’est que dans le discours des tenants de la littérature-monde, reviennent les mots identité/pureté, mots dont on sait quel poids de déviances possibles ils transportent. Ces mots sont utilisés pour expliquer de quelle manière un écrivain – ou une institution, ou un lectorat – fait partie de la littérature-monde… ou n’en fait pas partie. Dangereux processus d’exclusion. Camille de Toledo relève ce processus, qu’il appelle maladresse… mais qui peut être plus dangereux qu’une simple maladresse :
« Ils [les écrivains du manifeste] ébauchèrent une relecture extrêmement simpliste de l’histoire littéraire où l’on voyait au centre les catarrheux, les dépressifs, ceux qui ont congédié le récit, l’histoire, la fiction, ceux à qui il manque le souffle et qui, par mélancolie, par tristesse, ne croient plus à l’imaginaire. Mais qui ? On ne le saura pas. […] Et à la périphérie, les écrivains, les vrais, entre deux mondes, entre deux langues, les outre-français qui appellent à un dépassement des frontières anciennes de la littérature et mettent en acte la rupture de la nation et de la langue » (VF, 15-16).
Et Camille de Toledo de souligner l’aspect non révolutionnaire du manifeste : « En suivant l’exemple post colonial anglo-saxon […] le manifeste s’associait assez malicieusement à des clivages construits, des oppositions admises » (VF, 16).
Alors qu’Onésime Reclus utilisait le mot francophonie selon la pensée progressiste de son temps, devons-nous refuser cette contextualisation pour le nôtre ? Devons-nous reprendre les mêmes mots et les mêmes dynamiques de conquête et d’exclusion, entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, entre ceux qui ont raison et ceux qui ont tort, pour inventer une nouvelle universalité tout aussi fallacieuse, peut-être, que celles du XIXe siècle ou du XXe siècle ? Démarche dangereuse non seulement pour l’échange et la vie des idées, pour la littérature, mais aussi pour la langue.
Quel monde pour la littérature-monde ?
De manière inattendue, lorsque Michel Le Bris cesse d’appeler à la naissance de cette nouvelle classification de la littérature, il revient à la description du monde breton qu’il a sous les yeux : « Voilà maintenant des heures que j’observe la baie de Terenez depuis la fenêtre de mon bureau, l’ombre fuyante des nuages sur les niches jaunes, les géométries savantes sculptées sur la vase par la mer en allée » (LM, 48).
De la même manière, Wajdi Mouawad organise son texte en trouvant racine dans une correspondance avec son père et les paysages de l’enfance. Fabienne Kanor replace son initiation à la francophonie puis à l’écriture dans sa lecture de Chamoiseau. Il s’agit bien, pour chacun d’entre eux, de découvrir, voire de révéler jusque dans le manifeste, le lieu où se trouve le cœur de leur langue multiple et de cette richesse qu’ils pratiquent et apportent. Ils ne trouvent pas cette richesse dans leur combat contre une langue pure, ni dans les récriminations contre une langue-nation. Ils la trouvent dans un retour à leur manière d’exister dans une vie intime et réelle, loin de tout combat et de toute idéologie. C’est, comme le montrent les pauses de Le Bris, la voix du père de Wajdi Mouawad, la forme du journal choisie par Fabienne Kanor, une attentive perception de ce qui est profondément à l’œuvre dans le processus créateur : multiplicité et entre-deux, certes, mais perçus par un sujet dépouillé de ses réflexes identitaires, de ses formules idéologiques, de ses emphases rhétoriques, de ses idéaux révolutionnaires, des « clivages construits » comme dit Camille de Toledo. Là, sans doute, se trouve la véritable révolution. Rimbaud, Michaux et Nicolas Bouvier ont parfaitement mis en pratique, malgré leur appartenance sans doute à cette écriture-monde, le nécessaire effacement du sujet pensant pour mieux atteindre l’illumination du monde. Pour les écrivains de la fin du XXe siècle qui ne sont ni Michaux, ni Rimbaud, ni Bouvier (c’est-à-dire qui ne sont pas de ceux qui mettent sciemment en danger leur personne, leurs croyances, leurs pensées et leur spiritualité), cette révolution n’est possible que parce qu’une ou deux générations d’écrivains ont étudié le fonctionnement des systèmes de signes, pour en débusquer la fausseté et les illusions, afin que d’autres, les voyageurs, puissent se sentir libres face à leur langue personnelle. Si Michel Le Bris, à la suite de Waberi, célèbre la fin de la francophonie, il ajoute, car il est conscient de l’ambiguïté de sa proposition : « oui, si l’on entend par là un espace sur lequel la France mère des arts, dépositaire de l’université, dispensant ses lumières » (LM, 45)… Il contextualise, en quelque sorte, et rend à Onésime Reclus les illusions qui appartiennent à son temps. Mais c’est aussitôt pour rejeter le mot de francophonie. Certes, à brasser large, on fait mieux entendre ses revendications. Mais à brasser trop large, on laisse s’installer des glissements sémantiques qui pourraient laisser une belle idée s’enliser dans des idées dangereuses de pureté versus non pureté, dont on sait qu’elles n’apportent que du danger.
En fait, le monde dont se réclame cette littérature-monde est très organisé. Il s’agit, selon Mabanckou, du « concept de la multiplicité d’expériences, la reconnaissance de la force de l’art dans ce qui apparaît comme le “désordre de la vie”. Elle part du constat qu’il nous faut désormais imaginer l’écrivain dans sa mobilité et dans l’influence que suscite en lui l’émerveillement de ce qui ne vient pas nécessairement de son univers » (LM, 64). Grégoire Polet va plus loin : « Le monde, un lieu de vie collective et simultanée, cela signifie simplement qu’il n’y a plus de centre, que tous les points sont le centre du monde » (LM, 127). Mais aussitôt, chacun des contributeurs semble ne pas pouvoir imaginer cet ailleurs loin d’un centre auquel il dit pourtant aspirer. Grégoire Polet ne peut envisager qu’il n’existe pas de centre. Il multiplie donc les centres : « confier à chacun de nos personnages le centre du monde : Révolution ! » (LM, 127)…
Or, cette multiplication des points de vue, des focalisations, et des lieux d’énonciation romanesques existe en littérature française au moins depuis Proust. Elle a été analysée et conceptualisée par l’un de ces critiques que Michel Le Bris voue aux gémonies : Gérard Genette, en 1972, dans Figures III29. Tout se passe comme si l’écrivain de la littérature-monde ne parvenait pas à s’extirper, de manière conceptuelle et/ou de manière créatrice et artistique, de cette vision du monde selon laquelle il existe un centre et/ou plusieurs centres, et des périphéries. Il se comporte comme si cette distribution topographique et symbolique en centre et marges était une norme indépassable. Même si le centre se trouve multiplié, il y a toujours des marges ou des périphéries à ces centres multiples.
Mabanckou voit le danger, et de manière plus précise : « Nous risquerions de réveiller le vieil exotisme » (LM, 65). Le mot est lâché, et il est absolument juste. Si réclamer un changement de conceptualisation en histoire littéraire est souvent légitime, en revanche, reprendre la même organisation, en luttant pour la faire disparaître, mais en la renforçant, c’est rater sa cible. C’est peut-être ce que fait le manifeste de la littérature-monde. Jean-Xavier Ridon, chercheur à l’université de Nottingham30, montre en quoi ce concept de littérature-monde en français conforte en fait le préfixe « exo » de cette littérature qui n’en finit plus de s’écrire dans les marges. Selon lui, le manifeste et le concept de littérature-monde ne font qu’habiller de modernité la pratique de cette littérature exotique, définitivement classée comme institution littéraire, et ne pouvant plus changer de classification sous ce nouveau concept. Ainsi, écrire de la littérature-monde placerait l’écrivain dans la case de ce marginal qui se situe loin de la métropole, de ses cadres et de ses points d’appui.
Plus grave, cette revendication renforce la représentation d’un monde rigide. Il existe bien des marginaux, qui sont éloignés du centre, et ces marginaux ne peuvent plus exister dans le centre (qui est centre de pouvoir et décisionnaire des normes, selon Foucault, rappelons-le) puisqu’ils existent dans ses marges. En suivant ce raisonnement, la littérature-monde n’effacerait pas un pouvoir central, au contraire elle le renforcerait. Elle donnerait non seulement des outils théoriques pour penser les marges et le centre, mais elle cantonnerait ces marges dans une esthétique. Michel Le Bris propose :
« Regarder, plutôt que des hommes-océans [référence à Victor Hugo] tout simplement dirais-je l’océan en chaque homme, la voix immense de ce qui en chacun se refuse à la seule loi du monde, aux stricts déterminismes de l’histoire ou de la matière et que, continuellement, réveillent nos histoires, nos fictions, et les figures du sens, cette étrange aventure qu’on dit littérature » (LM, 52).
Ce disant, Michel Le Bris n’impose-t-il pas, loin de Victor Hugo, la vision d’un monde centré toujours sur le même endroit, qui redéfinit la littérature exotique, sans jamais oublier le préfixe « ex » ? Se retrouver parmi ceux qui « se refusent à la seule loi du monde », parmi ceux qui se refusent « aux stricts déterminismes de l’histoire ou de la matière », c’est demeurer au dehors de, c’est rester dans l’ex de l’exotisme. C’est toujours classer les processus de création artistique selon qu’ils sont dedans ou dehors. Le monde tel que le revendiquent les écrivains du manifeste oublie les propositions philosophiques de notre époque (ce qui est logique, puisqu’ils renient les avancées intellectuelles de la critique des textes, ce qu’ils appellent le « Structuralisme »). Mais aussi, sur le plan de la représentation du monde, ils oublient ce que Clément Rosset, par exemple, analyse31. Le philosophe montre de quelle manière le réel (soit « le monde », selon les manifestes de la littérature-monde) n’est toujours représenté, en fait, que comme ce qui nous convient. L’homme a tendance à se détourner du réel qui le dérange, qui ne correspond pas à son désir ou à son image du monde, et à vivre ainsi dans une illusion du réel, dans le double du réel. Affirmer que le réel que la littérature-monde représente est le seul monde vivant, c’est oublier que l’homme est formé de représentations, et qu’il s’agit, pour un écrivain comme pour tout artiste, d’être conscient de ce biais créatif, et autant que possible, de lui résister. Selon Jean-Xavier Ridon, cette littérature-monde ne se dégage pas d’une hiérarchie des représentations. Et, partant, d’une hiérarchie dans le monde perçu et vécu. Il ne fait que la renverser. Dès lors, la littérature du réel comme rencontre de l’autre et de l’ailleurs se trouve pervertie. Si l’autre est défini par des règles, des refus et des normes, il n’est plus vraiment l’autre. La littérature n’est plus une ouverture sur le monde, mais une confirmation des convictions figeant ce même monde de part et d’autre. L’autre défini par mes normes n’est que le miroir de mes attentes.
On ne peut reprocher à ces grands écrivains de la littérature-monde d’être dans l’imposition de nouvelles normes, ou dans l’illusion. En revanche, on peut leur reconnaître le droit, voire le devoir, d’être conscients qu’ils jouent avec des représentations qu’ils façonnent, et de l’assumer. Camille de Toledo va plus loin dans cette analyse, expliquant à quel point, dans toute création littéraire, le texte devient autonome, et finit par ne représenter que le processus fictionnel et ses potentialités. Certes cette pensée de la fiction toute puissante n’est pas dominante, et au XXIe siècle les romans témoignages ont le vent en poupe, mais qui peut se targuer (malgré les essais) d’aller retrouver Marguerite Duras sur le Mékong ? Qui, parmi les lecteurs de Salman Rushdie, pourrait retrouver l’Inde de ses romans ? Nombreux sont les voyageurs qui sont partis sur la route de L’Usage du Monde, de Nicolas Bouvier. Frédéric Lecloux en a rapporté un beau récit de photos32. En 2008, Gaël Métroz tourne in situ un film qu’il intitule Nomad’s land – sur les traces de Nicolas Bouvier. Voyage déceptif pour l’un, route détournée pour l’autre. Le texte et le film ne sont pas ce qu’ils prévoyaient d’être. On ne retrouve pas « le monde ». Le lecteur effleure parfois le monde perçu de Nicolas Bouvier, mais il retrouve surtout le monde de l’écrivain-photographe et celui du cinéaste.
Écriture-monde : si cette ambition oublie que le monde que nous pouvons écrire, décrire, narrer, n’est que notre monde, celui de nos représentations construites, elle oublie la multiplicité de ce qu’est le monde, et risque de glisser vers une vision idéaliste et rigide de ce qu’est la littérature. Ne pas obéir au romantisme aliénant du beau mensonge sur le monde, c’est, soit prendre en compte le chemin tracé par les analystes des discours et des signes, et apprendre auprès d’eux à se méfier des mensonges de la langue, soit effectuer sur son existence de sujet au monde un travail immense d’effacement qui n’est jamais terminé.
Réinventer la francophonie ?
D’où vient l’idée de littérature-monde ? Michel Le Bris rappelle la naissance, au début des années 1990, du festival Étonnants Voyageurs dans la ville de Saint-Malo, et lie explicitement le manifeste pour la littérature-monde à la littérature voyageuse.
Revenons à ces prémisses. En 1992, un collectif d’écrivains voyageurs qui ne songent pas à se revendiquer de la langue française, publie un petit volume : Pour une littérature voyageuse33. Contributeurs : Alain Borer, Michel Chaillou, Jean-Luc Coatalem, Alain Dugrand, Jacques Lacarrière, Gilles Lapouge, Michel Le Bris, Jacques Meunier, Georges Walter et Kenneth White. Ce volume ne propose pas seulement de saisir le monde extérieur qui serait celui du « Grand Dehors ». Il propose aussi une forme de poétique, au sens étymologique : un processus de création qui, à la manière de Kerouac, de Bruce Chatwin, de Stevenson, de Conrad, du Miller du Colosse de Maroussi, affirme que toute écriture littéraire est d’abord une écriture du déplacement, du décentrement et du mouvement. Le succès du festival Étonnants Voyageurs lancé par Michel Le Bris, ainsi que les publications toujours plus nombreuses et toujours plus demandées des récits de voyage viendraient, d’après les contributeurs, de cette authenticité de l’écriture littéraire lorsqu’elle est conçue comme un déplacement dans le réel. Kenneth White, dans la dernière contribution du volume, développe le concept qui lui est cher, et dont il est l’auteur, de géopoétique. Il se réclame de la parole de Novalis, appelant déjà de ses vœux un décentrement de l’acte de création vers la terre et non vers l’aventure psychologique, et posant ainsi les fondations du romantisme allemand – « L’art d’écrire n’a pas encore été inventé, […] mais il est sur le point de l’être […] Ces livres [de voyage] véhiculaient tout un déplacement culturel, concentrant toute une recherche encyclopédique, psycho-cosmique » (Kenneth White, LV, 192) – et traverse les siècles pour montrer à quel point ce que l’Europe et la littérature américaine appellent « roman » s’est appauvri au contact de l’esprit humain insuffisamment voyageur. Kenneth White se réclame également d’Henry Miller, s’écriant, d’après lui : « J’en ai marre d’écrire des romans, à partir de maintenant je vais écrire pour les canards sauvages ! » (cité par Kenneth White, LV, 193).
En dehors du pittoresque de ces citations, ce que propose Kenneth White est une poétique dans laquelle le principe de la création littéraire vient du statut du voyageur : « Nous les voyageurs sommes ainsi faits. Notre pulsion pour le voyage est en grande partie de l’amour, de l’érotisme. Le voyage romantique est à moitié rien d’autre que l’attente de l’aventure. L’autre moitié est cependant une pulsion à métamorphoser et à résoudre l’érotisme. Et cet amour, qui appartenait en fait à la femme, est à distribuer en jouant au village et à la montagne, au lac et à la gorge. Nous détachons l’amour de l’objet. […] Nous ne cherchons pas de but dans le voyage, mais seulement la jouissance du voyage lui-même, le fait d’être en chemin » (Kenneth White, LV, 191). Et Kenneth White de commenter : « Que l’éros fasse partie du voyage, c’est certain, mais à l’éros s’ajoute le logos, et le logos s’ouvre sur le cosmos. […] Il s’agit d’ouvrir un autre espace » (ibid.). La géopoétique proposée consiste donc à « renouveler notre rapport à la terre, de rendre ce rapport plus complexe, plus subtil, plus intelligent et plus sensible [selon une] conception globale des choses, alliée à une composition, une expression » (ibid.).
Si la proposition est intéressante, et la référence à Hesse enrichissante, il subsiste chez Kenneth White des angles morts. Relevons-en deux : Le premier est celui de la « jouissance du voyage ». Du voyage sans but. La représentation du monde, dans une littérature voyageuse, serait donc simple jouissance. Or, ce n’est pas si simple. De tous les écrivains voyageurs, pas un seul qui ne revendique un véritable travail de l’écriture. Il ne s’agit pas seulement du logos comme « moyen d’expression », mais d’un véritable « travail à l’atelier », selon les mots de Nicolas Bouvier. Écrire le monde est un déplacement des formes de la représentation. Et ce déplacement ne se contente pas de prendre en compte l’ordre marge/centre, ou unicité/multiplicité. Il s’agit, pour les écrivains-voyageurs, de mettre en danger les formes habituelles (figées) de la langue, pour atteindre la singularité d’un rapport au réel. Le déplacement dans l’espace est un outil dans le travail du texte comme compte rendu du réel rencontré sur le chemin. Bouvier le montre dans Le Poisson-Scorpion34 : le voyageur, pour devenir écrivain, ne se contente pas de jouissance. Il doit aussi passer par la dépression, la maladie35, l’ascétisme du corps, des mots et des formes, pour atteindre une forme de vérité littéraire. Ainsi la « jouissance » et le « chemin sans but » sont-ils surtout travail d’ascétisme. Sans le vouloir certainement, Kenneth White et ses propositions esthétiques ne s’éloignent pas tant que cela des analyses de Roland Barthes dans Le Plaisir du texte36. Une fois de plus, les voyageurs sont les héritiers des sémiologues et des analystes du discours. Ils font bien de ne pas refuser ce précieux héritage, qui leur permet de travailler les signes et la langue comme une matière, et de ne pas se laisser prendre aux illusions des mots. Alors, en effet, comme l’affirme Kenneth White, le logos peut atteindre au cosmos. La langue débarrassée de ses faux-semblants, de ses clichés, et de ses images et élans trompeurs, peut atteindre une forme de création poétique proche du sensible. L’utilisation de l’outil de la langue par ces écrivains, qu’ils soient voyageurs ou tenants de la littérature-monde, est aussi une redéfinition de la langue. La jouissance du voyage sans but est en fait une difficile entreprise de dénuement linguistique, intellectuel et imaginaire. Si seul le chemin importe, c’est un chemin ascétique, qui emprunte aux travailleurs du discours bien des épreuves et des hypothèses.
Le second angle mort des propositions de Kenneth White est celui qui suggère de « renouveler notre rapport à la terre, de rendre ce rapport plus complexe, plus subtil, plus intelligent et plus sensible ». Mais de quelle terre parle-t-on ici ? S’il s’agit uniquement de cette terre que les écrivains-voyageurs arpentent, dans quelle mesure seuls quelques élus peuvent-ils se targuer d’être en capacité d’entretenir ce rapport « plus intelligent » avec la terre ? En quoi, parce qu’il est voyageur, un écrivain serait-il plus lucide sur ce monde arpenté depuis des millénaires par des milliards d’humains ? La proposition de Kenneth White est abrupte, et elle oublie ce que Bouvier lui-même soulignait, lorsqu’il admirait les textes de Cingria : on peut voir le monde sans bouger d’un centimètre. Elle oublie aussi qu’au XXIe siècle (ou à partir des années 1970), des milliers d’humains peuvent parcourir la planète, et que le temps des Malraux au Cambodge, des Segalen en Chine, ou des Gide au Congo, est révolu. Le monde est sans cesse regardé, raconté, senti, décrit par des millions d’individus, tous plus ou moins soumis à des biais cognitifs, des connaissances intuitives ou érudites, des points de vue, des principes religieux ou des expériences philosophiques et culturelles, des images aux cadrages subjectifs ou tronqués. Dès lors, ce que les écrivains voyageurs proposent – et quelques-uns parmi eux en sont conscients – c’est seulement une image du monde centrée sur eux-mêmes. C’est-à-dire sur leur identité de voyageurs. Ce que Kenneth White appelle « la terre », c’est la perception de quelques-uns, une perception mouvante, éphémère, discutable, prête à être sans cesse renouvelée, transformée, racontée et présentée autrement. Cette perception, Camille de Toledo l’appelle « les fictions rêvées »37. Car c’est un fait : raconter le monde, c’est raconter un fantasme de monde. Ce que Kenneth White propose, c’est un monde centré sur le fantasme du voyage dans un ailleurs qui n’existe peut-être pas. Michel Le Bris souhaite des textes qui parlent du réel « comme l’entend Segalen ». Mais depuis Segalen et son esthétique du divers, nous avons changé de monde. Le voyage du XXIe siècle n’est plus celui de René Leys ou des Immémoriaux. Il est cette multiplication des moyens de locomotion, des regards déplacés, des voix décentrées. Il est cet aplanissement des paysages et des comportements par la mondialisation heureuse ou catastrophique, selon le point de vue. Il est cette liquidité contemporaine des esprits et des imaginaires. Le réel n’est plus ni cosmique, ni soumis au logos, et l’érotisme n’est plus univoque. Le monde – la terre – est à tout instant infiniment arpenté(e), et infiniment non possédable par les mots.
On peut aller plus loin, de manière moins néologisante, et défendre une idée dont nous avons montré dans notre première partie que le manifeste la contournait de manière maladroite, et qui est pourtant constitutive de cette littérature du déplacement : il s’agit de la forme obstinée d’effacement du sujet pour aboutir à une disponibilité absolue de l’écrivain et du voyageur aux propositions du voyage. Nicolas Bouvier en est l’un des plus grands adeptes, et l’un de ceux qui réussissent le mieux à tenir ce pari de l’effacement du sujet. Pas de voyage sans que « le monde, comme une eau, vous traverse38 ». Or, la littérature-monde, dans les mots de Michel Le Bris, semble affirmer le contraire, appelant au retour du sujet et du récit. Si Nicolas Bouvier, en 1955, propose cette alternative énonciative, ce n’est pas par coquetterie littéraire. C’est parce que le monde auquel il est confronté ne s’adapte jamais à l’ego littéraire d’un seul (et en particulier d’un seul sujet occidental voyageant dans un ailleurs qui n’est ailleurs que pour lui, pas pour les hommes et les femmes qu’il rencontre). C’est sans doute l’un des grands apports de la littérature de voyage à notre modernité, au moment où entrent en jeu le doute et le soupçon occidentaux. Dans l’écriture du monde en voyage, il y a donc l’acceptation de cette multiplicité moderne des voix possibles. Il est impossible pour un Bouvier ou un Lacarrière39 de ne pas entendre son propre effacement. De ne pas entendre, même, l’effacement de tout sujet, la mise en question du réel par la puissance des voix autres. Dès lors, ce qui est en cause, ce n’est pas tant le monde ou la langue, que la disposition du sujet à s’effacer pour faire advenir la multiplicité qui le dépassera toujours. Notre monde moderne est la conscience de cette multiplicité. Camille de Toledo sauve une partie du manifeste de la littérature-monde, en voyant dans cette disposition une forme de sacré, qui dépasserait la voix individuelle. Peut-être, la foi des voyageurs et des contributeurs au manifeste dans les pouvoirs de la littérature comme voix toujours autre et multiple, peut en effet éclairer ce nouveau rapport au monde entretenu par le XXIe siècle : incertain, soupçonneux, multiforme. Mais aussi hospitalier.
Dès lors, dans cette littérature-monde issue de la littérature voyageuse, est-il possible de sauver l’idée de francophonie ? Une fois que le mot est débarrassé de ses poids historiques, politiques, institutionnels et néo-coloniaux ? Oui, si on envisage cette francophonie comme l’ensemble des utilisateurs d’une langue qui est un outil multiforme et hospitalier. C’est-à-dire un outil qui ne servira plus les idées de centre et de périphérie (fût-ce pour les combattre), ni de vérité unique et universelle, ni d’origines, ni de normes, ni de jouissance spontanée et exclusive par ceux qui la maitrisent ou la réinventent. En concevant aussi la langue comme le lieu où l’énonciateur s’efface comme locuteur alourdi de passé et de principes. C’est ce que souhaitaient, au départ, les écrivains-voyageurs.
Rappelons-le, à la suite de Jean-Xavier Ridon et de Camille de Toledo : la francophonie n’a pas les caractéristiques des communautés de langue anglaise, celles qui ont fait naitre un Salman Rushdie. Pour une raison institutionnelle toute simple si on s’en tient à la surface des choses : il n’existe pas, au Québec, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, à Madagascar, en Algérie, au Maroc, à Pointe à Pitre, à Cayenne ou à Fort de France, de champ littéraire institutionnel, social et économique qui pourrait avoir autant d’importance que le champ littéraire métropolitain, avec éditions, prix, académies, réseaux de librairies, festivals, résidences d’artistes, institutions de subventions. Cette absence est historique, certes, mais le combat pour une littérature-monde en français reste faible, s’il ne s’attaque pas à ces piliers institutionnels. Réclamer une littérature-monde en français sans inventer d’autres centres que Paris et la France, c’est illusoire. Et dans ce combat, fustiger la francophonie, c’est se battre contre un moulin à vent. La francophonie existe, et elle se réinvente sans cesse à l’aune de la multiplicité du monde contemporain.
La littérature-monde en français existe, point n’est besoin, peut-être, d’un manifeste pour appeler à sa naissance. Surtout, imposer dans ce manifeste de nouvelles normes, de nouvelles exclusions, de nouveaux combats identitaires, c’est acheter un cercueil à la littérature-monde juste après avoir appelé à sa naissance. Proposer une idéologie, fût-elle nouvelle, c’est nier la littérature. Michel Le Bris le dit lui-même, dans Pour une littérature voyageuse : « Nous savons, aujourd’hui un peu mieux qu’hier, de quoi meurt la littérature : de s’être fait la servante des idéologies, sous le prétexte de l’engagement » (LV, 140).
Pourquoi alors, proposer une nouvelle idéologie, sous les mots « littérature-monde », une idéologie combattante, excluante, impérieuse, appelant tout autant que toutes les autres à un entre-soi ? Enlevons au mot francophonie ses réflexes nauséabonds de rapports de pouvoir, de centre et de marges, d’affirmations nostalgiques des identités excluantes. Donnons au mot sa puissance de langue mobile et hospitalière, favorisons la naissance de champs littéraires francophones efficaces ailleurs que dans l’Hexagone. Une langue est un outil de partage. Une littérature est un moyen de multiplication des sensibilités humaines.
Notes
- Cette précision est importante, voir infra, nos réflexions en fin de première partie de cette étude.
- Michel Le Bris et Jean Rouaud (dir.), Pour une littérature-monde, Paris, Gallimard, 2007, abrégé en LM, suivi du numéro de page, dans les notes infra.
- Les contributeurs au volume sont les suivants (par ordre d’intervention) : Jean Rouaud, Michel Le Bris, Alain Mabanckou, (entretien avec) Édouard Glissant, Dany Laferrière, Jacques Godbout, Tahar Ben Jelloun, Grégoire Polet, Patrick Raynal, Ananda Devi, Nancy Huston, Boualem Sansal, Wajdi Mouawad, Lyonel Trouillot. Maryse Condé, Nimrod, Fabienne Kanor, Anna Moï, Brina Svit, Eva Alamassy, Michel Layaz, Esther Orner, Chahdortt Djavann, Raharimanana, Gary Victor, Dai Sijie.
- Nous appelons « institutions » ce qui constitue la part la plus visible de ce que Pierre Bourdieu nomme le champ littéraire et oriente les choix des lecteurs : académies, jurys de prix, grands médias nationaux ou régionaux, associations de lecteurs, souvent programmes scolaires voire universitaires, critiques littéraires adoubés par les médias et les discours officiels, enfin, en France, les maisons d’édition à réputation ancienne et incontournable, longtemps parisiennes et concentrées à Saint-Germain-des-Prés (Gallimard, Grasset, Seuil), rassemblant les publications de ce qui est considéré comme le patrimoine littéraire français au moins du XXe siècle (Proust, Céline, Camus, Aragon, Malraux, Perec et d’autres). De manière plus récente, il s’agit de maisons d’éditions même « de province » ayant publié des textes couronnés par de grands prix prestigieux : Actes Sud et les éditions Verdier par exemple. C’est ce que Michel Le Bris appelle le « milieu littéraire » dans Pour une littérature-monde.
- Philippe Jaccottet, L’Effraie et autres poésies, Paris, Gallimard, 1953. Philippe Jaccottet, poète suisse, a d’ailleurs été naturalisé français en 1950. (Nous ne citons que son premier recueil.)
- Jean-Philippe Toussaint, écrivain belge. La Salle de bain, Paris, Minuit, 1986 (nous ne citons que son premier roman, qui l’a fait connaitre).
- Antoine Wauters, écrivain et scénariste belge. Mahmoud et la montée des eaux, Lagrasse, Verdier, 2021 l’a fait connaitre du grand public
- Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art : genèse et structure du champ littéraire, éditions du Seuil, 1992.
- Patrick Chamoiseau, Écrire en pays dominé, Paris, Gallimard, 1997.
- Patrick Chamoiseau, Éloge de la créolité, Paris, Gallimard, 1989.
- Édouard Glissant, Introduction à une poétique du divers, Montréal, Presses de l’université de Montréal, 1995, Paris, Gallimard, 1996. Voir également, du même auteur, les volumes de Poétique : Soleil de la conscience, Paris, Seuil, 1956 ; L’intention poétique, Paris, Seuil, 1969 ; Poétique de la relation, Paris, Gallimard, 1990 ; Traité du Tout-monde, Paris, Gallimard, 1997 ; et La Cohée du Lamantin, Paris, Gallimard, 2005. En 2006, Édouard Glissant fonde l’institut du Tout-Monde, à Paris.
- Voir en particulier le formidable mélange des genres et des langues de Biblique des derniers gestes, Paris, Gallimard, 2002.
- Patrick Chamoiseau est lauréat du prix Goncourt pour son roman Texaco, publié aux éditions Gallimard en 1992.
- Camille de Toledo, Visiter le Flurkistan ou les illusions de la littérature-monde, Paris, PUF, 2008, noté VF, suivi du numéro de page, dans les références infra.
- Vassilis Alexakis affirme ainsi : « Je n’ai pas l’impression que mon passage au français, pour difficile qu’il fût et douloureux à bien des égards, a réduit mon imagination, limité ma liberté, atténué mon plaisir d’écrire. C’est le contraire qui est vrai : le français a augmenté mon plaisir, il m’a ouvert de nouveaux espaces de liberté. […] Certes, j’ai parfois l’impression pendant que j’écris que le français songe déjà à la suite du texte, qu’il va me faire des suggestions aussitôt que j’aurai terminé ma phrase en cours. Je peux les rejeter bien sûr, mais généralement elles vont dans le sens que je désire. », Paris-Athènes, 1989, Paris, Gallimard, Folio 2006, p. 18.
- Philippe Hamon, Du Descriptif, Paris, Hachette, 1981.
- Kateb Yacine, Nedjma, Paris, Seuil, 1956.
- Léopold Sédar Senghor, Éthiopiques, Paris, Seuil, 1956 ; Ce que je crois : Négritude, francité, et civilisation de l’universel, Paris, Grasset, 1988.
- Cheikh Anta Diop, Nations nègres et culture : de l’Antiquité nègre-égyptienne aux problèmes culturels de l’Afrique noire aujourd’hui, Paris, Présence africaine, 1954.
- Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Paris, Présence africaine, 1956.
- Ahmadou Kourouma, Les Soleils des indépendances, Paris, Seuil, 1970 ; Allah n’est pas obligé, Paris, Seuil, 2000.
- Maryse Condé, Célanire cou-coupé, Paris, Robert Laffont, 2000.
- Marie N’Diaye, Rosie Carpe, Paris, Minuit, 2001.
- Fatou Diome, Le ventre de l’Atlantique, Paris, Anne Carrière, 2003.
- Michel Tremblay, Les Belles-sœurs, Montréal, Leméac, 1968 et Chroniques du plateau Mont-Royal, Montréal, Leméac, 1978-1997 (9 volumes réunis en un seul volume en 2019 chez Leméac et Actes Sud).
- Sans citer Roland Barthes, auteur de ce titre et de cette formule. Rappelons que L’Empire des Signes est, au-delà d’un système théorique analysé ailleurs par Roland Barthes, l’éloge d’un langage qui, justement, entraine une faille dans l’univocité des langues humaines. Roland Barthes, L’Empire des Signes, Paris, Skira, 1970.
- Roland Barthes, Le bruissement de la langue, Paris, Seuil, 1984.
- Tzvetan Todorov, Devoirs et délices : une vie de passeur, Paris, Seuil, 2002.
- Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972.
- Jean-Xavier Ridon, « Littérature-Monde, or Redefining Exotic Literature? », dans Transnational French Studies, Postcolonialism and Littérature-monde, Liverpool, University of Liverpool Press, 2010, p. 195-209.
- Clément Rosset, Le Réel et son double, Paris, Gallimard, 1976.
- Frédéric, Lecloux L’usure du monde, Marseille, Le Bec en l’air, 2008.
- Pour une littérature voyageuse, Paris, Éditions Complexe, 1992, notée infra LV.
- Nicolas Bouvier, Le Poisson-Scorpion, Paris, Gallimard, 1985.
- Camille de Toledo rappelle très justement que celui qui est « malade », qui « tient la chambre » est peut-être celui qui est le tenant de notre modernité, celui qui sait voir notre réalité d’hommes du XXIe siècle, conscients de vivre dans des traumatismes, des illusions, des fantasmes, face à une réalité immuablement là, mais indicible.
- Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973.
- Op. cit, p. 29.
- Nicolas Bouvier, L’Usage du monde, Genève, Librairie Droz, 1963, excipit.
- Jacques Lacarrière, premier organisateur, en 1992, avec Michel Le Bris, Nicolas Bouvier et Jacques Meunier du festival Étonnants Voyageurs, lieu de naissance en 2007 du manifeste Pour une littérature monde. Son œuvre majeure est L’Été grec, Paris, Plon, collection Terre Humaine, 1976.