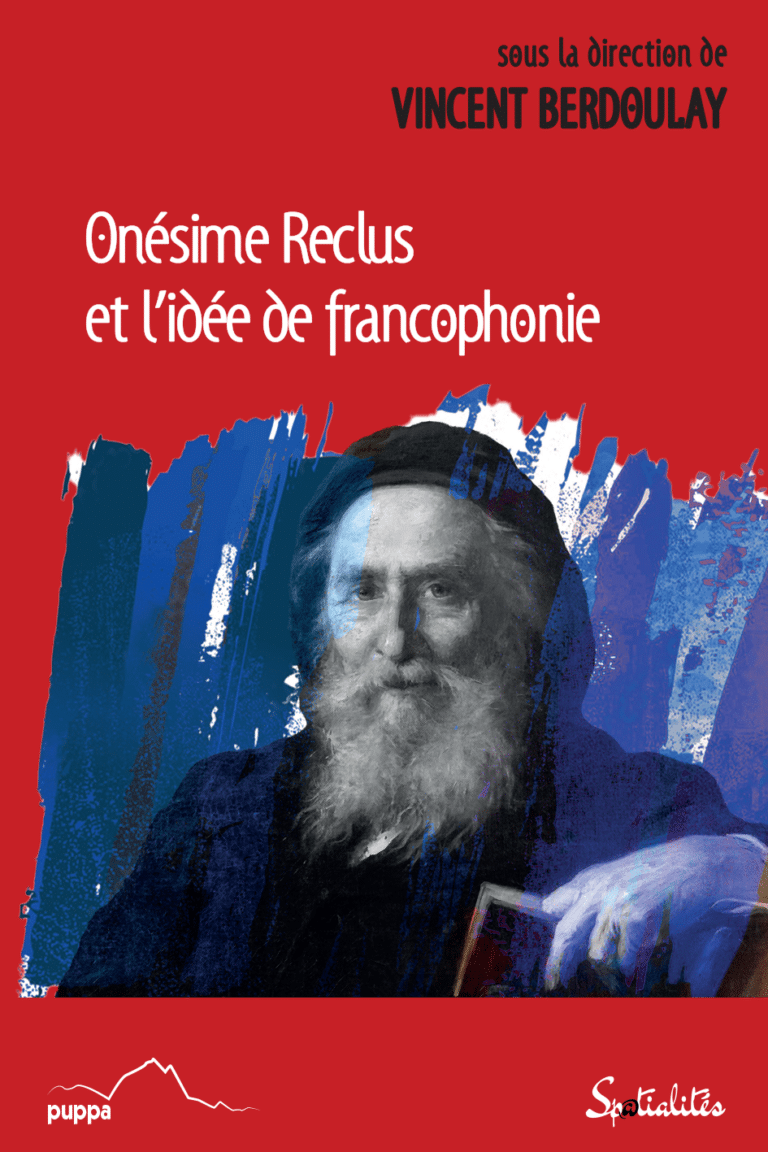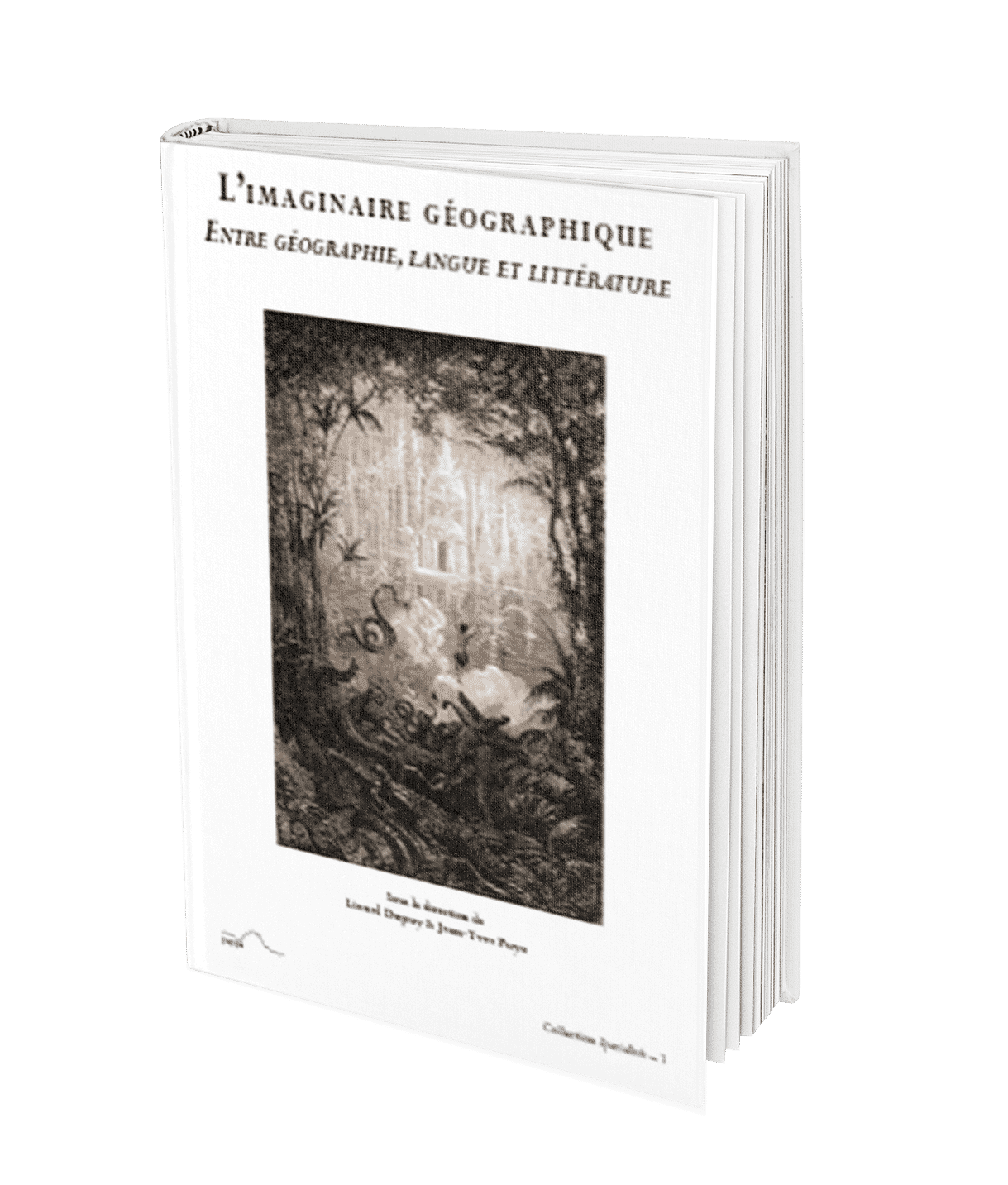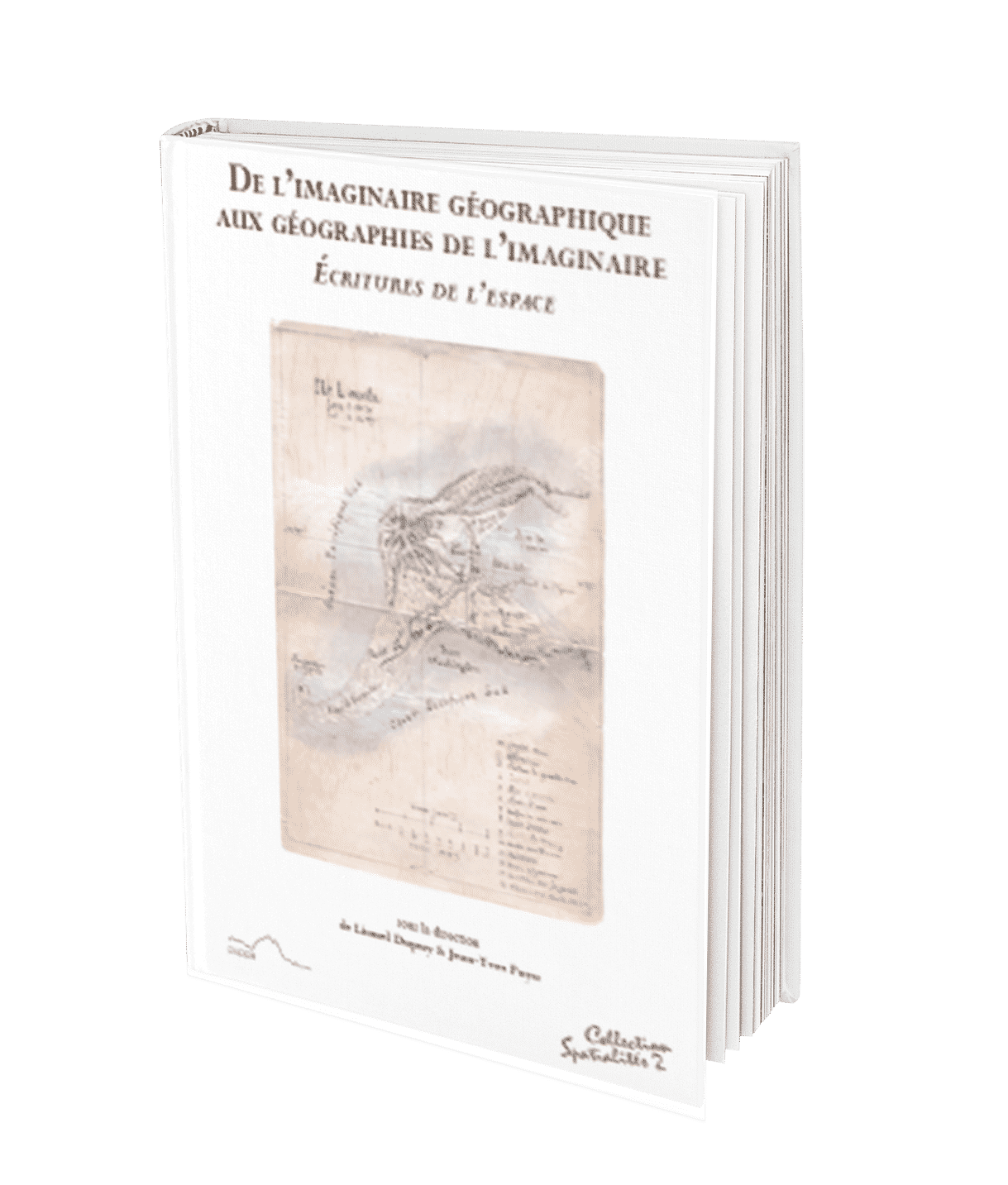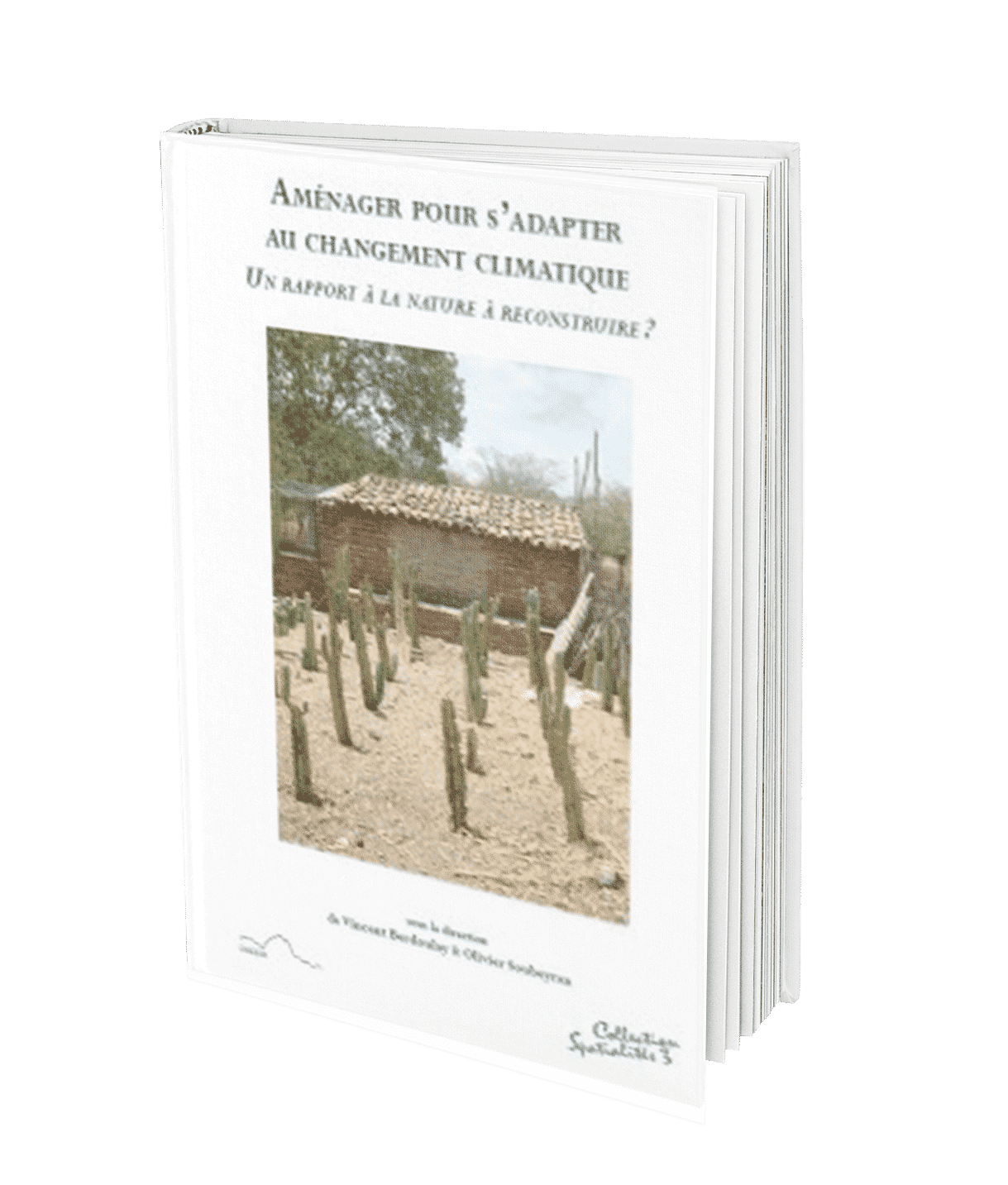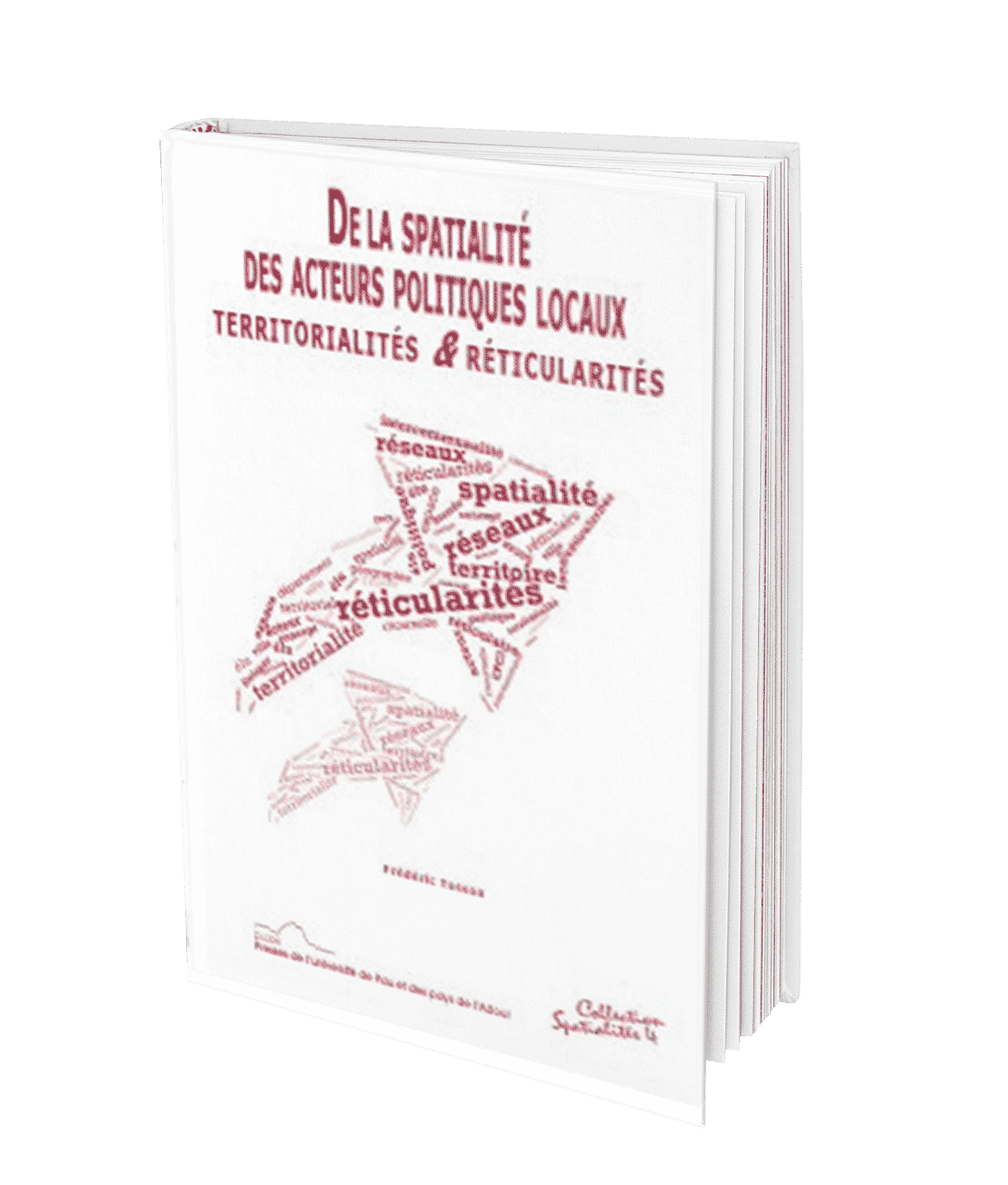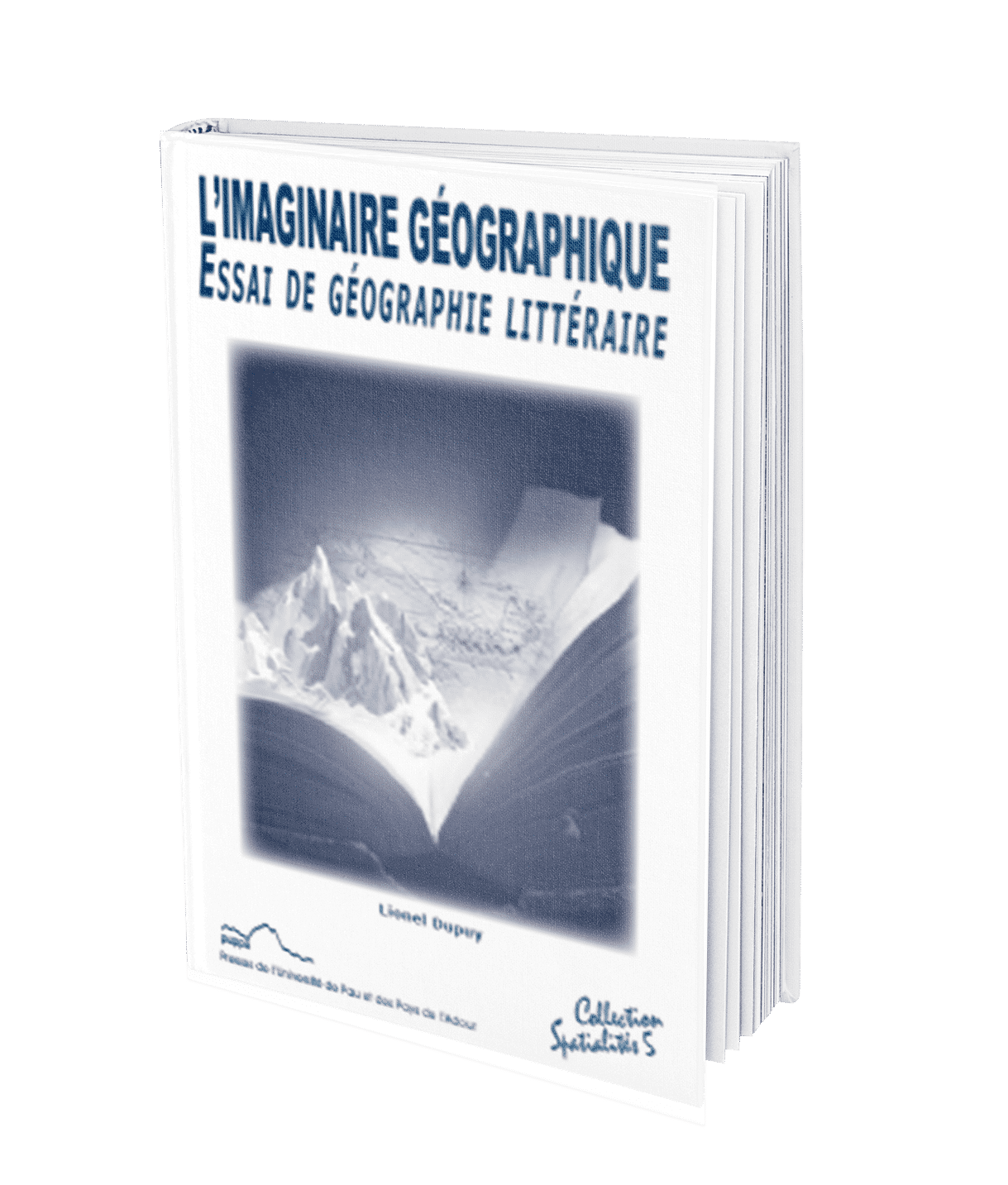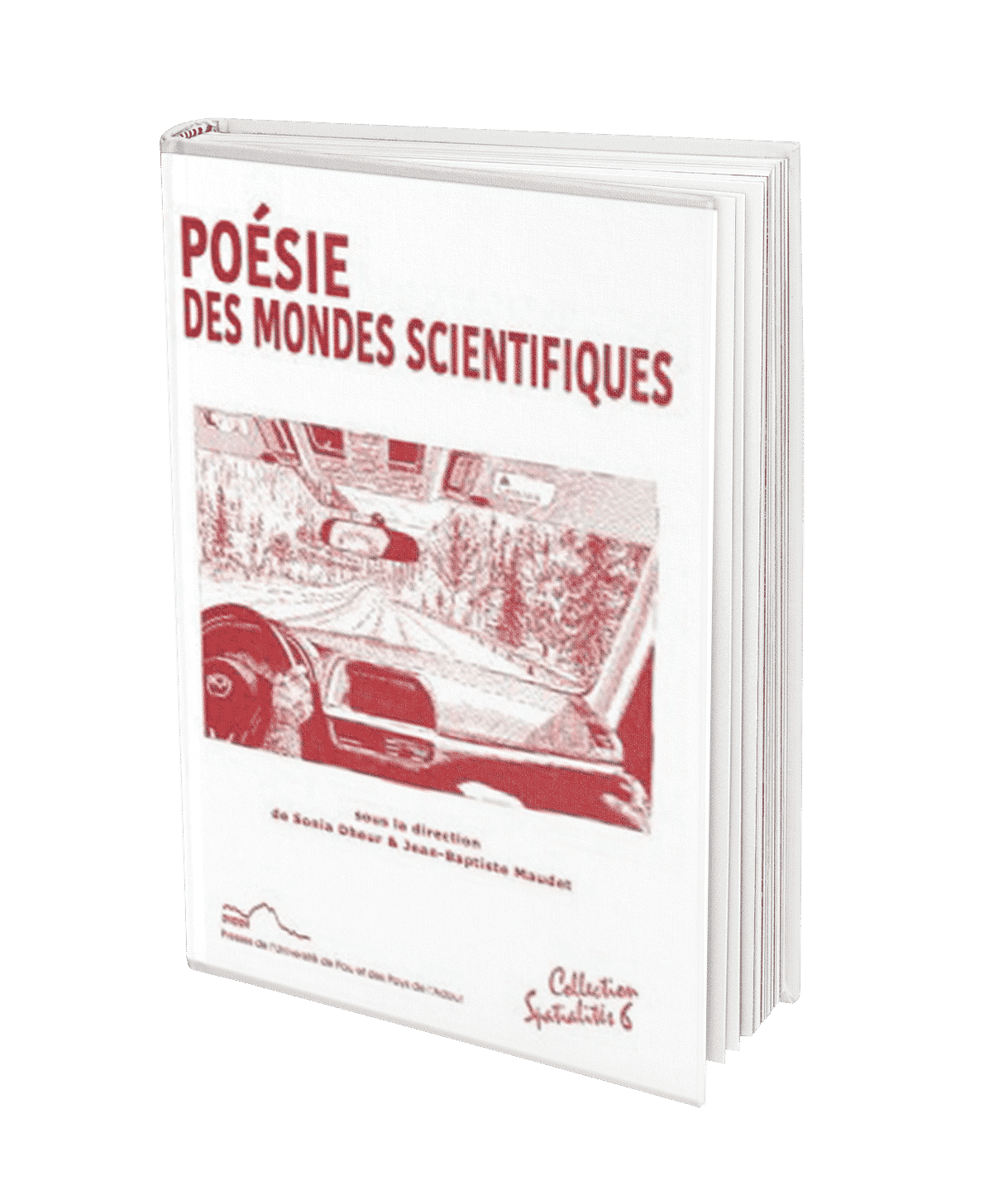Depuis l’Antiquité, l’Afrique est décrite, par les voyageurs, les explorateurs, les écrivains, les historiens, les géographes, comme un continent dont les habitants parlent plusieurs langues. Il n’y a pas de communauté linguistique monolingue. Chaque communauté linguistique parle les langues des communautés linguistiques voisines. Une seule personne peut parler jusqu’à cinq langues, voire plus. La langue française est parlée en Afrique avant la colonisation1. Les chefs côtiers du Cameroun écrivent plusieurs fois à la reine d’Angleterre pour lui demander de venir les coloniser. Cela signifie qu’ils lisaient et écrivaient déjà l’anglais avant la colonisation. Joseph Merrick, ancien esclave noir libéré par un acte de la Reine Victoria en 1838, raconte dans quelles circonstances il crée la toute première école à Bimbia au Cameroun en 1843. Il est abordé par des Africains : « Ils sont très désireux d’apprendre à écrire et à lire, et la raison qu’ils invoquent est qu’ils deviendront alors meilleurs commerçants et ne seront plus si facilement dupés comme ils l’étaient jusqu’alors »2. Cette école est créée pour apprendre aux Africains à lire et à écrire en vue de défendre leurs droits et leurs intérêts face aux commerçants européens. L’histoire de l’Afrique ne signale ni des conflits linguistiques, ni un vide linguistique soit à l’intérieur de l’Afrique, soit entre l’Afrique et le reste du monde.
Avec la création des grands empires, on ne voit aucun chef, aucun roi africain qui impose sa langue aux peuples conquis et leur interdit de parler toute autre langue que la sienne. Cette pratique est née avec le colonialisme ; Calvet décrit les langues coloniales comme des langues exclusives : « celles qui pour se développer hors de leur lieu d’origine font sous elles le vide des langues antérieures »3. Au moment où les pays africains deviennent indépendants, ils mettent à l’ordre du jour l’indépendance et l’unité linguistique de l’Afrique. Cependant, certains pays africains semblent opter pour l’appropriation des langues anciennement coloniales, parmi lesquelles le français.
Le présent chapitre n’a pas pour ambition de faire une étude des faits d’appropriation, soit dans le but de proposer « une méthodologie de remédiation »4, soit dans celui « de mieux comprendre le fonctionnement de la variété stylistique du français, objet d’appropriation »5. L’appropriation se faisant à deux principaux niveaux – social et institutionnel – nous nous concentrerons ici sur le niveau institutionnel6. Les États africains ayant fait du français leur langue officielle ne courent-ils pas le risque de connaître un développement aliéné7 ? Notre hypothèse est la suivante : le choix d’une langue étrangère comme langue officielle par un État vaut appropriation, sauf si celui-ci décide de renoncer à sa souveraineté.
Notre travail se fera dans le cadre de la sociolinguistique régulationniste, à la lumière de deux théories : la théorie des pôles et des relais et la théorie des régulations linguistiques8. Il s’articulera autour de trois points : 1) indépendance et unité linguistique de l’Afrique : un échec ? ; 2) évolution de l’attitude de l’OUA (Organisation de l’Unité africaine) vis-à-vis des langues étrangères ; 3) appropriation du français : une solution au problème linguistique en Afrique ?
Indépendance et unité linguistique de l’Afrique : un échec ?
Depuis sa création en 1963, l’OUA lutte pour la libération de l’Afrique du joug colonial et néocolonial, de l’apartheid et des séquelles post apartheid, des influences de la guerre froide et des conflits entre Israël, la Palestine et les pays arabes. Dans le cadre de la présente recherche nous n’allons nous occuper que du volet sociolinguistique de ce combat.
Directives de l’OUA pour la substitution des langues africaines aux langues étrangères en Afrique
Après leurs indépendances politiques, les pays africains se réunissent à Addis-Abeba en Éthiopie pour créer l’OUA. Le 25 mai 1963, trente-deux États prennent part à cet événement en qualité de membres fondateurs. L’un des objectifs majeurs qu’ils se fixent est l’indépendance linguistique de l’Afrique. La Charte de l’OUA dispose en son article XXIX que : « Les langues de travail de l’Organisation et de toutes ses institutions sont, si possible, des langues africaines, ainsi que le français, l’anglais et le portugais ». De surcroît, « tous les États membres signataires de la Charte de l’OUA, ont reconnu que l’unité et la solidarité qu’ils recherchaient et qu’ils s’efforçaient à réaliser, devaient s’effectuer, non seulement sur le plan politique et économique, mais aussi sur le plan culturel et linguistique »9. C’est ainsi que le Bureau linguistique inter-africain de l’OUA (BIL-OUA) dont le siège est fixé à Kampala en Ouganda sera créé en 1966.
Le BIL-OUA a pour cheval de bataille l’indépendance linguistique de l’Afrique. Il lutte contre la domination linguistique de l’Afrique et sa fragmentation par le colonialisme. Il encourage et soutient activement : « une pratique plus étendue des langues natales africaines à tous les niveaux et à tous usages » et travaille : « pour éliminer les langues étrangères à l’intérieur de l’OUA et dans d’autres activités panafricaines »10. Le BIL œuvre activement pour la promotion des « langues autochtones d’Afrique » et leur utilisation effective dans les affaires des États membres. Il s’investit dans l’adoption, par les Chefs d’État et de gouvernement, de la Charte Culturelle de l’Afrique (1976), du Plan d’Action de Lagos (1980) et du Plan d’Action Linguistique pour l’Afrique (1986) qui constituent les bases sur lesquelles repose le programme global et intégral de développement du continent.
La Charte Culturelle de l’Afrique11 préconise : « l’introduction et (l’) intensification de l’enseignement dans les langues nationales afin d’accélérer le processus de développement économique, social, politique et culturel de nos États » ; « Les États africains devront préparer et mettre en œuvre les réformes nécessaires à l’introduction des langues africaines dans l’enseignement. À cette fin, chaque État devra choisir une ou plusieurs langues » (art. 18) ; « L’introduction des langues africaines dans tous les ordres d’enseignement devra être menée de pair avec une alphabétisation des populations » (art. 19). Selon cette charte, « il ne saurait y avoir de politique culturelle sans politique d’information et de communication adéquate » (art. 20).
Les tentatives d’éradication des langues étrangères en Afrique
Depuis les temps anciens, les Africains pratiquent un multilinguisme additif. Ils considèrent le fait de parler plusieurs langues comme un gain, un avantage. Ce sont les étrangers qui, arrivés en Afrique, engagent une politique d’éradication des langues. Toutes les politiques linguistiques de substitution des langues étrangères en Afrique n’ont pas été faites à l’initiative de l’OUA. Dès 1913, le Gouverneur allemand interdit l’usage du pidgin english au Cameroun. Après la défaite de l’Allemagne à la première guerre mondiale (1914-1918), les puissances alliées décident de dégermaniser les anciennes colonies allemandes. Cette dégermanisation n’avait cependant pas été faite dans l’intérêt de l’Afrique12.
L’arabisation de l’Afrique
Les pays arabophones d’Afrique connaissent en réalité un processus d’arabisation-désarabisation-réarabisation. Les Arabes conquièrent certains territoires africains dès le VIIe siècle ap. J.-C. et y imposent leur langue, leur religion et leur culture par la force : c’est l’arabisation. Les Arabes ne parviennent cependant pas à éteindre les langues et les cultures africaines des territoires conquis. Les Berbères se battent pour préserver leur langue et leur identité culturelle.
Depuis le XIXe siècle, les Européens conquièrent à leur tour ces territoires et y imposent leurs langues, leurs cultures et leur religion : c’est la désarabisation. Cependant, l’arabe et les langues berbères survivent. Après l’accession à l’indépendance, ces pays choisissent de remplacer les langues anciennement coloniales par l’arabe, c’est la réarabisation. Celle-ci se fait avec le concours de la Ligue arabe, créée le 22 mars 1945 au Caire. Pour y adhérer, il faut entre autres remplir deux conditions : être indépendant et avoir l’arabe comme langue officielle. Quand les pays africains arabophones accèdent à l’indépendance, ils déposent leur candidature pour l’adhésion à la Ligue arabe, exception faite de l’Égypte qui est indépendante depuis 1922 et membre fondateur en 1945.
La réarabisation rencontre cependant des résistances : a) les populations autochtones luttent pour leur reconnaissance comme entités ethniques au plan institutionnel et la préservation de leurs langues et de leurs identités culturelles, b) celles-ci réclament la réinsertion des langues anciennement coloniales dans le système éducatif, c) certains continuent de considérer l’arabe comme une langue d’occupation.
En 1969 en Tunisie, onze ans après le début de la réarabisation, la langue française est réintroduite dans le système éducatif. Au Maroc, des mesures officielles sont prises en 1966 pour la réinsertion du français dans le système éducatif et le choix de l’arabe coranique comme langue d’enseignement. Les Berbères représentent 50 % de la population. Le Mouvement populaire fondé en 1957 réclame en permanence l’enseignement du berbère. Ce problème sera résolu dans la Constitution de 2011 qui stipule, en son article 5, que l’amazighe est : « langue officielle de l’État, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception ».
En Algérie, les Berbères représentent 30 % de la population. Ils s’opposent dès l’indépendance à la réarabisation. Ils marquent leur préférence pour le maintien du français et revendiquent l’utilisation officielle de l’arabe algérien et du berbère qu’ils considèrent comme des « langues populaires ». En réponse aux revendications des Berbères, le pouvoir algérien utilise la répression13. Depuis 1963, date de création de l’OUA, une succession de crises berbères ouvre la voie aux premières négociations entre les Arouch et le gouvernement en 2002. La révision de la Constitution et la reconnaissance du tamazight comme une langue nationale ramènent la paix sociale en Algérie.
L’arabisation n’a pas pu éteindre les langues autochtones. La colonisation n’a pas pu éteindre la langue arabe et les langues autochtones. La réarabisation n’a pas pu faire disparaître les langues autochtones et les langues européennes anciennement coloniales : anglais, italien, français. Le résultat est une cohabitation forcée qui peut être source de conflits. L’enquête menée par le KANTAR montre que, malgré l’arabisation, la langue française a conservé sa vitalité en Afrique du nord14.
La swahilisation
Le swahili n’est pas, à l’origine, une langue africaine, mais une langue née au Xe siècle du contact entre les langues bantoues parlées par les populations vivant sur la côte est africaine et l’arabe parlé par les marchands arabes et persans qui sillonnaient l’Océan Indien et habitaient les îles. Cette langue a cependant évolué au point où on la définit aujourd’hui comme une langue bantoue originaire de Tanganyika (actuelle Tanzanie).
Au XIXe siècle, le swahili se répand progressivement à l’intérieur du continent grâce au commerce des esclaves et de l’ivoire pratiqué par les caravaniers arabes. Les caravanes atteignent l’Ouganda vers 1850, l’Est de l’actuelle République démocratique du Congo entre 1870 et 1884. En 1885, le chancelier allemand, Otto von Bismarck, annonce la colonisation de l’Afrique de l’Est. L’administration coloniale allemande, dès ses débuts, impose le swahili comme la Landessprache ou langue territoriale (langue du pays, langue nationale, langue véhiculaire) du Tanganyika. Les missionnaires préfèrent enseigner les Stammessprachen, langues ethniques ou langues des tribus15.
La position du gouvernement ne fait pas l’unanimité au sein du clergé. Le swahili est victime de rejet de la part des congrégations religieuses occidentales qui le considèrent comme « la langue des musulmans de la côte »16. Pour que le swahili soit enseigné dans les écoles tenues par les missionnaires européens, cette langue doit passer de l’écriture arabe à l’écriture latine. Finalement, les missionnaires adoptent un enseignement bilingue langue ethnique-swahili. L’administration coloniale ouvre ses propres écoles où l’enseignement est d’abord dispensé en swahili. La loi du Protectorat du 10 septembre 1900 prévoit l’enseignement des langues européennes dans les colonies. Il se déclenche à Berlin le désir de diffuser la langue allemande dans les colonies, avant la Première Guerre mondiale. Le swahili reste la langue d’enseignement dans les écoles missionnaires, alors que dans les écoles gouvernementales l’allemand est introduit dans les classes supérieures. L’administration propose aux religieux d’importantes subventions pour l’introduction de l’enseignement de l’allemand dans leurs écoles : primes, fournitures, matériels scolaires17.
Après la défaite de l’Allemagne, les territoires allemands passent sous le contrôle des puissances alliées. Le Tanganyika est confié à l’Angleterre. Celle-ci favorise l’émergence du swahili. La langue allemande sera abandonnée. L’administration coloniale anglaise ne fait rien pour imposer la langue anglaise, l’éducation étant laissée aux mains des religieux. Les Britanniques donnent une aide insignifiante pour les écoles en général et les écoles de mission en particulier18.
En juin 1928, les Britanniques organisent le Comité sur la langue territoriale qui tient ses assises à Mombasa au Kenya, avec pour objet la normalisation d’un swahili standard. Le dialecte de Zanzibar, l’un des plus anciens, le kiunguja, est choisi comme base de la standardisation du swahili. L’administration coloniale britannique décide d’instituer le swahili comme langue commune à l’ensemble de ses colonies ou protectorats d’Afrique de l’Est : Ouganda, Kenya, Zanzibar et Tanganyika. À la fin des années 1950, la langue utilisée par les différents mouvements anticolonialistes, indépendantistes, nationalistes qui luttent pour les indépendances en Afrique de l’Est est le swahili. Maîtrisée par la quasi-totalité des habitants, cette langue réussit à fédérer les peuples de l’Afrique de l’Est en les amenant à développer une identité commune : l’identité swahili. Julius Nyerere, président du Tanganyika African Association (TAA) en 1953 et fondateur du Tanganyika African National Union (TANU) en 1954, dont le slogan est Uhuru na umoja (Liberté et unité), choisit le swahili comme langue officielle du Tanganyika indépendant le 9 décembre 1961, et de la Tanzanie indépendante le 24 avril 1964. L’Institut de recherche sur le swahili de l’University College de Dar-es-Salam et le Baraza ka Swahili la Taifa, organe officiel tanzanien, poursuivront l’unification et la standardisation du swahili. L’objectif est de supplanter l’anglais et de dépasser les clivages ethniques. Le swahili fait donc l’unanimité aussi bien au sein de la classe politique tanzanienne qu’au sein du peuple. La swahilisation de l’Afrique de l’Est est une réussite : « Parce que le kiswahili ne favorisait aucune ethnie, il fut aisément accepté par la société »19.
La langue anglaise est perçue comme la langue du colonisateur. S’affranchir de la présence du colonisateur équivaut aussi à s’affranchir de sa langue. Le swahili remplace progressivement l’anglais dans tous les domaines. À partir de 1965, le swahili devient la langue des campagnes politiques, de l’éducation, des tribunaux. En 1970, c’est la langue du parlement national. En 1980 l’enseignement secondaire se fait entièrement en swahili. En Afrique de l’Est, les enfants parlent, de moins en moins, non seulement la langue anglaise, mais aussi la langue de leurs grands-parents.
Le swahili quitte son berceau qui est la côte Est de l’Afrique. Aujourd’hui, il s’étend à plus de 14 pays : République Démocratique du Congo (RDC), Rwanda, Burundi, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Comores, Mozambique, Zimbabwe, Somalie, Malawi, Soudan du Sud, Oman, Yémen (Moyen-Orient). Depuis 1870, il est présent en Afrique centrale. Il a été adopté en Afrique australe où il est enseigné dans des écoles : Afrique du Sud, Botswana. La Namibie et d’autres pays envisagent de l’introduire dans leur système éducatif. Il est parlé au Moyen-Orient (Oman, Yémen).
Le swahili est langue maternelle au Kenya, en Tanzanie et au Mozambique. Il est langue officielle au Kenya, en Ouganda, au Rwanda et en Tanzanie. Il est langue nationale en République Démocratique du Congo. Il est langue officielle des organisations suivantes : Union africaine (UA), Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), Communauté de Développement de l’Afrique Australe (CDAA). La Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) a créé une institution dénommée East African Kiswahili Commission (EAKC) qui, depuis 2015, est leader dans la promotion du swahili dans la région de l’Afrique de l’Est et dans la coordination de son développement et de son utilisation pour l’intégration régionale et le développement durable. Le nombre de personnes ayant le swahili comme première langue est d’environ 15 millions. Les migrations ont permis au swahili de se développer au-delà du continent africain. Des personnes originaires de pays comme la RDC, la Somalie ou le Burundi se sont réfugiées dans des pays comme la Tanzanie où elles ont appris le swahili par immersion. D’autres se sont installées aux États-Unis où elles continuent de parler le swahili (il y est parlé dans des prisons par des prisonniers qui ne veulent pas se faire comprendre des autres). Le shikomor (ou comorien), langue officielle des Comores et aussi parlé à Mayotte (shimaoré), est très proche du swahili. Il est souvent considéré comme un dialecte du swahili, bien que certains le considèrent comme une langue distincte.
Le kiswahili est doté d’une importante masse critique capable de l’enseigner. Celle-ci n’est pas constituée seulement d’Africains. Il fut enseigné pour la première fois en 1961 à l’Université de Californie Los Angeles (UCLA). Aujourd’hui, il est enseigné aux États-Unis dans plus de 100 universités, collèges, lycées et écoles élémentaires. Selon Piedmont Global Language Solutions, un fournisseur de services linguistiques aux États-Unis, environ 90 000 personnes le parlent. Le swahili et l’amharique, langues originaires de l’Afrique de l’Est, sont enseignés dans des institutions russes. Les Nations Unies ont désigné la journée du 7 juillet comme la journée mondiale du kiswahili, première langue africaine à être ainsi valorisée. L’UNESCO en a fait la proposition parce que le swahili figure parmi les dix langues les plus parlées au monde, avec plus de 200 millions de locuteurs. Il s’impose aujourd’hui comme la langue des affaires en Afrique de l’Est20.
Cependant, la langue anglaise réapparaît en Tanzanie à la faveur de la création d’écoles primaires et secondaires où l’enseignement est dispensé en anglais. Il se développe ainsi en Tanzanie une nouvelle variété linguistique appelée Kiswa-English.
La malgachisation
Madagascar accède à l’indépendance en 1960. Cependant, jusque dans les années 1970, Madagascar est encore sous l’emprise de l’ancienne puissance coloniale, c’est-à-dire la France, des points de vue économique, éducatif et politique. C’est dans ces circonstances que naît le soulèvement qui conduit à la « malgachisation ». Le terme est créé dans les années 1970 pour désigner une politique linguistique et éducative (PLE) ayant le malgache comme langue d’enseignement. La contestation débute chez les étudiants de l’école de médecine de Befelatanana à Antananarivo et s’étend au milieu éducatif en janvier 1972. La répression violente qui s’ensuivra ne fera qu’amplifier le mouvement et engendrer les mouvements politiques de mai 1972 : « Les manifestants réclament un retour aux sources, une quête de la “malgachitude” afin de libérer le pays du “joug” colonial, notamment dans la gestion du pays en général et dans l’enseignement en particulier »21.
La malgachisation ne se réduit plus à une politique linguistique et éducative valorisant le malgache en tant que langue d’enseignement. Elle devient un vaste projet de société et un fourre-tout. Elle est née dans l’impréparation et connaît des dérapages et des débordements : « Le mouvement aboutit au renversement du pouvoir en place et à l’installation par les manifestants d’un pouvoir militaire en 1972, dirigé par le Général Gabriel Ramanantsoa, propulsé à la tête de l’État pour mener à bon escient le projet de société établi. Il est remplacé en 1975 par un pouvoir “révolutionnaire” du Capitaine de corvette Didier Ratsiraka, porté au pouvoir par référendum du 21 décembre 1975 »22. La compréhension du terme malgachisation varie d’un pouvoir à l’autre. Avec l’arrivée au pouvoir de Didier Ratsiraka en 1975, le concept de malgachisation inclut désormais, entre autres, la nationalisation des entreprises françaises installées dans le pays.
La politique linguistique et éducative et la révolution socialiste devaient se faire sur la base du malgache commun. Jusqu’au 17 juillet 1978, date à laquelle est promulguée la loi 78-080 qui formalise la politique linguistique et éducative de Madagascar, le malgache commun n’existe pas, chaque région utilisant sa variante régionale du malgache officiel alors que la malgachisation a commencé depuis 1972 et la révolution depuis 1975 : « Le malgache commun demeure un slogan sans lendemain, faute de planification et d’aménagement linguistique appropriés »23.
La malgachisation semble avoir réussi dans le primaire où elle est jugée « irréversible ». Elle semble n’avoir pas pu s’étendre au niveau du secondaire, ou elle est restée « stationnaire ». Des incohérences ont nui à son bon fonctionnement : 1) la traduction des manuels scolaires en malgache où se confrontent la tendance étymologique et celle fondée sur les emprunts, « au grand désarroi des enseignants et des élèves, qui ne savent plus laquelle des deux adopter »24 ; 2) les résultats catastrophiques, une baisse généralisée du niveau des élèves, des taux de redoublement et d’abandon élevés, une baisse du niveau des enseignants ; 3) le traumatisme engendré par l’échec qui se traduit par des représentations négatives des Malgaches sur leur langue et son incapacité à devenir une langue d’enseignement ; 4) le retour de la langue française dans le système éducatif (refrancisation). L’échec de la malgachisation a revalorisé la langue française qui est « devenue une langue de prestige et [est] préconisée par le Forum national de 1991, émanation des mouvements sociopolitiques de 1991 et réunissant les Forces vives de la Nation »25. Aujourd’hui à Madagascar, une nouvelle variété linguistique est née : le fran-gasy.
Les émeutes de Soweto
Les émeutes de Soweto désignent un ensemble de manifestations qui ont commencé le matin du 16 juin 1976 en Afrique du Sud par des élèves noirs de l’enseignement public secondaire, soutenus par le mouvement de la Conscience noire. Ces élèves décident de manifester parce qu’ils refusent de se laisser scolariser en afrikaans et veulent être scolarisés en anglais comme les enfants blancs. Pour disperser la foule, la police tire à balles réelles sur les manifestants faisant au moins 23 morts. Le mouvement va s’amplifier.
À l’origine des émeutes, il y a un décret signé en 1974 par M. C. Botha, ministre de l’Administration, du Développement et de l’Éducation bantoue, disposant que l’afrikaans serait la langue de l’enseignement à égalité avec l’anglais dans toutes les écoles noires. La mesure devait prendre effet à compter du 1er janvier 1975. Les Noirs d’Afrique du Sud, associant l’afrikaans à l’apartheid, considèrent que c’est la « langue de l’oppresseur ». Ils préfèrent l’anglais parce que c’est une langue internationale utilisée dans le commerce et l’industrie. Or, le décret de 1974 était destiné à sauver l’afrikaans de plus en plus abandonné par la jeune population noire.
Au début des émeutes, le 16 juin 1976, le bilan est de 23 morts et 200 blessés. À la fin des émeutes, certains parlent de 575 morts dont 570 Noirs. D’autres parlent de plus de 700 morts. En juillet 1976, pour calmer les manifestants, le gouvernement retire le décret de 1974. En 1977, l’ONU adopte un embargo sur les ventes d’armes à destination d’Afrique du Sud. L’OUA prendra une part active au boycott de l’Afrique du Sud. En 1979, une nouvelle loi sur l’éducation fait de l’anglais la langue principale d’enseignement dans les écoles publiques noires à partir de la cinquième année de scolarité. Depuis 1991, la journée de l’enfant africain est organisée chaque année le 16 juin sur toute l’étendue du continent africain en souvenir du massacre des enfants de Soweto.
Les pays ayant choisi de rester réservés sur la question linguistique
Depuis la création de l’OUA, certains États africains entretiennent une politique de mutisme autour de la question linguistique. Certains spécialistes26 ont diversement interprété ce phénomène. Pour le Bureau linguistique interafricain, les pays africains ne respectent pas leurs engagements en matière de politique linguistique27. Pour d’autres spécialistes, ces pays pratiquent le non-dit qui s’explique par le fait qu’ils sont incapables d’élaborer des politiques linguistiques explicites28. L’OUA pointe du doigt les États membres qui, quand ils sont en assemblée, adoptent une position, mais quand il faut la mettre en application en adoptent une autre. Le BIL-OUA note à cet effet : « un manque de volonté politique de la part des États membres individuels, non seulement de remplir toutes leurs obligations envers leur propre organisation, mais aussi d’agir en faveur des langues des populations majoritaires des États respectifs »29. L’élite africaine est particulièrement pointée du doigt parce qu’elle détient les pouvoirs intellectuel, administratif et politique, mais dénigre les langues autochtones alors qu’elle pourrait se servir de sa position sociale pour : « formuler une politique qui pourrait rehausser le statut des langues africaines en général »30.
On pourrait se poser la question de savoir si ce sont les pays africains membres fondateurs de l’OUA qui avaient rédigé la Charte de cette organisation. Sinon comment comprendre qu’ils ne soient pas en mesure de mettre en application des mesures qu’ils avaient eux-mêmes prises ? Vérification faite, c’est eux-mêmes qui l’avaient rédigée. Ce travail avait été confié à Modibo Keïta, président du Mali, et Sylvanus Olympio, président du Togo. Sylvanus Olympio sera assassiné par Nyassingbe Eyadema pendant qu’il rédigeait la Charte de l’OUA.
Le mutisme des dirigeants africains sur la question linguistique a-t-il pour origine l’assassinat de Sylvanus Olympio ? Si les pays francophones de l’Afrique subsaharienne peuvent prendre pour prétexte qu’ils n’ont pas été capables d’abandonner la langue française parce qu’ils étaient tenus par des accords secrets signés avec la France, que diront les pays anglophones, lusophones et hispanophones pour justifier le fait qu’ils n’aient pas substitué les langues africaines aux langues anciennement coloniales ?
Pierre Essengué semble avoir une réponse à cette question31. Il répertorie les critères pour qu’une langue soit érigée au statut de langue officielle. Selon lui, le « choix se fait non seulement en fonction des voisins avec lesquels on souhaite coopérer, mais aussi en fonction de critères objectifs que doit remplir la langue candidate à ce statut ». Sur le plan interne, il identifie trois conditions principales :
« (i) être véhiculaire ou acquérir un statut qui permet de le devenir, si elle ne l’est pas encore, en d’autres termes, elle doit être acceptée des locuteurs étrangers sans contrainte aucune, pour une raison qui peut être économique, politique ou stratégique ; (ii) avoir une tradition de normalisation définie par Mackey (1976, p. 311)32 comme “un facteur d’atténuation des variétés naturelles et des tendances évolutives du langage” ; (iii) avoir des institutions et des éléments de contrôle : académie, dictionnaire, grammaire. »
Cependant, on peut aujourd’hui affirmer que le mutisme autour de la question linguistique s’explique par le fait que les dirigeants africains ont décidé de prendre leurs distances vis-à-vis de la question linguistique. La mort de Sylvanus Olympio, les émeutes de Soweto, l’échec de la malgachisation, les difficultés rencontrées par l’arabisation doivent certainement servir de leçon. On peut ajouter le fait que ces pays aient adhéré à des organisations telles que la Francophonie, le Commonwealth of Nations, la Ligue arabe, etc. Ils sont membres des organisations internationales telles que l’ONU, l’UNESCO, l’OUA, la Banque mondiale. Pour participer à la vie internationale, il faut parler les langues internationales.
L’OUA et la naissance de la Francophonie
La même année (1963) qu’est créée l’OUA, Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Habib Bourguiba et Norodom Sihanouk se réunissent pour cosigner l’appel à rassembler tous les « parlants français » : ce sont les quatre pères fondateurs de la Francophonie.
En 1966, date à laquelle est créé le Bureau linguistique inter-africain de l’OUA, les chefs d’État de l’OCAM (Organisation commune africaine et malgache, créée l’année précédente) donnent mandat à Léopold Sédar Senghor et Amani Diori de convaincre les autres pays francophones d’Afrique de prendre part à des projets de coopération culturelle et technique33. Parmi les pays membres de l’OCAM, il y a des pays fondateurs de l’OUA. Ces coïncidences sont-elles fortuites ? Pour nous, non. Car c’est d’ici que semble partir l’idée de la création d’une communauté des États ayant la langue française en partage. Les pays francophones vont à l’OUA en rangs dispersés alors que les pays anglophones et arabophones sont regroupés au sein du Commonwealth et de la Ligne arabe. Le Commonwealth of Nations et la Ligue arabe existaient avant la création de l’OUA en 1963, respectivement depuis le 19 novembre 1926 et le 22 mars 1945.
Les anciennes colonies anglophones adhèrent au Commonwealth dès leur accès à l’indépendance. Les anciennes colonies françaises arabophones présentent leur candidature pour l’adhésion à la Ligue arabe dès leur accession à l’indépendance. Les anciennes colonies françaises non arabophones sont abandonnées à elles-mêmes. Les réunions parallèles qui se tiennent s’expliquent par le fait que c’est à l’issue de ces multiples rencontres que naîtra la Francophonie. Les pays francophones membres fondateurs de l’OUA sont les mêmes qui seront membres fondateurs de la Francophonie : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Maurice, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie. Le Cameroun est présent parmi les membres fondateurs le 20 mars 1970 à Niamey lors de la création de l’ACCT (Agence de Coopération culturelle et technique), première traduction inter-étatique de la Francophonie, mais préfère avoir un statut d’observateur par solidarité pour les Camerounais anglophones qui avaient été chassés du Commonwealth parce qu’ils avaient refusé de se rallier au Nigeria.
Ces pays conçoivent la Francophonie comme un « Commonwealth à la française », une sorte d’union-fait-la-force. Tous ces pays sont jaloux de leur souveraineté. Ce phénomène se manifeste au sein de l’OUA où deux blocs se forment : celui de Casablanca et celui de Monrovia. Le bloc de Casablanca est constitué de panafricanistes et a pour chef de file Kwame Nkrumah et celui de Monrovia est constitué de nationalistes qui ont pour chef de file Léopold Sédar Senghor. Les panafricanistes trouvent que pour mettre en application leur doctrine, les États doivent renoncer à leur souveraineté. Les nationalistes n’acceptent pas, après avoir acquis leur indépendance, de s’inféoder à une quelconque autorité. Léopold Sédar Senghor est en même temps chef de file des pays francophones qui fondent l’ACCT, chef de file des écrivains de la négritude qui prônent le retour aux sources, chef de file du bloc de Monrovia qui prône le nationalisme. Il se définit en plus comme un métis culturel. Les pays qui combattent le panafricanisme au sein de l’OUA sont les mêmes qui fondent l’ACCT. Il est possible qu’il y ait un lien entre la création de l’ACCT et celle du bloc de Monrovia, c’est-à-dire que l’ACCT est créée par les pays qui combattent le panafricanisme. Cela soulève deux questions. Est-il possible que des pays qui défendent leur souveraineté au sein de l’OUA renoncent à celle-ci au sein de l’ACCT (qui deviendra l’OIF – Organisation internationale de la Francophonie) alors qu’ils en sont membres fondateurs ? Comment se fait-il que des pays qui hier combattaient le panafricanisme soient aujourd’hui devenus ceux qui le défendent comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger ?
Évolution de l’attitude de l’OUA vis-à-vis des langues étrangères
On observe trois périodes dans la politique linguistique de l’OUA.
La lutte de libération
De 1963 date de sa création à 1985, l’OUA lutte contre l’esclavage linguistique en Afrique. Elle dicte aux États membres d’abandonner les langues étrangères et de les remplacer par les langues africaines.
La période transitoire
Au cours des années 1980, l’OUA s’installe dans une crise qui va entraîner son agonie. On lui reproche son incapacité à résoudre les conflits en Afrique, notamment sa tendance à contourner les problèmes en remettant leur résolution à demain. Elle prône la substitution des langues africaines aux langues étrangères mais est incapable d’accompagner les États dans la mise en application de cette politique linguistique. Elle est restée impuissante devant le fait que certains pays africains aient remplacé les langues occidentales par l’arabe alors que cette langue continue d’être considérée comme une langue d’occupation. Elle est aussi restée impuissante devant les émeutes qui ont conduit à la malgachisation et la répression qui s’en est suivie à Madagascar, les émeutes de Soweto en Afrique du Sud, le génocide des Tutsis au Rwanda, etc.
Le Plan d’Action Linguistique pour l’Afrique (PALA) est adopté par les Chefs d’État et de Gouvernements réunis à Addis-Abeba du 21 au 25 juillet 198634. Dès son préambule, l’OUA reconnaît que la plupart des États membres ne suivent pas sa politique linguistique :
« CONSCIENTS que jusqu’à maintenant, la plupart des États membres n’ont pas pris les
mesures nécessaires pour donner à leurs langues autochtones, leur rôle officiel légitime
conformément à la Charte Culturelle de l’Afrique, au Plan d’Action de Lagos et à d’autres
résolutions pertinentes de l’Organisation de l’Unité Africaine ;
RECONNAISSANT que chaque État souverain a le droit d’élaborer une politique linguistique
qui reflète les réalités socio-économiques de son pays, et qui soit conforme aux besoins
et aux aspirations de son peuple ».
Le mot « État souverain » apparaît plusieurs fois dans le PALA. L’OUA laisse désormais à chaque État souverain le soin d’élaborer sa politique linguistique extérieure : « la communication de l’Afrique avec le monde extérieur est inévitable et doit se traduire par l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique linguistique au niveau de chaque État souverain » (Préambule).
L’OUA reconnaît « qu’en Afrique, la coexistence de plusieurs langues dans presque tous les pays africains est une réalité et que le multilinguisme (maîtrise et utilisation de plusieurs langues par une personne dans ses relations avec autrui) est également un fait social important qui devrait inciter les États membres à accorder à la promotion du multilinguisme une attention particulière dans l’élaboration de leur politique linguistique » (Préambule).
Cependant, la lutte de libération de l’Afrique continue. Dans son titre I portant objectifs et principes, le PALA stipule ce qui suit aux alinéas c, d et g :
« c) Libérer les peuples africains de leur dépendance excessive vis-à-vis des langues étrangères comme principales langues officielles de leur pays en remplaçant progressivement ces langues par les langues africaines locales judicieusement choisies ; »
« d) Veiller à ce que les langues africaines, grâce à une législation appropriée et à une promotion pratique, assument leur rôle légitime comme moyens de communication officielle dans les affaires publiques de chaque État membre pour remplacer les langues européennes qui ont jusqu’ici ce rôle ; »
« g) Encourager et promouvoir l’unité linguistique nationale, régionale et continentale en Afrique dans le cadre du multilinguisme qui prévaut dans la plupart des pays africains. »
L’Afrique n’est plus perçue comme un continent qu’on peut unir par le biais d’une seule langue. L’OUA promeut désormais le multilinguisme et l’intégration régionale par le biais des langues transfrontalières.
La période des réformes
Cette période correspond à la fin de la crise de l’OUA et à la naissance de l’Union africaine. Elle est riche en innovations. L’UA se dote d’un instrument juridique lui permettant d’intervenir dans un État en cas de conflit : « Le droit de l’Union d’intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité »35. Cet article est en rapport avec le génocide des Tutsis au Rwanda, les émeutes de Soweto en Afrique du Sud, les crises berbères en Algérie, etc.
En matière linguistique, l’arabe devient l’une des langues de travail de l’Union africaine (art. 25), ainsi que le swahili36. L’Académie africaine des Langues (ACALAN), créée en juillet 2001, remplacera le BIL-OUA. Dans les Statuts de l’ACALAN, l’expression « langue africaine » est définie comme : « langue maternelle des populations d’un État africain »37. La dénomination langue étrangère semble ne plus s’appliquer à l’arabe. Cette langue officielle est la langue maternelle de près de 100 millions de personnes vivant dans plusieurs États africains.
Le remplacement du BIL-OUA par l’ACALAN marque un changement de cap dans la politique linguistique de l’UA. Il met fin à la politique d’exclusion des langues étrangères. L’UA adopte une politique de partenariat linguistique38 qui se traduit d’une part par : « la promotion de l’utilisation des langues africaines dans tous les domaines de la vie publique sur les plans national, sous-régional et international » (art. 4 i) et « comme médium et matière à tous les niveaux d’enseignement » (art. 4 j), et d’autre part par « la redéfinition des rapports entre langues africaines/langues partenaires » (art. 4 n), « des échanges de vues et d’information avec les institutions étrangères poursuivant des objectifs similaires » (art. 5 e). L’arabe semble être devenu une langue africaine, les langues étrangères sont devenues des langues partenaires. La redéfinition des rapports langues africaines/langues étrangères ouvre la voie à leur appropriation.
L’appropriation comme solution au problème linguistique en Afrique ?
Certaines élites africaines étaient favorables à l’abandon des langues coloniales en Afrique. Le Chef de file de cette tendance est Kahombo Mateene39, directeur du Bureau Linguistique Interafricain de l’OUA (BIL-OUA) qui avait fait de l’indépendance et l’unité linguistiques de l’Afrique son cheval de bataille. Cheikh Anta Diop trouvait qu’au lieu d’enrichir artificiellement une langue étrangère, les Africains feraient mieux de développer leurs propres langues40. Selon Pierre Alexandre, quelques-uns réclamaient même « la création (ou la “reconstitution”) d’un négro-africain commun qui deviendrait la langue officielle unique du continent noir »41.
Cependant, la question de l’indépendance linguistique de l’Afrique semble avoir deux solutions possibles. La première est l’abandon des langues étrangères et leur remplacement par les langues africaines comme chez Mateene, Anta Diop et autres. La deuxième est leur appropriation. La deuxième solution semble être l’option choisie par la plupart des États membres comme le relève le PALA dans son préambule.
La théorie de l’éclectisme culturel de Paul Biya
Le président Paul Biya fait partie des chefs d’État et de Gouvernement de l’OUA, réunis à Addis-Abeba en 1986 pour l’adoption du PALA. Sa théorie de l’éclectisme culturel préexiste au PALA42. Elle fera l’objet d’un exposé comme discours d’ouverture par François Sengat Kouo43, ministre de l’Information et de la Culture, au colloque sur l’« Identité culturelle camerounaise et les formes d’expression artistique et littéraire » organisé à Yaoundé du 13 au 20 mai 1985 par l’État du Cameroun :
« Les universaux culturels, racines de nos tribalités, doivent donc pouvoir constituer
le fondement de notre théorie de l’éclectisme culturel. Car notre configuration ethno-sociologique
milite pour une identité culturelle éclectique. […]
Cette théorie trouve déjà un début de vérification dans l’art culinaire et l’art musical
camerounais : sur le plan culinaire, nous consommons le kepen, le mbongôô tjobi, le
ndole et l’achu sans plus nous interroger sur leur origine tribale. Et nous les avons
valorisés au point de les faire apprécier au niveau international. De la même manière,
tous les Camerounais dansent au rythme du bikutsi, du mangambe, de l’assiko et du
makossa sans exclusive. Les “timbili”, mendzang, grelots et hochets investissent aujourd’hui
les salons musicaux du monde contemporain […]
L’intégration culturelle, étape majeure de notre intégration nationale, passe ainsi
par l’intégration linguistique. L’une et l’autre sont indissociables, et obéissent
aux deux plans vertical et horizontal ».
Paul Biya, auteur de cette théorie, ne la considère pas comme une théorie linguistique, mais comme la théorie culturelle qui guide son action politique. Il reconnaît cependant qu’on ne peut mettre en application cette théorie culturelle sans qu’elle ait une incidence au plan linguistique : intégration culturelle et intégration linguistique sont indissociables. La théorie crée une synergie entre les cultures ethniques, les identités ethniques, l’identité nationale, les langues nationales et les langues officielles. Elle prône une identité culturelle éclectique dotée d’un esprit de tolérance et prévoit trois niveaux d’intégration : le niveau ethnique, le niveau national et le niveau international. Au niveau ethnique, elle encourage le développement des langues nationales qui sont l’expression des cultures ethniques. Le niveau national est celui où on remonte avec ce que l’ethnie détient d’excellent et dont on enrichit les langues officielles. Le niveau international est celui où on s’ouvre au monde avec les universaux culturels du niveau national :
« L’on voit comment ce souci de dialogue et de complémentarité doit commencer à l’intérieur du Cameroun, pour déboucher fructueusement sur la scène de la coopération culturelle internationale. Car il faut promouvoir une culture qui soit aussi un produit exportable, de consommation nationale et de haute compétition internationale. D’où notre choix pour une présence culturelle camerounaise effective à travers le monde. Dans ce processus d’édification culturelle, le temps jouera un rôle de tamis et de stabilisateur »44.
Cette théorie montre comment les langues officielles subissent des régulations culturelles et ethniques et comment celles-ci se transforment en régulations institutionnelles. Elle redéfinit les rapports langues nationales/langues officielles comme le veut le PALA. La théorie de l’éclectisme culturel est à la fois une théorie de l’enrichissement des langues officielles, une théorie de l’appropriation des langues officielles, une théorie du partenariat linguistique, une théorie des régulations linguistiques et une théorie d’ouverture au monde. Comme le dit si bien son auteur : « le temps jouera un rôle de tamis et de stabilisateur »45.
La lutte contre l’insécurité linguistique
L’appropriation de la langue française pour lutter contre l’insécurité linguistique est une thèse défendue par Abdou Diouf, en tant que Président de la République du Sénégal puis Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Cette thèse sera présentée dans son Allocution de clôture des États généraux de l’enseignement du français à Libreville au Gabon en 200346 :
« Le temps du purisme élitiste est dépassé, il faut tourner la page et proposer de nouvelles normes prenant en compte des usages de bon aloi. […] Cette nouvelle norme africaine ne doit pas se limiter aux emprunts et néologismes lexicaux, mais s’étendre à la syntaxe du français. Dans ce domaine, les états généraux souhaitent que l’Afrique prenne ses responsabilités et qu’elle devienne le moteur d’une réforme dont même la France et ses propres locuteurs, natifs ou non, seraient les premiers bénéficiaires ».
Abdou Diouf invite l’Afrique à prendre ses responsabilités parce qu’elle doit devenir le moteur de régulations institutionnelles applicables à la langue française47. Il considère que l’avenir de la langue française et de la Francophonie est en Afrique. Pour lui, il y a bien un français de Belgique, un français du Canada, un français de France, un français de Suisse. Il est donc tout à fait normal qu’il y ait un français d’Afrique. Les Africains ne doivent pas avoir honte de leur français. Ils doivent s’approprier la langue française : « c’est le seul moyen de débarrasser le locuteur africain de son insécurité linguistique […] »48.
Un pays qui adopte une langue étrangère comme langue officielle court le risque de connaître un développement aliéné. Voilà pourquoi, pour le PALA, il faut : « libérer les peuples africains de leur dépendance excessive vis-à-vis des langues étrangères […] »49. Paul Biya et Abdou Diouf semblent cependant défendre l’idée qu’on est capable de parvenir au même résultat (libérer les peuples africains) en s’appropriant ces langues.
Francophonie multipolaire
L’expression francophonie multipolaire apparaît dans nos travaux depuis 2006, dans notre thèse de doctorat d’État publiée en 2013, où nous nous posons la question suivante : « Est-il possible de créer une nation sur la base d’une langue étrangère ? »50. Pour Roland Breton, un peuple qui utilise une langue étrangère court le risque de donner naissance à « une nation aliénée » ou « une nation qui se développe par dépendance vers un centre extérieur »51. L’exemple des pays africains aujourd’hui semble montrer qu’un peuple qui se sert d’une langue étrangère comme langue d’unité nationale peut connaître un développement autocentré, à condition qu’il s’approprie la langue étrangère adoptée comme langue officielle ou langue d’unité nationale.
L’appropriation de la langue française par les Africains est-elle réversible ? Le sentiment anti-français qui se développe en Afrique peut-il entraîner la mort de la langue française sur ce continent ? L’appropriation du français en Afrique est aujourd’hui une réalité52, ce qui signifie qu’il est devenu une propriété des Africains et qu’il fait désormais partie de leur patrimoine et de leur souveraineté. Il ne faut donc pas lier le sort de la langue française en Afrique à celui de la France. Ce qui n’est pas sans conséquences.
Il est alors vain de bannir l’expression français d’Afrique, comme cela semble le cas dans certains milieux de la recherche francophone où on lui préfère français langue seconde, comme si le français langue seconde était une variété linguistique. Dans cette perspective, l’appropriation de la langue française n’est pas seulement un problème linguistique que l’on peut étudier d’un point de vue grammatical, lexicologique, phonétique, etc. C’est aussi un problème politique qui peut avoir une incidence sur la survie même de la Francophonie.
C’est à la faveur de l’appropriation que la langue française cesse d’être perçue comme une langue coloniale et s’enracine sur le sol africain. La langue française n’est plus la langue de la France, c’est la langue de la communauté francophone internationale. Dans cette perspective, le français de France devient une variété régionale (par rapport à la communauté francophone internationale) au même titre que celui de Belgique, du Canada, de la Suisse et d’Afrique. La langue française et la francophonie doivent ainsi cesser d’être conçues comme des choses qui appartiennent à la France, la Francophonie en particulier comme zone d’influence de ce pays.
Il y a là un aspect à la fois linguistique et géographique qui doit être souligné, parce qu’il conditionne les formes et modalités d’appropriation. Il s’agit d’un phénomène de polarisation multiple de l’évolution de la langue française dans l’Afrique d’aujourd’hui, avec certaines capitales de ce continent (Yaoundé, Dakar, Abidjan, etc.), qui sont devenues – au niveau langagier – de véritables centres moteurs, des foyers de diffusion, des centres d’où partent des innovations. Le degré de polarisation n’est cependant pas le même pour toutes ces capitales. Il y a des centres qui sont plus des pôles que des relais, et des centres qui sont plus des relais que des pôles.
Il existe une francophonie africaine de même qu’il existe un français d’Afrique. La francophonie africaine est compatible avec le panafricanisme. Elle est totalement différente d’une francophonie unipolaire qui ne s’accommode pas du panafricanisme et qui le combat avec acharnement. La francophonie multipolaire est parfaitement compatible avec les idéaux de l’Union africaine53. Elle considère les langues africaines comme des langues partenaires. La francophonie multipolaire a sa place dans le monde multipolaire en pleine formation aujourd’hui où les pays africains revendiquent leur statut de pays membres fondateurs de la Francophonie.
Conclusion
L’indépendance linguistique est nécessaire pour un développement autocentré. On ne peut y parvenir que par deux chemins qui ont chacun ses spécificités et ses contraintes. Le premier est celui de l’éradication des langues étrangères. Mais avec la crise anglophone au Cameroun (6000 morts)54, les émeutes de Soweto, l’arabisation d’une partie de l’Afrique, cette solution est-elle encore envisageable ? Il n’est pas aisé d’éradiquer une langue d’un territoire, sauf à le vider de ses habitants par expulsion ou par génocide et à le peupler par des personnes venues d’ailleurs. L’éradication est donc une option certes plus rapide, mais davantage violente. On ne sait jamais, en la choisissant, jusqu’où elle peut mener. Dans de nombreux cas, elle a effectivement conduit au génocide et à la perte d’un patrimoine précieux. La Martinique et la Guadeloupe par exemple ont été peuplées d’esclaves venus d’Afrique après extermination des populations autochtones55. Le deuxième chemin est celui de l’appropriation. Il est plus long, plus ou moins pacifique parce qu’il consiste à construire progressivement l’unité en s’appuyant sur les identités existantes.
Ce dont l’Afrique a besoin aujourd’hui ce n’est pas de se débarrasser des langues anciennement coloniales mais de s’en servir pour son propre développement. Dans un pays comme le Cameroun par exemple, de 1884 à 1916, tous les documents originaux concernant le pays sont écrits en allemand. Si on ne comprend pas l’allemand, on ne peut y accéder sauf si on passe par le biais des traductions avec tous les risques de falsification et d’incohérences. De 1916 à nos jours, tous les documents originaux concernant le Cameroun sont écrits en français et/ou en anglais. Courir le risque d’abandonner les langues anciennement coloniales du Cameroun signifie que l’on se lance dans la formation de générations de Camerounais incapables de comprendre tout ce qui concerne leur pays depuis l’époque coloniale voire depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.
L’appropriation d’une langue n’est pas que l’introduction de quelques mots ou de quelques tournures. Elle est un vaste chantier qui consiste à enraciner la langue dans son nouveau contexte, à s’approprier la culture du pays et à la désigner, mais aussi et surtout à s’approprier le corpus de ce pays. Chaque pays africain gagnerait donc à former des gens capables de traduire tous les documents qui le concernent dans tous les domaines (histoire, géographie, économie, commerce, droit, coutumes, justice, médecine, etc.) dans ses propres langues afin que l’Afrique s’approprie son histoire, son économie, ses ressources énergétiques dans ses propres langues. L’Afrique a besoin de spécialistes de toutes les disciplines pour s’approprier sa propre histoire et la défalsifier : historiens, linguistes, lexicographes, hommes de lettres, spécialistes des sciences humaines, traducteurs-interprètes, économistes, géologues, etc. Tout le monde est utile dans cette œuvre.
Le choix opéré par la plupart les dirigeants africains est sans aucun doute de faire d’une pierre deux coups : s’approprier les langues anciennement coloniales et protéger, à défaut de promouvoir, les langues africaines. Si pour certains spécialistes ce choix correspond à une politique de non-dit ou une absence de politique, la réalité dans les pays africains incite à reconsidérer cette position. On observe en effet que dans la réalité des faits, le choix d’une langue étrangère comme langue officielle vaut appropriation, sauf à considérer que l’État décide d’hypothéquer ou de renoncer à sa souveraineté à cause de sa langue officielle. C’est à la faveur de l’appropriation que la langue française cesse d’être perçue comme une langue coloniale. Elle est donc le seul processus qui peut lui permettre de s’enraciner sur le sol africain.
Les pays africains francophones réunis au sein de l’OUA ont créé la Francophonie dans le but de défendre leur souveraineté et faire contrepoids aux pays anglophones et arabophones. Il est donc impensable que ces pays francophones africains aient pu renoncer à leur souveraineté au sein de la Francophonie alors qu’ils en sont les membres fondateurs. La crise qui traverse l’Organisation Internationale de la Francophonie aujourd’hui s’explique par le fait que ces pays réclament leur statut de membres fondateurs. L’Histoire retiendra que les Africains se sont approprié des langues qui leur avaient été imposées. Si l’avenir de la langue française et de la Francophonie est en Afrique, ne serait-il pas normal que le siège de l’OIF soit relocalisé sur ce continent ?
Notes
- Paul Zang Zang, « L’aventure d’une langue hors de son territoire d’origine : le français langue africaine » Écritures XIII, 2001, p. 176-188.
- Joseph Merrick, « Lettres », Études camerounaises, n° 33-34, 1951, cité dans Paul Zang Zang, Linguistique et émergence des nations. Essai d’aménagement d’un cadre théorique, Munich, Lincom Europa, 2013, p. 69.
- Louis-Jean Calvet, Linguistique et colonialisme. Petit traité de glottophagie, Paris, Payot, 1974, p. 132.
- Cf. Jean-Claude Touzeil, Quelques camerounismes. Contribution à un inventaire des écarts vis-à-vis du français standard recueillis dans la région de Yaoundé et à une méthodologie de remédiation, Yaoundé, CEPER, 1979.
- Cf. Carole De Féral, « Appropriation du français dans le sud du Cameroun », Langue française, n° 104 (Le français en Afrique noire, fait d’appropriation), 1994, p. 37-48 (p. 47).
- Paul Wald, 1994 « L’appropriation du français en Afrique noire : une dynamique discursive », Langue française, n° 104 (Le français en Afrique noire, fait d’appropriation), p. 115-124. URL : http://www.persee.fr /doc/lfr_0023-8368_1994_num_104_1_5743 ; Gervais Mendo Ze, Le français langue africaine, enjeux et atouts pour la Francophonie, Paris, Publisud , 1999 et Insécurité linguistique et appropriation du français en contexte plurilingue, Paris, L’Harmattan, 2009 ; Paul Zang Zang et Pierre Essengué, « Le français d’Afrique : une langue française de culture africaine ? » dans Peter Blumenthal (dir.), Dynamique des français africain : entre le culturel et le linguistique. Hommage à Ambroise Jean-Marc Queffelec, Frankfort, Peter Lang, p. 37-49 ; Paul Zang Zang, « L’appropriation du français comme politique linguistique aux niveaux social et institutionnel en Afrique », dans Richard-Laurent Omgba et Christophe-Désiré Atangana Kouna, La littérature camerounaise d’expression française. Des années de braise aux années d’espérance, Paris, L’Harmattan, 2018, p. 33-45.
- Roland Breton, Roland, Géographie des langues, Paris, PUF, 1976, p. 46-47.
- Paul Zang Zang, Linguistique et émergence des nations. Essai d’aménagement d’un cadre théorique, Munich, Lincom Europa, 2013 ; Jean-Paul Yongui, La théorie des régulations de Paul Zang Zang : De la théorie générale du changement linguistique au paradigme régulationniste, Londres/Chisinau, Éditions universitaires européennes, 2023 et La théorie des pôles et des relais de Paul Zang Zang : Maquette de gouvernance de la Francophonie multipolaire, Londres/Chisinau, Éditions universitaires européennes, 2023.
- John Kalema, « Introduction » dans BIL-OUA, Libération et unité linguistique de l’Afrique, Kampala, Éditions Bureau Linguistique Inter-Africain de l’OUA, 1985, p. 1-7.
- Ibid., p. 1.
- Organisation de l’Unité Africaine, Charte culturelle de l’Afrique, Port Louis (Maurice), 2-5 juillet 1976.
- Paul Zang Zang, « La dégermanisation du Cameroun », Revue électronique internationale des sciences du langage : Sudlangues, n° 14, 2010, p. 79-104.
- Louis-Jean Calvet, Les politiques linguistiques, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1996.
- Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Qui parle français dans le monde ?, 2016 : https://observatoire.francophonie.org.
- Aude Chanson, « Le kiswahili : une politique linguistique d’exception au Tanganyika », Les cahiers d’Afrique de l’Est/The East Africa review, n° 45, 2012, p. 49-65 mis en ligne le 7/05/2019, consulté le 09/12/2021 (p. 56). URL: http://journals.openedition.org/eastafrica/492.
- Ibid., p. 55.
- Chanson, op. cit.
- Ibid., p. 60.
- Ibid., p. 61.
- Jean Wycliffe Mawike Masezerano et Paul Zang Zang, « Language planning mechanisms towards Kiswahili as a trade language of the East African community in Rwanda », Open Access Library Journal, vol. 10, e9948, 2023. URL : https://doi.org/10.4236/oalib.1109948 ; Jean Wycliffe Mawike Masezerano, Paul Zang Zang et Cyprien Niyomugabo, « Attitudes of Rwandans towards Kiswahili as a language of trade and integration in the East African community », East African Journal of Education Studies, Vol. 6, n° 1, 2023, p. 266-279, DOI : https://doi.org/10.37284/eajes.6.1.1130.
- Vololona Randriamarotsimba, « La malgachisation, une expérience malheureuse pour Madagascar », Le français à l’université, 21-04-2016, mis en ligne le 13/12/2016, consulté le 20/12/2023.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- Kalema, op. cit. ; Pierre Dumont et Bruno Maurer, Sociolinguistique du français en Afrique francophone, Vanves, EDICEF/AUPELF, 1995 ; Paul Zang Zang, Linguistique et émergence des nations, op. cit.
- Kalema, op. cit.
- Dumont et Maurer, op. cit.
- Kalema, op. cit., p. 3.
- Ibid., p. 2.
- Pierre Essengué, « La Thèse de l’échec du bilinguisme officiel camerounais : une zone d’ombre ? », dans F. Tabe Ako Enoh Oben, F. (dir.), « Le Bilinguisme et le multilinguisme camerounais en question : Réflexions glottopolitiques et didactiques », Langue et Communication, n° 8, Yaoundé, 2021, p. 81-96, « Assimilation et promotion des langues allochtones au Cameroun : la part de l’idéologie », dans P.M. Abossolo et P. Essengué, Linguistique, littérature et didactique : ponts et passerelles. Mélanges offerts en hommage du Professeur David Ngamassu, Munich, Lincom Europa, 2023, et « La thèse de l’imposition au Cameroun des langues allochtones au statut de langues officielles », dans P. Zang Zang et P. Essengué, « Conflits linguistiques, conflits politiques : rôle des médias, responsabilités des acteurs », Résonance, n° 1, septembre 2023.
- William F. Mackey, Bilinguisme et contact des langues, Paris, Klincksieck, 1976.
- Paul Zang Zang, « Le problème francophone », dans Paul Zang Zang, Venant Eloundou Eloundou, Sanda-Maria Ardeleanu et Louis Hervé Ngafomo (dir.), La reconstruction de l’Afrique et de la Francophonie dans les discours politiques de la France, Paris, L’Harmattan, 2022, p. 17-38 (p. 6).
- Organisation de l’Unité Africaine, Plan d’Action Linguistique pour l’Afrique, adopté par les Chefs d’État et de Gouvernements réunis à Addis-Abeba du 21 au 25 juillet 1986.
- Union africaine, 2000, Acte constitutif de l’Union africaine, Lomé, 11 juillet 2000, art. 4h.
- Union africaine, Protocole sur les amendements de l’Acte constitutif de l’Union africaine, Addis-Abeba, 3 février 2003.
- Union africaine, Statuts de l’Académie africaine des langues (ACALAN), adoptés en 2005, art. 1c.
- Ibid.
- Kahombo Mateene et John Kalema, Reconsideration of African Linguistic Policies, Kampala, Éditions Bureau Linguistique Inter-Africain de l’OUA, 1980.
- Willy Bal, « Contribution à l’étude des opinions exprimées par l’élite africaine au sujet des rapports entre les langues nationales et le français », dans Paul Wald et Gabriel Manessy, Plurilinguisme : normes, situations, stratégies, Paris, L’Harmattan, 1979.
- Pierre Alexandre, « Problèmes linguistiques des États négro-africains à l’heure de l’indépendance », Cahiers d’études africaines, vol. 2, n° 6, 1961, p. 177-195 (p. 186).
- Voir p. 109-120 de Paul Biya, Pour le libéralisme communautaire, Paris, Pierre-Marcel Favre/ABC, 1986.
- François Sengat Kouo, « Discours d’ouverture », dans Ministère de l’Information et de la Culture, L’identité culturelle Camerounaise, Paris, ABC, 1985, p. 13-16.
- P. Biya, op. cit., p. 118.
- Ibid.
- Abdou Diouf, « Allocution de clôture », États généraux de l’enseignement du français, Libreville, 2003.
- Paul Zang Zang, « Codification et normalisation du français d’Afrique : enjeux et perspectives », Sudlangues : Revue électronique internationale des sciences du langage, n° 19, 2013, p.68-87 ; Zang Zang et Essengué, « Le français d’Afrique : une langue française de culture africaine ? », op. cit.
- A. Diouf, op. cit.
- Organisation de l’unité africaine, Plan d’action linguistique pour l’Afrique, 1986, op. cit., Titre I c.
- Zang Zang, Linguistique et émergence des nations, op. cit.
- Breton, op. cit.
- Pierre Dumont, Le français langue africaine, Paris, L’Harmattan, 1996 ; Mendo Ze, Le français langue africaine, enjeux et atouts pour la Francophonie, op. cit. ; Zang Zang et Essengué, « Le français d’Afrique : une langue française de culture africaine ? », op. cit.
- Union africaine, Guide de politique sur l’intégration des langues et cultures africaines dans les systèmes éducatifs, amendé et adopté par les ministres de l’éducation présents à la Conférence africaine sur l’intégration des langues et cultures africaines dans l’éducation, Ouagadougou (Burkina Faso), 20-22 janvier 2010.
- Paul Zang Zang, « Introduction à la sociolinguistique des conflits : une analyse de la crise anglophone », dans P. Zang Zang et P. Essengué (coord.), Résonances, n° 1, (Conflits linguistiques, conflits politiques, rôle des médias, responsabilité des acteurs, Actes des journées d’études de l’ACEL, Université de Yaoundé I, 10 et 11 juin 2021), Paris, Pygmies, 2023, p. 25-40.
- Calvet, Linguistique et colonialisme, op. cit., p. 112.