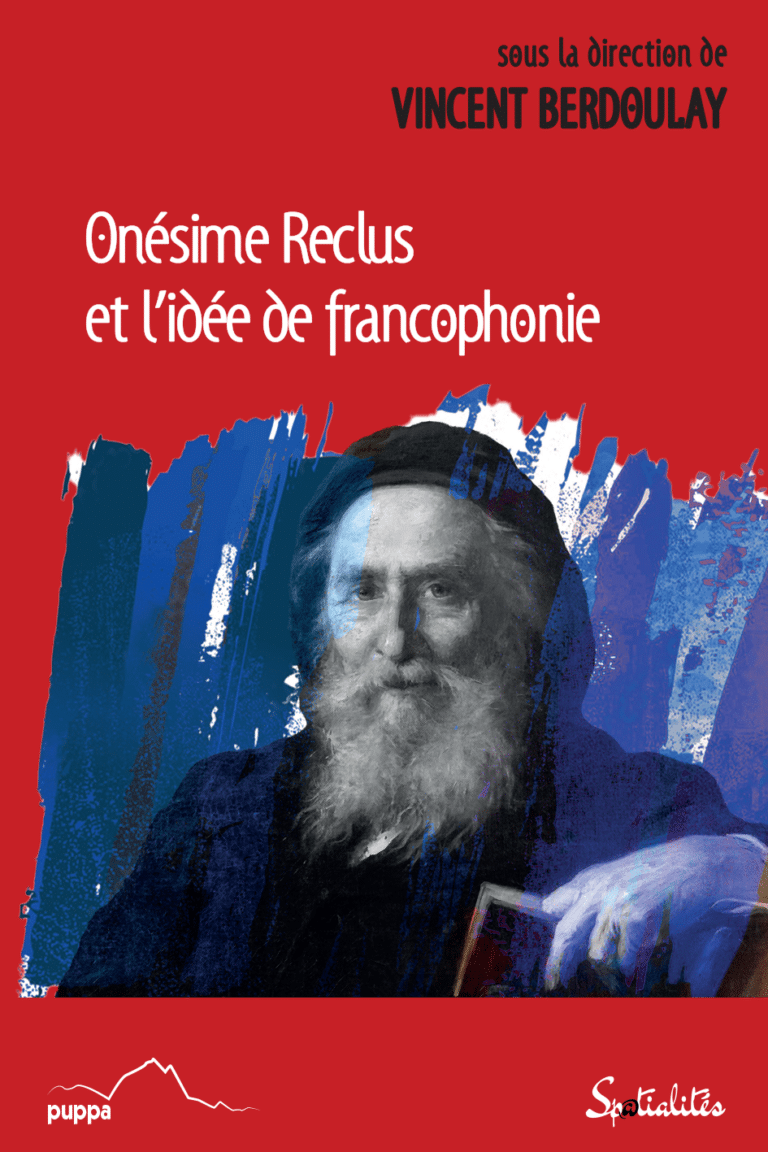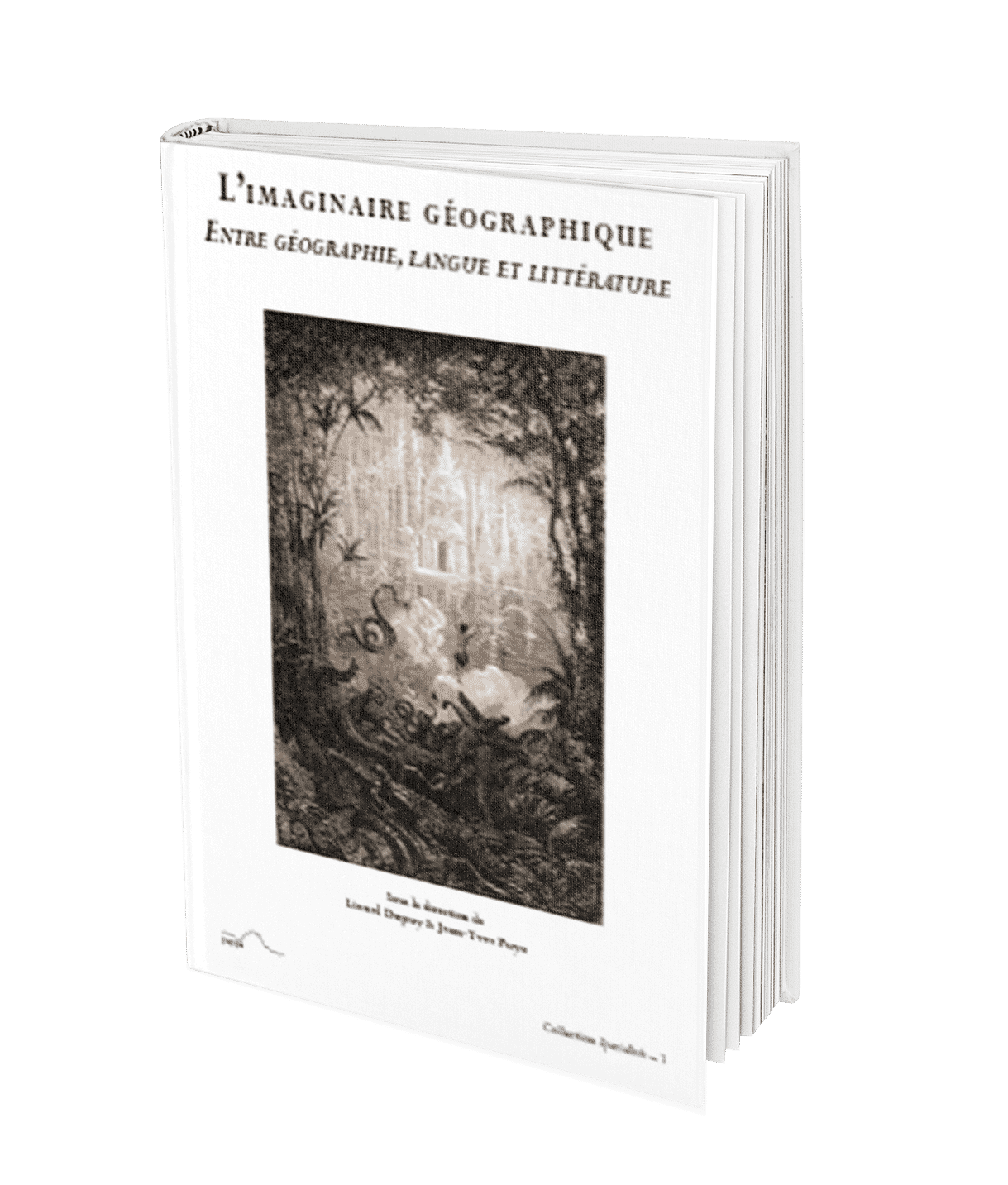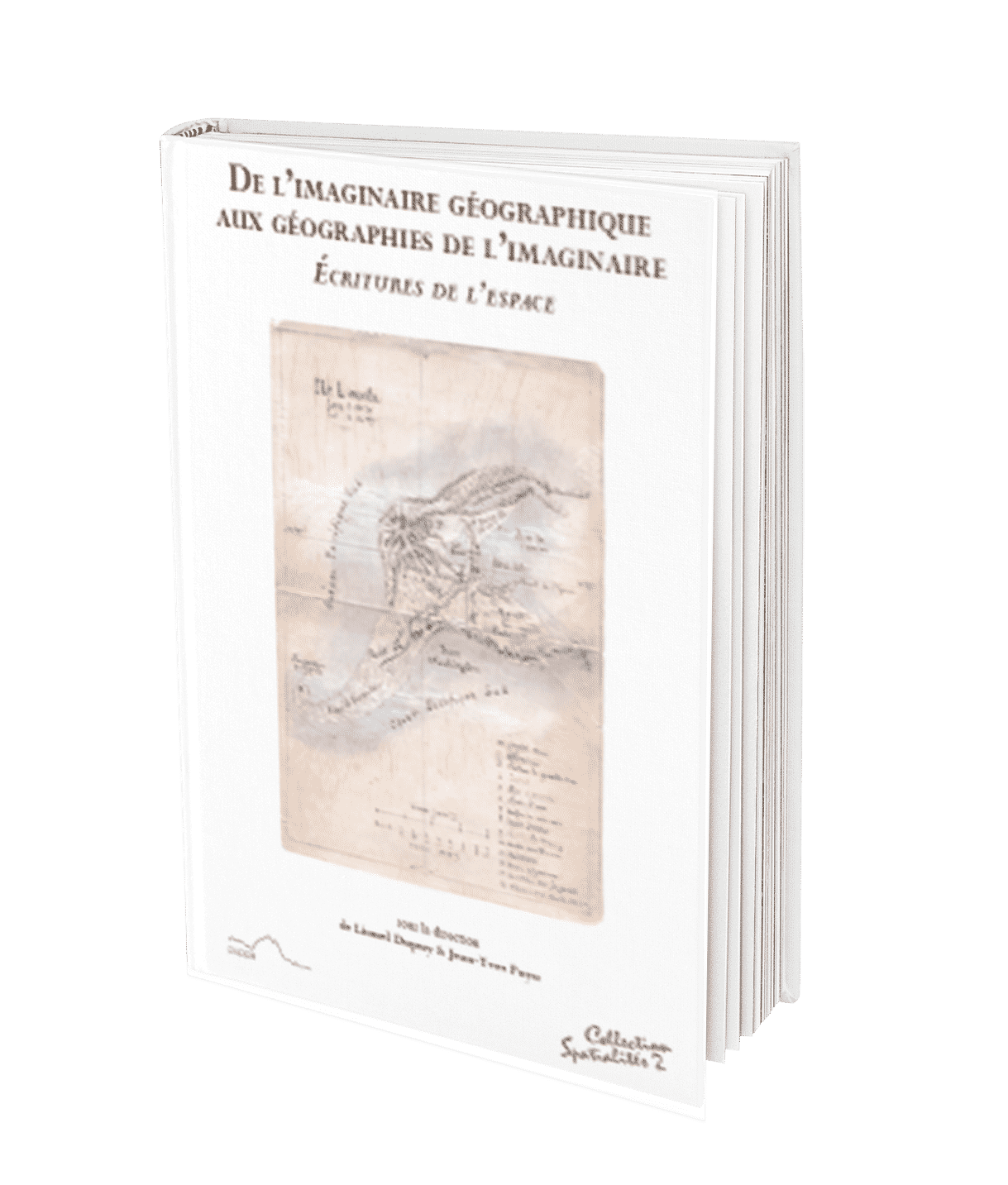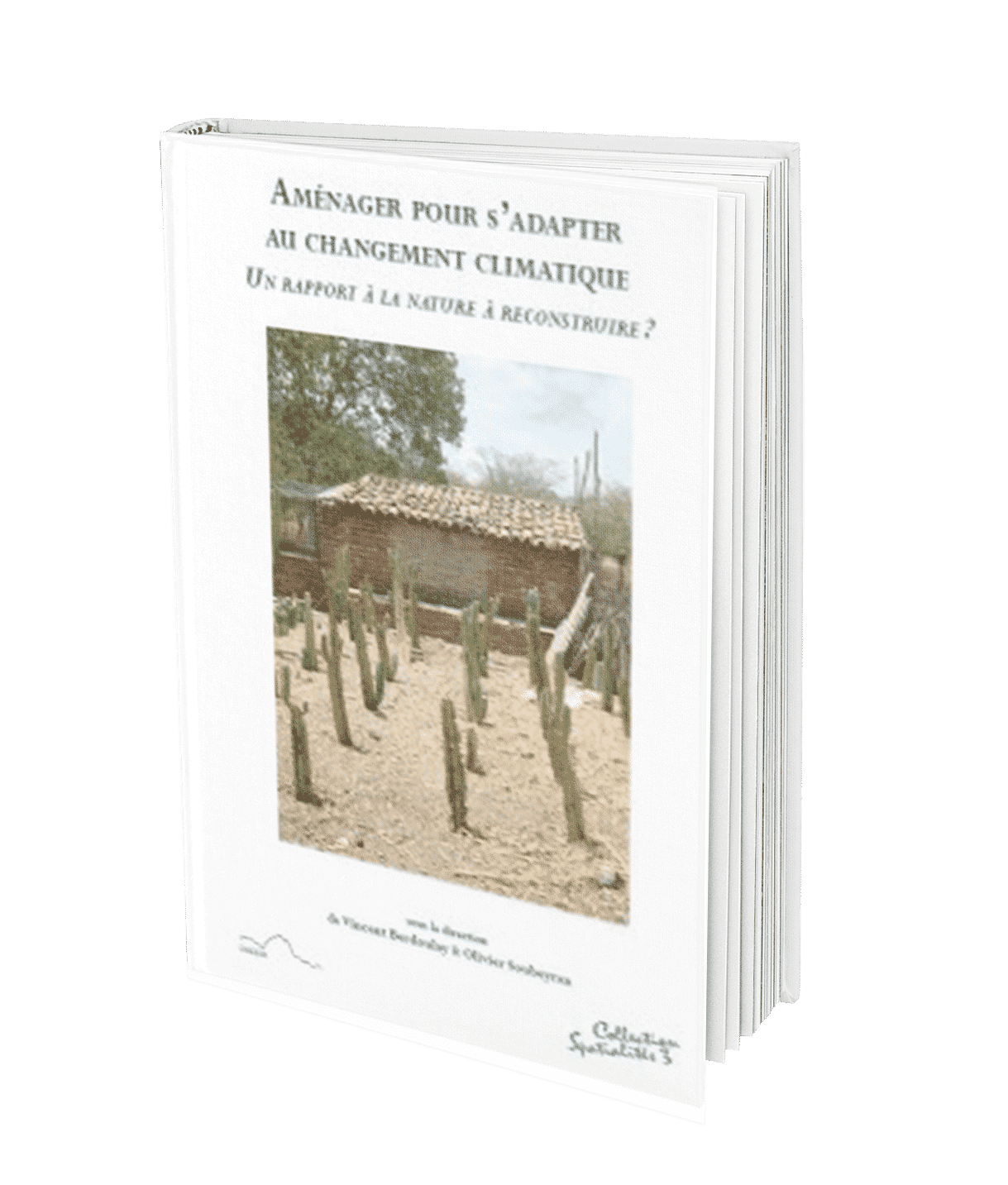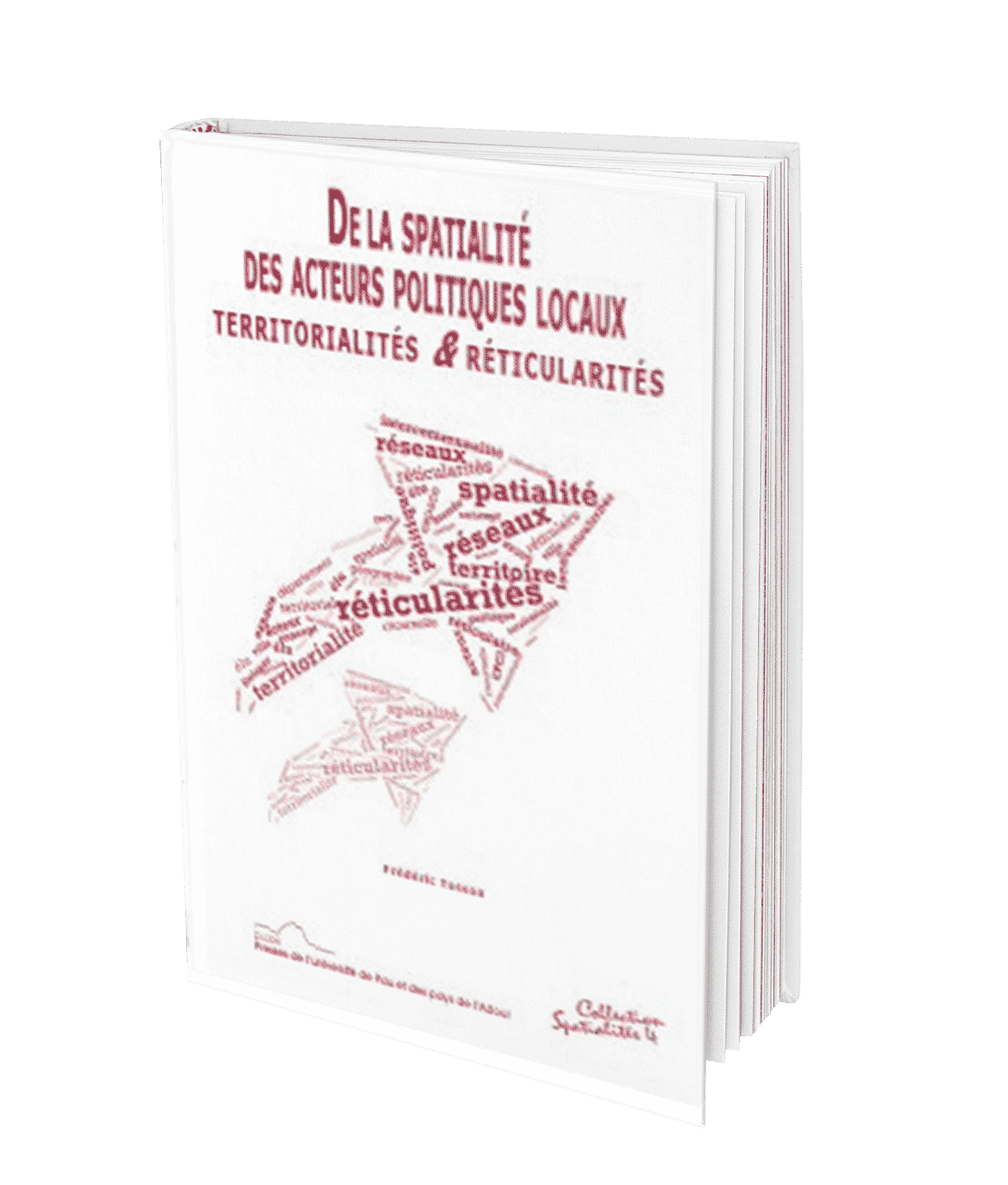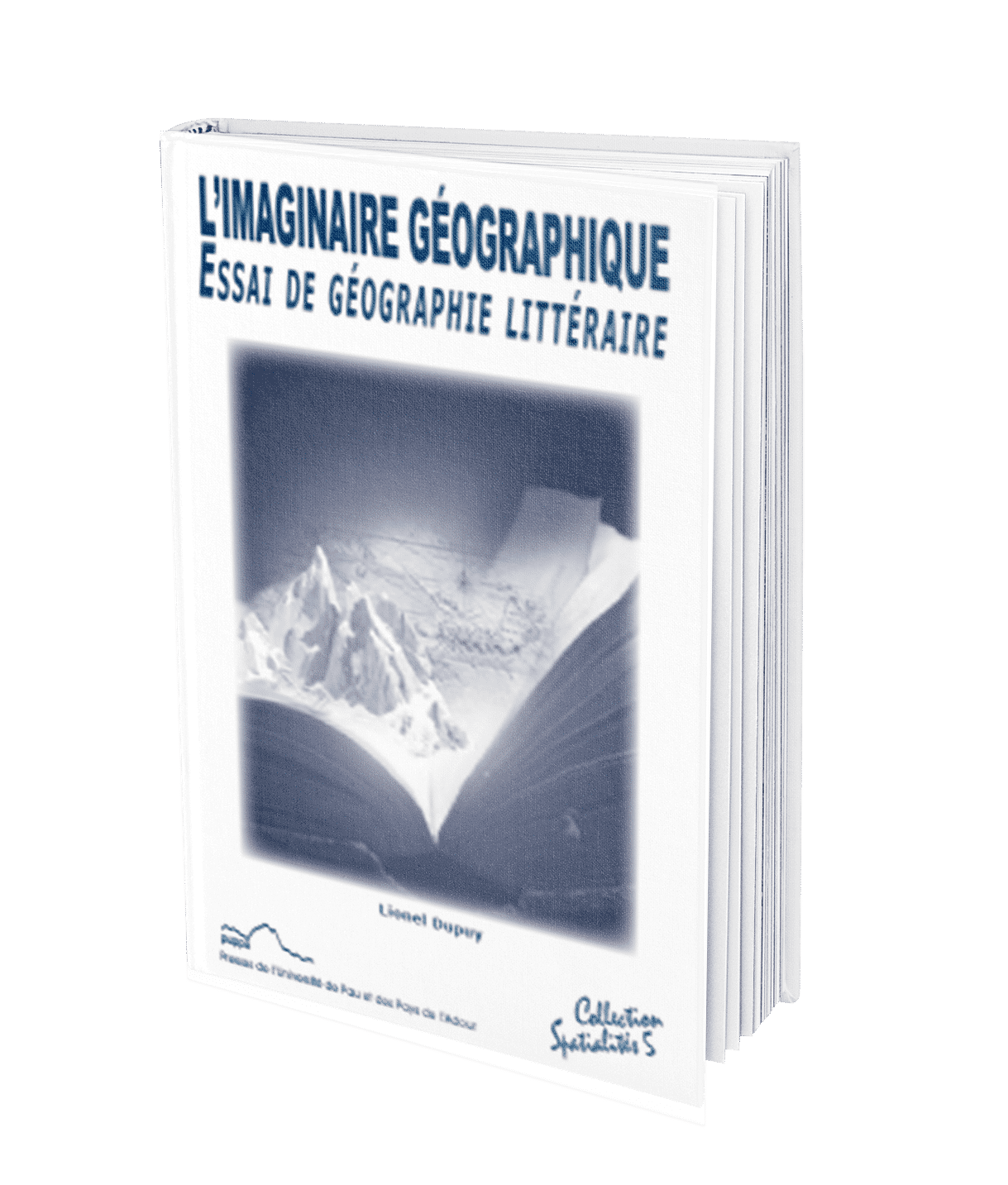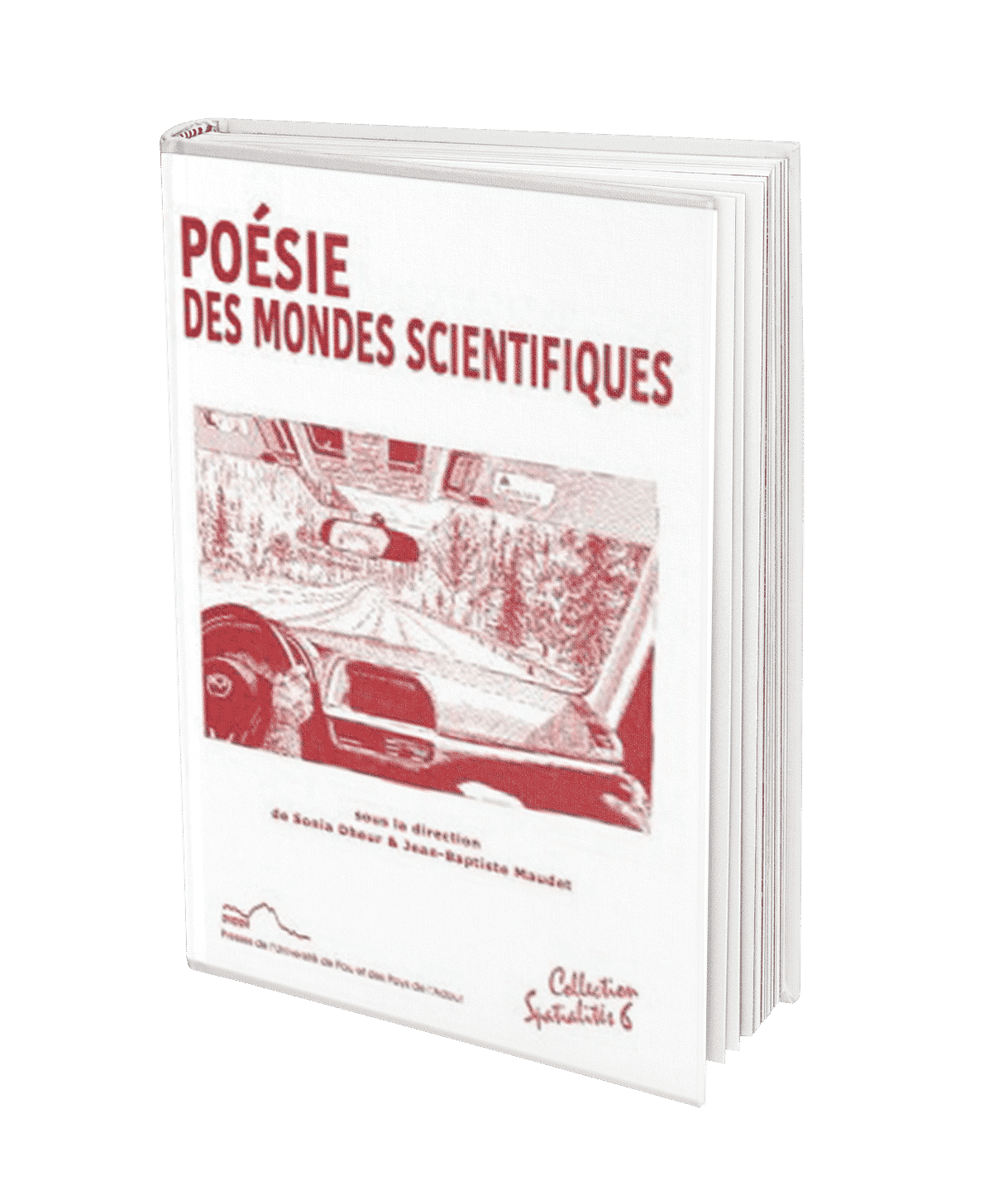Géographe polyglotte, essayiste étonnant, publiciste passionné, Onésime Reclus s’est profondément interrogé sur le devenir de la francophonie. Par l’abondance de ses écrits, il a attiré l’attention sur cette question, cherchant à la problématiser et à fournir des pistes d’action. Il est toutefois devenu plus une référence obligée pour mentionner l’origine du mot qu’un auteur intéressant à revisiter pour sa contribution. Né en 1837, il a écrit des textes qui portent la marque d’une époque révolue. Pour en saisir l’intérêt, il faut les replacer dans le contexte d’une époque troublée aux enjeux multiples. C’est ce que cet ouvrage a essayé de faire, certes de façon non exhaustive, mais attentive à la complexité de ces enjeux et au langage alors employé. Une lecture rapide ou partielle conduit facilement à réduire ses idées à des catégories contemporaines trop simples pour en tirer parti. Certes, certaines idées de son temps, surtout quand elles sont exprimées dans un langage inaudible aujourd’hui, ne facilitent pas la tâche.
C’est principalement le cas en ce qui concerne l’adhésion d’Onésime Reclus au mouvement colonial de son époque. D’une critique tout à fait légitime et nécessaire à son propos, il est tentant de sauter à celle de la Francophonie pour en disqualifier le bien-fondé1. Onésime Reclus se voit alors taxé d’impérialiste français et de raciste, accusé de distinguer les Français des francophones, c’est-à-dire des étrangers condamnés à rester périphériques. Or, les choses ne sont pas si simples. On pourrait reprendre à son propos ce que Mona Ozouf écrit de Jules Ferry : « Colonisateur, assurément. Mais colonialiste, non, si l’épithète comporte la touche d’infamie qui la colore de nos jours »2. Onésime Reclus, nous l’avons vu, ne propose aucune structure politique ou institutionnelle pour régir la francophonie, désignant par le terme de Francophones tous les locuteurs du français sans faire de différence en fonction de leur lieu de vie. Au-delà de ses préjugés pour certains paramètres culturels exprimés en des termes aujourd’hui choquants (Juifs principalement, rivaux européens ou langues asiatiques), il rejette catégoriquement la notion de race, mot polysémique alors employé couramment, prêchant plutôt pour un métissage des locuteurs du français, depuis l’Europe jusqu’au centre de l’Afrique. Quant à la colonisation, s’il est vrai qu’il choque aujourd’hui par son absence de préoccupation pour les problèmes vécus par les populations impactées, elle est abordée comme un processus universel qui est à la base de toute expansion linguistique, quels que soient le territoire (y compris en France), la langue, l’époque ou le foyer d’origine de par le monde. Au fond, pour Onésime Reclus, les langues ont plus besoin d’ancrage géographique que d’institutions politiques. Mais, géographe rejetant tout déterminisme de l’environnement, il n’attribue aucun essentialisme aux territoires où se déploie une langue, qu’ils soient en Europe ou ailleurs, refusant ainsi toute assignation identitaire à base linguistique ou territoriale3. Il ne pense même pas que le français soit une langue supérieure à toute autre. Les paysages, la protection de la nature, la diversité des peuples sont des points focaux de son imaginaire géographique. Mais ce qui le préoccupe avant tout, et influence son regard, ce sont les enjeux géopolitiques qui découlent du poids démographique des différentes langues. C’est à ce titre que ses analyses font surtout écho aujourd’hui.
L’angoisse existentielle pour l’avenir du français, qui avait motivé l’engagement de ce géographe, n’a en effet pas totalement disparu. Si l’impulsion donnée par les pères fondateurs de la Francophonie interétatique, principalement africains (Léopold Sédar Senghor, Hamani Diori, Habib Bourguiba), a maintenu un usage international de la langue française, celui-ci est malmené par la puissance des intérêts soutenus par les utilisateurs de la langue anglaise, et ce, en Europe même avec le consentement apparent des gouvernements français. Onésime Reclus percevait bien cet enjeu, en refusant de laisser le champ libre aux effets d’une prophétie autoréalisatrice trop répandue, au profit d’un plaidoyer à la fois pour le latin et pour l’apprentissage de plusieurs langues. Il faut garder à l’esprit qu’Onésime Reclus a, au niveau mondial, la francophonie modeste, en ce sens qu’elle ne peut aspirer à l’universalité exclusive, mais plutôt à une existence parmi d’autres grands espaces linguistiques. Toutefois, il prévient que la francophonie ne doit pas faire d’angélisme : les autres espaces linguistiques, et au premier chef celui à base anglo-saxonne, disposent d’organismes nombreux, puissants et variés pour diffuser et imposer l’usage de leur langue dans le monde, comme c’est le cas de l’anglais. Le réalisme géopolitique d’Onésime Reclus ne ferait-il pas défaut aujourd’hui à certains pays francophones ? On comprend à cet égard les critiques faites à l’égard de l’OIF dans la mesure où elle est instrumentalisée au service de la politique étrangère de pays particuliers, notamment la France, qui, ce faisant, se détournent des intérêts de la francophonie. Il n’en reste pas moins que le paramètre géopolitique invite à repenser la francophonie aussi en termes de puissance au niveau des relations internationales.
Si Onésime Reclus ne s’était pas intéressé à l’organisation pratique, politique notamment, du monde francophone, il avait eu l’originalité – la préscience ? – de la laisser ouverte. C’est que pour lui, à travers les temps, « l’âme humaine s’est dilatée », de sorte que le cadre de vie a changé d’échelle, passant de la seigneurie ou commune à la province, au royaume, à la république, à l’empire et débouche enfin sur la « communauté de langage ». Onésime Reclus parle d’« empires » et d’« impérialismes » pour désigner le fait récent que les êtres humains ont « moins le souci des étroites limites de leur patrie que celui de l’ensemble de contrées où l’on parle leur idiome »4. Il laisse toutefois ouvertes les modalités d’organisation de ces nouvelles configurations géographiques liées à une langue commune. Le défi politique est toujours d’actualité. Comme l’avait conceptualisé Senghor à propos des enjeux de la décolonisation auquel il était mêlé, et tout particulièrement celui de la citoyenneté, le devenir de l’Union française était tiraillé entre une logique « verticale » (l’axe Europe-Afrique) et « horizontale » (les logiques continentales d’organisation européenne et africaine). Au terme de son étude sur cette période, Frederick Cooper s’interroge : « Une question fondamentale subsiste cependant, en Europe, en Afrique, dans le reste du monde : sommes-nous capables de nous donner les moyens de concilier les aspirations à l’égalité et à la démocratie avec la diversité de l’humanité ? »5. La francophonie saura-t-elle trouver les équilibres utiles à son épanouissement ?
Une autre intuition d’Onésime Reclus correspond à sa volonté de ne pas exclure le décentrement qui pouvait atteindre la francophonie et auquel il semblait même aspirer en raison de sa vitalité attendue. C’est bien cette question du décentrement et de ses formes – multipolarité ou centre unique, voire opposition entre centres et périphéries – qui interpelle la francophonie contemporaine et déstabilise les manières de voir et les habitudes acquises, tant l’irruption de l’Afrique change la donne. Les gérants de plein droit de la langue française de par le monde sont devenus progressivement plus nombreux que ses seuls locuteurs européens. Des changements en cours témoignent des ajustements accomplis ou en germe6. D’autres mondes linguistiques en expansion ont dû – et font encore – face avec plus ou moins de difficultés à cet enjeu (anglosphère, hispanidad, lusophonie notamment) ; mais la francophonie encore fragile n’en semble qu’à ses premiers balbutiements. La composante géographique du défi posé à la francophonie est complexe car il implique autant des territoires que des polarités et des réseaux. La langue française persiste comme langue de cosmopolitisme, d’ouverture culturelle à dimension universelle, de plus en plus ancrée dans l’expérience d’espaces non français ainsi que chez des individus vivant en territoires non officiellement francophones. Ainsi, il faut éviter le tropisme de la carte (les limites territoriales), ne serait-ce qu’en raison des télécommunications et de l’importance du français en tant que langue accompagnante d’activités artistiques, scientifiques et littéraires dans des pays non francophones – un apport précieux au décloisonnement des « empires » et à la créativité culturelle.
En écho à Onésime Reclus, pour lequel l’ouverture à l’altérité s’inscrit dans un processus complexe d’évolution et de transformation, il faut penser que les constructions interétatiques ne peuvent précéder une géographie culturelle, si fluctuante soit-elle, et encore moins se substituer à elle. Les appels en ce sens sont multiples. N’est-ce pas, par exemple, ce que l’idée de « francophonie des peuples » cherche à dessiner aujourd’hui, ou encore ce à quoi pensent Alain Mabanckou et Achille Mbembe quand ils réclament que la langue française soit considérée comme un « bien commun » de l’humanité tout entière7 ? Et comme le dit François Jullien, il faut se rappeler que, par différence avec ce qui est uniforme, « le commun n’est pas le semblable »8.
Au fond, par-delà les défauts, les préjugés et les erreurs d’Onésime Reclus, ses écrits ont le mérite de nous rappeler que la francophonie est aussi affaire de géographie, c’est-à-dire notamment de géopolitique, de création culturelle, de prospective et d’action individuelle et collective.
Notes
- Ou pour critiquer l’usage qu’en font les derniers présidents français. Cf. Achille Mbembe et Alain Mabanckou, « Plaidoyer pour une langue-monde. Abolir les frontières du français », Revue du crieur, 2018, n° 2, p. 60-67.
- Mona Ozouf, Jules Ferry. La liberté et la tradition, Paris, Gallimard, 2014, p. 85.
- Sur la tentation essentialiste en Afrique et ses retombées géopolitiques, voir par exemple Cécile Canut, « “À bas la francophonie !” De la mission civilisatrice du français en Afrique à sa mise en discours postcoloniale », vol. 3, n° 167, p. 141-158, URL : https://www.cairn.info/revue-langue-francaise-2010-3-page-141.htm et Aboubakar Gounougo, « La rhétorique auto-victimiste comme stratégie argumentative dans la communication indépendantiste des panafricanistes du “Tout Sauf la France” », Altralang Journal, vol. 3, n° 2, 2021, p. 38-92, URL : https://www.asjp.cerist.dz/en/article/169513.
- Onésime Reclus, « Préface », p. VIII de id. (dir.), Grande Géographie Bong illustrée. Les Pays et les Peuples, t. I, p. I -VIII.
- Frederick Cooper, Français et Africains ? Être citoyen au temps de la décolonisation, Paris, Payot, 2014, p. 462.
- Par exemple, dans le domaine littéraire, voir Claire Ducournau, La fabrique des classiques africains. Écrivains d’Afrique subsaharienne francophones, 1962-2012, Paris, CNRS éditions, 2017 ; Christophe Charme, La dérégulation culturelle, Paris, PUF, 2015 ; Pascale Casanova, La République mondiale des lettres, Paris, Seuil, 1999 et La langue mondiale. Traduction et domination, Paris, Seuil, 2015.
- Kako Nabukpo et Caroline Roussy, Pour une francophonie de l’action, Paris, Fondation Jean Jaurès, 2018, URL : https://www.jean-jaures.org/publication/pour-une-francophonie-de-laction/?post_id=16890&export_pdf=1 ; Mbembe et Mabanckou, op. cit., p. 67.
- François Jullien, L’écart et l’entre. Leçon inaugurale de la chaire sur l’altérité, Paris, Galilée, 2011.