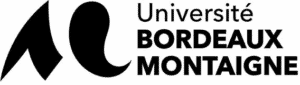Presses universitaires de Bordeaux (PUB)
Les Presses Universitaires de Bordeaux, maison d’édition publique créée en février 1983, sont un service de l’Université Bordeaux Montaigne. Première structure éditoriale au sein de cette université, elles perpétuent une tradition centenaire d’édition universitaire bordelaise connue internationalement pour des revues comme le Bulletin Hispanique, Suds (ex-Cahiers d’Outre-Mer), Communication & Organisation.
La politique éditoriale des PUB est initiée par le directeur et le comité éditorial dont les membres sont issus des établissements d’enseignement supérieur de Nouvelle Aquitaine et du monde de l’édition. Le catalogue des Presses Universitaires de Bordeaux comprend actuellement plus de 1 000 titres répartis en une quarantaine de collections portant essentiellement sur les lettres, les langues et les sciences humaines. La création et l’existence de certaines collections, surtout en sciences sociales, en sciences politiques, économiques et juridiques, soulignent l’importance des liens développés depuis des décennies avec les autres établissements d’enseignement supérieur de Bordeaux et de Nouvelle Aquitaine
Les PUB sont diffusées en librairie via l’Association Française des Presses d’Université-Diffusion – 5 représentants sur toute la France – qui s’appuie sur Dilisco, distributeur des éditions Albin Michel. Depuis plusieurs années une politique de publication et de diffusion en ligne a été systématisée. Les versions numériques des revues sont accessibles sur des portails spécialisés, Cairn, OpenEdition Journals et Persée et pour certaines sur le site des PUB. Les versions numériques des ouvrages sont disponibles sur le site des PUB et, pour certains, sur le portail OpenEdition Books et sur la plate-forme de distribution numérique, Immateriel.fr. où s’approvisionnent les grandes librairies en ligne.
Au fil du temps bien des coéditions internationales ont vu le jour avec, par exemple, les Presses de l’Université Laval au Québec, University of Exeter Press au Royaume Uni, Sud-Éditions en Tunisie en collaboration avec différentes institutions universitaires internationales.
Les Presses Universitaires de Bordeaux sont membres de l’Association des Éditeurs De Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AEDRES) qui regroupe une quarantaine de Presses d’Université.
Prendre contact :
pub@u-bordeaux-montaigne.fr
00 33 05 57 12 44 21