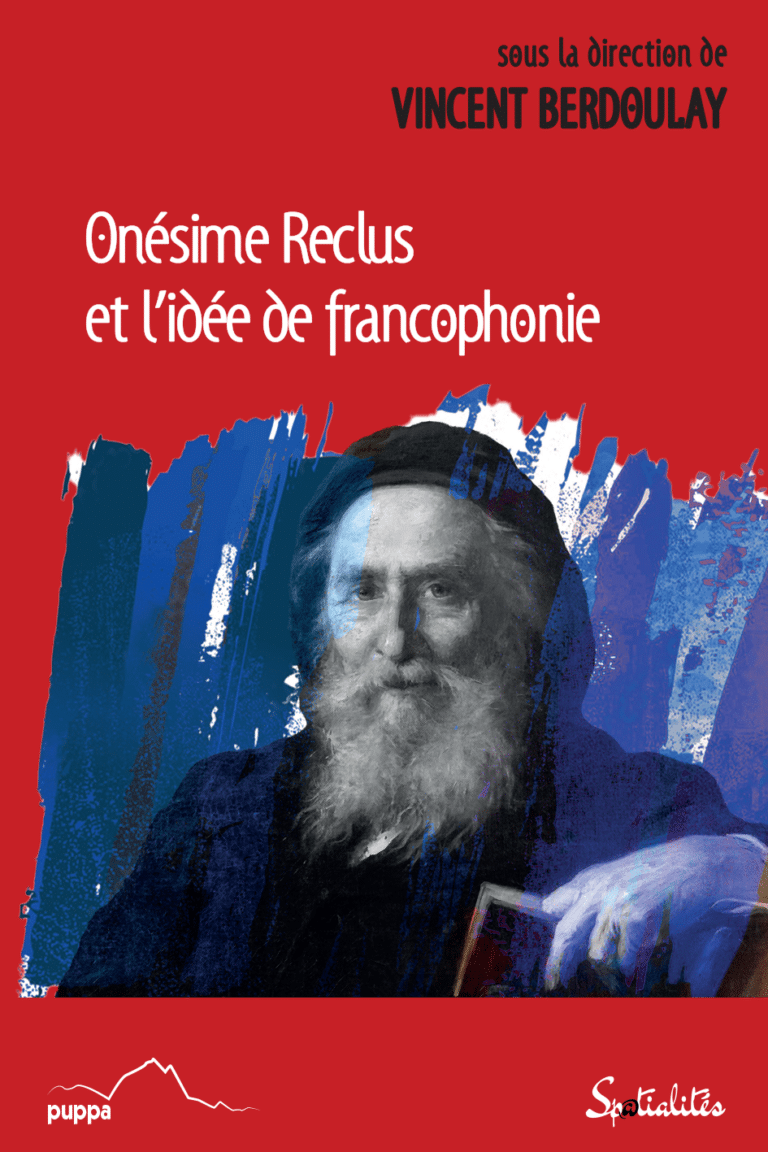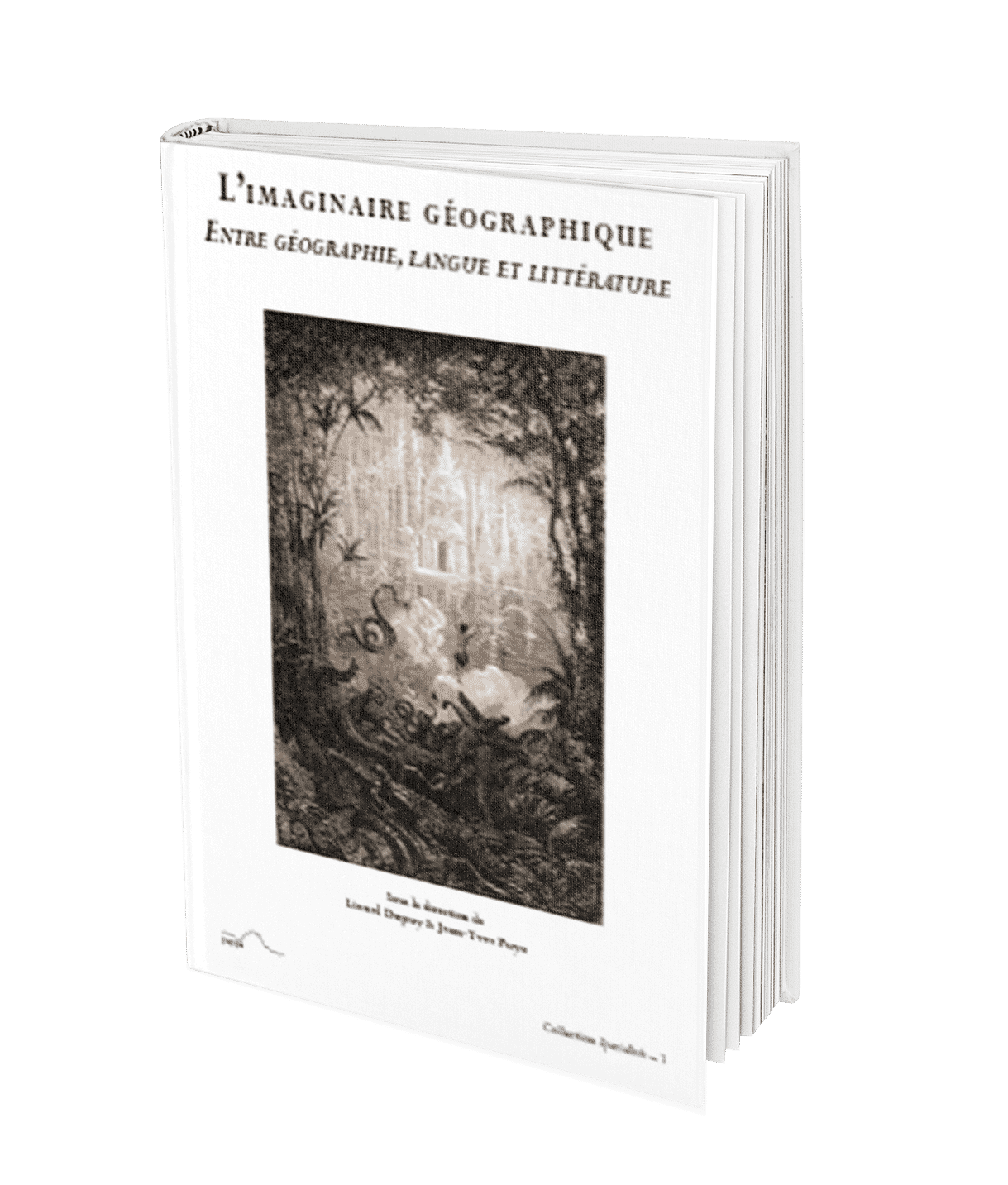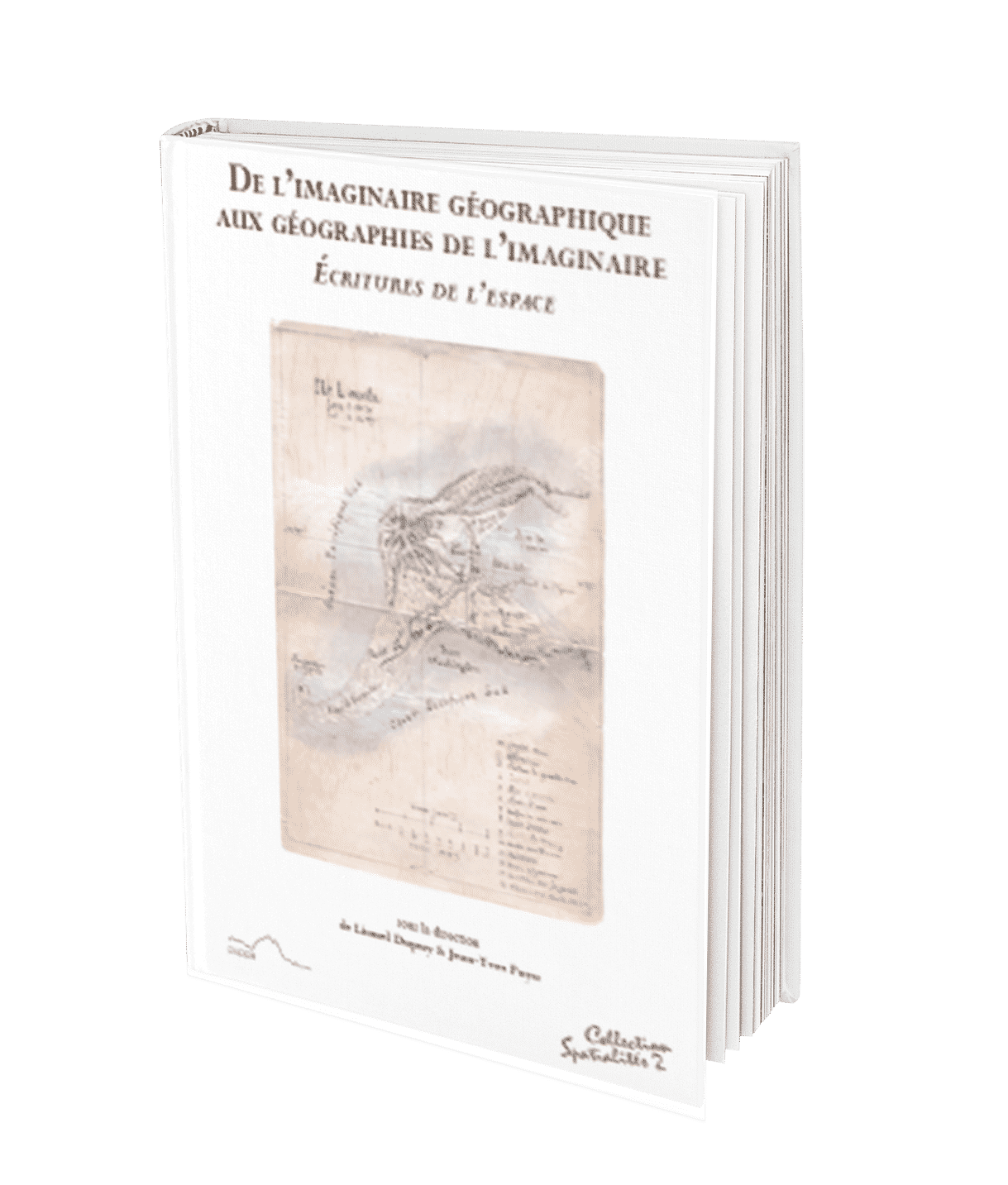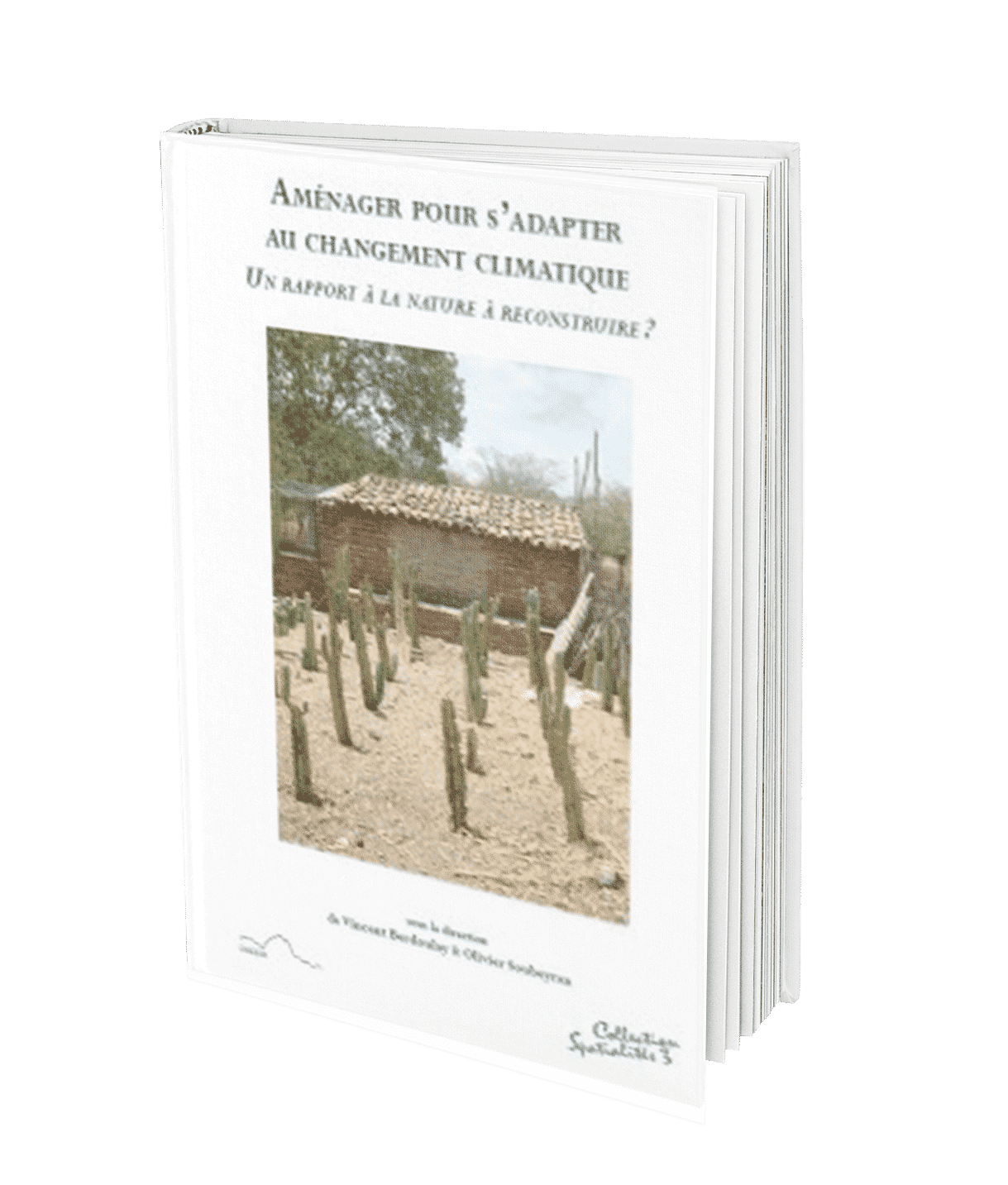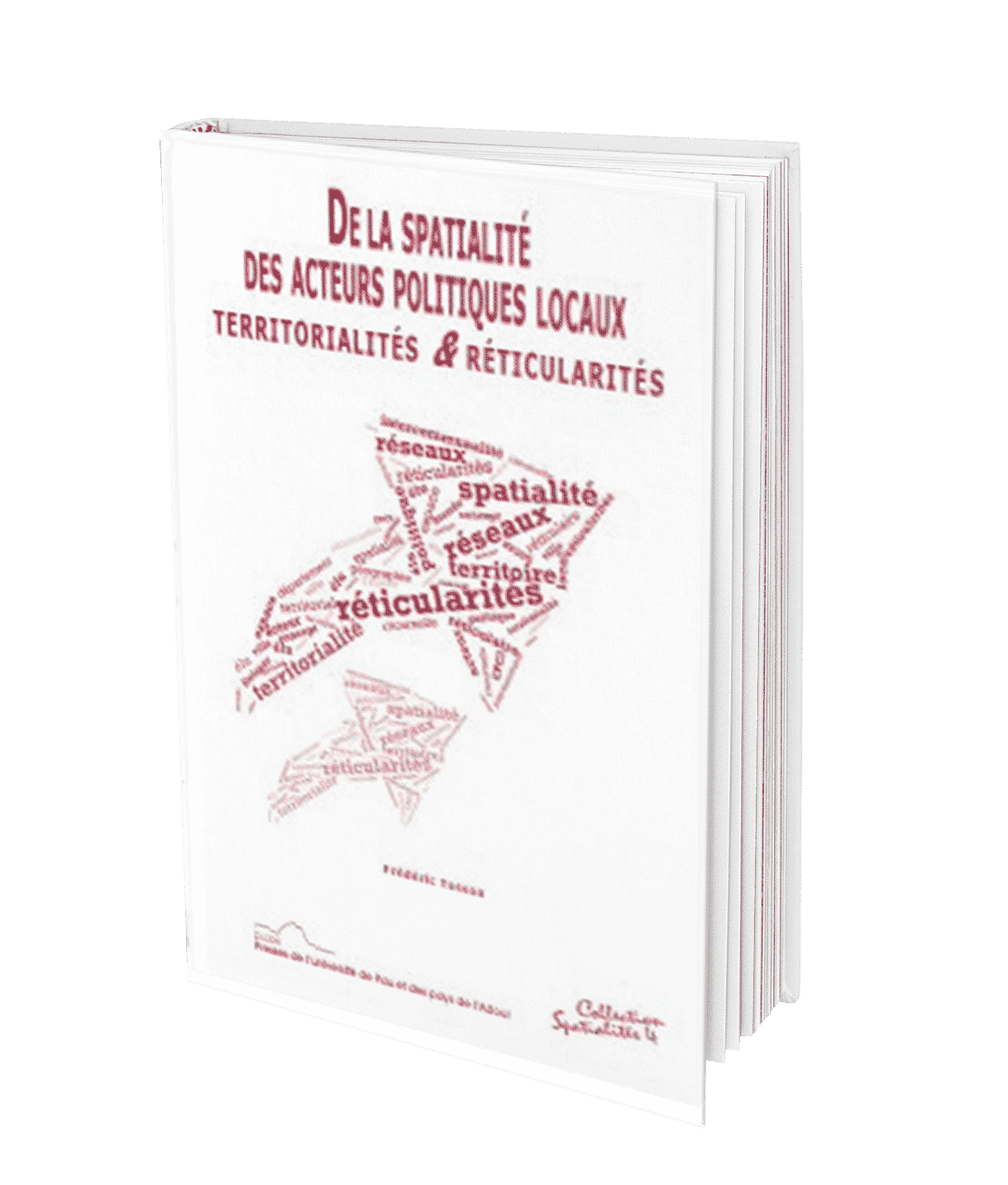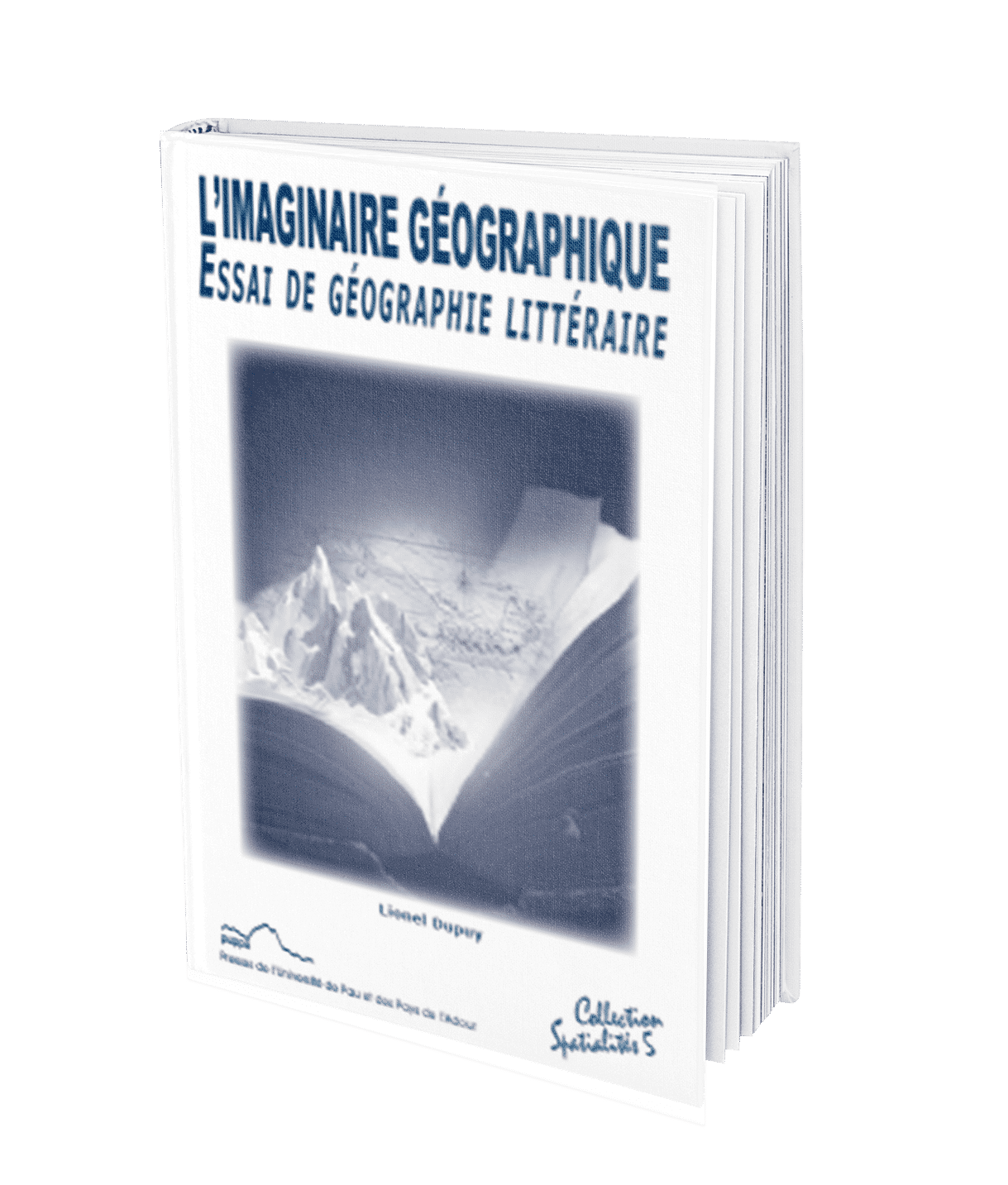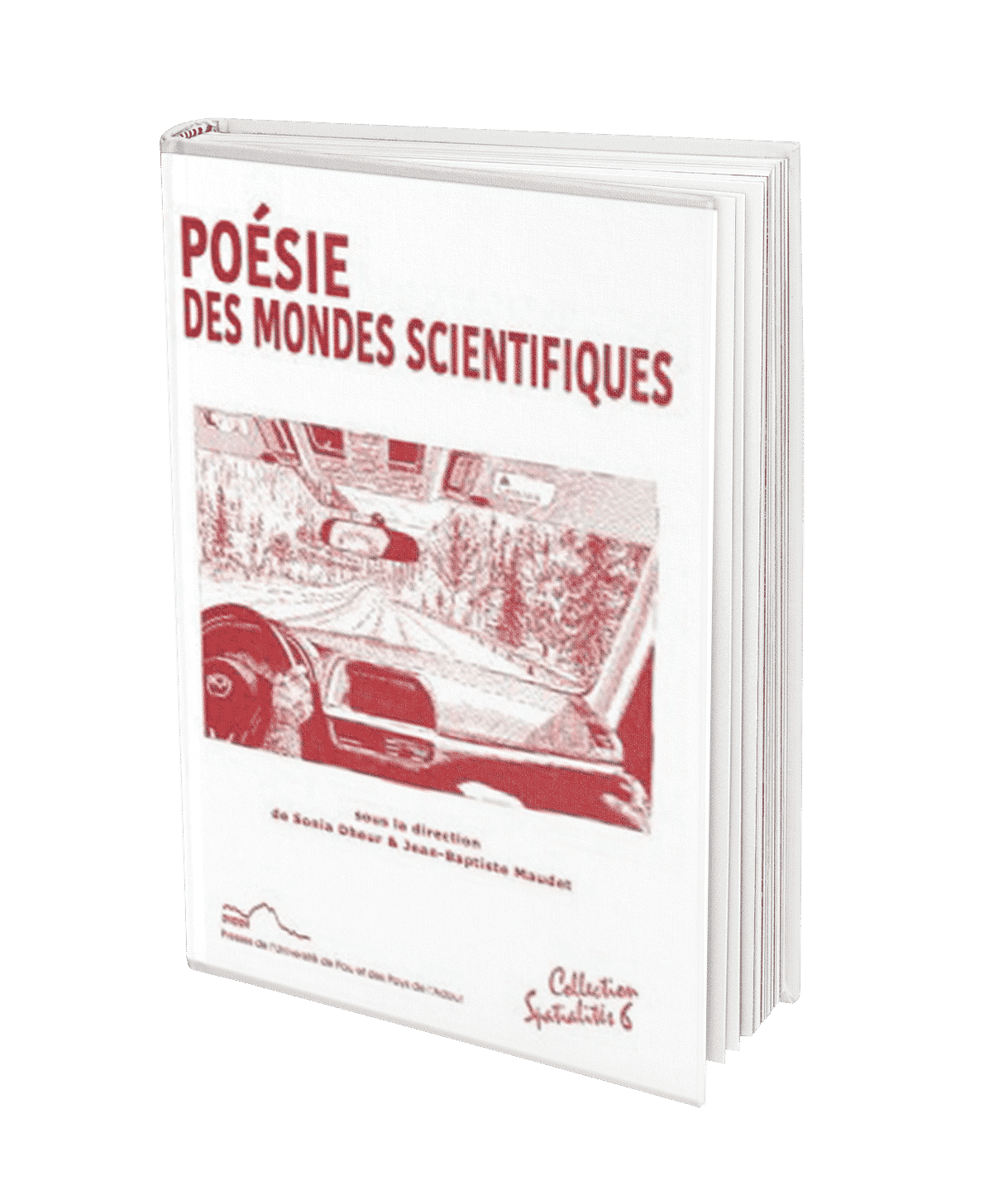Introduction
Nous avons vu que le contexte dans lequel Onésime Reclus avait élaboré ses idées, l’invitait à établir un lien étroit entre avenir de la francophonie et analyse géographique. Il s’agit maintenant de cerner comment il a cherché à le montrer. Comment sa conception géographique du monde était articulée à son diagnostic et pronostic de la francophonie ? Et en quoi l’imaginaire géographique d’ouverture au monde était sollicité par sa préoccupation pour le devenir de la francophonie ? Sans chercher à être exhaustif, nous aborderons ces questions sous trois angles.
Le premier, traité de front dans le chapitre 4, concerne une première difficulté, celle de comprendre l’importance qu’Onésime Reclus accordait à l’expansion coloniale ultramarine de la France. Justifie-t-il par là le lourd soupçon, voire l’accusation, que font peser sur la défense de la francophonie ses opposants, à savoir d’avoir servi à justifier le colonialisme voire ses avatars néocoloniaux plus récents ? La question est d’autant plus délicate à aborder que la discipline géographique elle-même a historiquement profité, pour son institutionnalisation, des politiques d’expansion coloniale. Il en va de même du nationalisme qui lui est souvent associé, ce qui renvoie aisément pour les critiques de la Francophonie à sa réduction à une machine au profit de la France. Qu’en est-il réellement de cette hypothèque coloniale, voire nationaliste française, qu’Onésime Reclus a pu faire peser sur les origines de la défense de la francophonie ? Est-il possible de la dépasser ? Pour en évaluer la portée, il faut se situer loin des lunettes contemporaines et inscrire le regard d’Onésime Reclus dans les problématiques de l’époque où il a cherché à montrer l’entrecroisement des politiques linguistiques et culturelles avec les défis géopolitiques.
À cette composante de l’imaginaire de la francophonie que développait Onésime Reclus s’en ajoute une seconde, tout aussi importante car portant sur son ancrage au milieu géographique. Sous l’angle de la protection de monuments et sites naturels, le chapitre 5 explore comment Onésime Reclus s’efforce de mettre en adéquation son regard francophone avec des territoires où la francophonie a prospéré. Pour ce faire, il avait tout particulièrement saisi l’opportunité que lui offrait un projet éditorial du Touring Club de France. Son approche d’un patrimoine paysager à valoriser correspond-elle à un « patriotisme géographique » dont la portée est à évaluer, d’autant plus que le projet ne s’appliquait pas aux territoires coloniaux au-delà de l’Algérie et de la Tunisie, laissant par là en suspens son rapport à l’universalité ? Ses écrits portent-ils une signification davantage paysagère ou davantage nationale ? Comment la sensibilité d’Onésime Reclus pour la nature, dont il réclame la protection, se combine-t-elle dans le regard géographique qu’il jette sur son pays ?
Il est par ailleurs possible de s’interroger sur l’universalité du regard qu’Onésime Reclus jette sur le monde entier. C’est cet angle de vue qu’adopte le chapitre 6 du fait d’une autre opportunité éditoriale offerte à Onésime Reclus, celle de coordonner une vaste géographie universelle. Comment s’y prend-il pour répondre à cette tâche ? Quel imaginaire d’ouverture au monde développe-t-il ? Quel regard cherche-t-il à transmettre à propos de la géographie de la diversité des peuples et des langues ? Quelle place la francophonie y occupe-t-elle ?
La francophonie s’inscrit dans une économie générale, une géopolitique, des langues à la surface de la terre, et ce, à toutes les échelles car Onésime Reclus se préoccupe autant des parlers locaux que des vastes aires linguistiques de par le monde. Sensible au fait que le rapport du français aux autres langues se joue aussi en France, n’établit-il pas un continuum entre cette problématique nationale et sa problématisation dans d’autres parties du monde ? Comment accommode-t-il son réalisme géopolitique à l’horizon culturel qu’il attribue au développement de la francophonie ? En quoi son hostilité envers certaines langues, dont les patois de France, fait-il écho à sa conviction que le monde s’organise de façon croissante non plus en nations mais en grands ensembles linguistiques, des « empires » comme il les appelle ? De fait, les chapitres qui suivent montrent un Onésime Reclus qui ne se trouve pas nécessairement là où on l’attend à propos de la francophonie.