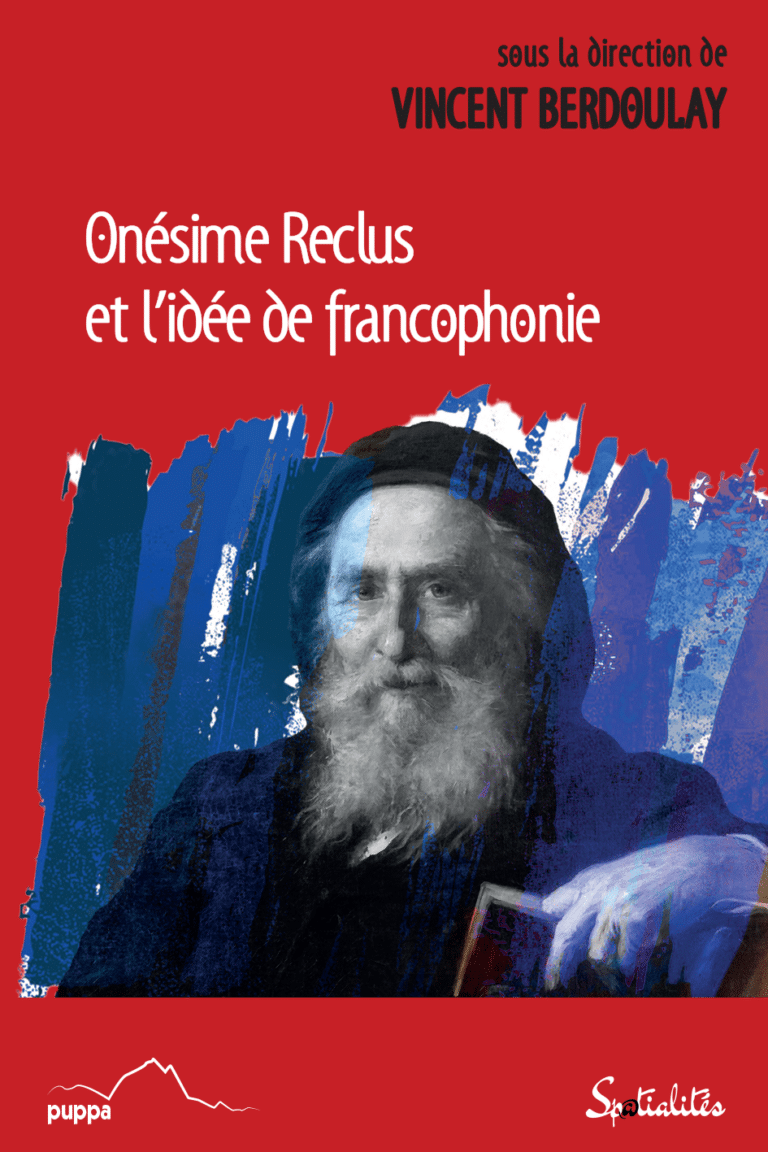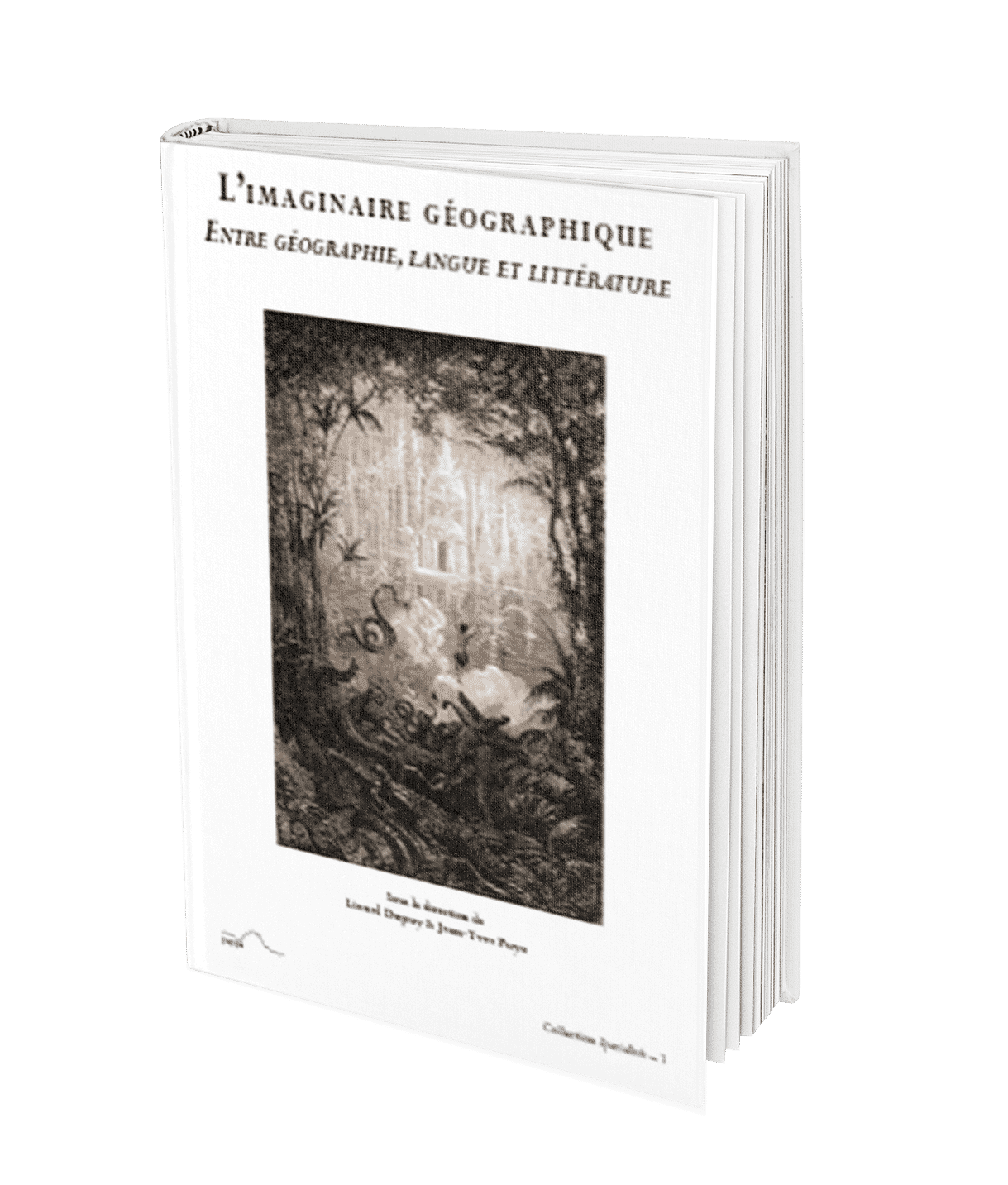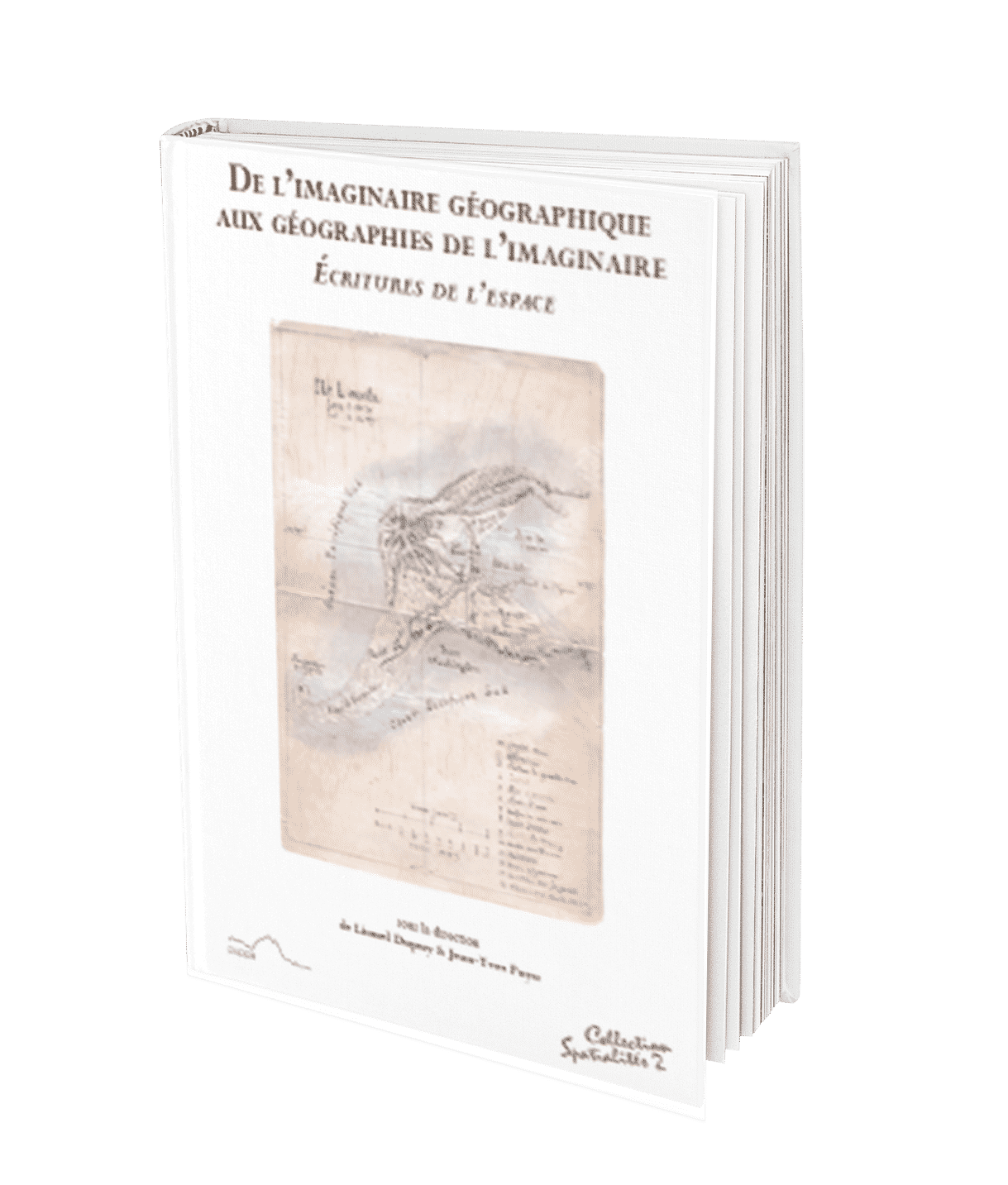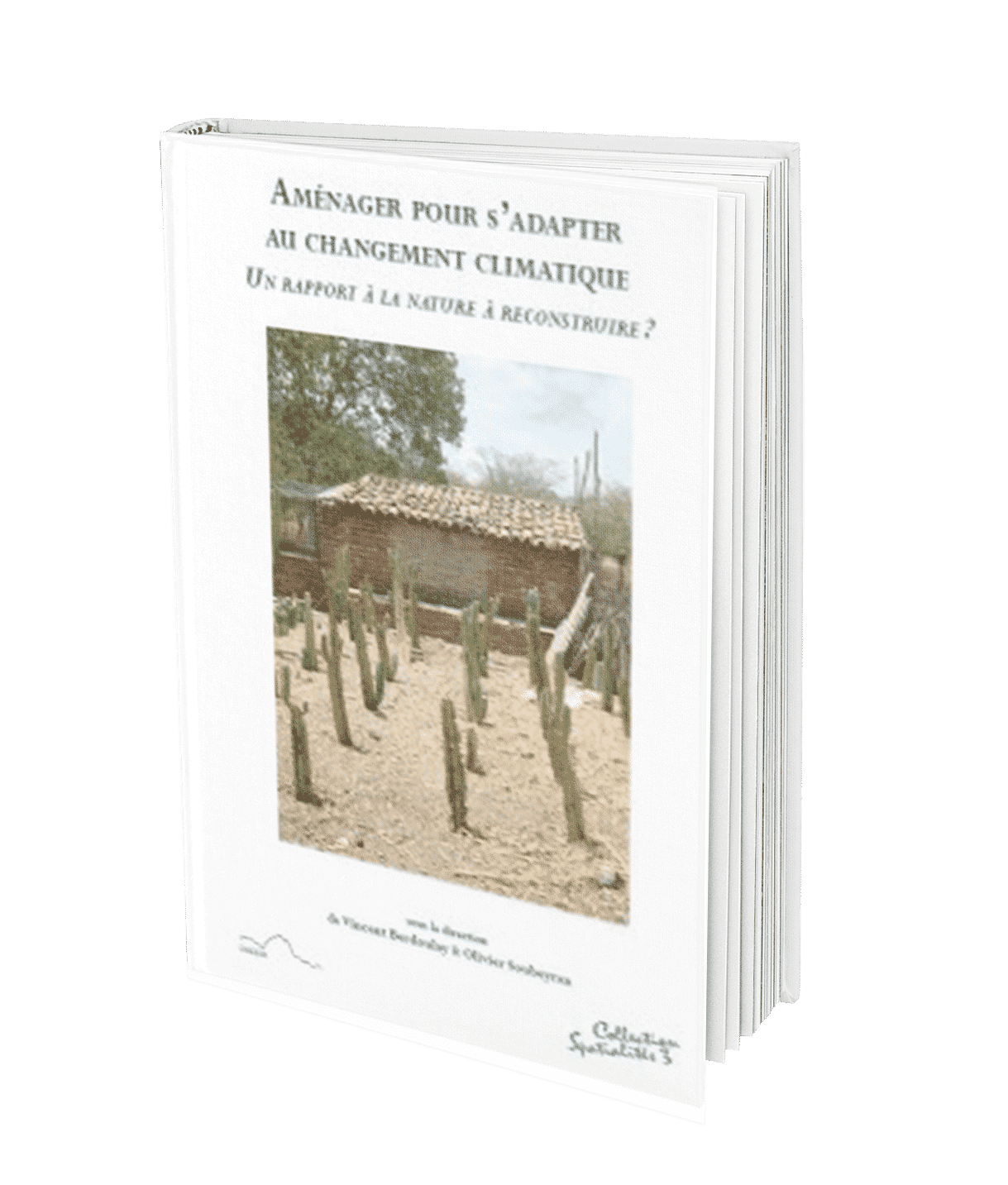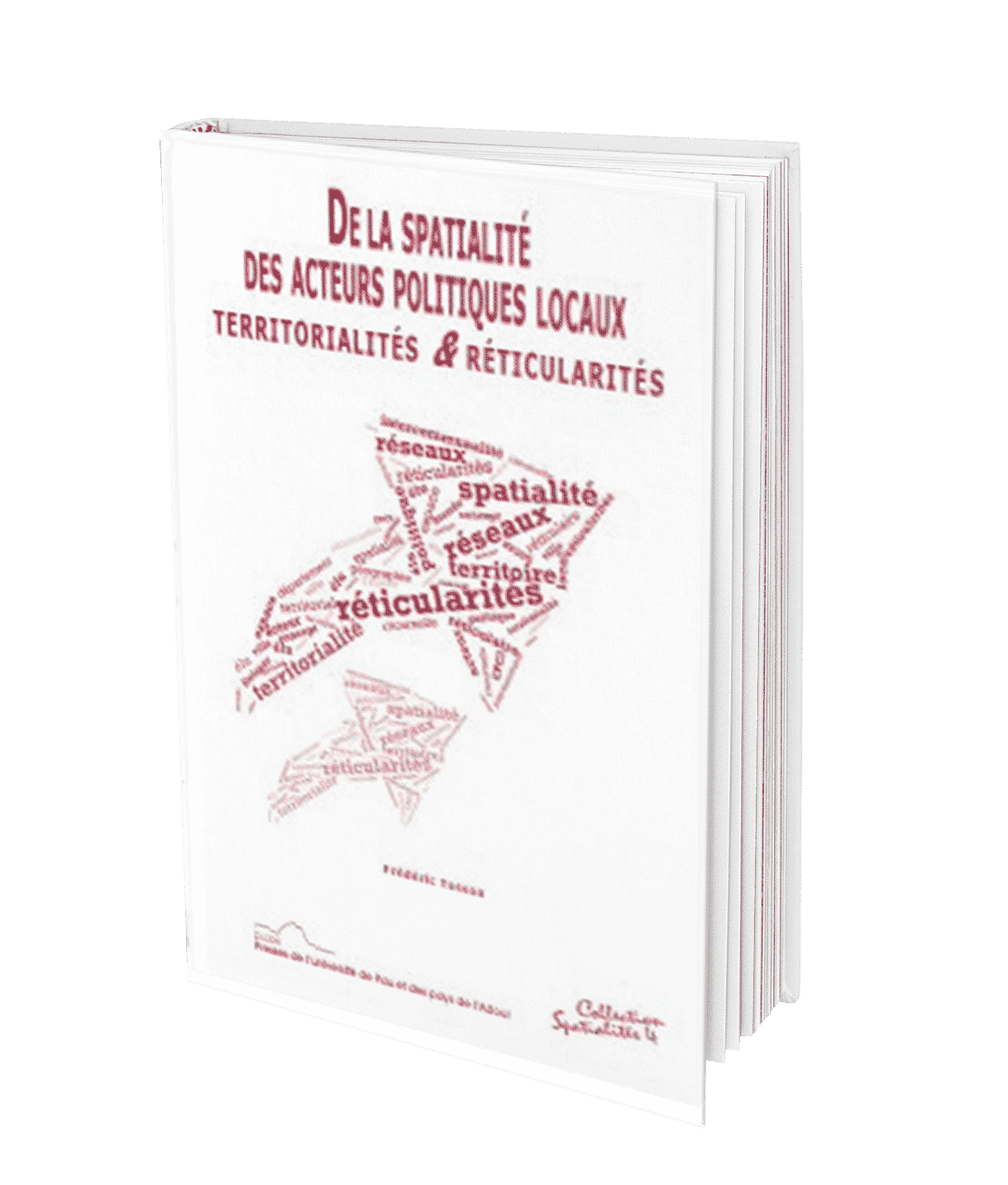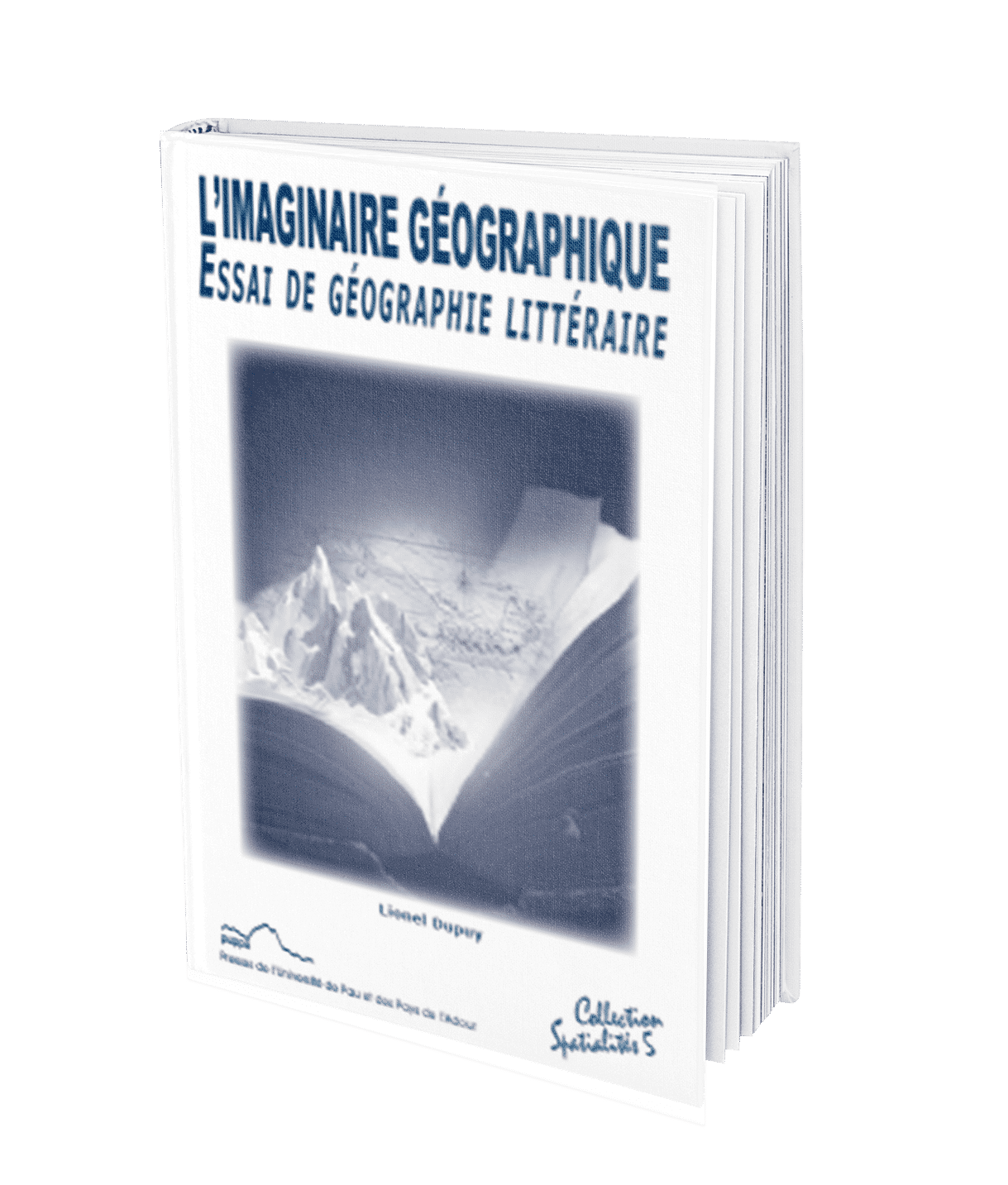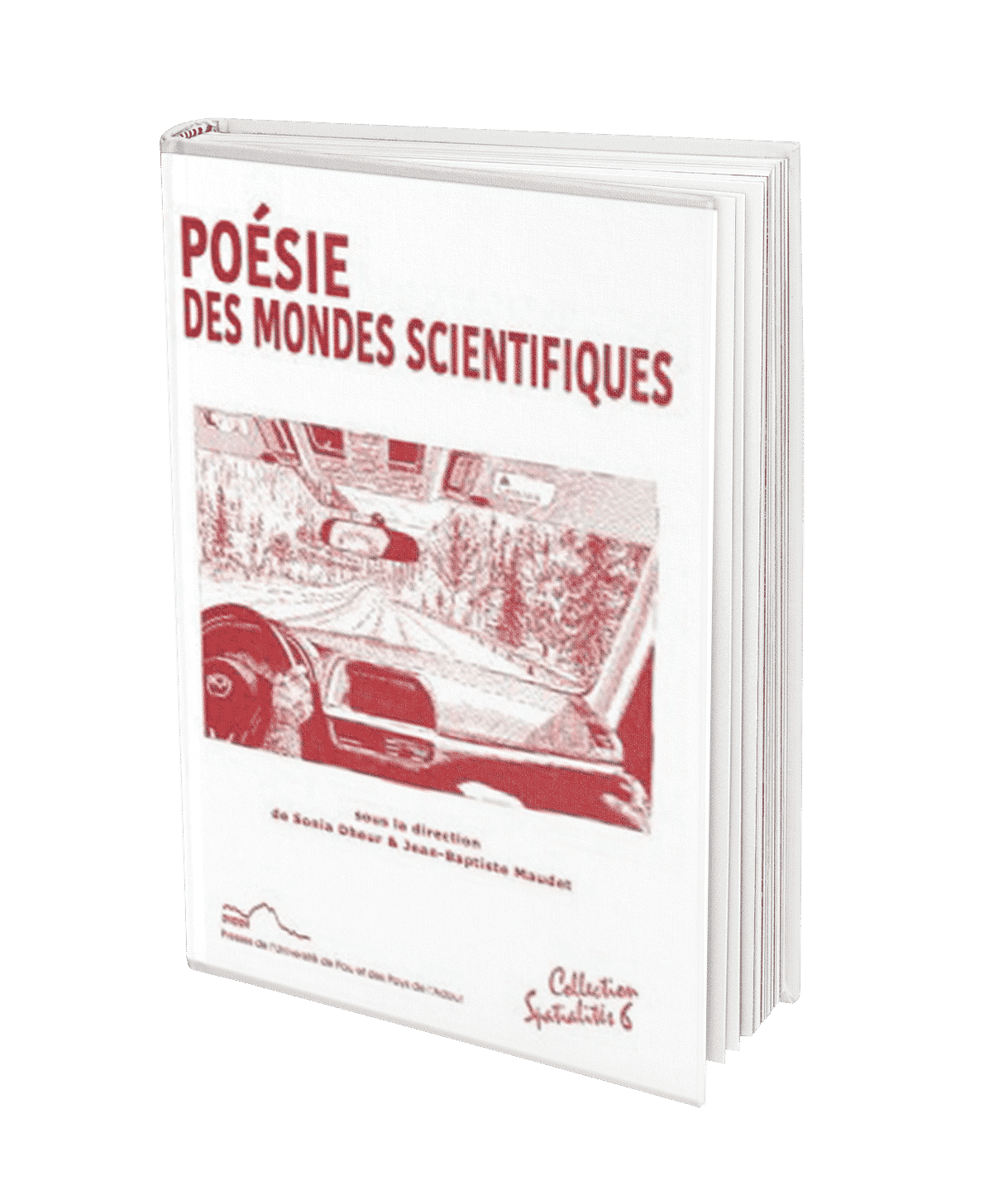C’est sous la plume d’Onésime Reclus qu’en 1886 sont d’abord diffusés les termes de francophone et de francophonie1. Indépendamment des idées de ce dernier, l’usage de ces termes n’est revenu en force qu’à l’époque de l’indépendance d’anciennes colonies par la création dans les années 1960-1970 d’un espace de coopération interétatique, impulsé à l’origine par Léopold Sédar Senghor (Sénégal), Hamani Diori (Niger), Habib Bourguiba (Tunisie) et Norodom Sihanouk (Cambodge)2. Depuis, les institutions se réclamant de la francophonie se sont multipliées dans tous les domaines de coopération et certaines ont atteint un niveau politique majeur, au premier chef duquel se situe l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), rassemblant de nombreux États et gouvernements, d’ailleurs souvent résumée sous le seul nom de Francophonie3. Il n’en reste pas moins que référence est souvent faite depuis quelque temps à l’« inventeur » du terme francophonie, Onésime Reclus. Or, sa pensée reste mal connue, au point qu’elle est invoquée de façon diverse, charriant de multiples interprétations, d’ailleurs souvent contradictoires. Elle peut par exemple être mentionnée comme valorisant le respect de la diversité culturelle ou bien son contraire, c’est-à-dire nationaliste française, colonialiste et uniformisatrice, ou encore comme réservant de façon excluante le terme francophone à toute création ou population situées hors de la France hexagonale, ou bien encore comme conférant au français un statut de supériorité sur toutes les autres langues ou lui attribuant une vocation hégémonique ; les apparentes contradictions ne manquent pas à propos de la pensée d’Onésime Reclus4 ! Il est clair que cette diversité des interprétations – ou mésinterprétations – provient surtout des enjeux qui pèsent actuellement sur l’ensemble des personnes utilisatrices de la langue française, en particulier celles cherchant à légitimer leur organisation au national et à l’international. La diversité caractérise les attitudes contemporaines vis-à-vis des politiques de développement de la francophonie : elles vont du soutien enthousiaste à la franche hostilité, en passant par l’indifférence ou le qualificatif de « ringardes ».
C’est pourquoi, afin de contribuer à clarifier les enjeux de la francophonie, un retour sur la pensée d’Onésime Reclus s’avère utile. Qu’est-ce que, chez ce dernier, l’irruption du terme de francophonie (et corrélativement celui de francophone) pouvait expliciter ou induire comme significations, enjeux et politiques ? Et quelles en sont les conséquences et la portée pour l’évolution de l’idée actuelle de francophonie ? Plus particulièrement, quelles en sont les dimensions géographiques ? En effet, Onésime Reclus, en tant que géographe, n’a eu de cesse de jeter un regard géographique sur tout ce qui concernait la francophonie comme ensemble actuel ou à venir des utilisateurs de la langue française. Or, il s’agit là d’une dimension de la francophonie qui est relativement peu abordée, une probable lacune dans la façon de la concevoir tant pour l’analyse que pour l’élaboration de politiques appropriées. Il est vrai que cette dimension géographique n’est pas facile à conceptualiser, mais cela rend justement le regard d’Onésime Reclus d’autant plus intéressant. Examiner la façon dont il a abordé géographiquement la francophonie doit être révélateur de multiples enjeux idéologiques qui la concernent. Retourner vers le premier utilisateur du terme doit permettre de cerner certaines des sources de l’idée élusive de francophonie.
Or la pensée d’Onésime Reclus, pourtant membre d’une fratrie célèbre en son temps, est restée dans l’ombre de celle de son grand frère Élisée, géographe de réputation internationale tant pour les écrits scientifiques que pour l’engagement anarchiste. L’originalité d’Onésime a ainsi été mal identifiée, soit que sa pensée géographique ait été réduite à une pâle copie de celle de son frère, soit qu’elle ait été soupçonnée d’en contredire la portée anarchiste – ce qui ajoute une autre couche aux mésinterprétations ! Pour lever ces ambiguïtés comme pour mieux comprendre ses idées sur la francophonie, il faut replacer la pensée d’Onésime Reclus dans son temps. Notre approche sera contextuelle, c’est-à-dire qu’elle cherchera à clarifier la pensée d’un auteur à partir de sa propre interaction avec le contexte sociétal de son époque, étant entendu que se mêlent chez lui personnalité, déterminations et actions visant à modifier ce conditionnement. Les éléments biographiques ne sont donc évoqués que pour identifier les sources potentielles de sa pensée, ses engagements, ses initiatives et ses idées novatrices. Cette approche vise à les saisir dans la complexité des enjeux qui étaient les leurs. Le sens des mots et des discours est à interpréter dans le contexte où ils sont employés, afin de ne pas plaquer sur eux les catégories analytiques développées récemment pour théoriser le présent ou le passé et éviter de les juger en fonction de critères anachroniques. Utiliser par exemple des cadres théoriques élaborés actuellement au titre de la démarche appelée postcoloniale ou décoloniale, quelle que soit son intérêt pour dégager des rapports logiques entre certains concepts, ne permettrait pas de caractériser la complexité sémantique, sociale, culturelle et politique dans laquelle agissait une personne telle qu’Onésime Reclus. À la manière de ce que s’efforcent de faire des historiens à propos des peuples extra-européens colonisés, il s’agit de « sortir de ses propres catégories »5. Ce volume, en somme, se limite à contribuer à l’histoire intellectuelle de l’idée de francophonie à travers l’examen de la pensée d’Onésime Reclus. Nous procéderons en trois temps, les trois parties du présent ouvrage.
Il faut d’abord préciser des éléments de contexte permettant de voir comment se posait la question du devenir de la langue française à l’époque d’Onésime Reclus. Il est ainsi significatif de noter que le souci de développer des actions en faveur de l’expansion du français hors de France ne commence pas avec Onésime Reclus. Toute une politique très originale aux multiples ressorts se mettait alors en place, notamment aux niveaux universitaire et associatif. De plus, pour les Français, la question de la diffusion de la langue française ne se limitait pas à l’extraterritorial, qu’il soit colonial ou non : elle se posait aussi à l’intérieur du cadre national où coexistaient de nombreux parlers. C’est dans ce contexte qu’Onésime Reclus déploya son énergie pour développer sa propre approche du développement de la francophonie. Aussi, quels étaient ses préoccupations, réseaux et points d’appuis ?
Il sera alors possible, dans un second temps, de mieux comprendre de grands aspects de sa pensée et de son action, avec leur originalité comme avec leurs impasses. Ils dessinent l’imaginaire géographique de la francophonie qui était le sien et qui s’écarte significativement des stéréotypes qui lui sont plaqués aujourd’hui. C’est le cas à propos de la colonisation dont il fut effectivement un grand partisan. Mais c’est aussi le cas de sa géographie : comment l’a-t-il mobilisée pour dire les paysages ou pour dire le monde ? En quoi son regard géographique éclairait-il son engagement pour le développement de la francophonie ?
Enfin, dans un troisième temps, il sera intéressant de voir quels échos du rêve francophoniste d’Onésime Reclus existeraient aujourd’hui – non que les préoccupations actuelles dérivent des siennes, mais plutôt qu’elles pointent certains enjeux que l’examen de sa pensée a pu soulever dans les parties précédentes. Si la diffusion mondiale du français est relativement bien documentée aujourd’hui, deux aspects le sont moins et seront ici abordés : ils ont été choisis, parmi d’autres, parce qu’ils recoupent ce que la pensée d’Onésime Reclus laissait en suspens, à savoir certains aspects pratiques de cette diffusion, tant au niveau institutionnel dans les nouveaux pays d’Afrique qu’au niveau littéraire. Il s’y manifeste divers enjeux de pouvoir dont la portée handicape l’essor d’une francophonie mondiale.
En somme, quels sont les enseignements que nous livre la clarification de la pensée d’Onésime Reclus, au-delà des paradoxes qu’elle peut contenir ou des rejets qu’elle a engendrés ? Entre l’universel et le particulier, entre une mondialisation et un repli, entre les contraintes géopolitiques et l’horizon culturel, comment la francophonie peut-elle dessiner son avenir ? Il va de soi que les tonalités parfois différentes des contributions qui suivent sont à l’image de la complexité d’un regard que ce volume essaye de présenter ; elles reflètent aussi la liberté des auteurs, composante de l’horizon actuel de la francophonie.
Notes
- Onésime Reclus, France, Algérie et colonies, Paris, Hachette, 1886.
- Xavier Deniau, La francophonie, Paris, PUF, 1983 ; Michel Tétu, La francophonie : histoire, problématique, perspectives, 3e éd. revue, Préface de L.S. Senghor, Montréal, Guérin, 1992 ; Papa Alioune Ndao (dir.), La francophonie des pères fondateurs, Paris, Kartala, 2008.
- Nous reprendrons ici l’usage courant d’attribuer une majuscule à Francophonie seulement quand ce terme renvoie à l’OIF et son action.
- À titre d’exemples de points de vue critiques : Luc Pinhas, « Aux origines du discours francophone. Onésime Reclus et l’expansionnisme colonial français », Communication & langages, n° 140, 2004, p. 69-82 https://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_2004_num_140_1_3270 ; Georg Glasze, « Von der Assimilation zur diversité culturelle – der Kolonialgeograph Onésime Reclus (1837–1916) als Vordenker der Frankophonie? » dans Sebastian Lentz et Ferjan Ormeling (dir.), Die Verräumlichung des Welt-Bildes, Stuttgart, Steiner, 2008, p. 155-179 https://archiv.geographie.uni-erlangen.de/wp-content/uploads/ggl_publik_vonassimilationzurdiversiteculturelle_091209.pdf.
- Frederick Cooper, Le colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire, Paris, Payot, 2010 [éd. orig. Anglaise 2005], p. 19.