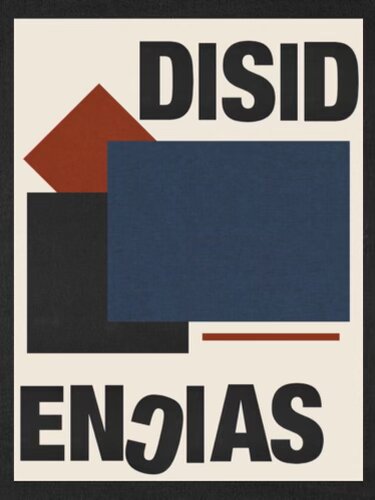Faire taire la différence. Prélude grec
Introduction : L’imagination et l’imaginaire
L’imagination est une faculté que possède l’individu comme sujet. L’imaginaire constitue à l’inverse un ensemble de représentations qui prend sa source dans la société et dont la diffusion manifeste l’action inconsciente de la société sur l’individu. Une opposition tenace s’installe ainsi dans nombreux champs disciplinaires. Une certaine psychologie ou sociologie tend à opposer explicitement l’« imaginaire » à l’« imagination ». Christophe Dejours affirme ainsi : « L’imaginaire (social) s’oppose ici conceptuellement à l’imagination (subjective). L’imagination est le résultat du travail psychique de liaison, à partir de formes figurées (les fantasmes) produites par le sujet lui-même et de leur association à des pensées latentes. […] L’imaginaire social, en revanche, est un répertoire d’images données de l’extérieur par la société…1 » On voit ici que l’individu produit de l’intérieur de lui-même les formes figurées ou fantasmes mais que l’imaginaire social lui est en revanche donné de l’extérieur et fonctionne un peu comme un « prêt-à-penser », s’apparentant de très près à ce que l’on nommait naguère l’« idéologie ». Est-ce à dire que l’imaginaire social ne peut être que donné et non produit et, en conséquence, que le rapport de l’individu à un tel imaginaire ne peut être que passif ? Ou bien est-il possible d’envisager que cet imaginaire lui-même soit modifié ou déconstruit, de manière à inquiéter les certitudes qui font sa force ? En allant plus loin, peut-on concevoir qu’un autre imaginaire social soit activement produit lui-même, non certes par un individu isolé, mais par des individus agissant en tant qu’acteurs collectifs et, si oui, à quelles conditions ?
L’enjeu politique de cette question est considérable. Il y va en effet de la possibilité d’opposer à l’imaginaire néolibéral dominant un « imaginaire alternatif », celui que nous appelons l’« imaginaire du commun ». Car une telle opposition n’implique nullement que ces deux imaginaires se situent sur le même terrain2. En réalité, le terme d’« imaginaire » ne prend pas le même sens dans les deux cas. L’imaginaire néolibéral est avant tout un imaginaire entrepreneurial. L’imaginaire du commun est un imaginaire d’une tout autre nature. Pour le comprendre, il faut examiner le, ou plutôt les, rapports possibles de l’imaginaire à l’imagination à partir de trois perspectives très différentes avant d’introduire dans la dernière partie de notre exposé le concept d’un « imaginaire des pratiques ».
Phénoménologie de l’acte d’imaginer
Notre imagination a été, et continue encore d’être vue comme une faculté témoignant d’un degré d’activité qui justifie que l’on parle d’elle comme d’une « force » ou d’un « pouvoir » : on la désignait par l’expression latine de vis formandi, c’est-à-dire comme force formatrice (bildende Kraft, dira Kant au XVIIIe sc.). L’imagination est un pouvoir de produire ou de former à partir de nous-mêmes des images, à la différence de la sensation par laquelle les objets nous sont donnés de l’extérieur. Elle constitue en ce sens un pouvoir de présenter un objet in absentia, en son absence, c’est-à-dire sans qu’il affecte directement nos sens externes (vue, toucher, ouïe, odorat, goût). Dans un cadre aussi large, on pouvait ranger une très grande diversité d’actes. Quelques exemples suffiront à le montrer.
Empruntons un premier exemple à Sartre3. Si je ferme les yeux, je ne vois plus la feuille de papier que j’avais sous les yeux l’instant d’avant. Pourtant, je sais bien qu’elle n’a pas disparu, qu’elle ne s’est pas anéantie. En effet, je puis la faire réapparaître tout en gardant les yeux fermés, elle a gardé sa forme, sa couleur et sa position. Je ne la vois plus et en même temps je la vois « en image », je forme en moi une image de cette feuille. Mais peut-on écarter si facilement l’hypothèse de l’anéantissement provoqué par la fermeture des yeux ?
Je peux toujours me livrer à une expérience de pensée, comme celle du Stephen de l’Ulysse de Joyce marchant les yeux fermés sur la grève de Sandymount et se demandant si le monde n’aura pas disparu lorsqu’il rouvrira les yeux4. Cette expérience ne prend tout son sens que si on la réfère polémiquement à la doctrine de l’immatérialisme professée au XVIIe siècle par l’évêque irlandais Berkeley : selon elle, la matière n’existe pas car il n’existe que des perceptions et des esprits qui perçoivent5. Il se pourrait donc que le monde disparaisse pendant que je ferme les yeux, puisqu’il cesse alors d’être perçu : « Ouvre les yeux maintenant. Oui. Un instant. Et si tout avait désormais disparu ? », se demande Stephen6. Durant cette expérience de pensée, le sens de l’ouïe reste pleinement actif et fait que Stéphane s’imagine les coquillages et le varech sur lesquels crissent ses chaussures. Du même coup, le temps comme forme de la succession subsiste, ne serait-ce que par le rythme de la marche et des bruits de pas. Aussi, lorsqu’il rouvre les yeux, Stephen ne peut que se rendre à l’évidence : loin d’avoir disparu, le monde subsiste pour toujours, identique à ce qu’il était avant l’expérience7.
Prenons ensuite deux autres exemples, regroupés ici pour des raisons de commodité. Premièrement, celui d’une évocation volontaire du passé : je me souviens de la maison de mon enfance. Ce faisant, je « re-produis » au sens où je produis de nouveau, c’est-à-dire que je forme cette image en posant cet objet comme ayant-été-présent pour moi. Deuxièmement, celui d’une image involontairement produite : je perçois une maison et cette vue me fait penser à la personne qui y habite et que je connais. Son image surgit alors en moi sans y être appelée par ma volonté, elle naît par association mentale. Elle est l’image d’une personne posée comme existante mais non actuellement perçue par moi.
Quatrième exemple : au lieu de me rappeler une maison que j’ai vue auparavant, je produis en moi, en ma qualité d’architecte, la forme d’une maison que je n’ai encore jamais vue. La formation de l’image d’une chose nouvelle atteste d’une faculté proprement inventive : tout en satisfaisant aux réquisits de l’habitabilité, faute de quoi on ne pourrait la subsumer sous le concept de maison, cette forme est posée par moi comme n’ayant jamais existé à ce jour. En effet, produire l’image de quelque chose de nouveau qui n’a jamais été vu ne revient pas au même que produire de nouveau l’image de quelque chose qui a déjà été vu.
Cinquième exemple : je produis l’image d’un centaure en train de jouer de la flûte (exemple emprunté à Husserl, le fondateur de la phénoménologie8) et je pose alors le centaure comme inexistant. Cette inexistence ou irréalité est plus radicale encore que celle de la nouvelle maison inventée par l’architecte en ce que l’inexistence du centaure est relative à notre monde pris comme totalité : son existence est radicalement exclue par les lois de la nature, comme l’établit Lucrèce se demandant ce que deviendraient les deux parties – homme et cheval – du centaure au bout de trois ans dès lors que leurs rythmes de développement sont incompatibles9, ce qui n’est nullement le cas de la maison à la forme inédite.
Inutile de prolonger cette énumération. On retrouve dans tous ces exemples la conjonction de deux traits qui donnent à l’acte d’imaginer sa relative unité : d’une part, ce qui m’apparaît a un caractère pour ainsi dire intuitif, il ne relève pas d’une représentation générale et abstraite, c’est-à-dire d’un concept ; d’autre part, ce qu’il rend présent ou « présentifie » n’est pas donné dans et par la sensation. L’important n’est pas que l’acte d’imaginer soit ou non volontaire, l’important est qu’il produise quelque chose, en dehors de toute présence sensible. C’est une action de « mettre sous les yeux » (subjectio sub aspectum10) quelque chose qui n’affecte pas le sens externe de la vue, donc qui n’est pas « vu », et qui pourtant est « comme vu », parce que donné intuitivement.
L’imaginaire comme dimension constitutive du moi
Cette phénoménologie peut sembler par trop suspecte à un examen plus circonspect quant aux prétendus pouvoirs du sujet : de quel droit rapporter tous ces actes d’imaginer à une faculté ou un pouvoir qui prendrait le nom d’« imagination » ? En effet, dans chacun de ces exemples, on a affaire à une visée par laquelle un sujet pose un objet sous différents modes (soit comme inexistant parce que son existence est impossible, soit comme inexistant parce que n’ayant jamais existé jusqu’alors, soit comme ayant-déjà-existé mais n’existant plus, etc.). On peut élargir le cercle et envisager un acte ou une visée par laquelle un sujet se rapporte à son objet sur le mode de l’anticipation, c’est-à-dire en le posant comme n’existant pas encore parce qu’à venir (l’architecte inventif est sans doute tenté de projeter la réalisation de la forme de sa maison dans l’avenir). Mais, à l’inverse, on peut se demander si toute « anticipation » présuppose une telle relation intentionnelle d’un sujet à un objet ou s’il ne faudrait pas admettre une anticipation structurante serait en-deçà de cette division sujet-objet et donc de toute anticipation intentionnelle.
Prenons ce que Lacan présente au début du Livre II du Séminaire comme « une découverte de l’expérience », et non comme une « catégorie » indépendante de l’expérience (ou a priori) : la découverte de ce que « le moi, dans son aspect le plus essentiel, est une fonction imaginaire » et que la « structure fondamentale, centrale, de notre expérience, est proprement de l’ordre imaginaire. »11. À l’encontre de tout naturalisme, Lacan souligne la distinction entre la fonction imaginaire telle qu’elle intervient dans la nature et la fonction du moi qui est présente chez l’homme. Dans l’annonce des subdivisions qui figure en tête du III du Livre II, « L’univers symbolique », l’expression étrange : « L’imaginaire naturel » est suivie immédiatement de cette autre : « Le dualisme freudien ». Illustrant la première expression, Lacan évoque toutes les « captations gestaltistes » liées à la parade chez les animaux, « si essentielle au maintien de l’attraction sexuelle à l’intérieur de l’espèce ». Mais la grande découverte de l’analyse, poursuit-il, c’est que l’homme fonctionne déjà différemment relativement à la vie de l’espèce elle-même : « Il y a déjà chez lui une fêlure, une perturbation profonde de la régulation vitale. C’est là l’importance de la notion qu’a apportée Freud de l’instinct de mort. » Par cette référence à la notion de l’ « instinct de mort » tel qu’elle est élaborée dans Au-delà du principe de plaisir, à savoir celle d’un retournement de la pulsion d’agressivité contre le moi, Lacan introduit à ce qu’il appelle le « dualisme freudien » : Freud, nous dit-il, « a voulu sauver un dualisme à tout prix » à l’encontre d’une conception « unitaire » et « naturaliste » de l’homme qui « nous réintroduisait à une philosophie de la nature. » Mettant les points sur les « i », il indique que ce dualisme « n’est rien d’autre que ce dont je parle quand je mets en avant l’autonomie du symbolique. » Dans le IV du Livre II, « Une définition matérialiste du phénomène de conscience », il introduit « la perspective exacte de l’excentricité du sujet par rapport au moi » : le sujet n’est pas le moi, le véritable sujet est l’inconscient, « ce sujet inconnu du moi, méconnu par le moi », qui est « le noyau de notre être » (der Kern unseres Wesens)12. Autrement dit, le moi n’est pas une « erreur » au sens d’une « vérité partielle » que l’on pourrait redresser en la complétant, il est en lui-même méconnaissance nécessaire du sujet parce qu’il « est un objet » qui remplit la fonction de l’imaginaire13. Que cet imaginaire soit un illusoire, voilà qui est indéniable. Mais on aurait tort d’en inférer que cet illusoire est purement subjectif. L’imaginaire comme fonction du moi est « un illusoire parfaitement objectif »14. À travers toutes ces formules, ce qui est visé, c’est bien entendu toute la tradition philosophique qui fait du rapport à soi de la conscience15 une sorte d’originaire qu’elle baptise indifféremment du nom de « sujet » ou de « moi ». La « découverte de l’expérience » dont il a été question plus haut est donc celle de l’expérience analytique, à savoir celle de la non-coïncidence du « sujet » (comme « inconscient ») et du « moi » (comme « fonction imaginaire »).
C’est dans la lancée de ces considérations que se trouve introduite « l’expérience du miroir ». Elle l’est par le truchement d’une image saisissante, celle du paralytique et de l’aveugle : le paralytique, soit celui « qui ne peut pas se mouvoir seul si ce n’est de façon incoordonnée et maladroite », est maîtrisé par l’image du moi « qui est aveugle, et qui le porte. » Lacan se réfère ici à un poème du moyen âge, mis en fable au XVIIIe siècle, dans lequel deux personnages pallient leurs infirmités respectives en collaborant : l’aveugle porte le paralytique tandis que le paralytique guide l’aveugle. L’aveugle dit au paralytique : « J’ai des jambes et vous des yeux : Moi je vais vous porter ; vous, vous serez mon guide, Vos yeux dirigeront mes pas mal assurés : Mes jambes à leur tour iront où vous voudrez. »16 Au-delà de la morale un peu convenue de la fable sur les bienfaits de l’entraide mutuelle, Lacan y lit la possibilité qu’un être ne puisse trouver son unité que dans sa relation à un autre, à l’instar du paralytique se reflétant dans la position de l’aveugle. La carence motrice du paralytique en vient alors à signifier analogiquement la dépendance motrice du nouveau-né. Et de même que le paralytique projette son indépendance dans les possibilités motrices de l’aveugle, de même le nouveau-né anticipe une indépendance motrice dont il est privé dans celle du double perçu dans le miroir. Il est à remarquer que c’est le paralytique qui est détenteur de la vision et que la fonction du regard se situe du côté de l’aveugle. Autrement dit c’est le paralytique qui est fasciné et c’est l’aveugle qui commande17. Le paralytique « ne peut s’identifier à son unité que dans la fascination, dans l’immobilité fondamentale par quoi il vient correspondre au regard sous lequel il est pris, le regard aveugle » : « La fascination est absolument essentielle au phénomène de constitution du moi. C’est en tant que fascinée que la diversité incoordonnée, incohérente, du morcelage primitif prend son unité.18 »
Là est l’essentiel de ce que l’on dénomme un peu vite le « stade du miroir ». Car ce qui est fondamentalement en jeu c’est que « le premier rapport à soi est irrémédiablement et à jamais un rapport à un autre », ce que met en lumière la façon dont l’enfant joue avec son image dans le miroir. Cette expérience, loin de se réduire à une simple étape dans un processus de maturation psychologique, se révèle à l’examen à la fois un lieu de naissance et une structure indépassable qui manifeste la relation étroite entre « séparation » et « constitution ». Lacan fait en effet fond sur la racine latine pars (partie) que l’on retrouve aussi bien dans separare, séparer, que dans se parere, s’engendrer soi-même, si bien que, comme il le dit, « c’est de sa partition que le sujet procède à sa parturition19 ». L’anticipation du corps unifié n’est donc pas un acte de l’imagination qui aurait sa source dans le sujet-conscience ou qui procèderait d’un pouvoir « du » sujet. Il s’agit plutôt, à travers l’expérience du miroir, de la constitution du moi lui-même, de sa génération ou de son engendrement. Par là il se vérifie que le moi comme fonction imaginaire, loin d’être purement subjectif, « détermine à un certain niveau la structuration du sujet »20.
La conclusion qui s’impose est que l’imaginaire est irréductible à l’imagination, de la même manière que le réel n’est irréductible au physique et le symbolique au culturel21 : l’imaginaire est une fonction à partir de laquelle le moi se constitue, l’imagination est sinon une faculté, du moins un acte du « sujet », au sens d’une conscience visant un objet de telle ou telle manière. En ce sens l’imagination est dérivée de l’imaginaire et non l’inverse. C’est dire qu’il ne saurait être question dans une telle perspective d’une quelconque « action » de l’imagination sur l’imaginaire, pas plus que d’une « production » de l’imaginaire par l’imagination (pour reprendre les termes de notre problème). L’unité trouvée par le corps morcelé dans l’image de l’autre « qui est sa propre image anticipée » n’est pas à mettre au compte d’un sujet tout constitué, puisqu‘elle est ce par quoi se précipite sa constitution. Mais la primauté de l’imaginaire sur l’imagination ne fait jamais que renvoyer au nouage du symbolique et de l’imaginaire lui-même.
Au cœur du symbolique on trouve un invariant structural, celui du Père, qui met en jeu le statut même de cet ordre comme « ordre-univers » dans lequel tout se tient, plus précisément le rapport que le « sujet » entretient avec l’institution de la société. Faut-il faire avec Lacan de la reconnaissance du Père comme Loi la condition de la naissance symbolique du sujet à lui-même ? Le penser c’est situer la source de l’institution sociale dans un Autre transcendant, « indiscutable et intouchable », au lieu de la rapporter à l’exercice d’un pouvoir instituant dont le père est partie prenante sans être jamais à l’origine22. Comme le dit Castoriadis, « le père n’est pas le père s’il ne renvoie pas lui-même à la société et à son institution, s’il n’est pas signifié à l’enfant qu’il est un père parmi d’autres pères, qu’il l’est pour autant qu’il désire être à une place qu’il n’était pas dans son pouvoir de créer, et qu’ainsi il figure et présentifie pour l’enfant ce qui explicitement le dépasse lui-même à un degré infini une collectivité anonyme et indéfinie d’individus qui coexistent dans et par l’institution et se continuent en amont et en aval du temps. Seule l’institution de la société, procédant de l’imaginaire social, peut limiter l’imagination radicale de la psyché et faire être pour celle-ci une réalité en faisant être une société.23»
Les dimensions « social-historique » et « psychique » de l’imaginaire radical
Dans ce passage très dense, Castoriadis fait procéder l’institution de la société de l’activité d’une collectivité anonyme et indéfinie24 : ce qu’il appelle l’« imaginaire social instituant » renvoie à ce collectif anonyme et impersonnel. Corrélativement, ce qu’il appelle l’« imagination radicale » renvoie à la constitution de la psychè individuelle. La distinction classique entre l’« imaginaire » et l’« imagination » s’en trouve passablement brouillée et compliquée : ni l’imaginaire ni l’imagination ne sont au pouvoir d’un sujet qui pourrait en infléchir l’action ou en modifier librement la teneur. Dans les deux cas, et là est l’essentiel, ce qui est produit n’est pas de l’ordre de la « re-présentation », c’est-à-dire d’un redoublement de la présentation. Dans le premier cas, celui de l’imaginaire social instituant, ce sont les « significations sociales imaginaires » (la maîtrise illimitée de la nature par la technique a dès l’origine constitué la bourgeoisie comme classe, l’entreprise est devenue aujourd’hui la signification sociale imaginaire par excellence du néolibéralisme). Dans l’autre, celui de l’imagination radicale, ce sont des fantasmes qui ne sont pas assujettis à un ordre ni à un rapport de représentation à la réalité extérieure. Entre les deux dimensions de l’imaginaire radical il y a une tension irréductible qui peut aller jusqu’au conflit. C’est bien pourquoi Castoriadis parle dans le passage cité plus haut d’une limitation de l’imagination radicale par l’imaginaire social instituant.
Conscient de la rupture qu’il introduit relativement à toute une tradition, il se réfère volontiers à la conception de l’imagination défendue par Aristote dans son traité De anima qui lui paraît frayer une nouvelle voie, malheureusement recouverte plutôt que suivie ultérieurement. Le texte dans lequel il s’explique sur cette « découverte recouverte » a été écrit en 1978 sous le titre « La découverte de l’imagination »25. Dans le traité d’Aristote, en III, 7, on peut lire cette affirmation fondamentale : « les images tiennent lieu de sensations pour l’âme pensante […] C’est pourquoi l’âme ne pense jamais sans image. » Ce qui veut dire que l’âme ne pense jamais sans ces phantasmata qui sont les produits propres de l’imagination, et donc que l’activité de l’imagination est indispensable à l’exercice de la pensée. Au début du chapitre 10 de ce même Livre III, l’imagination se trouve même définie directement comme « une sorte de pensée ». L’imagination dont il est ici question est désignée par Castoriadis comme première par opposition à l’imagination seconde dont il a été question jusqu’à présent, que ce soit celle de la remémoration ou celle de la recombinaison d’éléments. Les cinq exemples mentionnés plus haut se rapportent d’ailleurs tous à cette « imagination seconde ». À cet égard, même les deux derniers exemples mentionnés auparavant (l’invention architecturale et la fiction du centaure) peuvent être rapportés à l’imagination seconde ou dérivée comme pouvoir de recombinaison des données de notre sensibilité26. Car la recombinaison n’est pas la création et l’« imagination première » est proprement créatrice.
Si elle est dite « radicale », c’est en ce qu’elle est originaire et non dérivée. Elle n’est pas en notre pouvoir dans la mesure où elle nous constitue au plus profond de nous-mêmes. Elle est un pouvoir qui nous constitue et non un pouvoir qui est en notre pouvoir, c’est-à-dire un pouvoir que nous pourrions activer à notre gré. Nous sommes depuis toujours déjà pris en elle tout comme, en un sens, nous le sommes dans la pensée (au sens faible du terme, celui de penser à quelque chose). Pour le comprendre, il faut nous détourner de l’imago au sens de l’effigie ou du portrait (auquel se rattache encore Lacan à propos du stade du miroir), pour revenir au sens² du mot grec phantasia (imagination)et de son dérivé phantasma (image). Phantasia dérive de phainô « faire paraître à la lumière ». Phantasma (phantasmata au pluriel), terme qui renvoie à la même racine grecque, désigne proprement ce qui paraît à la lumière ou ce qui apparaît, soit des « apparitions » ou des « présentations » plutôt que des « re-présentations », des « re-productions » ou des « imitations » : les apparitions ne redoublent pas le déjà-existant, elles surgissent inopinément et brusquement sans être explicables par ce qui les précède. Si l’on considère la dimension de l’imagination radicale, celle de la psychè singulière (nommé par Freud « inconscient »), cela est tout particulièrement évident. Castoriadis parle à ce sujet d’un flux « illimité et immaîtrisable », d’un « surgissement perpétuel d’images » qui rompt toute « consécution fixe » et toute « correspondance rigide »27. De ce flux immaitrisable le jeune Hegel, qui n’avait pas encore recouvert l’imagination première par la mémoire (Mnémosyne), donne en 1805 une approximation saisissante. Parlant de l’image « inconsciente » qui peuple la « nuit de l’esprit » et « n’a pas à être exposée comme objet devant la représentation », il affirme :
L’homme est cette nuit, ce néant vide qui contient tout dans la simplicité de cette nuit, une richesse de représentations, d’images infiniment multiples dont aucune précisément ne lui vient à l’esprit ou qui ne sont pas en tant que présentes (…) ici surgit alors subitement une tête ensanglantée, là, une autre silhouette blanche, et elles disparaissent de même. C’est cette nuit qu’on découvre lorsqu’on regarde un homme dans les yeux – on plonge son regard dans une nuit qui devient effroyable, c’est la nuit du monde qui s’avance ici à la rencontre de chacun.28
De cette imagination radicale Castoriadis va jusqu’à dire qu’elle rend possible le langage lui-même et non l’inverse29, par où l’on prend la mesure de la distance entre cette conception de l’inconscient et celle de Lacan.
Cependant, peut-on se satisfaire d’une réduction du rapport entre ces deux dimensions, celle de l’imaginaire social instituant et celle de l’imagination radicale constitutive de la psychè singulière, à un simple rapport de « limitation »? Castoriadis sait très bien qu’une telle réduction serait gravement mutilante. Il affirme à maintes reprises que c’est à la psychè singulière qu’il revient de nourrir de sa « sève » l’imaginaire social instituant, faisant ainsi apparaître une certaine « action en retour » de l’imagination radicale sur l’imagination social instituant, même si cette action est indirecte et imperceptible. Mais jusqu’où peut aller cette action ? Certainement pas jusqu’à la production directe par l’imagination radicale de nouvelles significations sociales imaginaires, dès lors que cette production est l’œuvre du seul collectif anonyme et impersonnel, c’est-à-dire de « personne » (outis30). Mais alors comment non pas libérer l’imagination radicale de toute limitation sociale31, mais rendre pratiquement possible l’action en retour par laquelle la psychè singulière pourra féconder ne serait-ce qu’indirectement la société ? Pour cela l’imagination radicale doit parvenir à « transpirer à travers les strates successives de la cuirasse sociale de l’individu ». Or une telle action en retour est rarissime et imperceptible là où l’autonomie n’est pas instituée, si ce n’est à travers la « transgression » et la « pathologie »32. Il faut pourtant encourager et favoriser une telle action si l’on veut éviter d’en rester à la dualité d’un imaginaire social entièrement soustrait à l’action des individus et d’une imagination radicale rebelle à toute détermination. Ce serait en effet oublier que l’acte d’institution peut être, à la faveur de certaines conditions, « explicite », c’est-à-dire « conscient ». Comme tel il relève de la praxis et non d’une production aveugle. C’est d’ailleurs une telle auto-institution explicite qui définit proprement ce que l’on appelle une « révolution ». Mais quelle est la sorte d’imagination qui intervient dans la praxis instituante ?
L’« imagination délibérative » et les praxis instituantes
Pour clarifier ce point épineux il nous faut une nouvelle fois consentir un détour par Aristote. La thèse d’Aristote dans les chapitres 9 à 12 du livre III du De anima est que le désir ne peut s’exercer sans l’imagination : le désir meut le vivant mais il ne le meut pas sans la phantasia. Cette imagination, qui est bien une faculté spécifique, est sensitive(aisthètikè) et, à ce titre, elle est présente chez tous les animaux ; ou bien elle est délibérative (bouleutikè) et, à ce titre, elle n’appartient qu’aux « animaux rationnels », elle est la forme spécifiquement humaine de l’imagination. Il est remarquable que cette distinction entre les deux types d’imaginationne soit mentionnée nulle part ailleurs dans l’œuvre d’Aristote33. Que veut dire ici Aristote ? Il faut écarter une méprise : l’imagination délibérative n’est pas l’imagination qui délibère, « délibérative » ne veut nullement dire « délibérante », mais seulement qui a rapport avec la délibération au point de lui être indispensable. L’imagination délibérative est proprement celle qui intervient dans l’activité de délibération, elle est véritablement la condition de cette activité sans pour autant se confondre avec cette dernière : pas de délibération sans exercice de l’imagination délibérative. Mais comment l’entendre ?
Éclaircissons un premier point. En quoi consiste la délibération (bouleusis, d’où vient bouleutikè) et sur quoi porte-t-elle exactement ? Trois traits la constituent. Tout d’abord elle est œuvre collective : c’est le membre de l’assemblée du peuple (ecclèsia) qu’il appartient de délibérer sur les affaires communes, la délibération avec soi-même n’étant jamais que la forme intériorisée de la codélibération ou délibération en commun (sumbouleuein). Ensuite elle porte sur le possible, c’est-à-dire sur l’avenir. On ne délibère pas sur l’impossible pas plus qu’on ne délibère sur le passé. Enfin, on ne délibère pas seulement sur les moyens mais également sur les fins.
On ne saurait trop insister sur ce point. Il faut reconnaître une certaine présencede la fin dans la mise en œuvre des moyens. Cette immanence de la fin interdit d’identifier les moyens à de purs et simples instruments. Le choix des moyens doit donc toujours procéder d’une réflexion sur les effets qu’un moyen est susceptible de produire en allant à l’encontre de la fin poursuivie. En fait, la fin n’est déterminée que dans et à travers le choix des moyens, elle ne se découvre à l’agent que dans et par ce choix34. La bonne délibération est précisément celle qui détermine avec justesse « ce qui convient à une fin ». Or ce qui convient à une fin, c’est précisément les moyens et cette convenance signifie proprement que les moyens « viennent avec la fin », sont « convenants » et pas seulement « convenables », de telle sorte la fin, au lieu d’être posée comme un but à atteindre dans un futur plus ou moins lointain, est actualisée conjointement à l’actualisation des moyens qui lui conviennent. Du coup c’est la dissociation entre le futur du but idéal et le présent de la mise en œuvre des moyens qui cesse de valoir : la convenance de la fin et des moyens est expérimentée dans le présent de l’agir. Il nous faut aujourd’hui ramener la fin dans le présent de l’agir.
Or quel est le ressort de l’action, si ce n’est la motivation ? Et l’action de l’imagination est à cet égard irremplaçable. Selon Aristote, la sensation n’est source d’aucune action. En revanche, même chez les animaux les plus rudimentaires, la phantasia est toujours requise pour qu’il y ait mouvement, si bien qu’elle est cause de l’action et ressort de l’action. Mais la fonction spécifique de l’imagination bouleutikè est d’expliquer la motivation humaine. Elle consiste en une capacité de production des phantasmata et ces « images » interviennent précisément dans la délibération. Mais de quelle sorte d’images s’agit-il ? On peut supposer que ces images mentales sont détachées de toute expérience sensorielle directe et sont des images de choses absentes parce que rapportées au futur qui est objet de délibération. On peut aller plus loin encore : l’imagination délibérative procède, dit Aristote, à une comparaison entre plusieurs images mentales ou phantasmata de manière à former une image unique. Cette image unique fait littéralement voir à tous les participants de la délibération commune ce qu’est précisément l’objet de leur désir, c’est-à-dire la fin qui leur est commune. L’activité de l’imagination délibérative consisterait donc en une élaboration de l’objet du désir et par là une détermination de la fin de l’action35. Elle consisterait à se faire une image plus précise de cette fin, suffisamment précise pour produire la motivation indispensable à l’action. Par là s’éclaire cette formulation d’Aristote selon laquelle c’est par les phantasmes ou pensées qui sont en elle que l’âme pensante, « comme si elle voyait, calcule et délibère des choses à venir par rapport aux choses présentes.36 » L’expression « comme si elle voyait » dit à sa manière tout de la fonction de l’imagination délibérative : on ne peut délibérer des choses à venir que dans l’anticipation imageante de l’avenir.
Ces considérations peuvent contribuer à éclairer la place éminente que tient l’imagination dans les expérimentations sociales et politiques contemporaines, place qui est directement fonction de celle qu’y prennent la codélibération ou délibération en commun. On est là très loin des « phalanstères » de Fourier et des « Icarie » de Cabet qui se voulaient conformes à des plans imaginaires de reconstruction intégrale de la société. Ces utopies étaient des modèles abstraitement élaborés auxquels les pratiques devaient se conformer. On se demandait comment réaliser localement des plans imaginaires de société parfaite conçus dans le moindre détail : un bon exemple en est fourni par le Code de la Communauté de Théodore Dézamy (1842), qui prévoit de diviser la communauté nationale en autant de communes dont le territoire devra être le plus égal et le plus régulier et nombre d’habitants égal à 10000. L’imagination qui est à l’œuvre dans ce plan est une imagination architecturale et même cadastrale. On comprend que le rêve d’une société parfaite, harmonieuse et transparente à elle-même, fonctionne aujourd’hui plus comme un repoussoir que comme un attracteur de désir. Les expérimentations actuelles, que ce soit celle de la ZAD de NDL ou du Chiapas au Mexique, inaugurent un tout autre rapport à l’avenir : elles constituent des « utopies concrètes » ou encore des « utopies réelles » (Erik Ohlin Whrigt) qui entendent offrir une sorte d’« image réduite » de nouvelles relations sociales et donnent à « voir » la possibilité d’un autre avenir. Sans aller jusqu’à la construction de nouvelles institutions, toutes les pratiques qui « altèrent » l’institué existant dans un sens émancipateur ont pour condition cette nouvelle fonction de la figuration anticipante ou préfiguration. Ce qui est en jeu, c’est un rapport nouveau entre expérimentations et imagination : l’imagination se fait expérimentale au lieu d’être architecturale ou planificatrice, comme c’était le cas au XIXe siècle. Elle permet d’échapper à l’opposition entre l’imaginaire utopiste débridé et la science de la nécessité historique : il s’agit d’ouvrir le présent à toutes ses possibilités pratiques et d’imaginer à partir des pratiques elles-mêmes différents mondes ou différentes manières de faire-monde.
Conclusion : imaginaire du commun et imagination des acteurs du commun
Nous sommes à présent en mesure de reprendre la question du rapport entre imaginaire et imagination telle que nous l’avions posée au début. Un nouvel imaginaire peut être construit à partir des pratiques collectives. Considérons de ce point de vue le rapport imaginaire/imagination tel qu’il est mis en œuvre par la Commune de Paris, ou plutôt avant et pendant la Commune dans la mesure où l’imaginaire de la Commune se construit bien avant l’événement proprement dit (délimité par la séquence qui va du 19 mars au 27 mai 1871), comme l’a bien montré Kristin Ross dans un beau livre consacré précisément à L’imaginaire de la Commune. Il y a là un geste essentiel, celui qui consiste à valoriser la dimension de l’imaginaire dans l’expérience de la Commune et, dans cette perspective, à remonter jusqu’aux premières réunions populaires non autorisées en 1868 et à celles des clubs révolutionnaires37. C’est en se concentrant sur cette dimension qu’elle met en évidence à quel point la Commune ne s’est jamais complètement laissée réduire à « la fiction nationale française ». La raison en est que l’imaginaire de la Commune fut élaboré par ce que Kristin Ross appelle l’« imagination communale » et que cette imagination communale n’ambitionnait nullement de construire un nouvel Etat, mais nourrissait le projet d’une fédération des communes libres de France et au-delà, celui d’une fédération universelle des peuples. L’expression de « République universelle » a été formulée dès décembre 1870 par le Club de la Révolution réunie à Montmartre et s’est imposée pendant le siège de Paris dans les clubs. Autant dire que l’imaginaire politique de la Commune fut un imaginaire résolument non nationaliste, qu’il s’opposait au « régime cellulaire de la nationalité » (Eugène Pottier) et, en cela, à l’universalisme républicain (tel qu’il fut brandi par la IIIe République). L’imagination communale a ainsi produit une forme politique nouvelle, celle de l’« autogouvernement communal ». Ce fut une imagination « créatrice de sens », et non simplement la reproduction d’expériences politiques antérieures. Cet exemple est celui d’une indissociation vivante de l’imaginaire et de l’imagination. C’est cette indissociation qui est pour nous infiniment précieuse. L’imaginaire « alternatif » ne peut que procéder de « pratiques altératrices », c’est-à-dire de pratiques qui, comme on l’a dit, altèrent l’institué existant. Mais cette altération même présuppose que toute sa place soit donnée à l’imagination de ceux qui sont engagés dans ces pratiques. Comme on vient de le voir, c’est par la médiation de l’imagination délibérative que les pratiques du commun peuvent œuvrer à la construction d’un imaginaire du commun. C’est en effet seulement par cette médiation que l’« action en retour » de l’imagination radicale sur l’imaginaire social peut être encouragée et favorisée. Cet imaginaire du commun ne peut se construire que s’il s’oppose à l’imaginaire néolibéral qui est aujourd’hui la forme prise par l’imaginaire institué. Mais cette opposition, pour être productive, doit être portée par des pratiques collectives. Il n’y a donc aucune symétrie entre l’imaginaire du commun, qui n’est pas encore – tant s’en faut – un imaginaire social instituant mais procède déjà de praxis instituantes à visée émancipatrice, et l’imaginaire social institué qu’est l’imaginaire entrepreneurial. Ce qui fait la singularité de l’imaginaire du commun, c’est qu’il ne peut procéder que de l’imagination active des acteurs du commun, c’est qu’il ne peut être, selon l’heureuse formule d’un appel lancé par des psychiatres, « l’imaginaire de nos praxis ». Et c’est seulement à ce titre qu’il peut contribuer à battre en brèche le monopole de l’imaginaire néolibéral. C’est en ce sens que notre tâche est de créer le présent et, en créant le présent et à partir de cette création, d’imaginer l’avenir. En d’autres termes, il nous revient, non certes d’imaginer la disparition du monde visible avec l’interruption de nos sensations visuelles, mais d’imaginer un monde autre à partir des multiples manières de faire-monde que nous expérimentons dans notre propre présent.
Références bibliographiques
- Berkeley, G., 1969, Principes de la connaissance humaine, Aubier.
- Canto-Sperber, M., 1996, « Le rôle de l’imagination dans la philosophie aristotélicienne de l’action », dans Romeyer Dherbey, G. (dir.), Corps et âme Sur le De anima d’Aristote, sous la direction de Gilbert Romeyer Dherbey, Paris, Vrin.
- Castoriadis, C., 1975, L’institution imaginaire de la société, Paris, Seuil (réed. 1999.)
- Castoriadis, C., 1999, Domaines de l’homme. Les carrefours du labyrinthe, Paris, Seuil, coll. « Essais ».
- Castoriadis, C., 2002, Sujet et vérité dans le monde social-historique. Séminaires 1986-1987, Paris, Seuil.
- Castoriadis, C., 2008, La cité et les lois. Ce qui fait la Grèce. Séminaires 1983-1984, Paris, Seuil.
- Castoriadis, C., 2013, Quelle démocratie ? Écrits politiques 1945-1997. T.2, Paris, Editions du Sandre.
- Claris de Florian, 1793, « L’aveugle et le paralytique », Fables de M. de Florian, URL : https://fr.wikisource.org/wiki/Collection_compl%C3%A8te_des_%C5%93uvres_de_M._de_Florian/Fables/1/L%E2%80%99Aveugle_et_le_Paralytique
- Dejours, C., 2001, Le corps d’abord, Paris, Payot.
- Dissez, N., 2022, Les apologues de Jacques Lacan, Paris, PUF.
- Dardot, P. et Laval, C., 2016, Ce cauchemar qui n’en finit pas. Comment le néolibéralisme défait la démocratie, Paris, La Découverte.
- Dewey, J., 2011, La formation des valeurs, trad. Truc, G. et Bidet, A., Éd. La Découverte, coll. « Les empêcheurs de penser en rond ».
- Dewey, L. et Trotski, L., 2014, Leur morale et la nôtre, Paris, Ed. La Découverte, Coll. « Les empêcheurs de penser en rond ».
- Hegel, G.W.F., 1982, La philosophie de l’esprit 1805, Paris, PUF.
- Hume, D., 1999, Enquête sur l’entendement humain, Paris, Le Livre de Poche.
- Joyce, J., 2004, Ulysse, Paris, Gallimard.
- Kant, E., 1993, , Leçons de métaphysique, Le Livre de poche.
- Lacan, J., 1980, Le Séminaire Livre II, Paris, Seuil.
- Lucrèce, De la nature des choses, Paris, Le Livre de Poche, [2002].
- Ogilvie, B., 1993, Lacan Le sujet, Paris, PUF.
- Poirier, N., 2018, Castoriadis L’imaginaire radical, Paris, PUF.
- Ross, K., 2015, L’imaginaire de la Commune, trad. Dobenesque, E., Paris, La Fabrique.
- Sartre, J.-P., 1969, L’imagination, Paris, PUF.
- Tombs, R., 2014, Paris, bivouac des révolutions La Commune de 1871, Éditions Libertalia.
Notes
- Dejours, 2001, p. 186. Nous soulignons.
- Nous avons nous-mêmes cédé à la tentation d’une fausse symétrie dans certaines formulations de Ce cauchemar qui n’en finit pas (Cf. Dardot et Laval, 2016, p. 94-95).
- Sartre, 1969, p. 1.
- Joyce, 2004, p. 53-53.
- La formule latine par laquelle Berkeley résume cet immatérialisme est : « esse est percipi aut percipere » (être, c’est être perçu ou percevoir).
- Prévenant l’objection adressée à l’immatérialisme : « On considère comme une absurdité singulière qu’en fermant les paupières, j’anéantisse à la ronde tous les objets visibles », Berkeley affirme que c’est pourtant ce que reconnaissent les philosophes (Cf. Berkeley, 1969, p. 247). Par exemple, les arbres sont dans le jardin et les chaises sont dans le salon « juste le temps où quelqu’un se trouve là pour les percevoir » : « Je ferme les yeux : tout le mobilier de la pièce est réduit à néant ; il me suffit de les ouvrir pour le ressusciter. » (Ibid., p. 245).
- « Vois maintenant. Tout a subsisté sans toi : et à jamais pour les siècles des siècles. » (Joyce, 2004, p. 53).
- Sartre,1969, p. 146-147.
- Lucrèce, De la nature des choses, Chant V, 878-889, Le Livre de Poche, 2002, p. 537.
- Kant, 1993.
- Lacan, 1980, p. 50.
- Ibid., p. 59.
- Ibid., p. 60.
- Ibid., p. 64.
- Lacan explicite cet enjeu en ces termes : « Il s’agit de libérer notre notion de la conscience de toute hypothèque quant à la saisie du sujet par lui-même. » (Lacan, 1980, p. 75).
- Jean-Pierre Claris de Florian, « L’aveugle et le paralytique », in Fables de M. de Florian, (1792), URL : https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Aveugle_et_le_Paralytique
- Cf. Dissez, 2022, « Ouverture ».
- Ibid., p. 66-67.
- Cité par Ogilvie, 1993, p. 107.
- Lacan, 1980, p. 68.
- Le point est bien souligné par Ogilvie, 1993, p. 118.
- Poirier, 2018, p. 138.
- Castoriadis, 1975 (1999), p. 450.
- Il s’agit pour lui de prendre au sérieux la fameuse formule de Marx dans Le 18 Brumaire selon laquelle « les hommes font leur propre histoire », tout en en modifiant le sens : ce « faire » est une véritable « création ».
- Publié par la suite in Castoriadis, 1999, p. 409 et sq.
- Ce qu’a bien vu Hume (Cf. Hume, 1999, p. 63).
- Castoriadis, 2002, p. 89.
- Hegel, 1982, p. 13.
- Castoriadis, 2002, p. 89.
- Comme on sait, c’est le nom qu’Ulysse donne au Cyclope qui lui demande comment il se nomme.
- Cf. la condamnation sans appel formulée dans Castoriadis, 2008, p. 194-195.
- Castoriadis, 2013, p. 255.
- Castoriadis souligne à juste titre que « l’on ne peut que tenir pour capitale » cette nouvelle distinction tard venue dans le De anima (cf. Castoriadis, 1999, p. 434).
- Ce point est remarquablement dégagé par John Dewey dans sa critique de Trotski (Dewey et Trotski, 2014, p. 103 et sq.) et dans sa réflexion sur la formation des valeurs (Dewey, 2011, p. 118 et sq.).
- Canto-Sperber, 1996, p. 458-459.
- De anima, III, 7, cité par Castoriadis, 1999, p. 415.
- Ross, 2015, p. 21. À l’encontre de toute une tradition historienne qui minimise cette dimension en arguant que la Commune a finalement réalisé peu de choses vraiment nouvelles (Cf. Tombs, 2014).