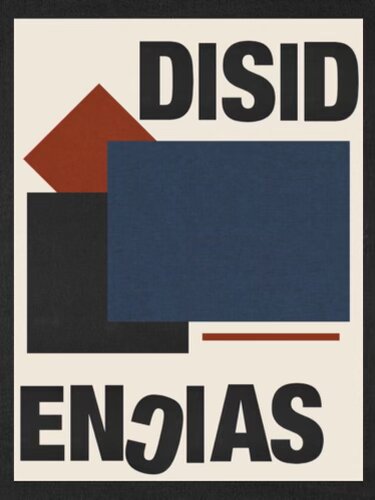Faire taire la différence. Prélude grec
Traduit par Thierry Capmartin.
Construire une nouvelle forme de vie : tel est l’immense défi du présent face à une société qui s’effondre. Jamais l’humanité n’a su si sûrement qu’elle était au bord de la catastrophe dans d’innombrables domaines : la santé, les relations internationales, l’économie, l’environnement sont autant de lieux où les conflits se sont tellement enracinés qu’il est devenu difficile de penser l’avenir. On pourrait dire que l’une des caractéristiques justement de cette post-modernité néolibérale, c’est qu’elle nous a privés de futur et qu’elle menace gravement notre capacité à imaginer un avenir. La contradiction capital/travail s’est étendue à tous les domaines pour devenir finalement une contradiction capital/vie1.
Il est urgent de trouver une boussole qui indique la possibilité d’une alternative, ce qui passe nécessairement par une modification profonde des modes de vie individuels et collectifs. Il est urgent de se donner un impératif (po)éthique du commun qui pose les fondements incontournables sur lesquels construire une nouvelle subjectivité aspirant à une nouvelle manière d’être au monde. Et qu’elle y aspire, qu’elle le désire est loin d’être un détail quand on est confronté à la plus grande machine à produire du désir dans l’histoire de l’humanité, le capitalisme néolibéral médiatique. C’est pourquoi nous comprenons que l’impératif dont nous parlons ici ne peut être seulement éthique, mais doit être en même temps, pour garantir son efficacité, poétique et esthétique. Éthique, au sens où il doit contribuer à la production d’un ethos, d’une manière d’être éloignée des pratiques prédatrices et non solidaires du capitalisme. Poétique, dans la mesure où nous sommes confrontés à la nécessité d’inventer de nouvelles formes de subjectivation et, par conséquent, d’organisation sociale. Esthétique, car les nouvelles formes de vie ne peuvent se construire par une attitude seulement défensive, comme une rhapsodie de petits « non » face à la séduction du capital. Spinoza nous rappelle qu’un affect ne peut être contrarié que par un autre de sens contraire et de puissance égale ou supérieure, de sorte que l’impératif du bien commun doit être assorti de stratégies qui permettent aussi de définir un mode de vie affirmatif. Pour le dire à la manière de Nietzsche, le grand non aux formes de vie du capital – même si capital et vie, comme nous l’avons souligné, relève de l’oxymore – doit s’accompagner d’affects joyeux parce que, suivant complètement en cela l’approche de F. Lordon, nous pensons que la politique est en dernière analyse un ars affectandi2.
Le conatus du commun
Le concept de conatus est l’un des éléments centraux de la philosophie de Spinoza. Il énonce que « chaque chose, autant qu’il est en elle, s’efforce de persévérer dans son être3 ». Un effort que Spinoza, dans sa forme consciente, assimile au désir, de sorte que « nous ne nous efforçons à rien, ne voulons, n’appétons ni ne désirons aucune chose, parce que nous la jugeons bonne ; mais, au contraire, nous jugeons qu’une chose est bonne parce que nous nous efforçons vers elle, la voulons, appétons et désirons4 ». En d’autres termes, le conatus est un effort, une prédisposition, pourrait-on dire, qui vise à nous faire persévérer dans l’être, qui vise à notre survie. La vie, son maintien déterminent l’objectif premier et minimal d’une éthique, comme l’avait déjà fait remarquer Enrique Dussel5[5].
Il convient ici d’évoquer une seconde question concernant la philosophie spinoziste, à savoir la prise en compte du caractère composite de tout individu, de telle sorte que le sujet politique collectif – la multitude dans la terminologie de Spinoza – est aussi un individu et que, par conséquent, il devrait pouvoir se voir attribuer de la même façon un conatus. C’est ce que nous avons à l’esprit en avançant l’idée d’un conatus du commun ou d’un conatus de la multitude, dont nous tirons un impératif (po)éthique, aux résonances kantiennes évidentes, qui s’énoncerait comme suit : « Agissons de telle sorte que nos actions permettent le maintien de l’être commun, la survie de l’homme. » Une action qui, dans la logique spinoziste, devrait être motivée par le désir et non pas par une obligation faite à soi-même de nature morale.
Les maladies, les guerres, la disparition des écosystèmes, les migrations désespérées et la mort constituent l’horizon de notre époque. Quoique sans parvenir à le court-circuiter, ce sinistre panorama coexiste avec l’imaginaire de la jouissance des sociétés médiatiques consuméristes. Jesús Ibáñez parlait de cette jouissance qui abolit toute dimension d’avenir pour nous installer dans un présent qui envahit tout, comme étant caractéristique des sociétés qui font de la consommation la forme centrale de leur production et de leur reproduction : « Dans le capitalisme consumériste, note-il, tout le temps est rabattu sur le présent.6 » Dans le capitalisme néolibéral consumériste et médiatique, le désir et les affects constituent le levier fondamental des pratiques subjectives et investit totalement les individus, puisque, comme le soulignent Deleuze et Guattari, « [ils] font partie de l’infrastructure elle-même7 ». Comme l’a justement souligné Lordon, le fordisme et le post-fordisme se complètent dans la construction de sujets ajustés aux pulsions du désir. Le fordisme par le biais d’un désir transitif, orienté vers l’objet, sous la forme de la consommation. Le post-fordisme par un désir intransitif orienté vers la construction de soi, caractéristique du capitalisme néolibéral. En d’autres termes, le panorama terrifiant dans lequel nous nous trouvons ne propose pas, du moins pour le moment, d’alternatives vitales capables d’atténuer les effets dévastateurs de la société contemporaine. Ce n’est pas tant qu’il n’y ait pas de prise de conscience sociale des énormes tensions auxquelles la planète et avec elle l’humanité sont actuellement soumises, mais plutôt que cette prise de conscience ne parvient pas à construire un désir différent, à se projeter dans une alternative sociale, qui peine à voir le jour. Peut-être parce que la somme de ces malaises, de la guerre, de la maladie, de l’effondrement écologique, de la migration désespérée, des féminicides ne reçoit pas la dénomination identificatrice et unificatrice qui lui revient : capitalisme. De sorte que le problème, au-delà de la remarque de Jameson, n’est pas qu’« il nous est plus facile d’imaginer la détérioration totale de la terre et de la nature que l’effondrement du capitalisme tardif8 », mais que « capitalisme » est un terme qui n’est presque plus exclusivement utilisé que par ceux qui ont déjà une attitude critique à son égard. L’énorme efficacité du capitalisme dans la construction des subjectivités se manifeste, entre autres, précisément par le fait que ces subjectivités s’avèrent incapables de pointer, et encore moins de dénoncer le caractère capitaliste de la société contemporaine. Bourgeoisie et capital se sont toujours livrés à ce jeu de cache-cache.
D’où la nécessité de faire que les mal-être se rencontrent, de les montrer comme les multiples visages de notre présent, comme condition nécessaire pour articuler ce grand non qui déverrouillera le présent et permettra, en se gardant de donner l’exclusivité aux seules politiques de la résistance, de commencer à façonner l’avenir. Mais quelle forme donner à nos actes pour qu’ils aillent dans ce sens ? Comment faire en sorte que le capitalisme ne monopolise pas les passions joyeuses et n’abandonne pas les passions tristes à ce qui lui fait face ? Comment, en somme, passer d’une joie idiote – de l’ídios –à une joie commune, du commun, du koinós ? En réalité, ce que nous proposons n’est rien d’autre que de revisiter encore et toujours les stratégies de construction d’une subjectivité antagoniste.
Pour ce faire, il nous semble indispensable de partir de l’idée que la politique est un ars affectandi, comme le souligne Lordon. Que toutes nos actions répondent à une cause, c’est ce que Spinoza avait déjà souligné à l’aube de la Modernité. Il appelait ces causes des affects dans l’exacte mesure où elles affectent des sujets. Dans son effort pour analyser les êtres humains tels qu’ils sont et non tels que nous voudrions qu’ils soient9, Spinoza a mis en évidence la double condition de l’être humain, à la fois rationnel et passionnel, de sorte que les affects qui affectent le sujet appartiennent tout aussi bien à l’ordre de la raison qu’à celui des passions. La politique, en tant qu’ars affectandi, est donc un ensemble de stratégies, rationnelles et passionnelles, de construction de la subjectivité ; stratégies dont le capital s’est montré le maître absolu. Les êtres humains sont rarement affectés par des raisons ou des passions pures ; nos actions sont donc un inévitable mélange de raison et de passion. Dès lors, la gestion politique de la subjectivité implique ce double exercice fort délicat consistant à rationaliser nos passions, pour ne pas être soumis à leur puissance sans le filtre de la réflexion, et à passionner notre raison, pour éviter qu’elle ne devienne un froid calcul aveugle aux pulsions sociales. Mais puisque nous parlons de politique, et de politique antagoniste de surcroît, cet exercice doit se faire à travers un regard collectif qui prenne en vue notre condition d’« individus sociaux10 » comme disait déjà Marx, d’individus intimement liés les uns aux autres. Il est de toute première importance de nous installer dans cette dimension « transindividuelle11 », dans une ontologie de la relation dans laquelle les limites et les confins de l’individu sont brouillés par les multiples connexions (à d’autres individus, à des objets, à d’autres êtres, au monde en somme) qui, en réalité, nous façonnent. Le sujet doit s’entendre alors comme multiplicité relationnelle, et il n’est sauvé que si le reste est sauvé.
De manière assez surprenante, on trouve chez Dostoïevski, et plus précisément dans son roman L’Adolescent publié en 1875, une réflexion qui en raison de ses connotations spinozistes peut nous être de quelque utilité. L’un des personnages, Vassin, y fait la remarque suivante :
Pour beaucoup de gens, la conclusion logique se transforme parfois en un sentiment des plus puissants, qui envahit tout l’être et qu’il devient très difficile de chasser ou de transformer. Pour guérir un homme de ce genre, ce qu’il faut, c’est changer le sentiment lui-même, ce qui n’est possible que si on le remplace par un autre, qui aurait la même force. Cela, c’est toujours difficile, et, parfois, impossible.12
Ce sentiment, le personnage le qualifie plus loin d’« idée-sentiment13 » et cela nous semble proche du concept d’ « idée affectante » utilisé par Lordon. Il ne suffit donc pas d’une déduction argumentative impeccable pour conduire à l’action, il faut aussi doter ces idées d’une dimension affectante, d’un supplément qui imprègne le sujet14. Le passage de Dostoïevski évoque aussi l’idée spinoziste selon laquelle un affect ne peut être contrecarré que par un autre affect aussi puissant ou plus puissant de sens inverse. Tout cela ne fait qu’approfondir une conception de la subjectivité dans laquelle la dimension rationnelle et la dimension passionnelle sont nécessairement imbriquées, ce qui conduit avec la même nécessité à ce mot-valise de Silvia Rivera Cusicanqui, qui parle d’un « sentir-penser [sentipensar] itinérant15 ».
Mais ce n’est pas seulement sous cet aspect que Rivera Cusicanqui peut être d’une aide efficace pour faire face aux défis que nous avons décrits. Son engagement en faveur d’un monde ch’ixi, mixte, métissé, composé de mille fils qui tissent une toile et composent, dans leur étroite intrication, une réalité unitaire dans sa diversité, exige des stratégies inédites capables de rompre avec les usages traditionnels de la pensée. En un sens, elle pointe aussi une question qui rejoint nos préoccupations pour le commun, en comprenant que la pensée doit être une tâche collective, abordée à partir de la complicité : « Je considère que nous devons former des collectifs multiples de pensée et d’action, que nous devons penser avec le cœur [corazonar] et en commun, afin d’être en mesure d’affronter ce qui se présente à nous.16 » Cette notion de corazonar me semble particulièrement pertinente, car si elle fait référence aux savoirs mayas et aymaras, lesquels proposent de penser avec le cœur et la mémoire, elle peut aussi se lire comme un co-raisonner [co-razonar], c’est-à-dire un raisonnement en commun s’appuyant sur une raison qui n’est plus l’autre du cœur. Car l’intelligence stratégique, comme le rappelle le Comité invisible, renvoie au cœur17. Cela nous oblige, poursuit Cusicanqui, à nous doter d’une « boussole éthique18 » qui nous permette de voyager entre plusieurs mondes.
On dirait que le cœur, avec la charge métaphorique qu’il transporte, peut devenir un mot-clef pour aborder ces questions. Mais revenons à Spinoza, qui n’est jamais très loin. Plus précisément au chapitre 5 de son Traité politique, où il est établi que « la fin en vue de laquelle un état civil se fonde (…) n’est autre que la paix et la sécurité de la vie », l’État juste étant finalement celui où « les hommes passent leur vie dans la concorde et celui dont les droits communs sont observés sans violation19 ». La concorde apparaît donc comme le régime passionnel qui convient à une société juste. C’est l’harmonie des cœurs qui devient la garante du développement maximal du vivre-ensemble (convivencia) humain, car comme Spinoza le souligne dans la partie iv de l’Éthique : « Ce qui engendre la concorde se ramène à la justice, à l’équité et à l’honnêteté20 ». Le lien que Spinoza établit entre concorde et droits communs retient toute l’attention. D’abord parce qu’il se réfère à l’observance des droits communs et non à leur production, ce qui évoque évidemment un moment où de tels droits correspondent à une réalité sociale qui est en danger. Rappelons dans ce sens que le XVIIe siècle connaît un processus violent d’expropriation des droits et des biens communs, tout particulièrement dans les pays où le capitalisme commence à se développer, comme c’est le cas en Angleterre et aux Pays-Bas. Il est important de le noter, car cela témoigne d’un passé pas si lointain où la propriété commune jouait un rôle extrêmement important dans la vie des gens. À tel point que, comme le souligne Marx dans Le Capital, il a fallu une violence extrême, qui a duré des siècles, pour transformer la structure de la propriété en Occident et l’adapter aux besoins et aux exigences du capitalisme naissant. Il n’est peut-être pas inutile de rappeler les mots par lesquels Rousseau ouvre, en 1755, la Seconde Partie de son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes :
Le premier qui ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne !21
C’est sur cet oubli efficient – oubliant même qu’on a oublié – que se fonde notre société capitaliste. Mais, au-delà de cette question et en second lieu, il faut insister encore sur le lien que Spinoza établit entre la concorde et la propriété commune ou, pour mieux dire, entre la discorde et la propriété privée. Il le rappelle dans son Traité politique : « Une autre disposition de grande importance contribue à la paix et à la concorde, c’est que nul citoyen ne possède de biens fixes22 ». On peut en déduire que si la concorde est la base de la paix et de la justice et que la société humaine, en tant qu’individu collectif, entend exercer son conatus pour persévérer dans l’être, les droits communs ont un rôle très important à jouer dans la construction de relations sociales susceptibles de nous éloigner de la pulsion suicidaire qui s’est emparée de nos sociétés néolibérales.
Concorder. Faire en sorte que nos cœurs, de passions et de raisons entremêlés, co-raisonnent, s’amalgament, sentent-pensent (sentipiensen) à la constitution d’un socle commun capable d’abriter nos différences, telle doit être l’entreprise politique du présent.
Organiser la sédition
« Partir, s’éloigner ». C’est l’étymologie latine du mot sédition, dans lequel le verbe aller (lat. ire) est flanqué du préfixe se pour annoncer un mouvement de fuite. Et sans doute sommes-nous à l’orée d’une grande fugue, d’une double fugue, où, contrairement à la fugue en tant que forme musicale dans laquelle le thème principal est répété sous de multiples variations tout au long de la pièce, il s’agit précisément d’effacer toute trace de cette origine pour inventer une mélodie d’un nouveau genre. Une double fugue donc, car il convient de fuir à la fois la société qui nous abrite et de nous-mêmes, c’est-à-dire de modifier radicalement le cadre de nos vies pour en produire de nouvelles éloignées de l’idiotie sociale du néolibéralisme contemporain23.
Comme nous l’avons souligné tout au long du texte, tout mouvement subjectif, du point de vue de Spinoza, est médiatisé par le désir. Par conséquent, la sédition, la révolution doivent également être nourries par le désir, comme le soutiennent Deleuze et Guattari : « Les révolutionnaires oublient souvent, ou n’aiment pas reconnaître qu’on veut et fait la révolution par désir, non par devoir24 ». Un désir qui, sur le modèle machinique de l’inconscient que les deux auteurs utilisent – en opposition à sa version théâtrale œdipienne – est le résultat d’une production. Il s’agit donc de produire le désir de sédition, le désir de révolution, le désir de la multitude25.
Un désir qui passe par une torsion subjective dans laquelle l’individu cède la place au collectif, l’ídios au koinós. La pensée commune dont parle Cusicanqui, ou même Marx à travers son concept d’Intellect Général, débouche sur une économie morale de la multitude. Le capitalisme est né en essayant de briser une importante immunité groupale qui accompagnait les sociétés de la première modernité. En effet, ces sociétés étaient fondées, tant dans leurs pratiques économiques que culturelles, sur de puissantes formes de commun qui étaient particulièrement résistantes et réticentes au propriétarisme individualiste que le capitalisme tentait d’imposer. Mais d’autre part et avec une extrême violence, le virus du Capital provoque dans l’Europe moderne une mortalité extrême sous forme de famines ou de persécutions, qui accompagne son expansion territoriale. De Marx à Federici26, on a montré comment l’accumulation originelle se produit en faisant violence à des économies et des savoirs du commun qui se mettaient en travers de l’entreprise disciplinaire et prédatrice du capital. C’est cette « économie morale de la multitude » dont a parlé Thompson27, qui a tissé un solide lien collectif de pratiques et de croyances. Les lois anglaises sur les pauvres, à partir du XVIe siècle, ont conduit à des dizaines de milliers d’exécutions, dont 70 000 à l’époque d’Henri VIII, qui ont plongé les populations expropriées de leurs moyens de subsistance dans un état de terreur. Cela a conduit Baruch Spinoza, observateur attentif de son temps, à établir, dans le cadre de son Traité politique, une corrélation entre les sociétés justes et pacifiques et celles dans lesquelles « les droits communs sont observés sans violation28 ».
Notre époque a vu la politique entrer dans une crise profonde. Après la chute du mur de Berlin, le prétendu triomphe des démocraties libérales n’a eu de cesse de s’étioler à mesure que ses éléments constitutifs, notamment le modèle de représentation politique29, étaient discrédités. Les soulèvements de 2011, qui ont balayé le monde entier, ont été l’expression de cette crise et ont mis en lumière la nécessité d’une nouvelle politique. Il n’empêche que le processus a été court-circuité avec une certaine rapidité, soit par l’intervention décisive des pouvoirs systémiques, comme l’a montré très clairement le cas de la Grèce et de Syriza, soit par la dynamique même des organisations qui ont émergé de ces processus, comme cela s’est produit en Espagne avec Podemos. En d’autres termes, la nécessité d’un projet capable de repenser la politique ainsi que ses formes d’organisation reste une question ouverte.
Dans ce domaine, l’un des défis les plus complexes est de construire des formes de relation et d’organisation, indispensables à un processus de sédition comme celui que nous envisageons, qui ne reposent pas sur une ontologie des essences mais des relations, en sorte que les dynamiques de construction soient plus efficaces, ouvertes et plurielles, appelées à se réaliser à l’horizon d’un koinós. La notion deleuzienne d’agencement peut sans doute nous aider à préciser. Écoutons-le juste avant de conclure :
Qu’est-ce qu’un agencement ? C’est une multiplicité́ qui comporte beaucoup de termes hétérogènes, et qui établit des liaisons, des relations entre eux, à travers des âges, des sexes, des règnes – des natures différentes. Aussi la seule unité́ de l’agencement est de co-fonctionnement : c’est une symbiose, une « sympathie ». Ce qui est important, ce ne sont jamais les filiations, mais les alliances et les alliages ; ce ne sont pas les hérédités, les descendances, mais les contagions, les épidémies, le vent.30
C’est de contagion qu’il est question ici. Sans contrôle des origines ou des essences, mais par la production d’un désir partagé.
Références bibliographiques
- Aragüés, J.M., 2020, De idiotas a koinotas. Para una política de la multitud, Madrid, Arena Libros.
- Aragüés, J.M., 2018, Deseo de multitud, Valencia, Pre-textos.
- Balibar, E., 2018, Spinoza politique. Le transindividuel, Paris, PUF.
- Comité invisible, 2014, À nos amis, Paris, La Fabrique.
- Deleuze, G. et Parnet, C., 1996, Dialogues, Paris, Champs-Flammarion.
- Deleuze, G. et Guattari, F., 1972, L’Anti-Œdipe, Paris, Éd. Minuit.
- Dostoïevski, F., 1968, L’Adolescent, Arles, Actes sud.
- Dussel, E., 1998, Ética de la liberación, Madrid: Trotta.
- Frederici, S., 2004, Caliban and the Witch. Women, The Body and Primitive Accumulation, New York, Autonomedia.
- Jameson, F., 1994, The Seeds of Time, New York, Columbia University Press.
- Gil, S., 2021, « Femenismo y marxismo: claves de un debate para repensar la izquierda », dans Aragüés, J.M. et Arenas, L. (coord.), Marx contemporáneo, Madrid, p. 319-346.
- Ibáñez, J., 1997, A contracorriente, Madrid, Fundamentos.
- Lordon, F., 2016, Les Affects de la politique, Paris, Seuil.
- Marx, K., 2018, Manuscrits de 1857-1858, dits « Grundrisse », Paris, Éditions sociales.
- Rivera Cusicanqui, S., 2018, Un mundo ch´ixi es posible, Buenos Aires, Tinta limón.
- Rousseau, J.-J., 1971, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Paris, GF.
- Spinoza, B., 1965, Éthique, trad. Ch. Appuhn, Paris, GF.
- Spinoza, B., 1966, Traité politique, trad. Ch. Appuhn, Paris, GF.
- Thompson, E.-P., 2015, Les Usages de la coutume. Traditions et résistances populaires en Angleterre (XVIIe-XIXe siècle), Paris, Gallimard/Seuil.
Notes
- Gil, 2021, p. 319-346.
- Lordon, 2016.
- Spinoza, 1965, p. 142.
- Ibid., iii, 9 sc., p. 145.
- Cf. Dussel, 998.
- Ibáñez, 1997, p. 161. Nous traduisons.
- Deleuze et Guattari, 1972, p. 75.
- Jameson, 1994, p. xii. Nous traduisons.
- Cf. Spinoza, 1966.
- Marx, 2018, p. 451.
- Balibar, 2018.
- Dostoïevski, 1998, p. 56.
- Ibid., p. 57.
- Cf. Lordon, 2016.
- Rivera Cusicanqui, 2018, p. 59. Nous traduisons.
- Ibid.
- Comité invisible, 2014, p. 16.
- Rivera Cusicanqui, 2018, p. 70. Nous traduisons.
- Spinoza, 1966, p. 37. Traduction légèrement modifiée.
- Spinoza, 1965, IV, Append., chap. 15, p. 296.
- Rousseau, 1971, p. 205.
- Spinoza, 1966, p. 57.
- Cf. Aragüés, 2020.
- Deleuze et Guattari, 1972, p. 412.
- Cf. Aragüés, Deseo de multitud, 2018. Pour la traduction française de cet ouvrage sur cette même plateforme : https://una-editions.fr/desir-de-multitude.
- Frederici, 2004.
- Thompson, 2015.
- Spinoza, 1966, p. 37.
- On remet à plus tard l’examen de la question de la crise de la représentation dans ses différentes acceptions, politique, mais aussi épistémologique et ontologique. Tâche indispensable s’il en est, mais qui dépasse largement le cadre de cette étude.
- Deleuze et Parnet, 1996, p. 84.