Des synthèses sur la question de l’école et des langues de France existent, à commencer par la thèse de Youenn Michel, De la tolérance à l’intégration, l’École et l’enseignement des langues régionales en France, du régime de Vichy aux années 1980, soutenue en 2007 et, pour la période précédente, l’ouvrage malheureusement épuisé aujourd’hui de Jean-François Chanet, L’école française et les petites patries. Mais, si l’on se réfère à la production éditoriale qui concerne l’histoire de l’éducation, il est indéniable que la question du rapport de l’école française aux langues dites régionales demeure un angle mort. Et si la littérature scientifique s’est beaucoup intéressée – particulièrement à la suite des travaux de Suzanne Citron – à la question de l’enseignement de l’histoire comme outil de construction d’un mythe national, elle a bien souvent oublié (ce que Suzanne Citron, elle, n’avait pas fait) d’aborder de front la question de la diversité des langues et cultures en France. En ce qui concerne l’occitan, le sujet a été en grande partie déblayé par des chercheurs, à commencer par Philippe Martel dont les articles qui portent sur cette question ont été regroupés en 2007 dans un ouvrage, L’école française et l’occitan – Le sourd et le bègue.
Bien entendu, il est difficile de réserver à l’occitan un traitement à part des autres langues de France – à tout le moins d’une partie d’entre elles puisque certaines n’ont pas bénéficié des mêmes avancées – lorsqu’il s’agit de traiter de sa place dans l’école. Plusieurs éléments en font toutefois un objet d’étude particulier : l’étendue de l’espace sur lequel la langue est parlée, une revendication en faveur de son enseignement singulière en comparaison avec les autres langues de France et, en lien avec cela, le fait qu’une grande partie des ministres chargés de l’Instruction publique puis de l’Éducation nationale sont originaires de l’espace occitan. Si l’on s’intéresse par exemple à la Troisième république, sur 90 ministères qui se succèdent de 1870 à 1940, on ne compte pas moins de 43 qui ont à leur tête des ministres originaires de l’aire d’oc.
De quelle manière, donc, les relations entre l’école française et l’occitan ont-elles évolué ? C’est ce que nous allons essayer de voir et de comprendre de manière synthétique.
Un peu de préhistoire
Sans remonter à la nuit des temps, il est nécessaire d’avoir une idée générale du rapport de la France aux langues régionales. Une date charnière souvent mise en avant et qui est source de débats est, bien entendu, 1539, avec les ordonnances de Villers-Cotterêts. Dans deux articles, le roi François Ier entend rendre intelligible à la population les actes administratifs.
L’article 110 indique « Que les arrestz soient clers et entendibles. Et afin qu’il n’y ait cause de doubter sur l’intelligence desdictz arrestz, nous voulons et ordonnons qu’ilz soient faictz et escriptz si clairement, qu’il n’y ayt et ne puisse avoir aucune ambiguité ou incertitude ne lieu à en demander interprétation ».
On voit là qu’il s’agit d’abord de permettre que ces actes soient compris par la population. Cette nécessité tient au fait que lesdits actes sont généralement écrits en latin. Dans l’espace occitan, la langue occitane concurrence assez régulièrement le latin dans ces actes.
L’article 111 explicite la pensée du souverain :
De prononcer et expédier tous actes en langage françoys. Et pour ce que telles choses sont souventes fois advenues sur l’intelligence des motz latins contenus esdictz arrestz, nous voulons que doresnavant tous arrestz […] soient prononcéz, enregistréz et délivréz aux parties en langage maternel françois et non autrement.
Les spécialistes glosent depuis des décennies sur l’interprétation à donner de cette expression de « langage maternel françois ». Fait-elle référence à la langue du roi, c’est-à-dire, le français ? Ou bien fait-elle référence à la langue du peuple ? Dans l’hypothèse de cette deuxième solution, les actes pourraient être écrits dans toutes les langues de France car, à cette époque on estime que tout au plus un cinquième de la population du royaume parle français. Si l’on tient compte du fait qu’au moment de la promulgation des ordonnances de Villers-Cotterêts la seule langue en usage dans l’administration, outre le latin et le français, est l’occitan, on peut supputer que la volonté du roi est bien d’imposer sa langue.
Une autre étape importante dans le processus d’unification linguistique est bien entendu la Révolution française. Après avoir, à ses débuts, composé avec la diversité linguistique du pays à travers notamment une politique de traduction, l’exécutif révolutionnaire doit se rendre à l’évidence : le procédé est coûteux, lourd à mettre en place et d’une efficacité contestable. Mais le changement de stratégie qui se met en place à partir de 1794 a aussi des raisons idéologiques.
Plus que le fameux rapport de l’abbé Grégoire sur La nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française qui n’est en fait que le résultat d’une initiative personnelle de Grégoire, clerc mais aussi député du Tiers-État, c’est le rapport de Bertrand Barère de Vieuzac qui illustre la manière dont se met activement en place une nouvelle politique linguistique guidée par ce qui apparaît déjà comme un idéologie linguistique propre à la France.
C’est au nom du Comité de salut public, c’est-à-dire du pouvoir exécutif révolutionnaire, que Barère présente son rapport du 8 pluviôse An II (27 janvier 1794). Sa parole a donc un poids certain. Que dit-il ?
Il commence par constater qu’une partie importante de la population ne parle ni ne comprend le français : « Le législateur parle une langue que ceux qui doivent exécuter et obéir n’entendent pas »1. Barère désigne quelques départements en particulier : Haut et Bas-Rhin, Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Côtes-du-Nord, Basses-Pyrénées et Corse. Qu’ont-ils en commun ? D’abord qu’on y parle des langues qui ne sont pas le français et qui pour certaines – basque, alsacien, breton – en sont même très éloignées. Ensuite que certains sont frontaliers et que l’on y parle une langue qui est celle utilisée de l’autre côté de la frontière ou qui en est proche. C’est le cas du catalan, du corse, du basque et de l’alsacien. Le breton n’est pas une langue frontalière mais la Bretagne est très catholique et l’Église y utilise le breton. Il faut pouvoir surveiller, dans ces départements exposés aux menées contre-révolutionnaires de puissances étrangères ou de l’Église, ce qui se dit et s’écrit et pousser la population à adopter la langue française. Dans bien d’autres départements, et en particulier dans l’espace occitan, la population parle en majorité une autre langue que le français, mais le risque y est aux yeux de Barère moins grand et la surveillance rapprochée moins nécessaire.
Mais au-delà de cet aspect policier, destiné à se prémunir d’éventuelles offensives idéologiques d’un ennemi intérieur soutenu par l’extérieur, Barère développe aussi un volet tout à fait idéologique :
Citoyens, la langue d’un peuple libre doit être une et la même pour tous.
Dès que les hommes pensent, dès qu’ils peuvent coaliser leurs pensées, l’empire des prêtres, des despotes et des intrigants touche à sa ruine.
Donnons donc aux citoyens l’instrument de la pensée publique, l’agent le plus sûr de la révolution, le même langage.
Le peuple doit parler français car il s’agit de la langue de la Révolution. Et si les langues de France ne sont pas capables d’exprimer ces idées, les autres langues européennes ne le sont pas plus :
Ayons l’orgueil que doit donner la prééminence de la langue française depuis qu’elle est républicaine, et remplissons un devoir.
Laissons la langue italienne consacrée aux délices de l’harmonie et aux expressions d’une poésie molle et corruptrice.
Laissons la langue allemande, peu faite pour des peuples libres jusqu’à ce que le gouvernement féodal et militaire, dont elle est le plus digne organe, soit anéanti.
Laissons la langue espagnole pour son inquisition et ses universités jusqu’à ce qu’elle exprime l’expulsion des Bourbons qui ont détrôné les peuples de toutes les Espagnes.
Quant à la langue anglaise, qui fut grande et libre le jour qu’elle s’enrichit de ces mots, la majesté du peuple, elle n’est plus que l’idiome d’un gouvernement tyrannique et exécrable, de la banque et des lettres-de-change.
Nos ennemis avaient fait de la langue française la langue des cours ; ils l’avaient avilie. C’est à nous d’en faire la langue des peuples, et elle sera honorée.
La langue française est devenue, avec la Révolution, le véhicule privilégié des idées des Lumières. Des concepts tels que ceux de liberté et d’égalité ne peuvent être correctement exprimés que par cette langue. Mieux encore, cette langue porte ces concepts en elle-même. Ils ne peuvent donc pas être exprimés avec la même force et la même sincérité par une autre langue que le français. Le français, dit Barère en conclusion de son rapport, est tout simplement « la langue dans laquelle est écrite la Déclaration des Droits de l’Homme ».
Le rapport Barère débouche sur un décret qui prévoit l’installation dans les régions évoquées par le député (mais aussi dans les Alpes-Maritimes, frontalières de l’Italie) d’instituteurs chargés de diffuser la langue française. Dispositif qui ne sera que marginalement mis en place puisque le gouvernement révolutionnaire, occupé par ailleurs par les guerres engagées avec les autres puissances européennes, n’a pas forcément les moyens de ses ambitions. Il n’en demeure pas moins que s’ancre alors plus profondément en France cette idéologie qui veut qu’une langue domine les autres et les exclut. Si la question d’une quelconque supériorité du français sur les autres langues européennes – et même du monde – reste du domaine de l’affirmation péremptoire, quand bien même ceux qui portent cette affirmation peuvent y croire, puisque l’influence française y reste limitée, celle du français sur les autres langues parlées sur le territoire national s’installe durablement. De même, d’ailleurs, que le fait que ces autres langues sont considérées comme n’en étant pas vraiment et se trouvent reléguées au rang de patois.
Le XIXe siècle est celui de la généralisation progressive de l’enseignement primaire. La loi du 28 juin 1833, dite loi Guizot, institue que toute commune de plus de 500 habitants doit avoir une école primaire de garçons ou subventionner une école confessionnelle, que chaque département doit disposer d’une École normale pour former les instituteurs et crée un corps d’inspection. En 1850, la loi Falloux établit que les communes de plus de 800 habitants doivent avoir une école primaire de filles. En 1867, la loi Duruy donne la possibilité aux communes de lever un impôt exceptionnel pour financer la gratuité de l’enseignement. La loi Falloux avait fait de la lecture, de l’écriture, du calcul, de l’enseignement moral et religieux et, pour les filles, des travaux d’aiguille des matières obligatoires. Duruy y ajoute l’enseignement de l’histoire et de la géographie. Il va de soi que la lecture et l’écriture ne sont pas celles du breton ou de l’occitan, pas plus que l’histoire n’est celle de telle ou telle province française – la géographie laisse plus de place à l’étude du milieu local – et que donc la formation des futurs citoyens passe avant tout par l’enseignement du français. C’est là ce qu’explique on ne peut plus clairement Augustine Fouillée-Tuillerie sous le pseudonyme de G. Bruno dans son Tour de la France par deux enfants, publié en 1877, et qui deviendra le manuel scolaire de générations d’élèves durant toute la Troisième république et même un peu après. Dans ce passage, les deux garçons arrivent dans une auberge de la vallée du Rhône dans laquelle la patronne et les clients parlent occitan :
L’hôtelière était une bonne vieille, qui paraissait si avenante, qu’André, pour faire plaisir à Julien, se hasarda à l’interroger, mais elle ne comprenait que quelques phrases françaises, car elle parlait à l’ordinaire, comme beaucoup de vieilles gens du lieu, le patois du midi. André et Julien, qui s’étaient levés poliment, se rassirent tout désappointés. Les gens qui entraient parlaient tous patois entre eux ; les deux enfants, assis à l’écart et ne comprenant pas un mot à ce qui se disait, se sentaient bien isolés dans cette ferme étrangère. […] « – Pourquoi donc tous les gens de ce pays-ci ne parlent-ils pas français ? » « – C’est que tous n’ont pas pu aller à l’école. Mais dans un petit nombre d’années, il n’en sera plus ainsi, et par toute la France on saura parler la langue de la patrie. » En ce moment, la porte d’en face s’ouvrit de nouveau ; c’étaient les enfants de l’hôtelière qui revenaient de l’école. « -André », s’écria Julien, « ces enfants doivent savoir le français, puisqu’ils vont à l’école. Quel bonheur ! Nous pourrons causer ensemble. »2
Cette entreprise de francisation se fait au détriment des langues de France. Elles apparaissent en effet comme un obstacle à la diffusion de la langue nationale et autant de signes de la survivance d’une France féodale morcelée. L’unité du pays passe non seulement par l’usage d’une langue commune, mais plus encore d’une langue unique.
Le début de la revendication
Face au rouleau compresseur du français, des voix commencent à s’élever à partir des années 1870. Une des toutes premières initiatives en faveur des langues de France est celle menée par un trio d’érudits, Hyacinthe de Charencey, Henri Gaidoz et Charles de Gaulle (futur oncle du futur général), à travers une pétition rédigée en 1870.
Depuis 1865, un certain nombre de voix se sont élevées pour demander la mise en place en France d’une politique de décentralisation. Au début de l’année 1870, une commission est mise en place pour étudier la question. C’est dans ce cadre que s’inscrit la démarche de Charencey, Gaidoz et de Gaulle qui veulent évoquer la question linguistique.
La guerre de 1870 interrompt cette initiative avant même que la pétition soit envoyée, comme prévu, au Corps législatif. Elle ne sera finalement publiée par Henri Gaidoz qu’en 1903 dans le cadre des débats autour de la séparation des Églises et de l’État après qu’Émile Combes a publié, en 1902, une circulaire interdisant aux prêtres concordataires de prêcher et de faire le catéchisme en langue bretonne, basque, flamande…
Ce texte en quelque sorte mort-né, n’est cependant pas sans intérêt car il énonce des arguments en faveur des langues et cultures régionales qui seront pour partie amenés à durer et à être régulièrement réemployés.
Il y a bien sûr l’argument patriotique : l’attachement à la « petite patrie » est un préalable nécessaire à celui à la « grande patrie ». Voilà une idée qui sera sans cesse reprise sous la Troisième république et alimentera avec constance les débats autour des langues de France.
Partant ensuite du constat selon lequel les enfants qui arrivent à l’école ne connaissent pas forcément le français mais une autre langue, Gaidoz, Charencey et de Gaulle portent leur démonstration sur le plan de la justice sociale : en refusant d’utiliser la langue des élèves pour leur apprendre le français, on les prive d’un moyen efficace d’accéder à la langue nationale et donc à la compréhension des lois. Pire, en rabaissant leurs langues et cultures, on risque de les voir rejeter la langue nationale.
À cela s’ajoute un double argument pédagogique : d’une part, l’apprentissage forcé du français sans tenir compte de la langue première amène la population à ne parler qu’un jargon qui n’est en fin de compte ni du français, ni leur langue ; d’autre part, vouloir détruire les langues des populations, c’est les priver d’une ouverture sur le monde puisque nombre de ces langues sont transfrontalières ou, pour l’occitan notamment, permettent de comprendre des langues voisines.
Le long argumentaire débouche sur des propositions concrètes dont notamment la possibilité pour les enseignants du primaire d’utiliser la langue locale pour faire apprendre le français (mais aussi de faire apprendre ladite langue aux élèves), et même obligation pour les maîtres et maîtresses de justifier de leur connaissance de la langue du lieu où ils sont affectés.
La pétition de Charencey, de Gaulle et Gaidoz est indéniablement audacieuse pour son époque et va à contre-courant de la politique linguistique française de son temps. En particulier, parce qu’elle remet en cause un certain nombre de dogmes en ce qui concerne les « patois » et par ce qu’elle propose dans le cadre de l’enseignement primaire, qui est le niveau qui accueille l’écrasante majorité des élèves.
Du côté occitan, la seule association organisée est le Félibrige, créé en 1854, mais qui n’aborde de front la question de l’enseignement que tardivement.
Certes Mistral, dans un discours de 1868, à l’occasion de l’accueil de félibres catalans à Saint-Rémy-de-Provence aborde le sujet de l’école. « Nous voulons, dit-il, que nos fils, au lieu d’être élevés dans le mépris de notre langue […], nous voulons que nos fils continuent de parler la langue de la terre, la langue dans laquelle ils sont fiers, par laquelle ils sont forts, par laquelle ils sont libres. »3 Certes aussi, en 1875, à Montpellier, il dénonce l’école qui « pourchasse » la langue d’oc et « lui ferme la porte au nez », mais il s’agit avant tout dans ces discours de montrer du doigt ces gens du peuple qui abandonnent leur langue au profit du français pour imiter les « messieurs ». Mistral ne demande d’ailleurs pas, à ce moment-là, la moindre place pour la langue d’oc dans l’école, mais exprime plutôt le désir qu’elle demeure dans la maisonnée.
Le point de bascule est 1877. Cette année-là, dans le journal Lou Prouvençau, Christian de Villeneuve, confident de Mistral, écrit un article dans lequel, en s’appuyant notamment sur la pétition de Gaidoz, Charencey et de Gaulle, mais aussi sur Michel Bréal4, il demande à la fois qu’on laisse les enfants parler provençal à l’école puisque les petits paysans n’auront pas besoin du français dans leur vie aux champs, et que l’on se serve du provençal pour mieux apprendre le français. Quelques mois plus tard, c’est au tour de Mistral d’évoquer dans un discours la nécessaire place qui devrait être laissée à la langue d’oc à l’école :
Nous savons bien qu’en bonne justice les écoles hautes et basses devraient, dans le Midi, adapter l’instruction conformément à nos usages, à nos besoins, à notre nature. Si jamais le bon sens, la liberté, le droit règnent en ce monde, c’est ce qui adviendra, c’est ce qui sera. Mais rappelons-nous bien que le gouvernement, quel qu’il soit, n’aura jamais l’idée de donner quelque chose qu’on ne lui demande pas. Il est donc indispensable de réveiller partout, dans toutes les classes, le goût et l’orgueil de notre parler. Et quand le peuple comprendra la signification patriotique et la grandeur du Félibrige, alors il demandera qu’on lui enseigne sa langue, et les gouvernements lui enseigneront sa langue.5
Le discours se fait là plus offensif. De plus, viennent alors de paraître les Lectures ou versions provençales françaises du frère Savinien. Celui-ci, qui enseigne à Avignon, dans l’enseignement confessionnel, s’est inspiré des travaux de Michel Bréal pour élaborer une méthode de version qui permet, grâce à l’étude comparée du provençal et du français, de mieux apprendre la langue nationale ; ce qu’il résume en expliquant que le provençal peut faire office de latin des classes populaires. C’est là un instrument pédagogique qui peut permettre l’application de l’enseignement réclamé par Mistral.
C’est une position qui ne va guère changer dans les décennies suivantes. Sauf que, malgré son organisation, malgré ses Escolo et leurs nombreux membres, le Félibrige n’arrive jamais à mettre en place un outil de revendication efficace et se montre incapable de trouver des relais pour intervenir auprès du ministère y compris lorsque l’un des siens est à sa tête.
En 1901, le bureau du Consistoire adresse au ministre de l’Instruction publique – Georges Leygues, qui se trouve être occitan et membre de l’association la Cigale, une société savante de méridionaux – une requête dans laquelle est listée toute une série d’arguments en faveur de l’enseignement de la langue à l’école. Rien que de très habituel : mesure d’égalité et de justice susceptible d’offrir aux enfants l’amour de leur petite patrie (et donc de la grande), utilité pour l’apprentissage du français. En conclusion de cette requête, trois mesures sont proposées : interdiction de punir les élèves qui parlent occitan (au moins en dehors des heures d’école !), instauration facultative de l’étude comparée du français et de l’occitan et – voilà qui est original – prise en compte de cette étude dans les épreuves du certificat d’études et du brevet. Cela n’aboutira à rien, bien entendu, sinon à un refus quelques mois plus tard, sur lequel nous reviendrons plus loin. Pendant trois mois, entre novembre 1910 et février 1911, Maurice Faure est ministre de l’Instruction publique. L’homme est l’un des fondateurs en 1876 à Paris de la Cigale et devient en 1881 un des 50 majoraux qui siègent au Consistoire du Félibrige. Pourtant, relève Philippe Martel qui a étudié ses correspondances6, il ne vient à l’idée d’aucun félibre, Mistral compris, d’interpeller Faure pour qu’il fasse quelque chose pour l’enseignement de la langue d’oc. Et lui-même ne prend aucune initiative en ce sens. Cet immobilisme, cette incapacité, à tout le moins, à organiser un lobbying intensif est étonnant mais révèle aussi peut-être que la question de l’enseignement pour les félibres reste secondaire malgré leurs incantations.
Ce que nous disent ces revendications, depuis la pétition de Charencey, Gaidoz et de Gaulle, c’est que l’enseignement primaire est stratégique pour la diffusion de la langue française et donc aussi cause du recul des langues de France. Reste à savoir comment celle-ci doit être apprise aux petits français. Or, de ce point de vue, tous les pédagogues ne sont pas d’accord.
Questions de pédagogie
Que faire de la langue avec laquelle les enfants arrivent à l’école ? C’est là toute la question dès que se met en place une offre éducative assez étoffée et plus encore après la loi Ferry de 1881 qui rend l’école obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans.
L’un des premiers à prendre position en la matière est Michel Bréal. Dans son livre, Quelques mots sur l’Instruction Publique en France, publié en 1872, et qui est une proposition de réforme du système éducatif, il écrit :
La plupart de nos instituteurs enseignent le français comme une langue tellement au-dessus du patois qu’on ne peut même pas songer un instant à les mettre en parallèle : le patois pour eux est non avenu, ou s’ils en parlent, c’est comme d’un antagoniste qu’il faut détruire. L’élève qui arrive à l’école parlant son patois est traité comme s’il n’apportait rien avec lui ; souvent même on lui fait un reproche de ce qu’il apporte, et on aimerait mieux la table rase que ce parler illicite dont il a l’habitude. Rien n’est plus fâcheux et plus erroné que cette manière de traiter les dialectes. Loin de nuire à l’étude du français, le patois en est le plus utile auxiliaire.7
Au-delà de ce qu’il nous dit ici sur ce qu’il préconise, Bréal dresse le tableau de la réalité de l’enseignement de son époque et du rejet quasi unanime des langues maternelles des enfants. Bien entendu, ses préconisations ne sont jamais que cela, des préconisations, et jamais elles ne seront intégrées dans un quelconque programme officiel. Néanmoins, ses écrits et les conférences qu’il donnent parfois sur le sujet peuvent susciter l’intérêt d’enseignants. D’autant plus que certains, bien entendu, n’ont pas attendu Bréal pour utiliser en classe la langue maternelle qu’ils partageaient bien souvent avec leurs élèves, au moins à des fins de comparaison avec le français ou, tout simplement, pour traduire des expressions françaises que leurs élèves ne comprenaient pas.
L’influence d’un autre Inspecteur général est déterminante. Félix Pécaut, béarnais d’origine, a écrit en 1880 un rapport sur « la situation scolaire du pays basque » dans lequel, bien entendu, il évoque la question de l’apprentissage du français. Si, depuis 1880, l’article 14 du règlement modèle des écoles primaires indique que « le français sera seul en usage dans les écoles », Pécaut préconise d’avoir recours au basque lorsque cela est nécessaire. Il indique même que, au moins au début de la scolarité des élèves, cet enseignement pourrait être bilingue. Ainsi peut-on découvrir en 1883, dans le règlement des écoles primaires des Basses-Pyrénées, un article 12 stipulant que « le français sera seul en usage dans l’école, excepté dans les arrondissements de Bayonne et de Mauléon, où il pourra être fait des exercices de traduction du basque en français, et du français en basque » ; tout cela, bien entendu, « dans la limite du nécessaire et uniquement en vue d’enseigner aux enfants la langue nationale ».
Car, que l’on ne s’y méprenne pas, ni Bréal ni Pécaut ne sont d’ardents défenseurs des langues de France. S’ils entendent les tolérer dans une certaine mesure et inciter à les utiliser, c’est bien pour mieux diffuser le français et avec la conviction que cette francisation progressive aboutira à la disparition naturelle des « patois ». Et il ne faut sans doute pas non plus surestimer l’usage qui a pu être fait de la langue maternelle des élèves dans les écoles. Remarquons encore que, officiellement du moins, ce qui est autorisé en 1883 au Pays basque, ne l’est pas en Béarn et que, même alors, il faut du temps pour que le système se mette en place. M. Devinat, inspecteur de la circonscription de Bayonne écrit ainsi dans un rapport publié en 1888 que « avant 1884, un certain nombre d’écoles basques étaient dirigées par des Béarnais. On croyait alors proscrire absolument le basque de l’école, et choisir des maîtres complètement étrangers à l’idiome local »8. On voit là que, non seulement l’utilisation comparée du basque et du français est lente à être utilisée – et sans doute loin d’être systématique – mais qu’en plus, il y a eu précédemment une politique consistant à volontairement installer dans les classes du Pays basque des instituteurs ignorant la langue. Jean-François Chanet, dans son livre sur L’école républicaine et les petites patries, rappelle, quant à lui, que dans les années 1860 les trois quarts des instituteurs du Finistère utilisaient le breton en classe.
Mais, depuis 1860, deux événements ont eu lieu. La guerre de 1870 d’abord, avec la perte de l’Alsace et de la Lorraine qui donne à l’unité française une dimension d’autant plus importante que le pays s’est vu amputé de deux régions dont la population parlait une autre langue que le français. Les lois Ferry ensuite, qui ont généralisé l’enseignement et l’ont rendu laïque et gratuit. Les deux, bien entendu, se trouvent liés : l’unité nationale est d’autant plus importante après 1870 et la nécessité de former des citoyens passe par l’apprentissage du français même s’il doit se faire à marche forcée. Les langues de France apparaissent encore comme des ferments de séparatisme, souvent rattachées qui plus est, dans l’esprit d’une partie des républicains de l’époque, à la réaction par le truchement de la religion.
Irénée Carré est lui aussi un Inspecteur général. En 1888, après une mission en Bretagne, il publie dans la Revue pédagogique un article intitulé : « De la manière d’enseigner les premiers éléments du français dans les écoles de la Basse-Bretagne ». Il y insiste sur le fait que le breton – comme le basque et le flamand – est une langue qui n’a rien à voir avec le français. Les autres patois parlés en France sont aussi des langues romanes et, donc, leurs locuteurs comprennent mieux la langue nationale.
La méthode Carré, aussi appelée méthode maternelle, méthode directe ou méthode naturelle, consiste à considérer que l’élève qui arrive à l’école est comme un nourrisson face à sa mère. Il ne parle qu’un « babil » et c’est en imitant sa mère qu’il va apprendre à parler. Le petit breton qui entre à l’école est dans la même situation. Il parle une langue qui n’est pas celle de l’école et donc, l’instituteur s’adressera à lui uniquement en français pour l’amener, par imitation à apprendre la langue nationale. Cela passera par la répétition, l’usage de tableaux d’images, de musées scolaires, etc.
Corollaire qu’il nous faut évoquer : l’emploi du « signal » (aussi appelé « signe » ou « symbole »). Cette punition est préconisée dans la Correspondance générale de l’Instruction publique, en 1893, par un certain inspecteur Boitiat, chargé des écoles primaires de l’arrondissement de Barcelonnette, dans les Basses-Alpes :
Le matin en entrant en classe, le maître remet au premier élève de la division supérieure un sou marqué d’une croix au couteau ou de tout autre signe permettant de le reconnaître. Ce sou s’appelle le signe. Il s’agit pour le possesseur du signe, pour le signeur comme disent les élèves, de se débarrasser du sou en le donnant à un autre élève qu’il aura surpris prononçant seulement un mot de patois.9
S’il n’est pas systématiquement utilisé et s’il n’est pas non plus inventé à ce moment-là, mais bien avant, le signal existe bien. On dispose d’un certain nombre de témoignages en ce sens, jusque dans les années 195010. Dénoncé cette année 1893 par Frédéric Mistral dans sa revue L’Aiòli, il devient un symbole de l’oppression de l’école contre les langues de France. Voilà donc, dans toute sa complexité, la situation telle qu’elle est au début du XXe siècle ; complexité accentuée encore après la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, le recul des langues de France est patent. Elles constituent de moins en moins dans l’esprit des pédagogues et des politiques un obstacle à la diffusion du français. On consent donc un peu plus facilement à leur laisser une place dans l’école. Toutefois, cette place demeure marginale et reste attachée à l’idée de la promotion de la petite patrie qui permet de mieux aimer la grande. Pas question donc, d’aller trop loin dans l’enseignement comme le précise Stéphane Jolly, inspecteur d’Académie des Basses-Pyrénées en 1929, en parlant d’un devoir donné par un instituteur à ses élèves et portant sur le sujet « Notre village » : « Il leur apprend excellement la langue française, ce qu’il y a peut-être de meilleur dans notre patrimoine national, et en même temps, il les tourne insensiblement vers leur petite patrie qu’il leur enseigne très fortement à aimer. »11
Refus des autorités et structuration de la revendication
En 1923, est créée la Ligue de la Patrie Méridionale-Fédération des Pays d’Oc sous l’impulsion notamment des toulousains Camille Soula et Ismaël Girard. Un certain nombre de militants d’oc de l’époque dont une grande partie sont issus du Félibrige (Michel Camélat, Simin Palay, Pierre Azéma, Léon Teissier, Pierre Fontan et même le Capoulier Marius Jouveau) se joignent à ce projet fédéraliste qui, le temps de quelques réunions entre mai et novembre 1923, commence à établir un programme et un organigramme avant d’entrer en sommeil. Parmi les multiples commissions créées (Comité d’Action de la Presse, Comité Juridique, Commission de Défense Municipale et Provinciale, etc.), une seule va survivre à cette expérience avortée : la Ligue pour la Langue d’Oc à l’École. Animée essentiellement par Jean Bonnafous, membre de l’école félibréenne parisienne des Amis de la Langue d’Oc, elle mène plusieurs années durant une action en faveur de l’entrée de la langue d’oc dans les écoles.
Le projet, tel qu’il est structuré, pose pour plusieurs décennies au moins les bases de la revendication occitane en faveur de l’entrée de la langue dans les écoles. On y trouve principalement deux pôles : un pôle toulousain, chargé de la propagande auprès des milieux militants par le biais notamment de la revue Oc d’Ismaël Girard qui, dès son premier numéro, le 27 janvier 1924, accueille dans ses colonnes la Ligue pour la Langue d’Oc à l’École ; un pôle parisien, qui s’appuie sur les Amis de la Langue d’Oc et leurs réseaux pour toucher politiques et administration.
La première action d’importance de la Ligue pour la Langue d’Oc à l’École est un Appel aux membres de l’Enseignement envoyé en plusieurs vagues jusqu’à arriver à 99 adhésions. Les revendications qui sont présentées dans cet appel tiennent en six points. Les signataires de l’Appel s’engagent :
- à ne pas punir les élèves qui parlent patois ;
- à ne pas leur inculquer le mépris de leur langue ;
- à comparer le patois avec le français afin de faciliter l’apprentissage de ce dernier et à faire de même avec le latin et d’autres langues lorsque cela est possible ;
- à expliquer aux élèves que ce patois est une langue de civilisation ;
- à utiliser la littérature de langue d’Oc dans leurs cours ;
- à faire apprendre et traduire aux élèves des extraits d’auteurs occitans en commençant par ceux issus du même terroir que les élèves si possible.
S’il n’y a rien de bien révolutionnaire ni même, en réalité, d’audacieux là-dedans, cela permet toutefois de structurer sérieusement, pour la première fois, la revendication en faveur de l’enseignement de la langue d’oc et d’obtenir, en 1924, une première – bien que symbolique – victoire puisque paraît, en novembre de cette année-là, la circulaire du ministre François Albert qui autorise la tenue de conférences sur la langue d’oc dans les établissements secondaires et les Écoles normales du Midi, « à la condition que ces conférences ne soient pas trop nombreuses ».
L’été suivant, la Ligue décide de s’adresser au nouveau ministre, Anatole de Monzie, sénateur et président du Conseil général du Lot, maire de Cahors. Une lettre est envoyée qui lui demande « de bien vouloir adresser au personnel de l’enseignement primaire une circulaire autorisant ceux des maîtres qui le voudront à utiliser le dialecte maternel de leurs élèves pour l’enseignement du français »12. Non seulement Anatole de Monzie refuse mais, de plus, il publie une circulaire contre l’utilisation des dialectes :
Est-il donc vrai que le dialecte local puisse servir à enseigner le Français ? Ce n’est, à cette heure, l’avis d’aucun pédagogue qualifié. […] Comment, en surplus, accorder une telle proposition avec les méthodes générales de l’enseignement, avec la méthode directe dont il est usé pour apprendre l’Allemand ou l’Anglais ? Se servira-t-on du Languedocien comme truchement du Français, tandis que le mot d’ordre moderne est l’apprentissage du Français par le Français ? Les objections valables se multiplient sans qu’apparaisse en sens contraire aucun argument décisif.13
Le refus de Monzie n’en est qu’un de plus dans ces années d’entre-deux-guerres. S’il choque, c’est surtout par la brutalité avec laquelle il est exposé, loin des habituelles excuses – en particulier les programmes trop chargés et la priorité accordée à l’apprentissage du français – enrobées dans des hommages à peu de frais à une bien belle langue à laquelle on fait un beau cadeau en la laissant courir à travers champs et forêts plutôt qu’en l’enfermant dans une sombre et étroite salle de classe.
On pourrait presque résumer cette période à cela : une revendication qui se met en place lentement dans la difficulté face à des autorités qui se montrent réticentes à la moindre concession officielle. Occitania, mouvement de la jeunesse fédéraliste qui apparaît au début des années 1930, essaie, comme auparavant la Ligue de la patrie méridionale, de mettre en place un programme de revendication en faveur de l’enseignement qui se heurte aux mêmes écueils : manque d’investissement militant et d’interlocuteurs au niveau de l’État. Sur le terrain, toutefois, la situation est un peu plus complexe et ouverte. Les revues félibréennes et occitanistes se font régulièrement l’écho de cours donnés ici ou là dans des établissements scolaires ou de formation des enseignants avec la bénédiction parfois, la simple tolérance souvent, et sans doute aussi l’ignorance à certains moments, des autorités académiques. Le Collège d’Occitanie, fondé à Castelnaudary en 1927 puis installé à Toulouse, et spécialisé dans les cours par correspondance, ouvre ainsi des concours scolaires suivis par des classes de la région : on compte, dès 1927, près de 200 inscrits aux Jeux floraux scolaires organisés par le Collège. La langue d’oc est donc parfois présente dans l’école, mais elle y reste très marginale.
L’illusion de Vichy
La Seconde Guerre mondiale change la donne. L’arrivée au pouvoir du maréchal Pétain, sa volonté affichée de retour aux valeurs du terroir, laisse à penser aux militants d’oc que des avancées sont possibles. Très tôt, dès l’été 1940, un groupe de militants mêlant félibres et occitanistes décide de s’adresser au nouveau chef de l’État. Cette requête, comme de coutume, présente des revendications basiques.
On demande au maréchal Pétain de ne pas négliger « l’élément historique et linguistique »14 dans la délimitation des provinces, on le sollicite pour que, alors qu’il prévoit de réorganiser l’enseignement, « l’histoire locale et la langue locale figurent en bonne place sur les programmes de l’école primaire », et on formule le vœu que, dans « les futures Chambres où seront représentés tous les éléments vitaux du pays » les « authentiques forces traditionnelles de nos provinces aient la possibilité de faire entendre leurs voix ». Les péripéties du moment empêchent un départ rapide de cette requête en direction du chef de l’État français. Lorsqu’elle arrive enfin à destination, au mois de décembre 1940, le maréchal Pétain a déjà rendu un hommage appuyé à Mistral à travers une lettre écrite à sa veuve à l’occasion du 110e anniversaire du Maître. De plus, le 9 octobre 1940, Georges Ripert, secrétaire d’État à l’Instruction publique, a envoyé aux recteurs d’académies une circulaire dans laquelle il indique qu’il a « inscrit au programme quelques leçons sur l’histoire et la géographie locales » et « signale aux maîtres l’utilité que peut représenter pour eux l’étude du dialecte local » qu’il leur recommande d’étudier. Il ajoute enfin que « dans tous les pays du Midi, la langue d’Oc a une littérature magnifique qui ne doit pas être inconnue des élèves »15. Si tout cela ne peut guère déboucher sur quoi que ce soit de très concret, Pétain peut néanmoins, dans sa réponse à la requête des militants d’oc, se féliciter d’avoir devancé leurs attentes.
La déception est à la hauteur des espoirs placés dans un nouveau régime dont le régionalisme de façade dissimule en fait très mal le caractère éminemment centralisateur du pouvoir. Une avancée est toutefois gagnée à la fin de l’année 1941 avec la publication, le 24 décembre, de deux arrêtés signés par le ministre de l’Éducation nationale Jérôme Carcopino. Le premier autorise les instituteurs et les institutrices à « organiser dans les locaux scolaires, en dehors des heures de classe, des cours facultatifs de langue dialectale (langue basque, bretonne, flamande, provençale), dont la durée ne devra pas excéder une heure et demie par semaine ». Le second indique que, lors des épreuves du certificat d’études primaires, une des questions de l’épreuve écrite d’histoire-géographie portera sur l’histoire régionale, et qu’une autre, de géographie, « pourra être l’exécution d’un croquis ou porter sur la géographie locale ». De plus, la liste des cinq morceaux que doit proposer le candidat pour l’épreuve de chant pourra contenir un morceau « pris dans le répertoire local ». Là encore, les concessions sont mineures et relèguent, de fait, l’étude de la langue en marge du temps scolaire… pour peu que des enseignants et des élèves soient assez motivés par cet enseignement.
L’enthousiasme – mesuré – que provoque cette publication au sein du mouvement d’oc diminue assez rapidement lorsqu’il s’agit d’appliquer ces textes. Là encore, le constat est sans appel : tout dépend de l’investissement des militants sur le terrain et ils sont toujours aussi peu nombreux. Sous l’impulsion notamment d’Henri Mouly en collaboration avec l’abbé Joseph Salvat, du Collège d’Occitanie, et avec la bénédiction des autorités académiques, se met en place en Rouergue un enseignement de l’occitan sanctionné par un « certificat d’études occitanes » décerné par un jury présidé par l’inspecteur d’académie. Mais cette expérience est isolée et la réalité du terrain sur l’ensemble de l’aire d’oc est bien moins spectaculaire. Les inégalités demeurent entre les lieux où des enseignants militants arrivent à mettre en place des cours et la grande majorité des écoles dans lesquelles rien ne se fait. Ce qui pour l’État est un aboutissement – on a répondu à une revendication – n’est au mieux qu’une étape pour les militants d’oc. Mais les événements se précipitent : entrée des Allemands et des Italiens dans la « zone libre », mise en place du STO et, enfin, la Libération avec, dès août 1944, l’affirmation par le Gouvernement provisoire de la République française de la nullité de tous les actes promulgués par l’État français de Vichy.
Au sortir de la guerre, si le mouvement d’oc, qui s’en est tenu dans son ensemble à une revendication culturelle, n’a pas les mêmes problèmes que d’autres, l’implication de certains de ses membres dans la politique de Vichy et/ou dans la collaboration fragilise la revendication dans son ensemble. Alors qu’il tente de se refonder, la question de l’enseignement n’est plus prioritaire et il faut attendre une initiative bretonne pour véritablement relancer les négociations avec l’État.
Vers l’institutionnalisation
Après la Libération, la revendication en faveur de l’enseignement de la langue se fait donc un peu plus discrète, ce qui n’empêche pas des initiatives sur le terrain. On peut citer la création dans l’Hérault du groupe Antonin Perbosc à l’initiative d’une jeune institutrice, Hélène Cabanes. Des enseignants, essentiellement intéressés par la pédagogie active développée par Célestin Freinet, font une place à la langue occitane que nombre de leurs élèves parlent. Du côté provençal, à partir de 1946, est créée l’association Lou Prouvençau à l’escolo qui publie sa revue (d’abord une feuille ronéotypée qui devient une véritable revue en 1952) et un manuel.
Parallèlement, du côté des institutions françaises, un combat législatif commence en 1947. D’abord porté par le député communiste breton Pierre Hervé, un projet de résolution qui vise à « inviter le Gouvernement à prendre les arrêtés et mesures nécessaires à la conservation de la langue et de la culture bretonnes, à l’abrogation des dispositions qui proscrivent l’usage de la langue bretonne dans l’enseignement public et à l’organisation d’un enseignement de la langue bretonne dans les départements du Finistère, des Côtes-du-Nord et du Morbihan » voit s’agréger au fil des mois des revendications portées par des Catalans, des Basques et, surtout, des Occitans. Des négociations âpres débutent. Elles s’achèvent par le vote, le 22 décembre 1950, et la promulgation, le 11 janvier 1951, de la loi dite Deixonne, du nom de son rapporteur16. « La loi Deixonne présente surtout des avantages moraux »17 écrit Robert Lafont. En effet, sa portée pratique est très limitée. Outre une heure facultative de cours, en dehors des horaires normaux pour le primaire, elle permet l’entrée d’une épreuve de langue régionale au baccalauréat dont la note ne peut compter que pour obtenir une mention. Elle entérine cependant la dénomination de « langue occitane ».
Si la portée de la loi Deixonne est avant tout symbolique, la situation sur le terrain évolue peu à peu. De fait, que ce soit Lou Prouvençau à l’Escolo ou l’IEO qui se dote, à partir de 1950, d’une section pédagogique, un effort militant considérable est fait pour faciliter la mise en place de cours d’occitan par des enseignants : revues, manuels, stages pédagogiques sont créés et la langue d’oc entre petit à petit dans un certain nombre de classes, même si cela ne se fait pas forcément dans le cadre étroit ouvert par la loi. Là encore, la situation locale varie selon le bon vouloir des autorités académiques et la capacité militante. Mais, quoi qu’il en soit, l’enseignement de l’occitan se structure et fait, à sa manière, sa petite révolution : alors que la revendication a longtemps été portée par des militants qui n’étaient pas – et même qui étaient peu souvent – des professionnels de l’enseignement, elle devient après-guerre une affaire d’enseignants. Outre la production de matériel, cela implique une réflexion de fond sur la manière d’enseigner et l’objectif de l’enseignement de la langue d’oc. Ainsi, naît au sein de la section pédagogique de l’IEO une réflexion sur la « pédagogie occitaniste » que l’on peut résumer à travers ce qu’en dit Robert Lafont lors de l’assemblée générale de l’Institut de mars 1950 :
Quand vous aurez fait en sorte qu’un Occitan ait compris qu’en lui tout est occitan, depuis son nom jusqu’à sa manière de sentir, de voir les choses, et de les dire, quand lui-même aura trouvé que tout est occitan dans son environnement : monuments du passé, réalité géographique, structure économique, alors, naturellement, d’Occitan qu’il est, il sera devenu occitaniste, parce que l’occitanisme n’est pas une nouvelle croyance patriotique mais la fidélité envers soi, la conquête de son être total. [traduit par nous]
Ce que Robert Lafont évoque là, en parlant de l’environnement – historique, géographique, économique – de l’Occitan, est aussi l’un des prémices de la réflexion plus générale qui va être menée autour des questions économiques et politiques, qui débouche, outre les conflits internes à l’IEO, sur la création en marge de l’Institut du Comité occitan d’étude et d’action (COEA). C’est cet organisme qui diffuse notamment le concept de « colonialisme intérieur » afin d’expliquer le sous-développement économique des régions périphériques. Cela se traduit par une montée de la revendication politique au sein du mouvement occitaniste et, partant, par une forme de politisation de l’enseignement ; d’autant plus que, dans l’étroit cadre règlementaire qui le régit, cet enseignement marginal (ou marginalisé) est dispensé par des enseignants qui sont souvent des militants.
1968 fait aussi son œuvre et contribue d’autant à favoriser la revendication politique que celle-ci est portée, dans le même temps, par une partie des chanteuses et chanteurs de la Nouvelle chanson occitane qui contribue à diffuser la parole de l’occitanisme à un public plus large. Ces années-là sont celles où le mouvement se politise et où de plus en plus d’élèves apprennent l’occitan. Il convient toutefois de noter que si cet enseignement se développe, en particulier au lycée, c’est que, même si aucune loi en sa faveur n’est votée après la loi Deixonne, les avancées règlementaires moins ostentatoires permettent ce développement.
Pas assez vite cependant pour certains militants enseignants du primaire qui décident en 1979, à Pau, de lancer une école associative immersive sur le modèle des ikastolak basques. La Calandreta de Pau accueille ainsi ses premiers élèves en janvier 1980. Le développement de ces écoles hors du service public d’éducation joue aussi un rôle d’aiguillon pour l’Éducation nationale. Après l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République, la circulaire Savary de 1982 permet notamment d’expérimenter un enseignement bilingue dans l’enseignement public. Dans le même temps, les enseignants créent des structures, les Centres régionaux d’enseignement de l’occitan (CREO), qui ne sont plus rattachés à l’IEO et permettent de mieux négocier avec les pouvoirs publics, ce qui favorise indéniablement des avancées comme la création en 1991 du CAPES d’occitan-langue d’oc. Cela va de pair, le nombre d’élèves ayant accès à une modalité ou une autre d’enseignement (enseignement bilingue immersif ou à parité horaire, initiation, sensibilisation…) de l’occitan croît régulièrement dans ces années-là et, dans le même temps, comme le disait déjà Denise Imbert dans le numéro 58 des Cahiers pédagogiques de l’IEO en 1972, cet enseignement institutionnalisé perd de sa charge militante : « […]nos cours facultatifs formaient des “militants” si on peut donner ce nom aux jeunes occitans volontaires des années 60 ; nos cours “dans le cadre des horaires des maîtres et des élèves” nous envoient des élèves. Il faut accepter ce revers d’une médaille que nous avons réclamée. »
Afin de garder une distance nécessaire mais aussi parce que l’étude de la situation de l’enseignement de l’occitan dans l’école française pour les deux ou trois dernières décennies nécessiterait un bien long développement, nous arrêtons là ce panorama historique des rapports entretenus entre la langue occitane et l’institution scolaire.
Il ressort néanmoins de tout cela que, si l’on a tendance à penser que la revendication en faveur de l’enseignement de la langue et les réponses qui y sont apportées par les pouvoirs publics semblent se répéter indéfiniment, la situation n’a cessé de changer. Peut-on vraiment parler de progrès si l’on part du XIXe siècle, un temps où la langue d’oc était encore celle de la majorité de la population occitane ? Certes pas. On ne peut que constater l’immense recul, la fin progressive de la transmission familiale, la manière dont le français s’est imposé au nom d’une idée bien française consistant à faire du monolinguisme un des fondements de l’unité de la nation. Néanmoins, et bien que cela suscite encore de nos jours bien des crispations chez les tenants de cette idéologie linguistique française, l’enseignement de l’occitan, grâce à un long investissement de plusieurs générations de militants, s’est institutionnalisé et a considérablement assis sa place dans l’institution scolaire. On sait bien entendu combien cette place est fragile, et les dernières années ont démontré combien une politique scolaire peut rapidement saper des années d’efforts de développement. Reste que l’enseignement de l’occitan comme des autres langues de France est bel et bien là. Encore faut-il maintenant lui donner la possibilité de former des locuteurs pour que la langue sorte de l’école et qu’elle puisse plus irriguer la société.
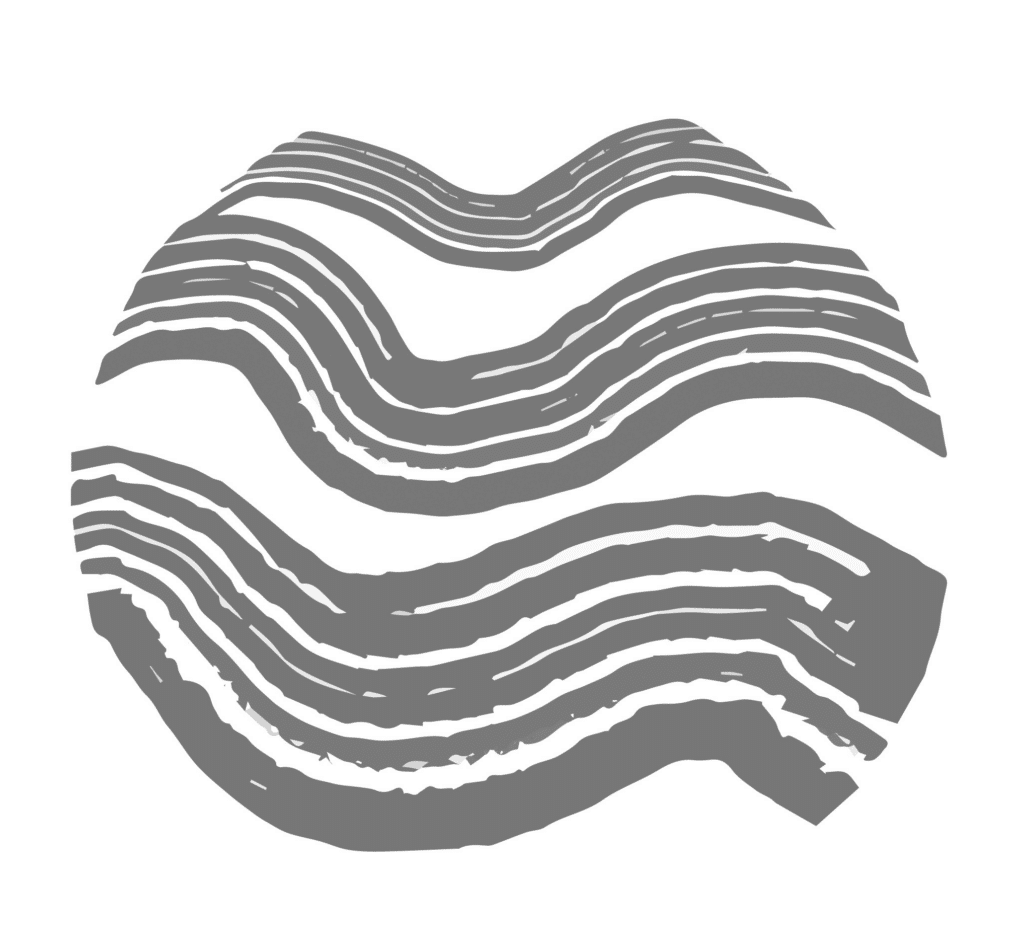
Bibliographie
- Abrate Laurent, 1900/1968 Occitanie des idées et des hommes, [Puylaurens], Institut d’études occitanes, 2001, 622 p.
- Certeau Michel de, Julia Dominique et Revel Jacques, Une politique de la langue, Paris, NRF, 1975. Rééd. Gallimard, coll. « Folio Histoire », 2002, 328 p.
- Chanet Jean-François, L’école républicaine et les petites patries, Paris, Aubier, 1996, 427 p.
- Lafon Michel, Qui a volé mon patois ?, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2015, 359 p.
- Lafont Robert, La revendication occitane, Paris, Flammarion, coll. « L’Histoire vivante », 1974, 324 p.
- Lespoux Yan, « Soixante ans d’enseignement de l’occitan : idéologie(s) et institutionnalisation », Les Langues Modernes, n° 4/2010, octobre-novembre-décembre 2010, p. 43-46.
- Lespoux Yan, « Autour d’une revendication méridionale : la Ligue pour la Langue d’Oc à l’École », Annales du Midi, n° 271, juillet-septembre 2010, p. 391-406.
- Lespoux Yan, « Occitania : une revendication fédéraliste de la jeunesse occitane dans les années trente », dans Amalvi Christian, Lafon Alexandre, Piot Céline (sous la dir. de), Le Midi, les Midis dans la IIIe République, Nérac, Éditions d’Albret/AVN, 2012, p. 79-97.
- Lespoux Yan, « Illusions et tentations : la requête des félibres et occitanistes au Maréchal Pétain (1940) », dans Pfeffer Wendyet Thomas Jean (sous la dir. de), Nouvelles recherches en domaine occitan : approches interdisciplinaires, Thurnout, Brepols, 2015, p. 341-354.
- Lespoux Yan, Pour la langue d’oc à l’école, Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2016, 252 p.
- Martel Philippe, Le sourd et le bègue. L’école française et l’occitan, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2007, 190 p.
- Martel Philippe, Les félibres et leur temps. Renaissance d’oc et opinion (1850-1914), Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, coll. « Saber », 2010, 690 p.
- Moliner Olivier, Frankreichs Regionalsprachen im Parlament, Wien, Praesens, 2010, 411 p.
Notes
- Cette citation du rapport Barère et les suivantes sont extraites de Michel de Certeau, Dominique Julia et Jacques Revel, Une politique de la langue, Paris, NRF, 1975. Rééd. Gallimard, coll. « Folio Histoire », 2002, p. 321-331.
- G. Bruno, Le tour de France par deux enfants, Paris, Belin, 1907. Rééd. 2009, p. 161-162.
- Frédéric Mistral, Discours e dicho, Raphèles-les-Arles, CPM-Marcel Petit, 1980, p. 134.
- Michel Bréal (1832-1915), linguiste et pédagogue, est notamment l’auteur en 1872 de Quelques mots sur l’instruction publique en France. Sur son rapport aux langues dites régionales, on se réfèrera utilement à Pierre Boutan, « Michel Bréal, “Ami des patois” : linguistique, pédagogie, politique », Langages, n° 120, 1995, p. 33-51.
- Ibid. p. 28-31.
- Philippe Martel, Les félibres et leur temps. Renaissance d’oc et opinion (1850-1914), Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, coll. « Saber », 2010, p. 474-475.
- Cité dans Jean-François Chanet, L’école républicaine et les petites patries, Paris, Aubier, 1996, p. 226.
- « L’enseignement élémentaire du français dans le Pays basque », Bulletin officiel de l’Instruction primaire des Basses-Pyrénées, n° 1, janvier 1888.
- Cité dans Philippe Martel, Les félibres et leur temps, op. cit., p. 457.
- On peut notamment se référer à ce sujet à Michel Lafon, Qui a volé mon patois ?, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2015.
- « Rapport de M. l’inspecteur d’académie sur la situation de l’enseignement primaire dans les Basses-Pyrénées pour l’année 1928-1929 », Bulletin officiel de l’Instruction primaire des Basses-Pyrénées, n° 12, décembre 1929.
- Lettre reprise dans « Lous “patouès” a l’escole », Reclams de Biarn e Gascougne, octobre 1925, p. 30-31.
- Cité dans Ibid., p. 31-32.
- Texte de la requête publié dans « Le Maréchal Pétain et la langue d’Oc », Supplément au n° de février 1941 de Terra d’Oc.
- Cité dans Lo Gai Saber, n° 190, septembre-octobre 1940, p. 240-242.
- Pour le détail de ce long combat, nous renvoyons à notre ouvrage Pour la langue d’oc à l’école, Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2016.
- Robert Lafont, La revendication occitane, Paris, Flammarion, coll. « L’Histoire vivante », 1974, p. 227.




