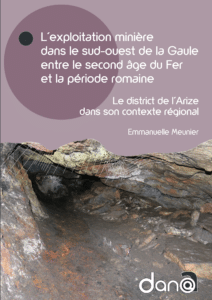UN@ est une plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine
Lieu d'édition : Pessac
23. – Bulle AC, articles (272) à (287).
22. – Bulles AB et BF, articles (255) à (270).
21. – Bulles Z et AF, articles (246) à (252).
20. – Bulles Y et AN, articles (239) à (244).
19. – Bulle X, articles (236) et (237).
18. – Bulles VV et GO, articles (220) à (234)
16. – Bulles S et AS, articles (188) à (204).
17. – Bulles T et FH, articles (206) à (218).
15. – Bulles Q et AR, articles (176) à (186).
L’exploitation des ressources minières est une activité qui a été pratiquée dans tous les massifs montagneux du sud-ouest de la Gaule (Pyrénées, Corbières, Montagne noire) à toutes les périodes. Cet ouvrage propose une synthèse sur les exploitations du second âge du Fer et de la période romaine, pour lesquelles les données ont été largement renouvelées depuis le début des années 2000.
Dans les Pyrénées centrales, deux districts ont été étudiés : le massif du Montaigu pour le plomb argentifère et celui des Hautes Baronnies pour le fer (fig. 18). Les recherches dans le massif du Montaigu ont été menées par J. Girard.
L’exploitation des ressources minières est une activité qui a été pratiquée dans tous les massifs montagneux du sud-ouest de la Gaule (Pyrénées, Corbières, Montagne noire) à toutes les périodes. Cet ouvrage propose une synthèse sur les exploitations du second âge du Fer et de la période romaine, pour lesquelles les données ont été largement renouvelées depuis le début des années 2000.