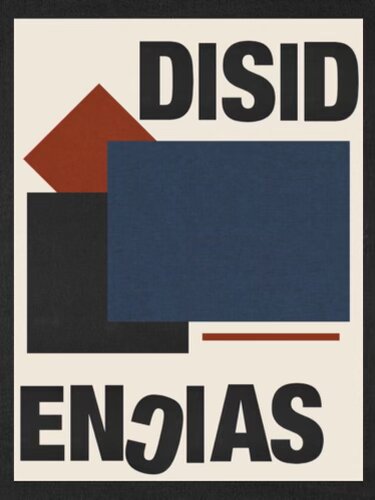Faire taire la différence. Prélude grec
Traduit par Corinne Ferrero.
Faire taire la différence. Prélude grec
Depuis plusieurs décennies, dans le sillage du développement des technologies de communication, nous assistons à l’explosion des catégories spatio-temporelles grâce auxquelles nous structurions la réalité, nos expériences et les événements de notre vie. La postmodernité se caractérise ainsi par l’apparition de cet environnement virtuel et intermittent, plastique, multidirectionnel, et la conscience – déjà présente dans les catégories héritées de la modernité telles que le hasard, l’indétermination, l’incertitude, le déséquilibre et l’instabilité – qu’il existe des phénomènes et des processus non linéaires et imprévisibles impliquant aussi le développement de modes d’écriture inédits dont les implications sociales et culturelles sont parfois déconcertantes. Face à une modernité qui savait mesurer et distinguer les temps de travail et de loisir et définir des espaces de résistance et d’émancipation, notre postmodernité se révèle discontinue et hétérotopique, décentrée, à la recherche de ces « centres nomades » deleuziens qui représentent le caractère provisoire, inconsistant, instable et fragile de toute connaissance. À la lumière des grandes transformations historiques et technologiques de notre époque, dans ce nouvel espace transnational qui est aujourd’hui le nôtre, je propose une réflexion sur la place de la théorie et de la pratique de la littérature à l’ère « post-théorique », postérieure, en tout cas à la grande époque de la théorie littéraire – la « high theory »1 – telle que décrite par Terry Eagleton dans son livre After Theory en 2003.
Dans ces conditions, il devient nécessaire d’aborder les différentes pratiques littéraires à la lumière d’une conscience écologique nouvelle qui permette d’aborder le langage non plus seulement comme un problème de critique philologique ou de talent littéraire, mais comme une opportunité d’émancipation, le lieu où doit surgir une créativité nouvelle basée sur un contact renouvelé avec soi-même, les autres et le monde.
Comme l’écrivait Yvonne Bordelois :
Il y a une écologie du langage que nous devons redécouvrir, et ce n’est pas une quête impossible. Chaque fois que nous ouvrons à une réflexion sur le sens caché des mots […], nous renouons avec le bonheur du langage et la possibilité de la poésie […].2
Cette quête, nous devrons la mener en partant d’une philosophie critique de la culture susceptible de nous orienter dans ce panorama complexe et parfois chaotique de la culture post-historique, où, comme on le voit souvent, tout devient possible, même l’art antiesthétique. En somme, une telle réflexion n’a de sens que si elle est abordée comme un effort pour (dé)situer les lieux habituels que l’art et la littérature occupent dans nos sociétés contemporaines et repenser les relations et interactions qui se produisent « entre la théorie du langage, la théorie de l’art et de la littérature, l’éthique et le politique »3.
Sauf à remettre en cause la catégorie de littérature elle-même (si tant est qu’une telle chose soit possible), l’on s’accordera, pour commencer, sur le fait que la fonction de la littérature, aujourd’hui, est de n’en avoir aucune (au sens où l’on entend habituellement la notion de fonction dans la rationalité économique dominante : l’utilité ou la rentabilité). Cependant, l’idée d’une fonctionnalité de la littérature a pu être déterminante tout au long de l’histoire, et la pratique littéraire a ainsi pu être associée au développement de croyances religieuses ou morales, de systèmes politiques ou culturels, ou a même pu constituer le support de méthodes thérapeutiques et bienfaisantes. La littérature fonctionne alors, pourrait-on dire, comme une sorte de soupape, un antidote permettant aux gens de faire face à des vies marquées par la privation, l’adversité ou la violence dans un système social et économique radicalement injuste4.
En ce sens, il est clair aussi que la littérature est inséparable d’une circulation sociale et économique de ses produits largement déformée par une consommation et une réception acritiques ; Il est également indéniable que l’activité littéraire, dans sa projection publique, est malheureusement plus étroitement liée à la valeur d’échange qu’à la valeur d’usage, bien plus proche du marché littéraire que de l’esthétique et que, dans un monde ravagé par un capitalisme économique, culturel et cognitif écrasant, plus cette circulation sera grande, plus les objets consommés dans le champ littéraire acquerront de la valeur et de l’autorité. Un champ littéraire traversé par deux forces qui ne sont pas toujours si opposées ou contradictoires qu’on voudrait le penser : l’université et le marché n’étant pas « nécessairement antagoniques »5, ainsi que le rappelle Damian Tabarovsky. Dans un système littéraire pris dans de telles dynamiques, la confrontation et l’analyse se voient elles-mêmes très affaiblies, la création de textes littéraires et la critique de ces mêmes textes étant en quelque sorte contrôlées par toute sorte de trafiquants littéraires aux intérêts partagés.
Dans ce contexte actuel, l’appauvrissement des enjeux théoriques de la création littéraire est notoire et l’on s’émerveille, dans une société (libérale) ayant fait de la liberté son emblème, de voir les stratégies d’(auto)censures très sophistiquées que développent des écrivain.es ayant majoritairement renoncé aux traits qui caractérisent leur activité depuis la modernité littéraire : l’exploration de formes nouvelles associée à une volonté de transformation du réel, la lucidité, la pensée critique, l’expérimentation, le risque, l’inventivité. L’on assiste ainsi à un spectacle auquel participent des éditeurs qui, obsédés par la rentabilité économique, ont oublié la dimension culturelle de leur activité professionnelle, et des écrivain.es développant leur œuvre dans l’angoisse non pas de l’influence mais de la célébrité ou de la confluence6 ; beaucoup de ces écrivain.es, conscient.es des lois économiques qui régulent le marché de l’édition, renoncent ainsi à la solitude et au silence qui sont les complices de tout travail créatif et rejoignent des alliances, des groupes et des réseaux communs dans le seul but de se faire connaître et si possible de parvenir rapidement à la notoriété. Si la logique capitaliste reconnaît la littérature comme une marchandise, l’auteur ne peut qu’assumer son rôle de producteur de cette marchandise ; la figure du travailleur a ainsi remplacé l’image romantique du génie créateur, avec pour résultat que de nombreux écrivains sont devenus des usines et des machines pour la production de masse et la création de plus-value. Marx l’avait déjà prévu lorsqu’il notait non sans ironie qu’un écrivain est un travailleur productif, « non parce qu’il produit des idées, mais dans la mesure où il enrichit l’éditeur qui publie ses écrits »7. Et de tels éditeurs et écrivain.es trouvent leur corrélat naturel non pas dans une communauté de lecteurs dotés d’esprit critique, mais dans une association de consommateurs de lectures considérant cette occupation comme un loisir supplémentaire. L’éditeur qui aura conquis une part de marché se battra ainsi de toutes ses forces pour maintenir et accroître sa présence économique sur le marché. Et dans cette lutte, il pourra toujours compter sur l’aide précieuse d’écrivain.es comprenant leur travail à l’aune des règles et de la servitude qu’impose un marché qui leur offrira en retour la reconnaissance économique. Il s’agit d’une sorte d’échange de bons procédés par lequel la littérature adopte la forme d’une marchandise destinée à être consommée par un client. Le texte s’est ainsi transformé en livre, un produit indéniablement commercial qui apporte néanmoins prestige et statut à celui qui le consomme. Et dans cette trame apparaît aussi un lecteur très particulier, le critique littéraire, un spécimen dont Aristote avait déjà esquissé le profil dans sa Poétique, en le décrivant non pas tant comme un lecteur officiant de manière indépendante, mais comme un vulgaire publicitaire vendu à certains privilèges sociaux et travaillant au service d’intérêts commerciaux.
En somme, nous vivons une époque où la majeure partie de la littérature publiée a baissé la tête, renoncé à son engagement critique vis-à-vis du langage et fait de la concession à la norme sociale sa stratégie habituelle (l’on en trouve de nombreux exemples dans tous les domaines de la littérature et de la poésie). Tabarovsky parle à ce sujet d’une pasteurisation de la culture et de la littérature et, bien qu’il se réfère à la production littéraire argentine des années 2000-2010, ses mots pourraient très bien s’appliquer à notre réalité, de l’autre côté de l’Atlantique :
Une grande partie de la littérature argentine contemporaine ne connaît pas l’échec parce qu’elle ne connaît pas le risque. Au cours de la dernière décennie, les valeurs plébiscitées par la société argentine se sont également retrouvées du côté de la littérature : le succès, la promotion sociale, les bonnes manières, l’efficacité, le zapping, la possibilité pour la langue de remplir une fonction de communication. La littérature a proposé une relation complaisante avec la langue, la primauté de la trame (comme s’il y avait des thèmes plus intéressants que d’autres), la recherche de romans bien écrits (comme les étudiants lorsqu’ils rédigent leurs travaux de recherche), une vision bureaucratique de la nouvelle (introduction-développement-conclusion). La littérature argentine est devenue une littérature de la convertibilité pure et simple : un mot est égal à un sens.8
Dans ces conditions, l’attitude consistant à maintenir une attitude critique vis-à-vis du langage (et à réfléchir sur ses implications dans le monde réel) est décidemment bien rare de la part des écrivain.es, tout comme est illusoire, de la part du lecteur, le sentiment de pouvoir choisir ses livres en toute liberté étant donnée la concentration croissante des maisons d’édition, des médias et des points de vente au sein de quelques oligopoles. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, et si l’on creuse un peu sous la surface on trouvera des maisons d’édition qui ne cherchent pas seulement le profit financier, des média intéressés à raconter la réalité d’une autre manière, et des librairies où les textes littéraires sont un peu plus que de simples marchandises9.
Dans le même ordre d’idées, à la fin des années 80, on a commencé à parler de roman light pour qualifier des formes narratives légères, insouciantes et superficielles, créées dans le but évident de plaire au lecteur, sans jamais l’incommoder le moins du monde ; des formes (le plus souvent romanesques) caractérisées par l’absence de complexité formelle et structurelle, un contenu léger et inconsistant, aussi facile à digérer qu’à oublier (les paroles de Tabarovsky parlent également de cela). Un produit consommable et jetable après lecture en somme. Voilà donc ce qu’est devenue une grande partie de la littérature publiée de nos jours, une littérature soumise aux aléas et aux intérêts du marché. Le capitalisme contemporain réduit ainsi la littérature à une marchandise dotée d’une certaine valeur d’échange, un produit périssable à consommer de préférence avant sa date de péremption ; un capitalisme qui, aujourd’hui, n’a d’intérêt que pour une littérature capable de fonctionner comme un objet commercial. La recherche de la postérité est remplacée, dans la littérature de consommation, par l’obsolescence programmée de textes qui sont digérés et évacués à la vitesse à laquelle sont consommés toutes sortes de gadgets et de produits commerciaux.
C’est pourquoi, compte tenu de cette situation de précarité idéologique et de déficit théorique dans laquelle nous nous trouvons, il est impératif de travailler – si l’on veut comprendre notre époque et la place qu’y occupe la littérature – à l’élaboration d’une réponse théorique nouvelle en commençant, ainsi que le suggérait Frédéric Jameson10, par questionner notre compréhension même du fait moderne dans toutes ses acceptions philosophiques et esthétiques (et, partant, des grands principes de la théorie postmoderne), au risque de devoir affronter la question de la perte du sens. Or, la littérature étant justement le lieu de la mise en jeu du sens (dixit Derrida), elle se révèle être aussi le lieu idéal pour mesurer les conséquences d’un tel déplacement. Il s’agit ainsi de faire reculer le territoire des certitudes établies, d’effectuer un travail salutaire d’oxygénation. Bien entendu, une pratique littéraire ainsi comprise ne connaît ni le produit garanti, ni l’achat assuré ; elle se développe sur un territoire incertain qui ne connaît ni paradigmes ni valeurs sûres ; elle n’a pas de public pré-assigné et captif, et son véritable destinataire est le langage, la scène où se déroule la mère de toutes les batailles.
L’enjeu est le type de monde où nous voulons vivre, et, en ce sens, il est nécessaire de modifier en profondeur les principes qui fondent nos systèmes de valeurs, une démarche consistant à repenser entièrement nos manières d’être et de connaître : « para a teoría crítica pós-moderna peto contrario todo o conhecimento crítico tem de començar pela crítica de conhecimento »11, écrit ainsi le sociologue Boaventura de Sousa Santos pour qui un tel renversement épistémologique aurait nécessairement des conséquences politiques immédiates puisqu’il impliquerait la substitution d’un type de connaissance régulateur par un type de connaissance émancipateur. Le premier, qui ne cherche qu’à domestiquer le chaos et à le transformer en ordre, s’opposerait ainsi à un mode de connaissance émancipateur tendu, pour le sociologue, vers la critique et le dépassement du modèle colonial, contestant les concepts d’autorité et de hiérarchie pour leur préférer celui de solidarité interculturelle. Ethique et conscience de soi radicale, telles sont alors les valeurs d’une écriture littéraire émergeant comme une activité de témoignage face à un système social aliénant et dévastateur, une tâche mue par un objectif que l’écrivain serbe Danilo Kis considérait comme imprescriptible12 : sauver tout ce qui est menacé de disparition. Ainsi, l’incertitude, l’insécurité, l’instabilité, le scepticisme et l’ambiguïté sont-elles des caractéristiques inhérentes à une littérature qui tente d’échapper au dogmatisme et au grégarisme, les deux traits dominants de cette mer d’huile où disparaît tout élément critique dans la pratique littéraire : « La littérature est le langage qui se fait ambiguïté »13, écrivait Blanchot, et c’est dans l’ambiguïté que réside aussi le risque de la perte de sens, qui est aussi une forme de gain.
L’expérience littéraire pourrait ainsi consister en l’acceptation d’une contingence, en la possibilité d’ouvrir un intervalle par lequel le monde réel pourrait être subverti et un horizon utopique entrevu, redoubler la réalité initiale en une réalité imaginaire qui ne se laisserait jamais prendre, dont le visage disparaitrait sitôt qu’on l’apercevrait et dont la parole ne serait rien d’autre que l’annonce d’une ouverture : l’expérience de la littérature contemporaine est largement une expérience de la marge et du bannissement permanent, du dépouillement et de l’éloignement du centre ; il n’y a probablement pas d’autre activité aussi consciente de la perte que la pratique de la littérature, une pratique qui, dans la création de ses propres images, porte les stigmates de sa propre destruction, le signe indubitable de sa disparition imminente, une pratique dans laquelle une voix se fait entendre pour proférer et fixer une parole errante au plus profond de l’absence. À la lumière des idées et des concepts articulés par Jean-Luc Nancy (la communauté inactive ou inopérante), Maurice Blanchot (la communauté inavouable) et Cornelius Castoriadis (la communauté imaginaire), Damián Tabarovsky propose ainsi de considérer l’incapacité d’une certaine littérature à se transformer en marchandise (comme l’exige le marché) ou en œuvre d’art (comme en rêve l’Académie) : « Appartenir à la littérature de la communauté inopérante, c’est intégrer la communauté de ceux qui n’ont pas de communauté »14. Littérature : communauté sans territoire.
Telle pourrait être la voie d’une littérature qui verrait, dans les pratiques artistiques contemporaines, non pas tant des modèles de référence que des occasions d’exercer la critique et la résistance face à tout système fondé sur la neutralisation des différences. Car la littérature continue d’être, en ces temps de difficultés sociales et de réaction idéologique, un bastion contre la standardisation, la simplification et l’homogénéisation dominantes, un lieu idéal pour comprendre que l’existence n’est que complexité et dynamisme et que la connaissance –comme le défendait le Socrate platonicien de la République – est toujours imparfaite, incertaine, inachevée, en construction permanente, non pas un fait, mais quelque chose en train de se faire. Cette idée d’imperfection était d’ailleurs pour le poète argentin Roberto Juarroz consubstantielle à la poésie, qu’il considérait comme l’art de l’impossible, la recherche permanente de l’autre côté du monde : « Peut-être nous faudrait-il apprendre que l’imparfait / est une autre forme de la perfection : / la forme que la perfection assume / pour pouvoir être aimée »15. Une imperfection qui ne doit pas être vue comme un défaut ou un manque, mais comme une multitude de possibilités, comme le fameux jardin aux sentiers qui bifurquent de Borges, ou le poème aux innombrables variations imaginé par Paul Valéry.
La littérature – à partir des catégories qui lui sont consubstantielles, comme le perspectivisme, la polyphonie, la polysémie, les significations multiples – n’a eu de cesse d’imaginer des univers complexes et changeants, où s’expriment aussi les conflits et les contradictions qui caractérisent la vie culturelle et spirituelle des êtres humains. Je pense ici, bien sûr, à un certain type de littérature, à des textes et des auteurs qui ont fait du langage littéraire non pas tant un outil de représentation qu’un outil de réflexion, de critique et de transformation du monde. Pour reprendre les mots de Blanchot : « Elle [la littérature] dit : Je ne représente plus, je suis ; je ne signifie pas, je présente »16. Et le fait est que la littérature, n’étant le langage de personne, nous convie dans cet espace vide où elle se prend le plus souvent elle-même pour objet, et nous nous retrouvons ainsi face à une pratique littéraire tantôt incapable de suivre le rythme des avancées technologiques, déconnectée du monde et obsédée par un retour incessant à ses propres affaires, tantôt convertie en une marchandise commerciale soumise aux intérêts économiques de l’industrie culturelle.
Quoi qu’il en soit, une façon de clore ce texte pourrait être de revenir au début et de reconnaître que, comme l’affirmait l’Hippias platonicien, le beau est difficile. Remplaçons alors le beau par le poétique et nous pourrons probablement conserver le sens de cette affirmation : le poétique est difficile, difficile à exercer et difficile à maîtriser, surtout dans un environnement comme le nôtre, caractérisé par une réalité dont nous sommes bien incapables de délimiter précisément les contours, ou de spécifier de quelle substance ou de quel matériau elle est faite.
Tout au long de cette exposition, j’ai également voulu attirer l’attention sur l’importance d’une « poésie de la pensée », pour reprendre une expression souvent utilisée par le poète argentin Roberto Juarroz dans son œuvre, et cela avec la conviction que c’est bien là, dans la pensée, que jaillit la vie avec le plus d’intensité, pour une poésie dans laquelle la pensée soit un élément déterminant de ce processus nécessaire de dés-automatisation des savoirs et des valeurs17 que j’ai évoqué préalablement. Cependant, cette défense d’une « poésie de la pensée » n’est pas incompatible avec la reconnaissance d’une écriture poétique désancrée de la réalité des choses, une écriture qui renonce à nommer ou représenter, une écriture qui soit l’expression la plus intense d’un langage qui veut être, et se suffire à lui-même, sans propriété ni objectif, une parole lestée du poids de la perte et de sa non-appartenance au monde :
En cette parole, nous ne sommes plus renvoyés au monde, ni au monde comme abri, ni au monde comme but. En elle, le monde recule et les buts ont cessé; en elle, le monde se tait; les êtres en leurs préocupations, leurs desseins, leur activité, ne sont plus finalement ce qui parle. Dans la parole poétique s´exprime ce fait que les êtres se taisent. Mais comment cela arrive-t-il? Les êtres se taisent, mais c’est alors l´être qui tend à redevenir parole et la parole veut être. La parole poétique n´est plus parole d´une personne: en elle, personne ne parle et ce qui parle n’est personne, mais il semble que la parole seule se parle.18
Alors, où se situe la limite de l’écriture poétique et, dans ces circonstances qui sont les nôtres, la poésie est-elle capable de construire une pensée utopique ? Oui, dans la mesure où une certaine poésie est, par définition, utopique, qu’elle n’a pas de lieu, ou, en d’autres termes, qu’elle peut advenir n’importe où, le lieu de la parole poétique étant, comme nous l’ont appris certains auteurs du poststructuralisme français, un non-lieu, un lieu sans ancrage. Mais cette tâche (utopique) de la poésie ne pourra s’accomplir qu’en recourant à l’imagination, cette faculté qui nous permet, pour Stevens Wallace, « to perceive the normal in the abnormal, the opposite of chaos in chaos »19. Encore une fois, la poésie est-elle capable de construire une pensée utopique ? Oui, dans la mesure où elle ouvre la porte à un autre espace et à une autre temporalité, un dehors ingouvernable et insoumis. Poésie exposée aux intempéries et aux menaces d’un dehors qui attente à notre propre imaginaire ; poésie appelée à fleurir sur un désert de silence et de solitude glacée. Comme le souligne Blanchot à la fin de L’espace littéraire : « le poème est la pauvreté de la solitude »20, une pauvreté qui est ici l’image d’un fruit et non le signe d’un manque, une solitude détachée de la solitude même qui l’a engendrée.
Comme le souligne Bachelard : « Tout pays inconnu n’est évoqué, dans sa réalité même, que par les forces de l’imaginaire »21[21]. Mais quelles sont ces forces ? Celles, selon nous, permettant de veiller les disparus, mettre au jour ce qui est dissimulé, rendre visible le caché, subvertir l’ordre établi en travaillant à éroder ses fondements, tels devraient être les objectifs d’une poésie qui concentrerait ses forces sur la nécessité de donner la parole aux morts. Il y a un instant, j’ai rappelé les considérations de Juarroz à propos de ce qu’il appelait « la poésie de la pensée », où la pensée a aussi beaucoup à voir avec la consolation et le salut, de telle sorte que l’écriture d’un poème pouvait, pour Juarroz, devenir un geste de solidarité et de fraternité, un acte, en somme, d’amour. Dans le poème « 9 » de Poesía vertical, premier recueil de poèmes (publié en 1958) d’une longue suite de recueils qui porteront toujours ce même titre, nous pouvons lire :
Je pense qu’en ce moment
personne peut-être ne pense à moi dans l’univers,
que moi seul je me pense,
et si maintenant je mourrais,
personne, ni moi, ne me penserait.
Et ici commence l’abime,
comme lorsque je m’endors.
Je suis mon propre soutien et me l’ôte.
Je contribue à tapisser l’absence toute choses.
C’est pour cela peut-être
que penser à un homme
revient à le sauver.22
Oui, « penser à un homme », c’est comme le soutenir pour l’empêcher de tomber au fond de l’abîme. Cet acte de penser (ou cette « poésie de la pensée ») est comme une bougie qui refuse de s’éteindre et de mourir, il nous rappelle que rien, aussi bien enfoui soit-il, ne sera complètement mort si nous en faisons la matière de notre conscience, et partant de notre vie elle-même.
Heidegger parlait à cet égard d’un travail de la pensée qui aurait comme objectif la contingence d’un mouvement vers un avenir possible, un travail dans lequel la poésie devait être d’un grand secours. Le poète Paul Celan aura lui aussi entrevu cette possibilité et concevra, dans une large mesure, sa poésie comme une conversation imaginaire avec l’auteur d’Être et Temps, dont la pensée était elle-même en dialogue constant avec la poésie de Hölderlin23. « À quoi bon des poètes en temps de détresse », se demandait déjà Friedrich Hölderlin dans ses Elégies. Pour l’espoir – même si ce mot lui-même est un trésor fragile et si rare – de voir émerger dans les paroles du poète la possibilité d’un monde meilleur.
Tout cela nous conduit à nouveau à l’idée selon laquelle la poésie émerge là où le langage se retire et retourne à ce lieu originel gardé par le silence, ce lieu qui laisse place à la suspension de la parole, mais aussi à une quête éperdue d’une parole poétique qui creuse cette faille immense où s’abîme la pensée elle-même : « Le poète cultive les fissures »24, écrivait aussi Juarroz. La poésie est comme ce voyageur qui n’arrive jamais, toujours en mouvement et aux aguets, un voyageur que l’on attend tout en sachant qu’il ne se présentera jamais, toujours en approche et repartant sans jamais être arrivé à destination. Un voyageur qui n’est jamais aussi réel que dans cette attente qui donne sa forme au désir et à l’absence.
Mais qu’est-ce que la poésie ? Qu’est-ce qu’elle dit et qu’est-ce qu’elle ne dit pas ? Qu’est-ce qu’elle (dé)fait ? Qu’est-ce qui disparaît quand elle apparaît ? Qu’est-ce qui se produit quand elle fait sentir sa présence ? Comment se constitue-t-elle, et que reste-t-il quand elle se retire ? Blanchot, Foucault, Derrida, parmi d’autres, nous ont déjà mis en garde contre l’illusion de croire que nous pourrions apporter une réponse ferme et définitive à de telles interrogations qui sont sans doute condamnées à errer sur une mer où le sens fait naufrage et où l’énigme du sens persiste. Une réponse juste, honnête et authentique ne peut que se replier sur la question elle-même, pour Blanchot, et en prolonger indéfiniment l’interrogation à jamais sans réponse : « Elle peut se refermer sur celle-ci, mais pour la préserver en la gardant ouverte »25. Une réponse qui s’enroule en quelque sorte autour de la question elle-même pour la maintenir dans son ouverture, pour éviter qu’elle ne retombe. Extraterritorialité, en-dehors, dissémination, exil, tels sont les signes indiquant le sens de cette quête.
Références bibliographiques
- Aparicio Maydeu, J., 2015, La imaginación en la jaula. Razones y estrategias de la creación coartada, Madrid, Cátedra.
- Bachelard, G., 1970, Le droit de rêver, Paris, PUF, coll. “A la pensée”.
- Blanchot, M., 1968, L´espace littéraire, París: Gallimard.
- Blanchot, M., 1981, De Kafka à Kafka, París, Gallimard.
- Bordelois, I., 2005, La palabra amenazada, Buenos Aires, Libros del Zorzal.
- De Sousa Santos, B., 2001, Para um novo censo comum: a ciencia, o direito e a política na transição paradigmática, São Paolo, Cortez Editora (rééd. 2009).
- Eagleton, T., 2003, After Theory, New York, Basic Books.
- Jameson, F., 2002, A Singular Modernity. Essay on the Ontology of the Present, London/New York, Verso.
- Juarroz, R., 1987, Poésie et réalité (trad. Jean-Claude Masson), Ed. Lettres Vives, 1987.
- Juarroz, R., 1989, Poésie Verticale, (trad. Roger Munier), Paris, Fayard.
- Juarroz, R., 2000, Poesía y Realidad, Valencia, Pre-Textos.
- Juarroz, R., 2005, Poesía vertical I, Buenos Aires, Emecé.
- Kis, D., 1993a, Un tombeau pour Boris Davidovich, Paris, Gallimard.
- Kis, D., 1993b, La leçon d’anatomie, Paris, Fayard.
- Lacoue-Labarthe, P., 1986, La poésie comme expérience, Paris, Christian Bourgois Éditeur (rééd. 2004).
- Marx, K., 1974, Théories sur la plus-value [1861-1863], Tome I, Éditions sociales,
- Meschonnic, H., 2017, Pour sortir du postmoderne, Paris, Klincksieck.
- Saldaña, A., 2004, « Posmodernidad, historia, literatura », dans Romero Tobar, L. (éd.), Historia literaria/Historia de la literatura, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.
- Saldaña, A., 2013, La huella en el margen. Literatura y pensamiento crítico, Zaragoza, Mira Editores.
- Saldaña, A., 2017, « ¿Cabe algún tipo de literatura política entre las literaturas de consumo? », dans Alburquerque-García, L., García Barrientos, J.L., et Álvarez Escudero, R. (éd.), Escritura y teoría en la actualidad, Madrid, CSIC.
- Saldaña, A., 2018, La práctica de la teoría. Elementos para una crítica de la cultura contemporánea, Santiago de Chile / Barcelona, RiL Editores.
- Wallace, S., 1942, The necessary ángel. Essays on reality and the imagination, New York, Alfred. A. Knopf, (rééd. 1952).
- Tabarovsky, D., 2010, Literatura de izquierda, Cáceres, Editorial Periférica.
Notes
- Eagleton, 2003, p. 2.
- Bordelois, 2005, p. 28. Nous traduisons.
- Meschonnic, 2017, p. 12.
- Saldaña, 2004, p. 87-98.
- Tabarovsky, 2010, p. 14. Nous traduisons.
- Aparicio Maydeu, 2015.
- Marx, 1974, p. 167-168.
- Tabarovsky, 2010, p. 64. Nous traduisons.
- Saldaña, 2017, p. 81-89.
- Jameson, 2002.
- De Sousa Santos, 2001 [2009].
- Cf. Danilo Kis, Un tombeau pour Boris Davidovich (1979) ; ou La leçon d’anatomie (1993).
- Blanchot, 1981, p. 57.
- Tabarovsky, 2010, p. 27.
- Juarroz, 1989, p. 84.
- Blanchot, 1981, p. 43.
- Cf. Saldaña, 2013, et 2018.
- Blanchot, 1968, p. 38.
- Wallace, 1942 (1951), p. 153.
- Blanchot, 1968, p. 338.
- Bachelard, 1970, p. 113.
- Juarroz, Poésie verticale, 1989, p. 12.
- Lacoue-Labarthe, 1986 (2004).
- Juarroz, 1987, p. 22.
- Blanchot, 1968, p. 281.