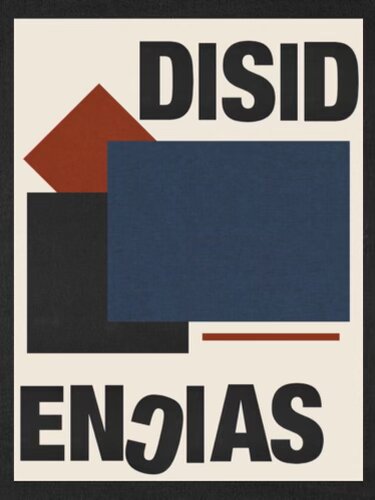Faire taire la différence. Prélude grec
Faire taire la différence. Prélude grec
[…] no pasa un día sin que me pregunte cuándo volverá el futuro.
Martín Caparrós, El hambre1
Si le monde a à être transformé c’est parce qu’il se transforme déjà. Il y a dans le présent quelque chose qui annonce,
qui anticipe et appelle le futur. L’humanité n’est pas ce qu’elle a l’air d’être,
ce qu’une bonne enquête psycho-sociale pourrait photographier
(et c’est pourquoi ce genre d’enquête de photographie est toujours infiniment décevant par la pauvreté des clichés produits),
l’humanité est aussi ce qu’elle n’est pas encore, ce qu’elle cherche, confusément, à être.
Jean-François Lyotard, Pourquoi philosopher ?2
Dans le cadre du colloque international « Créer le présent, imaginer le futur… » qui s’est tenu à l’Université de Pau du 28 février au 3 mars 2022, nous avons eu l’honneur de recevoir l’écrivain (journaliste, cronista et essayiste) argentin Martín Caparrós pour une rencontre exceptionnelle. Martín venait alors tout juste de publier son extraordinaire « Ñamérica » (2021), qui fut le prétexte d’une longue conversation destinée à présenter (et explorer) l’une des œuvres les plus importantes de la littérature de langue hispanique (et ñamériquaine) de ces trente dernières années.
Nous reproduisons ici une version (révisée et augmentée pour l’occasion) du texte de présentation qui servit de préambule à cette rencontre. Nous remercions du fond du cœur Martín Caparrós pour sa participation, pour sa gentillesse, pour ses livres, et cette obstination singulière des grands écrivains à « transmettre au langage la passion de ce qui est à venir »3.
Te présenter (et te remercier), cher Martin, n’est pas chose si facile, au regard de l’extraordinaire amplitude et diversité de ton œuvre (composée d’une trentaine d’ouvrage parmi lesquels, des romans, des chroniques littéraires, des essais, des chroniques-essais d’un genre nouveau4), mais peut-être pourrais-je me risquer à le faire en partant de ces « raisons d’écrire » dont parlait Francis Ponge dans Proêmes, de ce qui pousse à choisir d’écrire plutôt que de se taire, de devenir poète (ou écrivain·e) plutôt que policier ou pompier…
Des « raisons d’écrire » qu’il faut rechercher au plus profond de soi (dans le rapport à soi et au monde) et obéissent toujours à une sorte de « nécessité intérieure »5, pour le philosophe Paul Audi (reprenant les mots de Kandinsky) : autant de raisons impérieuses qui, une fois conçues, deviennent « absolument déterminantes et comminatoires »6, disait aussi Ponge.
« Notre premier mobile fut sans doute le dégoût de ce qu’on nous oblige à penser et à dire »7, écrivait Ponge dans sa propre auto-analyse (« Des raisons d’écrire ») où cette « nécessité intérieure » dont parle Audi – cette « rage froide de l’expression »8 qui liait intimement l’activité critique et créatrice9 –, déterminait aussi une poétique (une po/éthique) que le poète résumait alors en ces termes : « parler contre les paroles », contre l’ordre social qu’elles font consister autour de nous (et à l’intérieur de nous-mêmes, insiste le poète), contre « l’ordre de choses honteux […] [qui] crève les yeux et défonce les oreilles »10… Un mot d’ordre (poétique) qui faisait bien sûr du langage (des paroles, disait Ponge) le lieu de notre asservissement (individuel et/ou collectif), mais aussi l’instrument par excellence de notre libération, au prix d’une traversée longue, et parfois douloureuse, contre le pouvoir qui est dans la langue, comme disait Barthes ; contre ce « chant dominateur »11 silencieux qu’évoque aussi Patrick Chamoiseau dans son puissant essai pour une pensée marronne, celui qui « te déforme l’esprit jusqu’à faire de toi-même ton geôlier attitré »12…
« Écrire contre le langage »13, comme disait aussi Duras : contre toute forme de servitude, contre l’uniformisation, l’assignation au lieu commun, la fossilisation des significations, contre la pourriture qui est dans la langue.
Ou encore : écrire vraiment, c’est-à-dire, risquer une parole, avec la conviction que le monde, comme l’écrit Eugenia Almeida à propos de la langue, « n’est jamais qu’un accord, une convention, quelque chose qui peut toujours être reformulé à nouveau ».14
Des raisons d’écrire – un véritable crédo révolutionnaire – dont j’aime à penser qu’elles sont aussi au principe de ton travail d’écrivain (et de journaliste), à moins que ce ne soit la lecture de tes livres qui nous y ramène, ou plutôt qui les (re)crée (comme aurait dit Borges) en donnant à cette « rage […] de l’expression » théorisée par Ponge dans les années 1930 une vigueur nouvelle, en en faisant une sorte de théorème de la résistance pour ces temps obscurs…
Ce présent souvent si désespérant que tu racontes aussi dans « Ñamérica », ce fabuleux essai-chronique consacré au sous-continent latino-américain, rebaptisé dans ton livre « Ñamérique ». Cette « terre de mythes à foison »15 longtemps prisonnière du regard – et du désir – d’un autre : trouver le Paradis Terrestre, faire advenir le « Nouveau Monde » rêvé par les colons européens… Chaque fois (ou presque) l’illusion s’était fracassée contre la réalité, expliques-tu dans ton livre ; chaque fois l’on se rendait compte que tout cela n’était qu’un rêve (l’Eldorado, le « bon sauvage », la République, la démocratie, etc.) ou que « le paradis était devenu un enfer »16, comme l’écrirait Rodrigo Fresán à propos de la grande vague néolibérale qui allait plonger le sous-continent dans la misère au tournant des années 1990. Un cauchemar qui était en quelque sorte le revers cynique (et dramatique) de l’utopie des mouvements de gauche révolutionnaire qui avaient essaimé dans les années 1960-70, et dont il ne restait plus rien…
Dans ce livre, c’est ce désespoir que tu prends à bras le corps, et le sentiment de résignation qui semble s’être emparé de tous les esprits en Ñamérique (et ailleurs) face à ce cauchemar qui n’en finit pas – pour reprendre le titre de l’un des ouvrages de Pierre Dardot et Christian Laval17 –, ou plutôt « l’abandon de l’illusion de construire des sociétés vraiment différentes » – écris-tu – réellement égalitaires, humaines, profondes.
La tristesse de la résignation. Quand avons-nous accepté l’idée que ça ne changera plus […]que la laideur de tant d’injustices ne nous dérange pas tant que ça, que nous savons vivre avec la misère de millions d’autres […]. Comment avons-nous appris à nous dire que les choses sont ainsi et qu’on n’y peut rien, qu’il n’y a aucun moyen de les changer : qu’ainsi va le monde et qu’il en sera toujours ainsi ?18
Raconter cette perte, les trahisons, les défaites, les répressions épouvantables où conduisirent les promesses les plus belles et regarder en face « les blessures béantes, sanglantes, purulentes [qui] qui recouvrent aujourd’hui de leurs odeurs putrides tout espoir d’un arôme nouveau »19, c’est sans doute l’un des enjeux narratifs les plus puissants (et les plus périlleux) de « Ñamérica » : un livre qui témoigne, ô combien (à l’instar de La faim, le premier essai-chronique de cette nature publié en 2014), de ces « raisons d’écrire » que j’évoquais plus haut (et d’une singulière « éthique de la forme »20, comme disait Piglia), et peut se lire aussi comme une manière de transformer la mélancolie en or, pourrait-on dire, ou de faire de la mélancolie (et de la douleur de la perte) une raison de vivre, d’écrire et d’espérer…
Un véritable écrivain n’a d’autre patrie que sa loyauté et son courage, disait en substance Roberto Bolaño (dans son fameux discours de réception du prix Rómulo Gallegos de littérature), qui invitait à sa manière à mesurer la valeur d’une œuvre (ou d’un écrivain) à sa façon de se tenir ou de se dresser dans l’existence, de « s’expliquer avec la vie »21, comme dit aussi le philosophe Audi, de conjurer le désespoir…
« Ñamérica » est ainsi un ouvrage hybride, irréductible aux classifications génériques standard ; un ouvrage construit pour faire cohabiter et mettre en tension le travail de la pensée et l’invention de l’écriture, selon un dispositif narratif (très élaboré) alternant (ou mêlant) l’enquête rigoureuse (l’effort de pensée théorique, philosophique, historique, sociologique, etc.) et la chronique littéraire : ce récit à la première personne dans lequel l’auteur, le narrateur et le chroniqueur (journaliste) ne font qu’un pour tenter d’appréhender, au plus près – au plus proche de soi-même –, ce présent toujours insaisissable, complexe, fuyant, désespérant…
Une expérience d’écriture parfois extrême où celui qui raconte s’immerge au cœur d’une réalité le plus souvent lointaine, meurtrie, cet « AutreMonde » – ainsi que tu l’appelles – absent du flux des petits et grands récits qui saturent l’espace médiatique contemporain ; une réalité que nos mots et nos concepts ont, comme tu le rappelles aussi dans La Faim, le fabuleux pouvoir de faire disparaître, invisibiliser, neutraliser, adoucir, rendre (presque) supportable… Ce « grand édifice des concepts » dont parlait déjà Nietzsche, et cette humaine capacité d’oubli et de dissimulation qu’il s’agit aussi, dans tes livres, de combattre dans et par l’écriture : cet étrange « entêtement de pratique »22 (cette « bêtise obstinée »23, pour le poète Christian Prigent) qu’il fallait toujours considérer, pour Barthes, comme un combat singulier et « assez solitaire contre la servilité de la langue »24 et les fabulations de l’idéologie dominante…
À cet égard, il me semble que La faim (l’essai-chronique consacré à cette réalité presque disparue de nos imaginaires politiques) qui inaugure ce singulier dispositif narratif de mise en tension de la pensée théorique et de l’écriture (au sens poétique, ou po/éthique, du terme), est aussi le lieu d’une confrontation brutale avec le socle des utopies émancipatrices de la gauche (cet humanisme des Lumières qui s’était donné pour fin idéale « une communauté de citoyens égaux »25, comme le rappelait Lyotard), mais aussi avec toute une littérature ivre d’elle-même et de ses supposés pouvoirs…
« Volveremos » (« nous reviendrons »), c’est le mot qui ponctue le chapitre de « Ñamérica » consacré aux inégalités dans l’Amérique Latine d’aujourd’hui (« Le continent déchiré ») ; un verbe au futur qui ne cesse pourtant de se conjuguer au passé, pour dire la promesse non tenue, et nous presser d’en imaginer de nouvelles : ne pas s’en tenir au possible (« qui est l’horizon de la pensée managériale »26, rappelait Jean-Luc Nancy), et retrouver la foi en notre commune capacité à construire ce « nouveau paradigme de l’impensable »27, comme tu l’écris aussi dans La Faim.
Car écrire contre, c’est toujours aussi, dans tes livres, écrire pour, et tout d’abord, peut-être, réinventer dans l’écriture les mille et une manières de ne plus « manquer au monde »28, comme dit joliment le poète-philosophe Jean-Claude Pinson, à son devoir de « seconder le monde »29, selon la formule de Kafka.
Ou encore : faire de l’écriture une forme de vie et un exercice (spirituel) susceptible d’ouvrir à une perception plus intense du réel. Cette « vigilance » qui devait, pour Pierre Pachet, rendre sensible à la solitude de l’écriture et sa puissance d’arrachement du présent, nous rendre plus attentifs « à la consistance [et la complexité] des présents »30, moins raisonneurs, moins prisonniers de la dialectique ou de l’idéologie…
Une aventure qui commence peut-être un peu par hasard (enfin si l’on croit au hasard) à la fin des années 1980 en Argentine, dans le cadre de ton travail de journaliste (au sein du journal « Página 12 », dont tu es l’un des co-fondateurs), puis dans ton premier livre de chroniques, Larga Distancia, publié à Buenos Aires en 1992 ; un ouvrage qui réunit des textes d’un genre nouveau – que l’on n’appelle pas encore, en Argentine, des « chroniques », expliques-tu –, de longs récits de voyage plus ou moins lointains (la Bolivie, le Pérou, Hong Kong, Moscou…) où celui qui raconte accepte de « se laisser envelopper par l’incompréhensible »31, écris-tu alors, de ressentir l’absolue étrangeté, de jouer à être un autre…
Des textes où « l’écrivain solitaire, célibataire et nomade » (pour reprendre la belle expression du photographe Raymond Depardon32) se laisse doucement porter tout en recherchant déjà, écris-tu alors, à « occuper [cet] endroit sans espace »33, aux confins du journalisme et de la littérature : dans ces « chroniques [littéraires] » où celui qui raconte se donne aussi pour tâche de mettre à l’épreuve sa capacité à regarder, et penser le rapport à ce qui est autre : « organiser une petite fête de la solitude humaine »34, ainsi que l’écrivait Pierre Pachet dans Le voyageur d’Occident – l’émouvant récit de son premier voyage en Pologne en 1980 –, se débattre avec les vieilles questions, échapper aux influences : « voyons voir, toi que voici et tel que voici, es-tu capable de penser quelque chose, d’opiner sérieusement ; ou bien ne peux-tu que répéter des opinions entendues ? avec tes moyens du bord, as-tu quelque pouvoir de considérer, d’orienter […] Juste là en passant ? »35.
« L’apogée d’un genre »36, écrira Tomás Eloy Martínez au moment de la publication de Larga distancia, soulignant (de manière si borgésienne) que ce livre permettait de redécouvrir l’importance du genre de la chronique dans l’histoire de la littérature argentine, modifiait en profondeur notre compréhension de ce genre insaisissable, et en redéfinissait puissamment les contours…
Des textes où s’affirmait déjà la volonté de construire un regard voyageur volontiers versatile et partial, aux antipodes de la neutralité supposée du journaliste-reporter37. Un premier pas décisif, peut-être, vers l’invention – ou la configuration – de cette voix narrative singulière qui porte tes chroniques : ce « sujet qui regarde et raconte »38, insistes-tu souvent, pour souligner l’importance d’opposer au langage uniformisant – prétendument neutre – et abrutissant de « la Machine-Journalisme »39 un regard délibérément partial (et passionné) où se joue aussi, contre la dissolution du sujet moderne (et/ou sa survalorisation sociale, à l’ère néolibérale), la construction d’une subjectivité critique (indocile et réfléchie) à l’épreuve des balles.
Un narrateur-chroniqueur qui me ressemble, expliques-tu en substance dans Lacrónica, mais qui est n’est pas tout à fait moi, prends-tu toujours le soin de préciser, comme pour réaffirmer une vérité entêtante et peu glorieuse (« je est un autre », comme on sait) qui complique un peu la tâche, mais te permet aussi de faire de ce « je » multiple et fragmenté, un narrateur (chroniqueur) toujours sur le fil, « avançant dans les airs/ pieds nus/ sur un fil/ de fer »40, comme l’écrivain-équilibriste du roman de Piglia, un narrateur fragile, inquiet, toujours aux aguets…
Dès lors, raconter, dans tes chroniques, témoignera toujours d’un effort intense pour s’arracher au flot des images et des arguments économico-politiques saturant l’atmosphère, aux « systèmes d’évidences »41 qui nous paralysent ; un effort – ou plutôt une « vigilance », pour reprendre les mots de Pachet –, que tu présentes aussi comme une « obligation morale » pour interrompre et fracturer « le flux inlassable des énoncés hégémoniques »42, comme dit aussi Sandra Lucbert, où tournent en boucle les mêmes images, les mêmes paroles, les mêmes histoires imposant (per saecula saeculorum) la vérité d’un monde et l’hégémonie d’un ordre social.
Et si l’on acceptait de se demander un peu plus souvent pourquoi (ou pour qui) nous écrivons, pourquoi décidons-nous d’écrire sur ceci plutôt que sur cela, de raconter telle histoire plutôt que telle autre – écrivais-tu dans un article récent43 – ? Et si tant de paresse et d’incurie était aussi, tout simplement, le signe que nous n’y croyons plus, que nous avons abandonné la partie ?
Choisir, dans tes chroniques, de porter précisément le regard sur ce qui n’intéresse personne – les endroits reculés de « l’AutreMonde », « les étouffés, les écrasés, les carbonisés, les crevés »44, comme disait Elias Canetti –, est assurément une manière d’écrire contre et d’affronter le vide d’une langue commune ravagée par la razzia libérale et les pilleurs de sens qu’évoquait le poète Jean-Christophe Bailly dans sa critique du « capitalisme libéral triomphant »45 au tournant des années 1990.
Mais c’est aussi une manière de ne pas se dérober à ce qui s’impose comme aurait dit J.-L. Nancy, et de réaffirmer, contre les faussaires du sens, « l’idée délirante qu’on peut changer le monde »46 …
« Ce soir, je crois en la terrible immortalité »47, écrivait Borges dans l’un de ses poèmes (« Insomnio », 1936), aucun homme, aucune femme ne peut s’endormir et les morts eux-mêmes sont condamnés à une veille éternelle…
Dans la nuit ñamériquaine, dans la nuit de nous tous, ceux qui dorment et ceux qui ne peuvent pas dormir…
Il n’y a rien que je déteste davantage, rien que j’affectionne davantage, que la sensation de me retrouver pris dans le réseau d’une toile, dans l’entrelacs subtil d’un pluriel : dans un certain « nous ». Nous, nous sommes aujourd’hui les passagers patients, pauvres, entassés et pas très propres du Deus E Fiel. Nous, nous sommes une foule de mamans, d’enfants et d’hommes, tous allongés dans des hamacs : et voyager, pour nous, ça veut dire ici s’allonger, et laisser le monde passer.48
C’est par cette subtile entrée en matière que commence le récit de la traversée du fleuve Amazone dans Contra el cambio (2010).Doucement bercé par le va-et-vient régulier et serein du hamac, le voyageur (narrateur-chroniqueur) est celui qui regarde, qui attend, qui espère… Posé sur ce point d’équilibre et de partage fragile et toujours instable entre soi et le monde, comme s’il guettait l’apparition d’un « nous » que seule l’écriture a peut-être encore quelque chance de faire advenir…
Une personne, plus une autre, plus une autre…
L’on verrait alors que l’écriture a ouvert un intervalle par où la vie déferle, illuminée d’éclairs soudains et imprévisibles, et qu’elle peut encore, comme le dit Yannick Haennel, « produire des effets sur l’indifférence connectée du monde »49.
Une personne, plus une autre, plus une autre…
Références bibliographiques
- Almeida, E., 2019, Inundación, Córdoba, Ediciones Document A/Escénicas.
- Audi, P., 2005, Créer. Introduction à l’esth/éthique, Paris, Verdier (rééd. 2010).
- Audi, P., 2007, Supériorité de l’éthique, Paris, Champs Flammarion.
- Bailly, J.-C., 2024, Temps réel, Paris, Seuil, col. « Fiction & Cie ».
- Barthes, R., 1978, Leçon, Paris, Seuil.
- Barthes, R., 2002, Le Neutre. Cours au collège de France (1977-1978), Paris, Seuil, coll. « IMEC ».
- Borges, J.-L., 1989, Obras Completas II, Barcelona, Emecé.
- Caparrós, M., 1992, Larga distancia, Buenos Aires, Planeta, “Biblioteca del sur”.
- Caparrós, M., 2010, Contra el cambio, Barcelona, Anagrama.
- Caparrós, M., 2014, El hambre. Un recorrido por el Otro Mundo, Barcelona, Random House, “Biblioteca Martín Caparrós” (rééd. 2021).
- Caparrós, M., 2015, La Faim (trad. Alejandra Carrasco), Paris, Buchet-Castel.
- Caparrós, M., 2016, Lacrónica, Buenos Aires, Planeta.
- Caparrós, M., 2021a, Ñamérica, Barcelona, Random House, “Biblioteca Martín Caparrós”.
- Caparrós, M., 2021b, « Bajo el volcán », El Diario, 21-10-2021.
- Caparrós, M., 2023, Ñamérique (trad. Robert Amutio), Paris, Gallimard.
- Canetti, E., 1978, Le territoire de l’homme, Paris, Albin Michel.
- Chamoiseau, P., 1997, Écrire en pays dominé, Paris, Gallimard.
- Dardot, P. et Laval, C., 2016, Ce cauchemar qui n’en finit pas. Comment le néolibéralisme défait la démocratie, Paris, La Découverte.
- Deleuze, G. et Guattari, F., 1993, Qu’est-ce que la philosophie?, Paris, Minuit.
- Depardon, R., 2006, La solitude heureuse du voyageur, Paris, Seuil, coll. Points.
- Duras, M., 1984, Outside, Paris, Gallimard.
- Jamin, A., 2021, « Yannick Haennel : Les vivants, les morts et la vérité. 2. » (entretien), Diacritik, 2/02/2021, URL : https://diacritik.com/2021/02/02/yannick-haenel-les-vivants-les-morts-et-la-verite-2-janvier-2015-le-proces/
- Lucbert, S., 2024, Défaire voir. Littérature et politique, Paris, Éd. Amsterdam.
- Lyotard, J.-F., 1993, Moralités postmodernes, Paris, Galilée.
- Lyotard, J.-F., 2012, Pourquoi philosopher ?, Paris, PUF.
- Nancy, J.-L., 2020, La peau fragile du monde, Paris, Galilée.
- Pachet, P., 1981, Le voyageur d’Occident, Paris, Gallimard.
- Pachet, P., 2020, Un écrivain aux aguets. Œuvres choisies, Paris, Pauvert.
- Piglia, R., 1980, Respiración artificial, Buenos Aires Sudamericana, coll. “Narrativas argentinas” (rééd.1988).
- Piglia, R., 2014, Crítica y ficción, Barcelona, Penguin Random House.
- Piglia, R., 2016, Tres vanguardias, Buenos Aires, Eterna Cadencia.
- Pinson, J.-C., 2013, Poéthique, Paris, Champ Vallon.
- Ponge, F., 1967, Le parti pris des choses, Paris, Gallimard, coll. « Poésie » (rééd. 1989).
- Prigent, C., 1991, Ceux qui merdRent, Paris, P.O.L.
Notes
- Caparrós, 2014 (2021), p. 649.
- Lyotard, 2012, p. 99.
- Piglia, 2014, p. 93.
- Citons, du côté de ces ouvrages aux confins de l’essai et de la littérature, les livres Contra el cambio (2010), El hambre (2014) et Ñamérica (2021).
- Audi, 2005 (2010).
- Ponge, 1967 (1989), p. 164.
- Ibid., p. 162.
- Ibid., p. 205.
- Ainsi que le feront, par exemple, Deleuze et Guattari, pour la philosophie, dans leur dernier ouvrage commun Qu’est-ce que la philosophie ? (Deleuze et Guattari, 1993).
- Ponge, 1967 (1989), p. 155.
- Chamoiseau, 1997, p. 18.
- Ibid.
- Duras, 1984, p. 35.
- Almeida, 2019, p. 64. Nous traduisons.
- Caparrós, 2021, p. 571. Toutes les citations extraites des ouvrages de M. Caparrós sont traduites par nos soins.
- https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bookcourt.org%2Froberto-bolano%2F#&
- Dardot et Laval, 2016.
- Caparrós, 2021, p. 625.
- Ibid.
- Piglia, 2016, p. 221. Nous traduisons.
- Audi,2005 (2010), p. 18-19. Dans Supériorité de l’éthique (2007), Paul Audi expose sa conception de l’éthique (comme processus de « ressaisissement de soi par soi ») qui donne forme à sa « théorie esth/éthique de la création ».
- Barthes, 2002, p. 207.
- Prigent, 1991, p. 17.
- Barthes, 1978, p. 25.
- Lyotard, 1993, p. 174.
- Nancy, 2020, p. 16.
- Caparrós, 2014 (2021), p. 655.
- Pinson, 2013, p. 101.
- Ibid.
- Pachet, 2020, p. 404.
- Caparrós, 1992, p. 64.
- Depardon, 2006, p. 35.
- Caparrós, 1992, p. 9.
- Pachet, 1982, p. 39.
- Ibid.
- Caparrós, 2016, p. 22.
- Ibid., p. 9.
- Ibid., p. 120.
- Ibid., p. 121.
- Piglia, 1980 (1988), p. 179. Nous traduisons.
- Lucbert, 2024, p. 19.
- Ibid., p. 35.
- Caparrós, M., « Bajo el volcán », « El Diario », 21/10/2021.
- Canetti, 1978, p. 24.
- Bailly, 2024, p. 22-24.
- Caparrós 2014 (2021), p. 648.
- Borges, 1989, p. 238. Nous traduisons.
- Caparrós, 2010, p. 9. Nous traduisons.
- « Yannik Haennel : Les vivants, les morts et la vérité. 2 » (entretien), Diacritik, 2/02/2021. https://diacritik.com/2021/02/02/yannick-haenel-les-vivants-les-morts-et-la-verite-2-janvier-2015-le-proces/