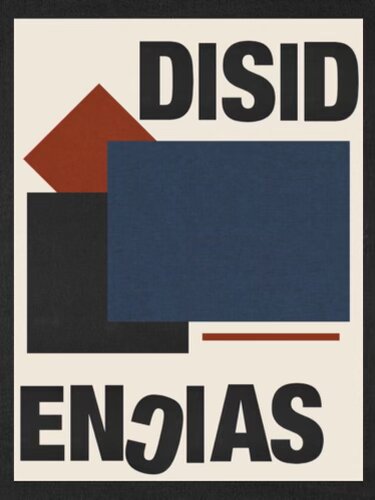Pour qui s’efforce de relire la réalité selon une optique matérialiste, la question du sujet doit faire l’objet d’une attention prioritaire, car la Modernité hégémonique, depuis Descartes, a développé avec succès une opération de naturalisation et d’universalisation de la subjectivité qui s’est avérée centrale dans le développement de la politique moderne. En effet, la fiction du contrat social, qui en est la pierre angulaire, et qui se prolonge jusqu’aux propositions actuelles de Rawls, n’a pu se construire que sur la base d’une conception essentialiste du sujet. Déconstruire cet essentialisme, allié incontournable du concept d’identité, et développer une anthropologie matérialiste, nous apparaissent ainsi comme les préalables indispensables au développement d’une politique antagoniste. Afin de ne pas réitérer des arguments qui ont déjà fait l’objet de développements antérieurs1, nous nous centrerons ici sur la polémique relative à la mort de l’homme, et à ce que nous pourrions appeler le cyborg antagoniste, c’est-à-dire une subjectivité qui oriente le composé homme-machine vers de nouveaux champs d’affrontement politique.
Que tous ceux qui ont lu Les mots et les choses…
… lèvent le doigt. Ceux-là pourront toujours faire l’économie d’une relecture de ce chapitre de l’histoire de la subjectivité du XXe siècle, car nous voudrions surtout tenter ici de tordre le cou à ce lieu commun qui voudrait que Foucault soit le fossoyeur de la subjectivité. Nous savons bien qu’il est possible de construire une histoire de la philosophie en attribuant à un auteur quelques phrases, bien choisies, qui finissent par tordre le sens de l’œuvre. Dans ce genre d’histoire-là, sans doute faudrait-il faire une place de choix à la “mort du sujet” chez Foucault.
Rien de plus ardu que de livrer bataille contre des mentalités étriquées qui, à la moindre occasion, s’indignent face à ce qu’elles considèrent être des atteintes portées aux fondements d’on ne sait pas très bien quoi. Et comme on sait, ce sont ces discours toujours prompts à crier au scandale, fustigeant tout ce qui tend à dépasser du cadre étroit de leurs certitudes, qui, malheureusement, ont la main mise sur le discours établi.
1966 : Les Mots et les choses. La France se remet tout juste de la gueule de bois humaniste qui avait suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Althusser construit un rempart théorique contre l’humanisme socialiste que le marxisme orthodoxe importait directement du Kremlin. Foucault avance sa thèse provocatrice, mais pas vraiment nouvelle, puisqu’elle puise à la source nietzschéenne : la possible mort de l’homme. Mais il l’enrichit d’une argumentation, pour sa part inédite : le caractère très récent de sa naissance, ou plutôt de la naissance du concept d’homme – où “concept” doit être souligné. “Avant la fin du XVIIIe siècle, l’homme n’existait pas”2, écrit Foucault. Il faut beaucoup d’imagination pour comprendre cette phrase en un sens différent de celui qui est le sien, et qui désigne, bien entendu, l’apparition de l’“homme” en tant qu’objet de réflexion théorique. Ce n’est pas pour rien que cette naissance de l’homme, que l’on pourrait qualifier d’épistémologique, s’accompagne de la naissance de disciplines telles que la biologie, la linguistique ou l’économie : “Non plus [qu’existaient] – ajoute Foucault à la suite de la phrase précédemment citée – la puissance de la vie, la fécondité du travail, ou l’épaisseur historique du langage”. C’est pourquoi l’homme “est une toute récente créature que la démiurgie du savoir a fabriquée de ses mains, il y a moins de deux cents ans”3. Ce dont il est question ici ne fait aucun doute : il s’agit d’un savoir, d’un type de discours qui conçoit l’homme comme un objet pour le transformer en concept. Situation inédite, selon Foucault, dans la mesure où les réflexions sur l’humain péchaient encore par universalisme, ne permettant pas de concevoir une véritable science de l’homme:
Il n’y avait pas de conscience épistémologique de l’homme comme tel. L’épistémè classique s’articule selon des lignes qui n’isolent en aucune manière un domaine propre et spécifique de l’homme. Et si on insiste encore, si on objecte que nulle époque pourtant n’a accordé davantage à la nature humaine, ne lui a donné de statut plus stable, plus définitif, mieux offert au discours – on pourra répondre en disant que le concept même de la nature humaine et la manière dont il fonctionnait excluait qu’il y eût une science classique de l’homme.4
On pouvait difficilement délimiter de manière plus claire, stricte et concise le problème. Et c’est cette approche particulière de la question, qui s’appuie sur l’historicité du “concept” d’homme et son caractère de construction théorique (qui se substitue à celle de “nature humaine”), qui permet à Foucault de poser l’hypothèse d’une disparition future du concept comme résultante de son obsolescence théorique.
On croit que c’est jouer le paradoxe que de supposer, un seul instant, ce que pourrait être le monde et la pensée et la vérité si l’homme n’existait pas. C’est que nous sommes si aveuglés par la récente évidence de l’homme, que nous n’avons même plus gardé dans notre souvenir le temps cependant peu reculé où existaient le monde, son ordre, les êtres humains, mais pas l’homme.5
Il faut reconnaître que la réflexion autour de la “mort de l’homme” se produit dans un certain contexte théorique, celui de la première partie de l’œuvre de Foucault (“l’époque de l’archéologie”, pour reprendre les mots de Morey6), durant laquelle il fallait, comme l’écrit le philosophe lui-même, “définir une méthode d’analyse qui soit pure de tout anthropologisme”7. Il s’agissait alors de mettre en lumière les règles de formation du discours sans le rattacher à une subjectivité productrice, ni même à un “au-delà” du discours qui rendrait raison de son origine. Dans ces années, l’accent est mis sur l’autonomie du discours, que Blanchot caractérise de la manière suivante:
L’Archéologie du savoir, comme L’Ordre du discours marquent la période – la fin de la période – où Foucault, en écrivain qu’il était, prétendit mettre à découvert des pratiques discursives presque pures, en ce sens qu’elles ne renvoyaient qu’à elles-mêmes, aux règles de leur formation, à leur point d’attache, quoique sans origine, à leur émergence, quoique sans auteur, à des déchiffrements qui ne révéleraient rien de caché.8
La précision de Blanchot, “en écrivain qu’il était”, est pour le moins surprenante, car il semblerait précisément que Foucault n’avait pas d’autre intention que de souligner le caractère superflu du principe de l’auteur ou de l’expression du discours. Quoiqu’il en soit, au-delà de cette contradiction possible, l’intention foucaldienne de mener à bien une analytique du discours où le rôle de la subjectivité soit réduit à celui d’instance d’expression discursive, est bel et bien soulignée. Il ne fait aucun doute qu’une telle position entraîne la suppression de ce privilège que la tradition classique et moderne, pour utiliser les périodisations foucaldiennes, reconnaissait au sujet.
Il existe bel et bien au sein de l’approche foucaldienne, en-deçà de sa référence à l’“homme” en tant que concept théorique, une critique de la théorie de la subjectivité propre à la Modernité et à sa conception de l’homme.
Le seuil de notre modernité, écrit-il, n’est pas situé au moment où on a voulu appliquer à l’étude de l’homme des méthodes objectives, mais bien le jour où s’est constitué un doublet empirico-transcendantal qu’on a appelé l’homme.9
Ce qui n’est pas très éloigné de l’essentialisme dont il dénonce également l’existence à l’âge classique au travers de l’omniprésence du concept de nature humaine. On pourrait dire que le concept a subi une transformation à l’époque moderne, mais que nous demeurons encore dans le domaine de l’abstraction et de la généralisation. L’homme dont parle la modernité, désormais comprise comme une catégorie chronologique de l’histoire de la philosophie, se caractérise par un essentialisme qui va être radicalement remis en question, non seulement par Foucault, mais aussi par une bonne partie de la philosophie de la deuxième moitié du XXe siècle. Comme le souligne fort justement Marx à propos de l’incapacité de Feuerbach à réaliser, une fois remise en question la figure de Dieu comme projection de l’essence humaine, une critique de l’essentialisme anthropologique, la philosophie de la Modernité est elle-même impuissante à se débarrasser de cette réminiscence théologique. Laquelle, selon la définition qu’en donne Stirner, présuppose l’essentialisme humaniste. Et c’est précisément dans le cadre de cette critique de l’homme de la modernité que s’ébauche, dès cette première “époque archéologique” de l’œuvre de Foucault, une théorie de la subjectivité, ou plutôt d’une nouvelle forme de subjectivité. Alors que l’anthropologisme moderne s’égare dans l’abstraction et l’essentialisme, Foucault, en s’appuyant sur Nietzsche, pose en ces termes le problème des nouvelles formes de subjectivation :
On comprend que le pouvoir d’ébranlement qu’a pu avoir, et que garde encore pour nous la pensée de Nietzsche, lorsqu’elle a annoncé sous la forme de l’événement imminent, de la Promesse-Menace, que l’homme bientôt ne serait plus, – mais le surhomme ; ce qui, dans une philosophie du Retour voulait dire que l’homme, depuis bien longtemps déjà, avait disparu et ne cessait de disparaître, et que notre pensée moderne de l’homme, notre sollicitude pour lui, notrehumanisme dormaient sereinement sur sa grondante inexistence.10
Dans Les Mots et les choses, on trouve déjà une double réflexion sur la subjectivité contemporaine. L’une qui, pour instaurer un nouvel horizon analytique – tel qu’on le voyait se dessiner depuis Nietzsche – s’emploie à définir les différentes formes historiques de subjectivation, celles que la Modernité reconnaissait sous les termes de “nature humaine” et d’“homme”. Pour cela, Foucault fait dans un premier temps référence à un concept extérieur, celui de surhomme, qui prend sa source dans une mutation complète du système du savoir :
De nos jours on ne peut plus penser que dans le vide de l’homme disparu. Car ce vide ne creuse pas un manque ; il ne prescrit pas une lacune à combler. Il n’est rien de plus, rien de moins, que le dépli d’un espace où il est enfin à nouveau possible de penser.11
Dans un deuxième temps, sa réflexion s’attelle à la critique, non plus d’un concept qui a été historiquement dépassé, mais d’une compréhension essentialiste des processus de subjectivation. Ce qui s’annonce après l’homme, quel que soit le concept qu’on lui assigne, n’est plus déterminé par une essence aux contours préalablement définis, mais sera la résultante, ou l’effet, de lignes préalables de subjectivation :
L’Anthropologie constitue peut-être la disposition fondamentale qui a commandé et conduit la pensée philosophique depuis Kant jusqu’à nous. Cette disposition, elle est essentielle puisqu’elle fait partie de notre histoire ; mais elle est en train de se dissocier sous nos yeux puisque nous commençons à y reconnaître, à y dénoncer sur un mode critique, à la fois l’oubli de l’ouverture qui l’a rendue possible, et l’obstacle têtu qui s’oppose obstinément à une pensée prochaine. À tous ceux qui veulent encore parler de l’homme, de son règne ou de sa libération, à tous ceux qui posent encore des questions sur ce qu’est l’homme en son essence, à tous ceux qui veulent partir de lui pour avoir accès à la vérité, à tous ceux en revanche qui reconduisent toute connaissance aux vérités de l’homme lui-même, à tous ceux qui ne veulent pas formaliser sans anthropologiser, qui ne veulent pas mythologiser sans démystifier, qui ne veulent pas penser sans penser aussitôt que c’est l’homme qui pense, à toutes ces formes de réflexions gauches et gauchies, on ne peut opposer qu’un rire philosophique – c’est-à-dire, pour une certaine part, silencieux.12
Face à la myopie de ceux qui voient dans “homme” un seul et unique procédé de subjectivation et qui, scandalisés, accusent Foucault d’être l’artisan d’une pensée d’où la subjectivité est absente, la lecture de quelques-unes des pages les plus significatives de Les Mots et les choses suffit à poser qu’il y a dans cette œuvre une évidente préoccupation pour les processus de subjectivation. Face à l’étroitesse de vue de ceux qui, avec la disparition d’un concept, considèrent que disparaît le problème auquel ce dernier était censé répondre, Foucault met l’accent sur l’historicité des processus de subjectivation et, par conséquent, sur la nécessité de donner une réponse historique à la question des formes de subjectivation au sein de la société contemporaine, celle-là même que certains qualifient de postmoderne. Et il suffit pour s’en convaincre de se référer à ces pages de Les Mots et les choses.
Deleuze sur Foucault
L’expression est textuelle. Deleuze sur Foucault. On sait combien Deleuze était enclin à prendre de revers13 d’autres philosophes pour engendrer de nouveaux rejetons théoriques. Avec Foucault, sur Foucault, il atteint des sommets d’extase particulièrement réjouissants.
Et c’est à partir de la reprise par Foucault de la figure nietzschéenne du surhomme que Deleuze entreprend à son tour une réflexion autour de la question de la subjectivité. Dans la dernière partie du célèbre ouvrage qu’il consacre à son ami, Foucault, publié en 1986, on trouve ainsi un texte qui s’intitule exactement : “Sur la mort de l’homme et le surhomme”. Deleuze pose à nouveaux frais le problème que Foucault lui-même avait mis au jour : qu’est-ce qui doit remplacer cette catégorie d’homme, porteuse de cet essentialisme qui avait caractérisé la Modernité ? Quel est ce surhomme dont Foucault annonçait prudemment l’avènement, et qui sera appelé à remplacer l’homme ?
Tout au long de sa réflexion, Deleuze souligne le fait que cette nouvelle figure du surhomme est redevable de la mort de Dieu, mais, d’une manière surprenante, il explique que cette mort de Dieu, loin de renvoyer à une thématique nietzschéenne, provient directement de Feuerbach. En disant surprenante, nous voulons souligner que c’est Nietzsche qui vient d’abord à l’esprit lorsque l’on évoque la mort de Dieu. Or, Deleuze met en lumière le fait que la mort de Dieu, en réalité, constitue déjà un lieu commun philosophique que l’on rencontrait par exemple chez Feuerbach. Il écrit ainsi :
On défigure Nietzsche quand on en fait le penseur de la mort de Dieu. C’est Feuerbach le dernier penseur de la mort de Dieu : il montre que, Dieu n’ayant jamais été que le dépli de l’homme, l’homme doit plier et replier Dieu.14
Comme on sait, Feuerbach pointe le fait que Dieu n’est rien d’autre qu’une projection de l’essence humaine, et que l’essence humaine ainsi projetée est une transcendance à laquelle on donne le nom de Dieu. En réalité, Dieu est une création de l’être humain, ce qui signifie que ce n’est pas l’homme qui a été créé par Dieu (comme le dit la tradition religieuse), mais Dieu qui a été produit par l’être humain au travers d’un processus de transcendantalisationde l’essence humaine.
Feuerbach théorise donc la mort de Dieu, mais cette mort de Dieu, telle que la comprend Deleuze, entraîne immédiatement la mort de l’homme, Dieu étant le seul et unique fondement possible d’une conception essentialiste de l’homme. Et c’est bien là, pour Deleuze, le véritable sens de l’entreprise de Nietzsche, constater la mort de l’homme :
… Ce qui l’intéresse, c’est la mort de l’homme. Tant que Dieu existe, c’est-à-dire tant que la forme-Dieu fonctionne, l’homme n’existe pas encore. Mais, quand la forme-Homme apparaît, elle ne le fait qu’en comprenant déjà la mort de l’homme.15
Une fois le fondement disparu, une fois Dieu disparu, c’est l’homme qui en vient aussitôt à disparaître ; en d’autres termes, il y a là un enchaînement dans lequel la mort de Dieu entraîne immédiatement la mort de l’homme. Suivant l’analyse de Deleuze, il se produit une accélération des événements au terme de laquelle la mort de Dieu, telle qu’elle est envisagée par Feuerbach au milieu du XIXe siècle, conduit ipso facto à la mort de l’homme.
Nous ajouterons que cette mort de l’homme trouve un écho privilégié dans un texte qui voit le jour au milieu du XIXe siècle : la sixième thèse de Marx sur Feuerbach. Dans ce texte de 1845, Marx jette les bases d’une nouvelle conception de l’anthropologie : “L’essence de l’homme n’est pas une abstraction inhérente à l’individu isolé. Dans sa réalité, elle est l’ensemble des rapports sociaux”16, écrit Marx, qui pointe ici la dimension de construction sociale que revêt la subjectivité. En dépit de l’emploi par Marx du concept d’essence, qu’il faut entendre comme inhérent à ce texte, et très lié à la confrontation avec Feuerbach, c’est l’essence humaine qui se trouve ici radicalement remise en question. Marx concevra ainsi le sujet comme l’effet des médiations multiples et changeantes auxquelles il se trouve soumis et qui ont pour corollaire l’émergence d’une subjectivité traversée par la différence. Mais revenons-en au texte de Deleuze.
Dans son analyse de Les Mots et les choses, Deleuze souligne le fait que Foucault propose un développement des processus de subjectivation qui implique de traverser trois moments pour parvenir à la figure du surhomme : un premier moment qui suppose la représentation de l’infini et, parallèlement, la représentation de Dieu. En effet, la première théorisation de la subjectivité, à l’époque classique, présuppose la représentation de l’image de la divinité, qui implique elle-même que l’être humain soit créé à l’image de Dieu et à sa ressemblance. Il s’agit pour Deleuze de la première étape des théories de la subjectivation chez Foucault : Dieu apparaît comme fondement d’une essence humaine, et c’est l’infini de la divinité qui est représenté dans la subjectivité. Dans un deuxième temps, c’est la conscience de la finitude qui fait son apparition à l’extérieur de la subjectivité. Cette apparition se produit, selon les deux auteurs, dans trois domaines différents : ceux de la vie, du langage et du travail, dont on retrouve la transposition dans le domaine du discours et dans celui des sciences. Ainsi, l’économie politique renvoie au travail, la linguistique au langage et la biologie à la vie. La conscience de la finitude fait son apparition dans la subjectivité, ce qui signifie qu’elle est assumée par le sujet. Le sujet prend conscience de sa finitude, et c’est à partir de là, dit Foucault – repris par Deleuze –, que naît le concept d’homme. Par conséquent, cette catégorie d’“homme qui va mourir” est l’expression de la finitude, ou la conscience de la finitude qui se manifeste au sein du sujet à partir de ces trois domaines. Enfin, troisième moment de ce processus de subjectivation, le surhomme fait jouer les forces de l’extérieur, les forces de la vie, les forces du langage, la force du travail, avec la force de l’homme afin de produire quelque chose de nouveau, et transcender cette finitude qui avait donné naissance à l’homme, et qui donne à présent lieu à un fini illimité, dit Deleuze. Sous cette perspective, le surhomme est l’expression de cette finitude illimitée qui correspond au processus d’articulation du sujet avec ces trois dimensions auxquelles nous avons déjà fait référence (la vie, le langage, le travail)17.
Dans son ouvrage, Deleuze adresse néanmoins une critique à Foucault, lui reprochant de se focaliser exclusivement sur la question du langage à travers la littérature. Pour sa part, Deleuze considère que ce surhomme doit instaurer un jeu, non seulement avec le langage, mais aussi avec le travail et la vie. Voici ce que Deleuze appelle le surhomme, cette figure de subjectivation qui s’emploie à instaurer un jeu de forces entre celles du sujet, du travail et de la vie :
Qu’est-ce que le surhomme ? C’est le composé formel des forces dans l’homme avec ces nouvelles forces. C’est la forme qui découle d’un nouveau rapport de forces.18
Pour tenter de prolonger Foucault et Deleuze – comme Deleuze prolongea Foucault –, nous pourrions dire que cette catégorie qu’ils appellent surhomme correspond à ce que l’on peut nommer le cyborg. En effet, Le cyborg est précisément l’articulation du sujet avec ces trois forces auxquelles nous faisions référence – langage, travail, vie – au travers de la machine. La machine de nos sociétés contemporaines, celle avec laquelle le sujet entre constamment en rapport, et qui est partout présente au sein de la vie de la subjectivité contemporaine. Une machine qui entre en composition avec la vie biologique par le biais de prothèses et d’instruments qui agissent sur nos corps, et peuvent être intégrés dans la chair, comme les régulateurs cardiaques, ou interagir depuis l’extérieur. Notre communication et notre langage sont constamment subordonnés à la machine, aussi bien pour ce qui est de l’expression subjective que pour ce qui a trait à l’information ou au divertissement. Il en va de même pour notre travail qui, de manière directe ou indirecte, se trouve dans une situation de dépendance toujours plus grande à l’égard du machinisme. C’est en entrant en composition avec la machine, et en se transformant en cyborg, que l’être humain entre donc dans la constitution de ces trois éléments dont fait mention Deleuze dans le cadre de son analyse sur Foucault.
La subjectivité du cyborg
La question du cyborg est un lieu commun de la littérature contemporaine. Donna Haraway a publié un Manifeste Cyborg et l’idée de l’homme-machine, de l’être humain-machine, est récurrente chez de nombreux auteurs contemporains. Deux auteurs ont travaillé assez sérieusement sur la question du cyborg, bien que sous des perspectives un peu différentes : le philosophe allemand Peter Sloterdijk et Paul Virilio en France. Le premier propose une vision du cyborg plutôt teintée d’optimisme tandis que le second, plus pessimiste, tend à mettre l’accent sur la face sombre de la question. De fait, nous retrouvons bien sous la plume de ces deux auteurs une critique de la société des machines, de la société technicisée dont les effets de domination sont particulièrement notables. Sloterdijk pointe l’utilisation de la machine comme mode de transformation de la réalité, tandis que Virilio la conçoit comme un instrument nous conduisant à une sorte de fascisme soft qui entraverait tout processus de rupture.
Sloterdijk s’intéresse tout particulièrement à la composition biologique, à la machine comme instrument permettant de potentialiser les capacités de la subjectivité. Il commence à y réfléchir dans Règles pour le parc humain, qui traite d’ un nouveau mode de construction de la subjectivité s’opposant au mode pastoral. Sloterdijk comprend la machine comme un instrument qui permet d’opérer à même le sujet afin de développer ses potentialités communicatives. Ce qui le conduit à modifier l’expression heideggérienne “es gibt Sein” (“il y a être”) en la remplaçant par “es gibt Information” (“il y a information”), considérant que la composition du sujet avec la machine peut rendre possible un processus de communication plus ample débouchant sur un dialogue entre cyborgs. Une vision somme toute optimiste voire habermassienne, au sens où le cyborg accroît les capacités communicatives de la subjectivité et rend possible un dialogue qui ouvre la voie au développement de nouvelles formes sociales et politiques, à de nouvelles “sphères” de rencontre19.
Virilio, quant à lui, nous apparaît comme bien plus pessimiste. Il souligne également le fait que la composition du sujet avec la machine provoque un accroissement des capacités subjectives, étant donné que nous entrons en composition avec des appareils technologiques nous permettant d’obtenir des informations ou de les transmettre à la vitesse de la lumière. Sans qu’il ait besoin de sortir de chez lui, le sujet postmoderne peut parcourir le monde et y produire des effets à une très grande distance. C’est ce que Virilio appelle l’“inertie polaire”, c’est-à-dire l’existence d’un pôle d’attraction dans lequel le monde entier peut se condenser, comme dans une sorte d’aleph postmoderne. Le sujet, assis ou même couché, chez lui, dans sa voiture, est capable depuis sa télécommande, son téléphone portable ou son ordinateur, de se déplacer virtuellement aux quatre coins du monde à la vitesse de la lumière. L’histoire de l’humanité, depuis la domestication du cheval jusqu’à l’avion en passant par le train à grande vitesse, peut être comprise en ce sens comme la production de véhicules toujours plus efficaces et véloces, permettant au sujet de se déplacer d’un bout à l’autre de la planète. Cependant, le moyen de transport le plus rapide est, dans notre société médiatique, le véhicule statique grâce auquel la subjectivité, sans se déplacer, parcourt la planète à la vitesse de la lumière. Ainsi Virilio écrit-il dans Un Paysage d’événements :
Après la longue, très longue génération des véhicules dynamiques, mobiles puis automobiles, voici venue l’ère du véhicule statique, audiovisuel, vecteur d’un mouvement apparent, d’une inertie qui s’apparente au plus vaste voyage, substitut d’un déplacement physique devenu inutile ou presque, avec l’instantanéité des échanges et des télécommunications.20
Réaliser un achat depuis chez soi, visiter des bibliothèques ou des archives, observer des paysages et autres événements, avoir des rapports sexuels, communiquer avec des personnes éloignées (plutôt qu’avec des proches, créant ainsi la communauté des absents)21, travailler, tout est désormais faisable depuis un point d’accès informatique situé à domicile. Mais cet aleph postmoderne débouche corrélativement sur la production d’une monade sans fenêtres, dépourvue de toute forme de communication avec le monde extérieur, de telle sorte que le sujet surinformé, le cyborg communicationnel peut aussi parfaitement être, paradoxalement, le sujet isolé et vide que l’on retrouve dans certains romans de Houellebecq. Le cyborg contemporain fait l’expérience du “plaisir d’un rendez-vous à distance, d’une réunion sans réunion, plaisir sans risque de contamination des télécommunications anonymes du minitel érotique ou du walkman ; perte d’intérêt pour notre prochain au profit d’êtres inconnus et lointains qui demeurent à l’écart, spectres sans importance qui n’encombrent pas notre emploi du temps”.22 Vu sous cet angle, nous sommes bien en présence de sociétés au sein desquelles la technologie est en train de se transformer en instrument de mise à distance des subjectivités entre elles, ce qui rend d’autant plus difficile l’intervention politique.
C’est dans ce sens qu’abonde également Jean Baudrillard tout au long de sa vaste réflexion sur l’interaction entre la technologie et le sujet. La présence écrasante de la technologie dans nos sociétés, loin de se présenter comme un instrument d’empuissantisation des sujets, tel que l’affirme le discours dominant, est une stratégie de domination récente, dont l’efficacité réside en cela qu’elle n’est pas vécue comme telle.
À travers la technique, c’est peut-être le monde qui se joue de nous, l’objet qui nous séduit par l’illusion du pouvoir que nous avons sur lui. Hypothèse vertigineuse : la rationalité, culminant dans la virtualité technique, serait la dernière des ruses de l’irraison, de cette volonté d’illusion, dont la volonté de vérité n’est, selon Nietzsche, qu’un détour et un avatar23.
Le lien paradoxal que Baudrillard met au jour entre la rationalité extrême inhérente à la technique, et la mobilisation des facettes les plus irrationnelles de la subjectivité, s’avère fort intéressant : en effet, ce mélange improbable est consubstantiel à ces nouvelles technologies qui, loin d’opérer comme un instrument permettant une meilleure saisie du réel, œuvrent au contraire à son effacement. Il s’agit du crime parfait, où la réalité disparaît sans laisser de trace :
Ainsi la prophétie est réalisée : nous vivons dans un monde où la plus haute fonction du signe est de faire disparaître la réalité, et de masquer en même temps cette disparition.24
D’autre part, les médias deviennent de véritables vecteurs d’uniformisation sociale. Ils génèrent des goûts, des manières de s’habiller et des habitudes de consommation qui tendent vers l’établissement d’un modèle humain unifié au service des intérêts de la consommation. Baudrillard évoque fort justement l’“enfer du Même”, qui constitue pour lui la conséquence politique la plus efficace de l’action exercée par la technologie de la communication dans le domaine anthropologique :
Le clone ne sera jamais exactement le même que l’original (bien sûr, puisqu’il y aura eu un original avant lui). Rien à craindre soi-disant du clonage biologique, car de toute façon la culture nous différencie. Le salut est dans l’acquis et la culture, eux seuls nous sauvent de l’enfer du Même.25
En tant que “terminal de réseaux multiples”, le sujet est devenu une marionnette technologique du pouvoir contemporain.
Mais nous souhaiterions encore proposer une réflexion autour de la figure du cyborg à partir de deux textes rédigés durant la deuxième moitié du XIXe siècle cette fois, le roman de Samuel Butler Erewhon, et le “fragment sur les machines” des Grundrisse de Karl Marx. On y trouve en effet une première esquisse du rapport récent et conflictuel entre l’être humain et la machine. Dans les Grundrisse tout d’abord, Marx pose que la machine est la dernière étape de la métamorphose des instruments de travail, celle qui a vu l’humanité passer des outils préhistoriques aux machines. Marx, qui est le témoin lucide de l’apparition de ce nouvel outil de travail qu’est la machine, dit du travailleur qu’il est devenu la partie consciente d’une machine qui, au sein du mode de production capitaliste, n’apparaît que dans le cadre d’une production de masse, et en aucun cas dans le but de soulager sa peine :
Elle [la machinerie] n’entre pas en jeu pour remplacer de la force de travail manquante, mais au contraire pour réduire à sa stricte mesure nécessaire une force de travail existant en masse. La machinerie n’entre en jeu que là où la puissance de travail existe en masse.26
En d’autres termes, la machine, dès ses origines, n’est pas conçue comme un instrument visant à faciliter les tâches, et n’est mise en place par le capital que dans le but d’accroître la productivité du travail. Ainsi le travailleur finit-il par se transformer en un simple appendice de la machine :
Réduite à une simple abstraction d’activité – écrit Marx –, l’activité de l’ouvrier est déterminée et réglée de tous côtés par le mouvement de la machinerie et non l’inverse.27
Marx souligne ainsi avec force que les processus de technicisation qui accompagnent le développement du capital ne sont aucunement envisagés dans la perspective d’une humanisation de la production, mais dans celle d’une machinisation de la force de travail. Dans la société capitaliste, la technologie ne met pas la machine au service de l’être humain, mais réalise plutôt le mouvement inverse en soumettant le sujet au diktat de la machine-capital. Or, la machine-capital, ne se contente pas de vampiriser le travail subjectif, mais s’approprie aussi le savoir social, ce que Marx nomme l’intellect général, et qui est constitué de l’ensemble des savoirs collectifs indispensables au développement technologique, mais qui ne bénéficie qu’à un secteur social minoritaire, la classe capitaliste.
Le développement de la machinerie par cette voie n’intervient qu’à partir du moment où la grande industrie a déjà atteint un niveau supérieur et où l’ensemble des sciences ont été capturées et mises au service du capital.28
Marx anticipe le concept de cyborg, mais il s’agit d’un cyborg traversé par la lutte de classes, où la partie humaine se trouve soumise aux intérêts du capital.
Cette question est également abordée dans le roman de Butler Erewhon ou De l’autre côté des montagnes, publié en 1872. On trouve en effet dans cet ouvrage un discours sur les machines qui fait dire au narrateur :
Combien d’hommes actuellement vivent dans un état d’esclavage à l’égard des machines ? Combien passent toute leur vie, du berceau à la tombe, à les soigner nuit et jour ? N’est-il pas évident que les machines gagnent du terrain sur nous, si nous songeons au nombre toujours croissant de ceux qu’elles réduisent en esclavage ?29
Si bien qu’au sein du rapport sujet-machine, tel que l’entend Butler, et il en est de même chez Marx, c’est bien à la machine et non au sujet que revient le rôle hégémonique.
Antagonisme et subjectivité
En conclusion, et pour en revenir à Foucault et à Nietzsche, il faut bien comprendre que le concept de cyborg est d’abord un concept descriptif qui fait référence au type de subjectivité que nous trouvons au sein des sociétés contemporaines hyper-technicisées. Comme le dit Haraway : “le cyborg est notre ontologie”30. Pour sa part, le concept de surhomme possède une dimension éthique et politique qui déborde le champ de la simple description. Le surhomme est le sujet de l’autonomie radicale, celui qui est capable de produire des valeurs et du sens.
Le rapport sujet-machine que décrit Marx dans les Grundrisse nous parle d’un sujet hétéronome, soumis, et bientôt subsumé sous la loi du capital. La lutte des classes a produit ses effets de domination au sein de la subjectivité. Le surhomme, revendiqué par Nietzsche et suggéré par Foucault, se trouve bien éloigné de cette typologie subjective. Il semble cohérent que pour atteindre la figure du surhomme à partir du cyborg du capital, il soit nécessaire de renforcer la dimension subjective au sein de la composition homme-machine, en activant les mécanismes antagonistes de la lutte des classes.
Nous parlons, par conséquent, de politique, de stratégies d’intervention qui modifient le rapport subjectivité-machine et qui rendent possible l’appropriation sociale du savoir, de l’Intellect Général. Le cyborg antagoniste est celui qui met la technologie de la production et de la communication à son service, pour libérer le temps de la soumission impérative au travail, et accroître les moments de temps libre. Il est aussi celui qui fait de la communication un instrument pour construire le commun. Le cyborg-surhomme magnifie sa puissance et érode la potestas de l’ordre établi. Mais comment transposer cette question au domaine pratique ?
Pour tenter de le faire le plus efficacement possible, il nous semble opportun de distinguer deux domaines concernant le rapport de l’être humain avec la machine : celui de la production et celui de la communication. En ce qui concerne le premier de ces deux domaines, on trouve déjà des traces de cette stratégie de renversement adoptée par le cyborg dans les pages des Grundrisse. Si Marx dénonce la subordination du sujet à la machine dans le cadre de la production capitaliste, et la constitution du “cyborg du capital”, l’opération inverse, soit l’assujettissement de la machine aux besoins du sujet, se présente comme le chemin qui doit être pris par la subjectivité antagoniste. Rappelons-nous que Marx pointe le fait que, dans le domaine de la production, la machine n’est pas employée comme un outil d’allègement du travail subjectif, mais d’intensification de la production. C’est pourquoi, dans le cadre du travail, il s’agit de mettre la machine au service de l’intérêt commun, de la majorité sociale, dans un geste qui fut déjà revendiqué par Marcuse et d’autres auteurs de la seconde moitié du XXe siècle. La machine, la technologie, comme moyen d’adoucir les tâches humaines et d’alléger le poids du travail. Est-il seulement besoin de rappeler l’incroyable accroissement de la productivité du travailleur tout au long du XXe siècle comme conséquence de l’introduction de la technologie dans le cadre de la production. Tandis que la productivité du travailleur a augmenté de manière exponentielle en moins d’un siècle, sa journée de travail n’a pratiquement pas été modifiée, ce qui signifie que l’extraction de la valeur ajoutée relative a, quant à elle, considérablement augmenté. Face à cette dynamique qui nous conduit tout droit à la production de produits de moins en moins onéreux, mais aussi, parallèlement, à une précarisation croissante du travail (dans une société où l’emploi est mal réparti et qui n’offre pas un égal accès à la consommation), il s’agit d’orienter le développement technologique dans le sens d’une amélioration des conditions de vie des citoyens, avec pour horizon une meilleure redistribution de l’emploi et une réduction drastique de la journée de travail.
Le second domaine, celui de la communication, est bien plus complexe, dans la mesure où les effets de domination y sont occultés par des stratégies de consommation et de divertissement qui les rendent le plus souvent invisibles. En ce sens, le devenir cyborg s’est érodé de manière effective dans nos sociétés développées, car le sujet, de manière pratiquement inextricable, se com-pose (ou se co-constitue) au moyen de dispositifs (téléphones, ordinateurs, tablettes, téléviseurs) qui, de façon consécutive ou simultanément, l’accompagnent à longueur de journée. Il faut donc partir de cette réalité et renoncer, à une stratégie politique, qui prônerait l’ascétisme et le refus de la technologie. La composition sujet-machine n’est pas prête de disparaître. Du moins pas dans un futur imaginable. Nous devons aspirer et œuvrer à l’évitement d’un processus de vampirisation qui, dans ce domaine particulier, finisse aussi par asservir le sujet à une machine transformée en mécanisme destiné à absorber son temps vital pour le convertir en temps-machine.
Face à certaines analyses indéniablement pessimistes comme celles de Virilio, les technologies de la communication ont démontré qu’elles pouvaient être employées de manière antagoniste. Le 15-M espagnol trouva dans les réseaux sociaux un outil d’articulation fondamental, avec les vertus et les faiblesses qui en découlèrent. Mais il mit en lumière quelque chose que nous aurions dû savoir de longue date : que les outils peuvent donner lieu à des usages très différents. Tout comme, dans le domaine de la production, la technologie est employée au profit du Capital, elle est, dans celui de la communication, utilisée en vue de la reproduction noologique de ce dernier. C’est pourquoi la stratégie, plus complexe dans ses développements, reste la même : il s’agit d’inverser le rapport avec la technologie afin de la transformer en un instrument de cette autonomie qui, comme nous le disions, caractérise le surhomme.
Cela suppose donc d’utiliser les réseaux dans le but de casser le monopole communicatif du pouvoir, générer de nouvelles valeurs au travers de nouvelles stratégies de divertissement, encourager les réseaux du commun, transformer le cyberespace en un lieu de production et de diffusion culturelle, et tirer profit des potentialités de la communication afin de consolider les processus démocratiques quotidiens. Nombreuses sont les actions que le cyborg antagoniste peut mener à bien au travers de son corps technologisé, à commencer par la prise de conscience que la lutte pour la production de subjectivité est le combat politique de ce début de XXIe siècle.
Depuis la publication par Foucault de Les Mots et les choses, le débat autour des processus de subjectivation s’est considérablement clarifié. L’idée relative à la fin d’une subjectivité essentialiste qui fut nommée “homme” et qui domina tout du long la Modernité, semble aujourd’hui difficilement contestable. La compréhension de la subjectivité comme construction sociale, déjà annoncée par Marx, s’ajuste de manière beaucoup plus précise à la réalité des processus contemporains de subjectivation. En dépit de cela, le concept qu’il nous faudrait utiliser pour désigner cette forme subjective demeure encore problématique. Mais au-delà du débat relatif aux concepts, nous voudrions soulever la question centrale qui sous-tend cette polémique : comment construire une subjectivité antagoniste, non soumise à la puissance systémique. Le système a fait la preuve de son efficacité dans les processus de construction de subjectivité, ce qui faisait dire au philosophe Jesús Ibáñez, il y a déjà plusieurs décennies, que le sujet est l’objet le mieux produit par le capitalisme31. Il ne fait donc aucun doute qu’avancer dans les stratégies de production de subjectivité antagoniste constitue le combat politique de notre époque.
Notes
- o, Zaragoza, Eclipsados, 2012.
- Foucault, M., Les Mots et les choses, Paris, Flammarion, 1966, p. 319.
- Ibid.
- Ibid., p. 320.
- Ibid., pp. 332-333.
- Cf. Morey, M., Lectura de Foucault, Madrid, Taurus, 1986.
- Foucault, M., L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, p. 26.
- Blanchot, M., Michel Foucault tel que je l’imagine, Paris, Fata Morgana, 1986, p. 19.
- Foucault, M., Les Mots et les choses, Paris, Flammarion, 1966, pp. 329-330.
- Ibid., p. 333.
- Ibid., p. 353.
- Ibid., p. 353-354.
- Cf. Deleuze, G., Pourparlers, Paris, Minuit, 2003, p. 15 : “…concevoir l’histoire de la philosophie comme une sorte d’enculage ou, ce qui revient au même, d’immaculée conception. Je m’imaginais arriver dans le dos d’un auteur, et lui faire un enfant, qui serait le sien et qui serait pourtant monstrueux. Que ce soit bien le sien, c’est très important, parce qu’il fallait que l’auteur dise effectivement tout ce que je lui faisais dire. Mais que l’enfant soit monstrueux, c’était nécessaire aussi, parce qu’il fallait passer par toutes sortes de décentrements, glissements, cassements, émissions secrètes qui m’ont fait bien plaisir.”
- Deleuze, G., Foucault, Paris, Minuit, 2004, p. 138.
- Ibidem.
- Marx, K., “Thèses sur Feuerbach”, in Marx, K., Engels, F., L’Idéologie allemande, Paris, Éditions Sociales, 1968, p. 33.
- Cf. Deleuze, G., Foucault, Paris, Minuit, 2004, pp. 139-141.
- Ibid., p. 140.
- Sloterdijk, P., Essai d’intoxication volontaire, Paris, Hachette Littératures, 2001, pp. 91-92.
- Virilio, P., Un paysage d’événements, Paris, Galilée, 1996, p. 118.
- Virilio, P., Cybermonde, la politique du pire, Paris, Textuel, 1996, p. 46.
- Virilio, P., Un paysage d’événements, Paris, Galilée, 1996, p. 130.
- Baudrillard, J., Le Crime parfait, Paris, Galilée, 1995, pp. 17-18.
- Ibid., p. 18.
- Baudrillard, J., L’Échange impossible, Paris, Galilée, 1999, p. 52.
- Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, dits “Grundrisse”, Paris, Éditions Sociales, 2011, p. 658.
- Ibid., p. 653.
- Ibid., p. 660.
- Butler, S., Erewhon, Paris, Gallimard, 2005, p. 246-247.
- Haraway, D., Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions, féminismes, Paris, Exils, 2007, p. 31.
- Ibáñez, J., Más allá de la sociología, Madrid, Siglo XXI, 1986, p. 58.