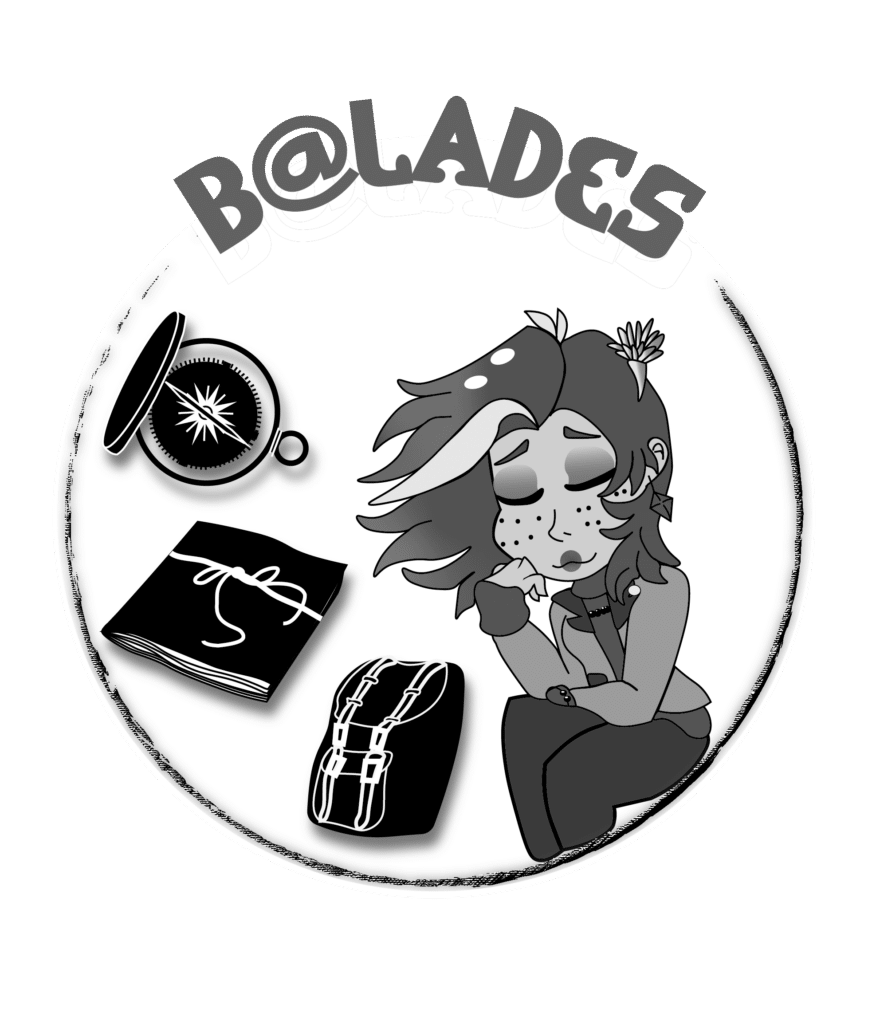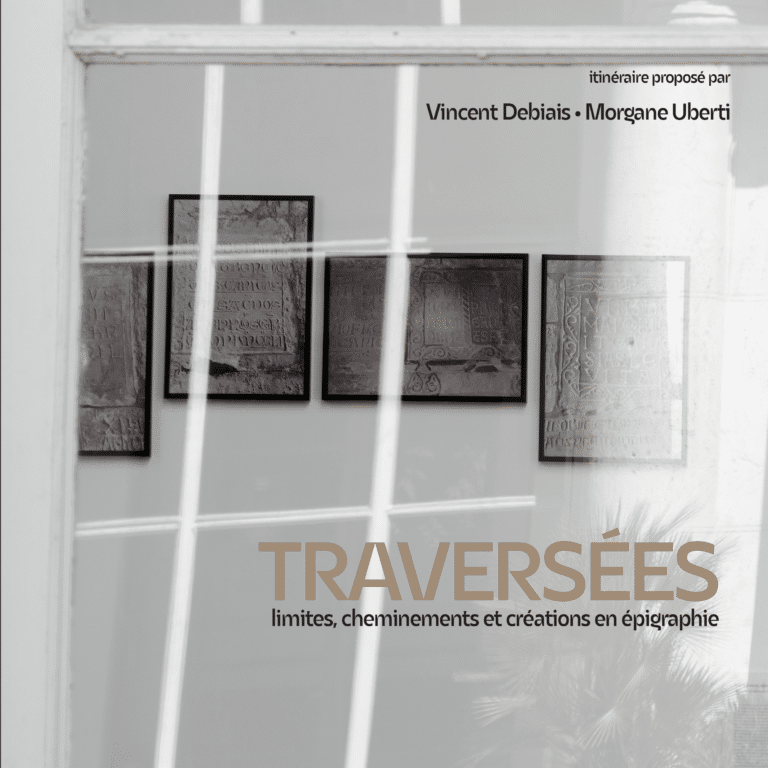Émancipé depuis plus d’un siècle, l’Artiste d’aujourd’hui se présente comme un homme libre, doté des mêmes prérogatives que le citoyen ordinaire et parle d’égal à égal avec l’acheteur de ses œuvres. Naturellement, cette libération de l’Artiste a comme contrepartie quelques-unes des responsabilités qu’il pouvait ignorer lorsqu’il n’était qu’un paria ou un être intellectuellement inférieur. Parmi ces responsabilités, l’une des plus importantes est l’ÉDUCATION de l’intellect, bien que, professionnellement, l’intellect ne soit pas la base de la formation du génie artistique. […] Pour rester à ce niveau et pour se sentir à égalité avec les avocats, les médecins, etc. l’Artiste doit recevoir la même formation universitaire.
Marcel Duchamp, “College”1.
Nous vivons dans une époque d’attrait simultané pour la “recherche créative” et pour “l’artiste chercheur”. L’irréductible altérité des méthodologies des arts de l’expérience et de la vérification, et des indisciplines de la création (même érudites) fonctionnent comme des pôles dont l’attraction mutuelle est encouragée par les institutions. Cet âge de l’artiste-chercheur et du chercheur-artiste se manifeste par plusieurs états complexes de critique et de créativité. Ces états de la recherche déjà pensés par les post-structuralistes dans le champ anglophone ont atteint les études francophones. Les années 1990 étasuniennes avaient été marquées par la critique institutionnelle d’Andrea Fraser, chercheuse et artiste de haut niveau. Le sociologue-philosophe Bruno Latour qui avait marqué en France la critique de la construction des savoirs a fondé en 2010 avec la dramaturge et historienne Frédérique Aït Touati un groupe de recherches mixte art et recherche (SPEAP/IEP). Le théâtre de Nanterre Amandiers qui leur était associé fut le plateau ou s’entrecroisaient chercheur·ses, comédien·ne·s et plasticien·ne·s. La philosophe-biologiste Donna Haraway écrit sous forme de fiction un futur de la parenté entre les espèces qui est difficilement pensable autrement que par l’hybridation des méthodes d’écriture2. L’art français est marqué par la présence d’artistes-chercheuses aux parcours mixtes, telles que Kapwani Kiwanga, qui use des outils de l’anthropologie pour entremêler les savoirs et participer à la construction d’une pensée décoloniale.
Est aussi parue en 2019 une thèse faisant l’archéologie de la figure de l’artiste-chercheur au XXe siècle. Sandra Delacourt s’est appuyée sur l’étude du parcours du sculpteur érudit Donald Judd en le replaçant au cœur d’une “aspiration collective”3. L’entrée des artistes à l’université que Marcel Duchamp, alors installé à New York, appelait à être généralisée, s’inscrit d’abord dans des possibilités institutionnelles d’accès aux études supérieures suscitées par une politique volontariste après le deuxième conflit mondial. Une génération entière rêve alors d’accéder à l’université. Et parce qu’ils se sont battus militairement, une génération d’hommes artistes en a les moyens grâce au programme GI Bill qui leur permet à la fois de voyager en Europe, de rencontrer visuellement l’histoire de l’art occidental, et de suivre l’enseignement de certaines universités prestigieuses comme Columbia et Cornell. Robert Rauschenberg, Robert Indiana, Reginald Pollack, Ellsworth Kelly, Richard Artschwager, Douglas Huebler en profitent. Au retour de la Guerre de Corée, une nouvelle génération fait la même expérience, dont les célèbres Dan Flavin et Sol LeWitt. À ce mouvement s’ajoute le recrutement massif d’artistes dans les universités étatsuniennes, différentes des écoles d’art françaises qui ont séparé l’enseignement de l’art et des sciences pendant longtemps. Pourtant, passé l’enthousiasme des années 1960, Sandra Delacourt décrit une certaine déception des artistes universitaires, devenus conscients de leur incapacité à faire fléchir la refonte des enseignements et de la radicale altérité de leurs méthodologies, comme en témoigne Keneth Evett, peintre et professeur à Cornell University :
J’ai beaucoup d’amis ici qui sont des universitaires et des intellectuels de haut niveau, et je sens qu’ils regardent un artiste à l’université comme quelque chose d’interlope. D’une certaine manière je suis d’accord avec eux, car ce à quoi ils doivent contribuer relève d’une certaine précision et d’une certaine clarté, et parce que cela s’enracine dans une tradition et une organisation qui leur permet, à eux, de fonctionner avec efficacité4.
Se dessine alors la figure d’un artiste érudit, souvent imaginé comme plutôt blanc et masculin, qui méprise les savoirs académiques. Ad Reinhardt, chantre de l’abstraction radicale et théoricien de l’“Art as art” fit alors figure de héros, qui venait donner sa vision de l’histoire de l’art dans de multiples universités5.
Donald Judd encore se montra d’un potentiel critique radical vis-à-vis de ses contemporains. La démarche qui permit de rendre les artistes experts de la théorie et de la recherche en art doit aussi beaucoup, comme le montre Sandra Delacourt, à l’influence de l’historien de l’art Meyer Schapiro, qui élabora une théorie de l’art fondée sur la création. Selon son analyse de l’art abstrait, c’est l’art de son temps, qui voyait émerger ces formes abstraites, qui permet de reconsidérer les dessins d’enfants, l’art dit “primitif” et l’art des fous que l’on n’appelait pas encore art brut. Cela se produisit dans la rupture avec une histoire des styles évolutive et nécessairement fondée sur le schéma : épanouissement, épuisement, ennui, réaction ( ). Son approche, influencée par ses convictions marxistes, lui permit de développer une vision de l’art très fortement appuyée sur l’histoire sociale.
Sandra Delacourt n’insiste pas sur le fait que Meyer Schapiro était un spécialiste de l’art roman, et qu’il enseignait cette discipline à Columbia. Il s’était fait connaître par son étude importante sur Moissac, qui tentait de faire entrer en corrélation les changements de l’époque de la Réforme de l’Église du XIIe avec la vision des temps à venir des images apocalyptiques de son tympan6. Plus encore, les artistes, dont Donald Judd et Ad Reinhardt, étaient de bons connaisseurs de ces sculptures qui leur offraient un pas de côté par rapport à l’histoire de la sculpture patiemment décrite par l’histoire de l’art conventionnelle qui faisait remonter à Rodin la simplification formelle.
L’histoire des apports de la recherche sur l’art roman quant au minimalisme et à l’art conceptuel est importante et a fait l’objet d’analyses fondées aussi bien sur des rapprochements formels que sur la méthode de travail elle-même7. L’importance de la figure du copiste médiéval, attentif, studieux et patient permet de comprendre l’attention pour certains artistes dits conceptuels comme John Latham, occupé à lire inlassablement l’Encyclopaedia Britannica8, au travail modeste et laborieux, comme l’a montré Valérie Mavridorakis9.
Si les artistes associés à l’art conceptuel étaient parfois des intellectuels dotés de prestigieux diplômes universitaires, dont le principal exemple est celui d’Adrian Piper, détentrice d’un doctorat de philosophie kantienne, ils et elles ne l’étaient pas tou·tes. Il serait erroné d’associer une pratique fondée sur l’écriture à un parcours universitaire spécifique. Lawrence Weiner avait arrêté l’école à 16 ans et travaillé sur les docks. Il s’est pourtant fait connaître à partir de 1968 par ses statements rappelant le linguistic turn impulsé par John Austin10. À la même époque, la docte Adrian Piper se déguisait et se recouvrait de vêtements maculés de produits périmés dans la rue11. Weiner avait plutôt singularisé la dimension sculpturale de l’écriture monumentale (◉ ), Piper utilisé ses fines connaissances de philosophie morale pour interroger notre être au monde, les questions de genre et de race, face aux plus banales des interactions sociales urbaines.
), Piper utilisé ses fines connaissances de philosophie morale pour interroger notre être au monde, les questions de genre et de race, face aux plus banales des interactions sociales urbaines.
Il y eut donc une rencontre entre des savoirs et des manières de travailler au sein des universités amenant à des apprentissages mutuels, à des illustrations parfois, ou au développement de méthodes renouvelées. Il y eut en retour une redécouverte des aspects formels, de l’œuvre plastique de certains chercheurs. Ces pratiques se sont déroulées dans des cadres institutionnels, mais aussi en dehors de ceux-ci au sein des écoles de pédagogies radicales (Donald Judd à la BMAS, école non diplômante), et avec une force subversive importante. On pourra dire qu’il n’y a là rien de nouveau, que Vasari était aussi bien artiste qu’historien, que John Ruskin peignait et enseignait la peinture à Elizabeth Siddal tout en écrivant les Pierres de Venise. Ce qui est important c’est plutôt que la “modernité” artistique ait justement séparé les champs et se soit construite sur le partage des méthodes, d’un côté la théorie et de l’autre, la pratique. Les temps post-structuralistes se sont beaucoup intéressés à repenser les gestes et les formes au sein de la recherche. Le travail de Georges Didi-Huberman autour de l’Atlas d’Aby Warburg, et les expositions qui ont été rendues publiques ont contribué à l’intégrer au sein de méthodes de travail par association d’images qui ont été plus tard mises en pratique par de nombreux artistes de photographie et d’installation12 ( ). L’opération fut si bien comprise que les étudiant·es que je côtoie aujourd’hui à l’École Supérieure d’art d’Angers citent souvent Aby Warburg comme un artiste du début du XXe siècle ! La pensée formelle d’un Jurgis Baltrušaitis fait l’objet d’expositions au musée d’art contemporain de Vilnius13 qui permettent de comprendre que c’est non par l’association d’images mais par le dessin qu’il concevait les rapprochements entre les œuvres. En même temps, des artistes brouillent les pistes : au début des années 2000, la très théorique Andrea Fraser, adepte de la sociologie de l’art bourdieusienne, mit en scène dans ses performances les tics les plus comiques de l’institution artistique, n’hésitant pas à entrer en communication sexuelle avec le musée Guggenheim de Bilbao, et à faire pour une exposition qui n’en était pas une à la Mica Foundation, l’ensemble des discours d’inauguration de l’artiste, du commissaire, et du mécène, entrecroisés de strip-tease14.
C’est donc en s’inscrivant dans un dense terreau de liens entre art et recherche, entre art médiéval en particulier et art contemporain que l’on peut lire les expériences des artistes de la Casa de Velázquez face au corpus d’images épigraphiques proposé par Morgane Uberti et Vincent Debiais. L’hypothèse largement vérifiée est que ces textes gravés dans la pierre faisaient déjà image, et que les artistes du début du XXIe siècle ne peuvent pas en douter. La dimension graphique de ces inscriptions a été réinterprétée dans sa matérialité même.
Dans l’exposition Sendas Epigráficas, deux projets collaboratifs ont fait dialoguer des méthodes de travail a priori opposées. Par ces travaux à quatre mains, la confrontation des méthodes apparaît de manière saillante. Le projet de Sylvain Konyali l’a amené à travailler avec Paul Vergonjeanne venu à la Casa de Velázquez pour faire ses recherches en bibliothèque alors qu’il est de son métier tailleur de pierre et compagnon. C’est le compagnon qui se présentait alors comme le chercheur, et il est vrai que Paul Vergonjeanne connaît les techniques médiévales de la taille aussi bien et mieux que tout chercheur en architecture médiévale. Avec Sylvain Konyali, ils ont élaboré un processus de travail qui décompose la chaine opératoire de leurs méthodes. Une pierre a été taillée en laissant apparentes les étapes de la taille, et utilisée comme matrice de gravure. Ces stades intermédiaires, peut-être banals pour un tailleur, sont interprétés dans leur dimension esthétique dans le regard que lui porte le graveur, qui en fait le support d’une nouvelle image. Cette proposition peut être lue comme la démonstration de la nécessité de l’enchevêtrement des savoirs.
Andrés Padilla Domene et Morgane Uberti ont procédé à un déplacement du problème épigraphique médiéval, en mettant en abyme la recherche sur un cas contemporain. Un artiste non professionnel avait recouvert les murs et les pierres de son village d’inscriptions et de signes qui finirent par orner l’ensemble des alentours. Ses messages étaient souvent cryptiques. Dans sa vidéo, Andrés Padilla confronte une enquête sans jugement auprès des témoins du village qui ont pu connaître l’artiste en question, et une interprétation scientifique, faite par Morgane Uberti analysant avec les outils conceptuels de la description épigraphique les inscriptions ainsi qu’elle le ferait d’inscriptions livrées sans contexte spécifique. Il en ressort un film étrange, jouant sur les savoirs non hiérarchisés avec beaucoup de fluidité. Cette capacité à montrer l’articulation de la pensée dans toute sa dextérité et sa beauté sans la corréler à une démonstration vérifiable est justement la liberté qu’il est possible de se permettre dans une démonstration qui n’a pas de visée scientifique.
Je défendrai facilement l’idée que l’art et la recherche ne se distinguent pas radicalement par leurs méthodes déductives ou intuitives, mais par la visée qui provoquera un arsenal démonstratif vérifiable dans un cas, et un choix du plus efficace ou du plus séduisant dans l’autre. Bruno Latour démontrait que les points de convergences sont importants entre la mise en scène du savoir scientifique et celle de l’art, mais que la spécificité du savoir scientifique est que ses démonstrations sont réversibles, et que l’on peut inverser la chaîne des conséquences15.
Marcel Duchamp qui signait aussi Rrose Selavy était un artiste érudit qui demandait à être pris au sérieux, tout en jouant de l’humour comme de l’érotisme. Il recommandait aux artistes d’aller à l’université pour être considéré d’égal à égal avec les chercheur·es de son époque. Aujourd’hui beaucoup d’artistes suivent des études supérieures. Certain·es collaborent avec des chercheur·es académiques. On n’a pas (tout à fait) les mêmes méthodes. Chercheur·es et artistes n’ont surtout pas la même visée. Les cannibalismes disciplinaires16 pour être féconds et permettre un travail émancipateur pour les deux camps ont pour condition de considérer positivement cette altérité même.
Notes
- M. Duchamp, “College”, “L’artiste doit-il aller à l’université ?”, Allocution à l’université d’Hofstra, New York, 1960, publié et traduit dans Duchamp du signe, Paris, 1975.
- D. Haraway, Staying in the trouble, Makin Kin in the Chtulucene, 2016. Donna Haraway avait de longue date explore les mérites de l’écriture fictionnelle, en particulier pour court-circuiter es impératifs de la domination masculine dans des textes fameux comme Le manifeste-Cyborg, voir Manifeste cyborg et autres essais. Sciences – Fictions – Féminismes, Anthologie établie par L. Allard, D. Gardey et N. Magnan, Paris, 2007.
- S. Delacourt, L’artiste-chercheur, un rêve américain au prisme de Donald Judd, Paris, 2019 ; elle était déjà co-autrice d’un recueils de textes d’artistes-chercheurs et de chercheurs artistes (Mathieu Kleyebe Abonnenc, Kapwani Kiwanga, lepeuplequimanque) : Id, V. Theodoropoulou, K. Schneller, Le chercheur et ses doubles, Paris, 2016. On peut lire aussi : M. Boudier, C. Dechery, Artistes-chercheur·es, chercheur·es-artistes. Performer les savoirs, Dijon, 2022.
- S. Delacourt, “L’artiste-chercheur…”, op. cit., p. 81.
- Lucy R. Lippard, Ad Reinhardt, New York, 1981.
- M. Schapiro,The Romanesque Sculpture of Moissac, New York, 1985.
- Voir notamment, A. Nagel, Medieval Modern, Art out of time, Londres, 2012.
- J. Latham, Encyclopedia Britanica, film silencieux, 1971, Londres.
- Voir V. Mavridorakis, “L’artiste conceptuel à son pupitre”, in : C. Denoël, L. Dryansky, I. Marchesin et E. Verhagen (dir.), L’art médiéval est-il contemporain ?, Turnhout, 2023.
- Voir la traduction de certains des relevés de Weiner dans G. Herrmann, F. Reymond, F. Vallos (dir.), Art conceptuel, une entologie, Paris, 2008, p. 373-388.
- A. Piper, Catalysis III, performance documentation, 1970, © Generali Foundation Wien and Adrian Piper Research Archive Foundation (APRAF), Berlin.
- G. Didi Huberman, Atlas ou le gai savoir inquiet, 2001, reprise su texte de l’exposition Atlas. How to Carry the World on One’s Back ? que G. Didi-Huberman a organisée entre novembre 2010 et février 2011 au Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), exposition reprise au ZKM-Zentrum für Kunst und Medientechnologie de Karsrühe puis à la Sammlung Falckenberg de Hambourg, entre mai et novembre 2011.
- ‘Jurgis Baltrušaitis’ Manuscripts: For All and None’, National Gallery of Art, Vilnius, 2016.
- Official Welcome, 2001, MICA Foundation.
- B. Latour, Les Microbes. Guerre et paix, suivi de Irréductions, Paris, 1984 ; voir aussi Enquête sur les modes d’existence, Paris, 2012.
- J’emprunte cette expression au titre d’un colloque sur les liens entre histoire de l’art et anthropologie au musée du quai Branly : T. Dufrêne et A.-C. Taylor (dir.), Cannibalismes disciplinaires, Paris, 2009.