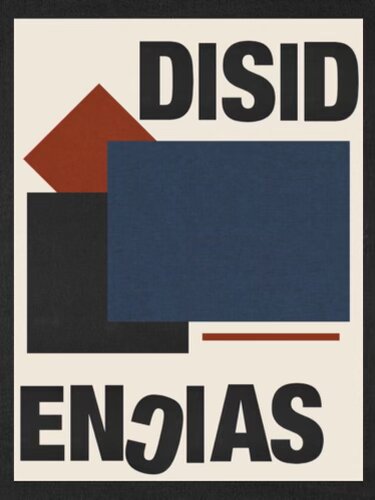Faire taire la différence. Prélude grec
In memoriam Jean-Luc Nancy
Saurons-nous apprendre [de ce cataclysme] pour tenter de tout changer ? […] Y aura-t-il plus de libertés, plus de répression, plus de compréhension, plus de rudesse ? La faim sera-t-elle plus terrible encore ? Y aura-t-il de nouvelles luttes ?
Est-ce que ce sera le début de quelque chose ou la fin de rien ?1
L’épidémie de Covid-19, par sa virulence et sa puissance de dérèglement planétaire, a pu être considérée comme le symptôme de la pathologie profonde de « notre civilisation rationnelle et opératoire »2, mais elle fut peut-être avant tout une expérience hautement affective où prenaient soudainement corps, de façon inouïe, les angoisses et les peurs apocalyptiques – toujours plus fondées et plus proches – qui, pour Michaël Fœssel, hantaient depuis quelques décennies les discours contemporains3, suspendant même pour un temps toute forme de projection dans l’avenir. L’inouï, comme le rappelait alors Jean-Luc Nancy, « on l’avait en fait déjà entendu, mais on ne l’avait pas perçu ou pas reçu », malgré l’avalanche des « signaux politiques, écologiques, migratoires et financiers »4 qui depuis plusieurs décennies avaient changé la face du monde. Or, le monde faisait alors l’épreuve d’une réalité inédite qui, comme le soulignèrent si justement Barbara Stiegler, ou Jean-Luc Nancy et Jean-François Bouthors5, avait réussi, comme aucune autre de ces crises (écologique, humanitaire, etc.) terribles dont nous étions devenus si familiers, l’exploit inconcevable de « suspendre [la] révolution [néolibérale] »6, stopper la fuite en avant éperdue de la croissance indéfinie, et enfoncer un coin dans cette « loi supposée naturelle de production compétitive illimitée »7 – ce « fondamentalisme libéral »8 tenant partout lieu de pensée depuis la fin du monde bipolaire, comme l’écrirait ailleurs Nancy. Sorte de miroir grossissant, pour beaucoup, de l’ensemble des crises dans lesquelles nous étions pris, la catastrophe sanitaire avait peut-être les mêmes vertus que celles qu’il fallait bien reconnaître, pour Frédéric Lordon,au désastre écologique dans la délégitimation – de plus en plus bruyante – de l’ordre social capitaliste9 : elle frappait les corps et les esprits avec une puissance bouleversante, nous plongeait dans la stupeur, et rendait incontournable, pour le philosophe, la nécessité de prendre la mesure de ces « forces de l’inconséquence »10 qui semblaient nous river au malheur et à la désespérance. Cette fois, la messe (poétique et politique) n’aurait plus lieu dans le vide le plus complet, pourrait-on dire en paraphrasant Witold Gombrowicz dans sa fameuse diatribe contre les poètes11, mais dans une expérience hautement affective, « strictement affective »12 – pour reprendre les termes de Paul Audi dans sa définition de la compassion –, qui nous réunirait (provisoirement) dans le partage de la souffrance et de la vulnérabilité de l’autre. Dans une crise épidémique qu’il fallait considérer comme l’énième épisode (démesuré, horrifique) d’un modèle économique de développement mondialisé qui avait fragilisé toutes nos défenses, pour Barbara Stiegler, qui décrira dans son journal de bord la vie quotidienne « en Pandémie » (ce « nouveau continent mental […] avec sa langue, ses normes et son imaginaire »13) et les effets terribles du délabrement avancé de nos systèmes de santé (y compris ceux des pays les plus riches) où désormais, « on compt[ait] les morts »14 et l’on abandonnait à leur sort des milliers de victimes isolées et/ou confinées à domicile ou dans des Ehpad désaffectés.
Tout ce que nous vivions et ressentions alors – dans ces moments de terreur qui déjà s’effacent insensiblement de nos mémoires –, semblait donner l’exacte mesure de l’épuisement et de l’asphyxie contemporaines : deux métaphores, ou deux images courantes du monde d’aujourd’hui, qui, par une sorte d’ironie cruelle, avaient cessé d’être ces concepts décolorés et froids – capables de dissimuler la réalité la plus insupportable – et (re)trouvaient pour un instant la vérité nue de l’expérience concrète, brutale, massive, de cette maladie respiratoire qui tordait les corps et les suffoquaient jusqu’à la mort. L’évidence de la mort que rendait à nouveau sensible ce virus apparemment sorti de nulle part : l’évidence de nous savoir des êtres finis – « et non indéfiniment puissants »15, expliquera Nancy –, l’évidence, enfin, d’une sorte de point de non-retour de notre « civilisation technocapitaliste »16 et sa cruauté délirante. Un coup de semonce ?
No fable here,
No lesson, no singing meadowlark,
Just a filthy beggar guessing
What happens to the heart
Leonard Cohen (« Happens to the heart », 2019)
Dans l’épilogue de la réédition de El hambre, en 2021 (La faim, publié en France en 2015) – un extraordinaire essai-chronique17 consacré à cette réalité presque évanouie de nos imaginaires politiques – Martín Caparrós raconte, presque en temps réel, l’irruption du virus dans nos vies quotidiennes et le nouvel empire de la peur où nous plongeait « l’ordre du marché global »18 – pour reprendre les mots de Toni Negri dans son fameux livre Empire (2000) –, ce monde où tout le monde vivait enfermé, barricadé, « assiégé de métaphores guerrières »19, et redécouvrait la peur de mourir ; un monde où des millions de personnes supplémentaires risquaient alors de se retrouver « en insécurité alimentaire »20 – dans la langue énervée de la F.A.O.21 –, raconte Caparrós, ce qui était aussi l’expression d’une réalité nouvelle où la faim cessait du jour au lendemain d’être cette chose lointaine « qui n’arrive qu’à d’autres »22, dans les pays de « l’AutreMonde »23 … Un éloignement, ou une extranéité, qui expliquait peut-être aussi, pour l’auteur, la relégation contemporaine d’une cause – la lutte contre la faim, l’épidémie la plus meurtrière de la planète – que l’on avait fini par intégrer au système, comme disait Lyotard24, en faisant de cette lutte l’enjeu de politiques assistancielles qui avaient en quelque sorte fini par résorber le scandale de ces milliers de morts quotidiennes dans un monde qui pourrait facilement nourrir le double de sa population actuelle25. Un monde où décidément plus rien ne permettrait de remettre en cause la légitimité de « l’Empire » avec ses millions d’individus « surnuméraires [et] jetables »26, explique en substance Caparrós dans cet ouvrage hors du commun (La faim) qui repose avec force la question de la « responsabilité civile »27 de la littérature dans « l’ordre du capitalisme absolu »28, pour reprendre les mots de Jacques Rancière : un ouvrage qui donne aussi la mesure de ce qu’il en coûte aujourd’hui, de traverser « le mur de représentations mortes »29 que les discours hégémoniques disposent – ou maçonnent – tout autour de nous pour faire oublier « [ce] meurtre de masse »30, selon les mots de Günther Anders (« la responsabilité homicide »31 du capitalisme dit aussi Lordon), et notre propre aveuglement face à la réalité d’un ordre social qui finira bien par éliminer purement et simplement ces millions de personnes « qui ne servent à rien dans l’engrenage de la machine [capitaliste] »32, alerte Caparrós : que pèsera « l’opinion publique humanitaire » quand on dira (et on lira) partout que « l’on ne peut plus se payer le luxe de nourrir toute cette population inutile » – fait ainsi mine de s’interroger l’auteur ? Combien de temps encore « avant qu’on ne décide de les liquider »33 ?
« Savoir et comprendre » tels sont, pour l’auteur, les deux objectifs déclarés de cette vaste entreprise de pensée et d’écriture34 que constitue l’ouvrage La Faim, portée par la conviction profonde que l’histoire est « l’unique endroit qui peut [nous] soulager de ce cauchemar dont [nous] cherchons à [nous] éveiller »35, pour paraphraser l’un des personnages de Respiration artificielle36, le grand roman de l’écrivain argentin Ricardo Piglia publié pendant la dictature militaire en Argentine ; une conviction qui est peut-être, pour l’écrivain, le premier acte de résistance face aux malversations de l’idéologie dominante : mais par quel miracle, s’interroge Caparrós, « l’aspiration la plus ambitieuse de l’humanité [un monde sans faim, une société d’égaux] est-elle devenue une vieille rengaine dépassée et archaïque »37 ?
Leur faim c’est l’échec d’une civilisation.
L’échec insistant, brutal, éhonté d’une civilisation.
Dénutris, inutilisables, détritus.38
Un livre – une forme littéraire nouvelle –, enfin, où la colère redevient ce « sentiment politique par excellence » dont Nancy déplorait la disparition – « avec les communismes et les marxismes »39 – au tournant des années 1990 : l’expression d’un refus face à l’intolérable et le premier pas pour frayer la voie d’un « nouveau paradigme [de] l’impensable »40 …
Je n’aime pas l’idée d’ « indignation ». Je trouve que c’est un sentiment élégant, contrôlé, qu’on rencontre parmi ceux qui ont d’autres options […]. Le désespoir, en revanche, c’est ce que l’on rencontre là où il n’y a plus rien, là où ça ne peut plus attendre. […]41
Je suis favorable à l’impensable parce qu’il s’est réalisé tant de fois. […]
Un nouveau paradigme, c’est ça l’impensable. Et c’est ce qui le rend si difficile et si attrayant, tellement difficile. C’est ça qui vaut la peine d’être pensé.42
Dans les petites chroniques que Jean-Luc Nancy s’efforça de continuer à tenir au plus fort de la tempête, le sentiment de terreur allait de pair avec la conscience de la pauvreté de la parole (philosophique), qui, dans ces moments extrêmes, était – elle aussi – devenue virale, et faisait courir le risque de ne rien trouver à dire que « le déjà-dit »43, ou de tomber dans la trappe débilitante du discours dominant et ses nouveaux « signifiants-maîtres », dont Paul Audi livrera aussi une analyse précieuse dans l’épilogue de la réédition de son livre L’Empire de la compassion (2021)44. Une parole appauvrie par la tristesse et la conscience que la menace « s’ajout[ait] comme une cruauté supplémentaire à la cruauté déjà si active des famines, des persécutions, de toutes les autres épidémies, maladies endémiques et conditions de vie infâmes »45. Comprendre la virulence de la crise impliquait alors de comprendre que c’était le principe même de notre civilisation qui était en cause, pour le philosophe, qui reprenait le fil des innombrables mises en garde, au cours du siècle passé, contre « l’assurance obstinée dans la croyance au progrès et dans l’impunité de la prédation »46 – et l’illusion d’une « épopée de l’émancipation du genre humain par la raison »47 –, faisant de la pandémie de Covid-19 le symptôme d’une pathologie bien plus profonde qui rendait nécessaire de trouver urgemment un vaccin contre « la réussite et la domination de l’autodestruction »48… On sait que durant les derniers mois de sa vie, l’auteur – qui souffrait lui-même d’insuffisance respiratoire – dut faire de nombreux allers-retours entre son domicile et l’hôpital ; l’on sait aussi, ou on se l’imagine, ce qu’une telle expérience, qui donnait au fond le sentiment que nous touchions réellement à nos limites – ainsi que l’exprimera en substance Nancy dans La Peau fragile du monde un an plus tôt –, put signifier pour le philosophe :
Nous y sommes, nos cancers nous bouffent, nous bouffons des particules, partout on crève de faim et de peur, notre technologie vacille sous ses grands airs transhumains. Nous y sommes sans que personne ne sache où nous sommes.49
Dans ces propos – dont le style, délibérément abrupt, résume assez bien les enjeux de l’écriture (et de la question du toucher) dans l’œuvre de Nancy50 –, il s’agit peut-être aussi d’insister sur une sorte de point limite à l’horizon de l’expansion indéfinie de la petite entreprise occidentale – dont Nancy retrace justement la généalogie dans La Peau fragile… – et d’une « rationalité technoscientifique » dont la légitimité serait devenue à elle-même sa propre fin – cette fameuse « loi supposée naturelle » qui accompagne le « fondamentalisme [économique] libéral »51 comme son ombre pour Nancy –, excluant désormais la moindre possibilité « de lui opposer ou lui substituer une autre perspective (morale, religieuse, idéologique) »52 : comme s’il n’était plus possible « d’imaginer, autrement que sous le régime de l’utopie, un retournement, une conversion, une révolution économique et sociale »53, écriront Nancy et Bouthors fustigeant la fuite en avant du capitalisme, ou plutôt l’incompatibilité manifeste entre son principe de croissance indéfinie et « la finitude du monde dans lequel il pompe », pour Frédéric Lordon, qui insiste également sur « l’approfondissement sans précédent de [la] domination » d’un ordre social devenu aujourd’hui une « évidence absolue » – « une chose sans bords ni extérieur »54 – confinant en quelque sorte les imaginaires dans sa perpétuation indéfinie.
« Cruor » – « qui signifie [en latin] du sang répandu »55 – c’est le mot que choisira Nancy dans son tout dernier ouvrage posthume pour figurer « le nouveau monde »56 ainsi créé par notre « civilisation techno-capitaliste » où la cruauté est en quelque sorte l’aboutissement, ou le point d’achèvement ultime de ce « monde sans esprit », selon la formule de Marx, ou encore le point de bascule de sa chute vertigineuse : une cruauté sans autre objet que « le service de la domination elle-même »57, explique Nancy, qui s’interroge – dans un texte qui se présente comme une nécessaire mise à jour de son livre Corpus (1992) – sur la résurgence des motifs de « la crudité […] [et] de la cruauté »58 dans nos civilisations contemporaines, et décrit l’inexorable poussée de cette domination moderne – « du sacrifice sacré au supplice de l’inanité »59 – et l’extension sans mesure, dans les rapports sociaux (en particulier salariaux) de la souffrance, sans autre perspective que la reconduction du même et la soumission aveugle à cette « loi supposée naturelle » de production compétitive illimitée…
La peur a succédé à l’espoir : la peur d’être sacrifiés, nous et ceux qui nous suivent, par une machine qui ne broie pas seulement les forces mais les repères, les marques ou les traces du sens d’exister. La peur, donc, non de la seule mort violente mais d’une mort instillée dans les veines d’une vie managée.60
Durant la crise épidémique, la mort ne nous plaçait pas seulement devant notre finitude, expliquaient aussi Nancy et Bouthors, mais face au « non-savoir », ou plutôt, au « risque de vivre en situation de non-savoir » et de « nous accommoder collectivement de la non-maîtrise de notre histoire »61 : un risque, ou plutôt un « impératif catégorique » – cette obligation faite aux hommes ne relevant d’aucune loi, mais faisant de nous des êtres-obligés62, pour Nancy –, qui est aujourd’hui « notre seule chance »63, écrira encore le philosophe dans les toutes dernières lignes de Cruor, celle de nous savoir « exposés à cet abandon de sens »64, comme l’écrivait déjà trente ans plus tôt le philosophe, et de retrouver la foi en notre commune capacité à le reprendre. Ce que l’on sait, posait déjà Nancy dans Le Sens du monde (1993), c’est qu’ « il n’y aura plus de “raison dans l’histoire“, ni de “salut du genre humain” »65, et que nous sommes bel et bien exposés à « la fin du sens du monde »66, selon la belle expression qui résumait, pour le philosophe, l’enjeu de la pensée elle-même (« être (…) capables d’une pensée athée », ou d’une pensée « a-téléologique »67) qui se confondait alors – contre « les ternes prophètes de la fin de l’histoire »68 – avec l’urgence de penser l’après du communisme, ou plutôt d’en sauvegarder l’exigence inassouvie, cette promesse qui devait, pour Nancy, « nous dispose[r] encore en faveur d’un événement à venir, d’un à-venir capable de briser l’inertie d’un monde cumulatif fondé sur l’absence d’événement »69. Déliée de son idéalité et de toute destination finale, l’utopie deviendra alors pour le philosophe, l’enjeu d’une autre écriture, d’un autre style : « une praxis de la pensée »70, écrira Nancy, donnant en quelque sorte le ton de l’exigence d’un faire au plus près de son dire, ou de leur empiètement réciproque.
« Avec l’impatience et la colère des choses qui ne peuvent pas attendre »71, selon la belle expression de Lyotard commentant la fameuse thèse de Marx.
On se réveillait tous les matins avec les chiffres des morts, les histoires des morts, les échos des morts : avec la mort dans la tête. Tout ce que nous avons fait au cours de ces derniers mois, nous l’avons fait par peur de la mort, avec la hantise de la mort. Pour une civilisation qui passe son temps à l’occulter, ce fut une catastrophe extraordinaire –il faudra voir ce que va changer en nous. Maintenant nous savons, de ce savoir physique, si rare et si précieux. Pas sûr que l’on puisse se défaire aussi facilement de sa présence, et redevenir de parfaits et sombres ignorants.
Je ne sais pas si cela nous a rendu, ou si ça nous rendra, plus réceptifs à la souffrance de ceux qui n’en pouvaient déjà plus. Je sais en revanche que ces souffrances, ces derniers mois, se sont démultipliées. Et qu’il a bien fallu les regarder en face.
Ça a été – provisoirement – un peu plus difficile de regarder ailleurs, de jouer au con.72
Dans ce petit texte extrait de l’épilogue de « Ñamérica »73, l’auteur saisissait sur le vif la brutalité du choc provoqué par la pandémie de Covid-19 en « Ñamérique»74, ce mauvais vent qui avait déjà fait trois fois plus de victimes que partout ailleurs, et mettait à nu les inégalités vertigineuses qui dévastaient « le continent déchiré »75. Une crise qui suspendait aussi l’avenir des nombreuses mobilisations populaires qui avaient eu lieu dans plusieurs pays ñamériquains, entre 2019 et 2020, dans le sillage de la grande explosion sociale de Managua en 2018. Ces soulèvements avaient en commun leur spontanéité – leur manière de prendre massivement la rue pour se faire entendre – et le rejet de démocraties représentatives dans lesquelles plus personne n’avait la moindre confiance76, expliquait l’auteur. Ils se produisaient aussi majoritairement au sein d’une jeunesse (urbaine, étudiante) qui semblait redécouvrir le plaisir de se rassembler pour réfléchir, imaginer et construire ensemble : (re)faire de la politique, en somme, dira Caparrós.
Qu’adviendrait-il de ces colères qui avaient défié les pouvoirs (honnis) les plus solidement établis et redonnaient au mot usé et déconsidéré de « politique » une vigueur qu’on croyait à jamais perdue ?
Depuis Managua, quelques mois plus tôt (en mai 2018), l’auteur racontait :
Ces jours-ci, au Nicaragua, la vie est devenue différente. La politique –si méprisée– occupe tant d’espace : les gens s’emparent de sujets auxquels ils n’avaient jamais réfléchi, s’interrogent, imaginent. Une révolution c’est le moment où les questions changent, où l’on n’a pas forcément toutes les réponses. Ces jours-ci, dans les villes nicas, la vie est différente : dans les rues, tout peut arriver à tout instant.77
Plus que partout ailleurs, peut-être, sur ce continent qui avait incarné la promesse des utopies des mouvements de gauche révolutionnaire, la colère des insurgés – contre la brutalité du régime de l’ex guérillero Daniel Ortega – avait en ligne de mire la trahison des idéaux portés jadis, au Nicaragua, par le FSLN, et l’abandon de « l’illusion de créer des sociétés vraiment différentes »78…
[…] Quand avons-nous accepté l’idée que ça ne changera plus […]que la laideur de tant d’injustices ne nous dérange pas tant que ça, que nous savons vivre avec la misère de millions d’autres […] Comment avons-nous appris à nous dire que les choses sont ainsi et qu’on n’y peut rien, qu’il n’y a aucun moyen de les changer : qu’ainsi va le monde et qu’il en sera toujours ainsi ?79
Dans la postface de son livre Du cap aux grèves – paru en 2020, au lendemain des grandes mobilisations sociales contre la réforme des retraites en France –, Barbara Stiegler s’interrogeait aussi sur l’avenir de ces mobilisations populaires brutalement interrompues par l’apparition de la crise épidémique et des premières mesures de confinement. Un isolement qui menaçait de briser ce que la grève avait permis de commencer à reconquérir : des espaces communs et une temporalité propre– « un présent partagé et ralenti, ici et maintenant »80 – à partir desquels il devenait possible, pour Stiegler, de « renouer avec un rapport critique à ce qui nous entoure »81 (au travail, à l’école, à l’hôpital, etc.), dans tous ces endroits où se cristallise un système de pouvoir – ou des dispositifs de gouvernementalité néolibérale – sur lequel nous n’étions peut-être pas sans prise. Ainsi « la grève » figurait-elle aussi, dans le livre de Stiegler, la possibilité retrouvée d’un repli (physique autant que psychique) dans un espace libéré des impératifs mortifères de la compétition (la mobilité et l’innovation) et l’opportunité de chercher la manière de s’extraire de « la matrice eschatologique »82 (chrétienne et socialiste) qui continuait de structurer nos imaginaires de la lutte sociale et semblait nous réduire à l’impuissance. Une structure temporelle qui informait aussi, pour la philosophe, le « grand récit » néolibéral qui avait progressivement imposé – au cours du siècle passé – le cap de la compétition mondialisée (« la grande compétition pour l’accès aux ressources et aux biens »83) comme le but incontestable de toutes nos sociétés, un modèle de développement – ou plutôt « une utopie néolibérale »84 – qui « saturait tous nos horizons depuis des décennies »85, et que l’on n’acceptait plus. Qu’on se le dise, l’on assistait alors, pour Stiegler, à une mobilisation générale « contre la mondialisation et ses impératifs d’adaptation »86 qui conduisaient à « l’épuisement généralisé de toutes les ressources vitales »87 (celle des écosystèmes, des espèces, de la planète, et de nos propres ressources psychiques) et à l’explosion des inégalités partout sur la planète, ce que la crise sanitaire mettait une nouvelle fois cruellement à nu. Une mobilisation que la philosophe chroniquera presque en temps réel dans son journal de bord, Du cap aux grèves, qui est aussi le récit – circonstancié et intime – d’un basculement individuel dans l’action collective (suite à la publication de son précédent ouvrage, un an plus tôt88) et une sorte de manifeste pour « la démondialisation et [la] miniaturisation »89 des grands enjeux de la transformation néolibérale de nos sociétés contemporaines consistant, avant toute chose, à questionner notre rapport intime à ces bouleversements de nos manières de vivre et de travailler90 (dans le rapport à soi, aux autres et au monde) pour inventer des formes de résistance – individuelles et collectives – à l’emprise de la fiction néolibérale sur nos esprits et sur nos corps.91 Une articulation subtile des enjeux de résistance individuelle et collective (au point de croisement entre l’éthique et la politique) qui se traduit aussi, sur le plan de la forme (littéraire), par une tension maintenue tout au long de ce récit à la première personne, entre l’intériorité (l’isolement, la solitude du philosophe) et l’extériorité bruyante du monde. Conjurer cette séparation ne revient certes pas, dans le texte de Stiegler, à (re)faire le procès de l’impuissance – et/ou de l’irresponsabilité – de la philosophie (ou de la littérature92), mais à reposer à nouveaux frais la question (marxienne) de l’exigence pratique de la philosophie à l’ère néolibérale et celle de « la responsabilité civile » du philosophe – selon la belle l’expression de Francis Ponge – dans un monde qui est toujours, comme l’écrivait encore Nancy, « à nouveau à interpréter et à transformer »93. « Faire de la lecture et de l’écriture de nos livres, de ces activités qui nous isolent et qui nous séparent physiquement du reste du monde, ce qui nous ferait basculer enfin, en chair et en os, dans une vie collective partagée avec d’autres vivants »94, écrit encore Stiegler, qui plaide aussi dans son petit ouvrage pour un nouveau matérialisme « pratiquement-critique »95 de l’espace et de ses lieux, du temps et de ses rythmes, de la fatigue et de la joie.
« Non, depuis le 17 mars, le virus n’a pas généralisé notre grève. Il l’a plutôt violemment confisquée. Á moins que l’on réinvente la grève confinée »96, écrira Stiegler à la fin de son livre. Une grève que la philosophe reconduira effectivement – et contribuera à réinventer – dans un second récit-journal écrit et publié en 2021 (De la démocratie en Pandémie97) qui reprendra le fil de la narration interrompue par l’apparition du virus du Covid-19, et continuera l’entreprise de résistance – individuelle et collective – engagée par Stiegler pour renouer décidément avec l’usage critique de la raison face aux relations de pouvoir : un enjeu éthique et politique qui repose, avec une gravité nouvelle, la question de la responsabilité individuelle « face à l’insupportable »98, pour reprendre les mots de Paul Audi dans sa lecture de « l’art de l’indocilité réfléchie chez Foucault », et la force politique du travail critique (et ses « événements de subjectivation ») pour « transformer son mode d’être [et] […] ouvr[ir] la perspective d’un monde autre à construire, à rêver »99.
Une masse énorme d’individus souffre de la même domination au même moment, et chacun se sent pourtant tout seul ou presque, incapable en tout cas de faire corps et de se mobiliser collectivement. […] Car l’idée est bien de passer du cap aux grèves, et de notre propre destruction à notre lente et profonde réparation. Y arriverons-nous ici même, à Bordeaux, dans les couloirs de nos universités, de nos lycées et de nos hôpitaux ? »100
con la harina del ocaso
amasan otro corazón/
Juan Gelman, Incompletamente (1993-1995)
« Le monde à venir », pour l’auteur de Ñamérica, résidait encore dansl’espoir que les mobilisations populaires que l’on avait vues fleurir en Ñamérique avant la pandémie de Covid-19 – qui furent chaque fois des expériences déconcertantes, mais aussi terriblement périlleuses –, susciteraient des désirs et des formes d’organisation radicalement nouvelles parmi cette jeunesse qui était aussi la première génération à « ne pas porter dans sa chair les cicatrices des dictatures »101 et leurs répressions épouvantables; la première génération à ne plus savoir « de ce savoir physique, si rare et si précieux »…
Le problème c’est toujours ce futur absent. Dans une région –dans un monde– où les inégalités sont toujours plus brutales, n’avons-nous pas renoncé à l’aspiration à l’égalité pour nous contenter de l’éventualité qu’un de ces jours, avec un peu de chance, si les vents soufflent en notre faveur et dieu prend pitié de nous, tout le monde puisse manger à peu près à sa faim ?102
Le cas de l’Amérique Latine (de Ñamérique) n’est pas très original, continue Caparrós, partout l’imagination est en berne, et même dans les discours qui prétendent les combattre, les inégalités ne sont presque jamais rapportées à leur contraire, l’idée d’égalité, celle qui façonna nos imaginaires politiques (à gauche) pendant plus de deux siècles, rappelle Shlomo Sand103 ; une égalité que notre civilisation suppose « fondée dans une égale valeur (ou dignité) des vies humaines »104, rappelle aussi Nancy dans ses chroniques : le seul principe à partir duquel on pourrait sérieusement, pour Caparrós, travailler à construire « un avenir [commun] désirable »105, et se demander « à quoi pourrait ressembler un monde qui ne nous ferait pas mourir de honte, de culpabilité ou de découragement »106.
Rien ne fut plus impressionnant pour moi que de comprendre que la pauvreté la plus cruelle, la plus extrême, est aussi celle qui te prive de la simple possibilité de t’imaginer d’autres vies. Celle qui te laisse sans horizons, et même sans désirs : condamné à la répétition du même, inéluctable.107
Dans La faim, cet ouvrage mêlant l’essai et le genre littéraire (très latinoaméricain) de la chronique, il s’agit aussi, pour l’auteur (l’écrivain-voyageur et chroniqueur) de redonner consistance à un concept (la faim) dont nous ne voyons plus qu’il est ce qui consume et dévore les corps (« un corps affamé c’est un corps qui se mange lui-même »108) mais aussi la réalité quotidienne, obsédante, de millions de personnes n’imaginant rien d’autre pour leur propre existence. « Une expérience de vie sans promesse »109, écrit aussi Caparrós dans Ñamérica pour décrire la vie des plus pauvres dans des sociétés ñamériquaines profondément fracturées par les inégalités qu’induit (et ne cessent d’aggraver)la concentration effrénée des richesses, cette manière si naturelle – longtemps très ñamériquaine – « pour quelques-uns, de s’approprier ce qui pourrait être commun à beaucoup d’autres »110. Des inégalités multiples (de race, de genre, d’éducation, etc.) qui convergent le plus souvent vers celle qui est au fond, pour l’auteur, la plus terrible de toutes : « l’inégalité de futurs »111,l’absence totale du moindre espoir que les choses changent, « des vies signifiées d’avance »112, assignées à résidence, foutues, sans espérance. Sur « le continent déchiré » – titre du chapitre consacré à la question des inégalités dans Ñamérica –, la pauvreté frappe précisément, depuis au moins deux décennies, par la coexistence, sur un même territoire, au sein d’une même ville, de la misère extrême et de l’opulence, du luxe et de sa privation : « la différence obscène »113, dit Caparrós, celle qui humilie quotidiennement, martyrise et brise « toute possibilité d’une construction commune »114 ou d’un avenir à partager. « Limosna y represión » (« charité et répression »), écrit souvent Caparrós pour résumer la quintessence des projets ou des alternatives politiques ñamériquains(y compris – ou surtout – progressistes) de ces vingt dernières années, mais surtout pour fustiger l’absence de la moindre tentative sérieuse de remise en cause des structures de l’ordre socio-économique capitaliste qui produit (et reproduit) la misère. Les pauvres, en Ñamérique, on les « contient »115 – dans tous les sens du terme –, explique aussi longuement l’auteur, on les soutient(par des mesures d’assistance minimale), et surtout, on réprime toute velléité de renverser un ordre social qui les confine massivement dans ses marges, aux portes des villes, en lisière des quartiers luxueux, dans leurs décharges d’ordures116. Un renoncement qui est sans doute le véritable arrière-plan, dans Ñamérica, de cette réalité de souffrances qu’aucune attente, qu’aucun horizon ne semble plus pouvoir soutenir…
« Volveremos » (« nous reviendrons »), c’est le mot – ou plutôt la promesse117 – qui ponctue de nombreux passages de ce chapitre consacré à la question des inégalités en Ñamérique, leur histoire, leur brutalité, mais aussi leur arraisonnement dans les plis du discours hégémonique où prévaut désormais, par exemple, l’idée que ce qui est important c’est une certaine « mesure » dans l’appropriation des richesses communes, que celle-ci ne soit pas trop scandaleuse, « qu’il n’y ait pas trop d’extrêmes »118… Qu’il semble loin le temps « où nous recherchions l’égalité parce que l’inégalité nous semblait intolérable, immorale »119, écrit Caparrós, pointant, une fois encore, la douleur de l’abandon de l’illusion de construire en Ñamérique – premier territoire utopique de l’histoire occidentale – des sociétés réellement égalitaires ; comme il paraît loin, aussi, le temps où certains mots frappaient les corps et les esprits comme s’ils étaient neufs, « quand ils n’avaient pas été répétés et trahis dans tous les sens »120…
Un oubli – ou un parjure – qui est peut-être le fil rouge invisible tressant au plus profond de cette œuvre littéraire immense son unité et son sens : « l’exigence éthique » dont elle se soutient, pour reprendre les mots de Paul Audi, et sa façon de répondre à la question en quoi se résume, pour le philosophe, tout l’enjeu de l’éthique : « comment traverses-tu cette vie ? »121
Références bibliographiques
- Assoun, P.-L., 2012, L’École de Francfort, Paris, PUF, coll. « Quadrige » (rééd. 2016).
- Audi, P., 2005, Créer. Introduction à l’esth/éthique, Paris, Verdier (rééd. 2010).
- Audi, P., 2011, L’Empire de la compassion, Paris, Pocket (rééd. 2021).
- Audi, P., 2019, Curriculum, Paris, Verdier.
- Caparrós, M., 2014, El hambre. Un recorrido por el Otro Mundo, Barcelona, Random House, “Biblioteca Martín Caparrós” (rééd. 2021).
- Caparrós, M., 2015, La Faim (trad. Alejandra Carrasco), Paris, Buchet-Castel.
- Caparrós, M., 2021, Ñamérica, Barcelona, Random House, “Biblioteca Martín Caparrós”.
- Derrida, J., 2000, Le Toucher. Jean-Luc Nancy, Paris, Galilée.
- Ferrero, C., 2024, “Una vida en prosa: Martín Caparrós, retrato de una pasión política”, dans Aragüés J.-M., et Ferrero, C. (dir.) [2024], Disidencias. (Po)éticas de la subversión, Zaragoza, PUZ, p. 305-319.
- Fœssel, M., 2012, Après la fin du monde. Critique de la raison apocalyptique, Paris, Seuil, col. « Points Essais » (rééd. 2019).
- Gefen, A., 2021, “Littérature et démocratie”, Esprit, “Politiques de la Littérature”, 476, juillet-août 2021.
- Gombrowicz, W., 1988, Contre les poètes, Bruxelles, Éditions Complexes.
- Lordon, F., 2016, Les affects de la politique, Paris, Seuil.
- Lordon, F., 2021, Figures du communisme, Paris, La Fabrique Éditions.
- Lucbert, S., 2024, Défaire voir. Littérature et politique, Paris, ÉditionsAmsterdam.
- Lyotard, J-F., 2012, Pourquoi philosopher ?, Paris, PUF.
- Lyotard, J-F., 1993, Moralités postmodernes, Paris, Galilée.
- Nancy, J.-L. et Bailly, J-C., 1991, La Comparution, Paris, Christian Bourgois Éditeur (rééd. 2007).
- Nancy, J.-L., 2006, “Préface à l’édition italienne de L’impératif Catégorique”, Le Portique, 18 | 2006, URL : http://journals.openedition.org/leportique/831.
- Nancy, J.-L., 1993, Le Sens du monde, Paris, Galilée.
- Nancy, J.-L., 2005, La Déclosion, Paris, Galilée, 2005.
- Nancy, J.-L., 2016, Que faire ?, Paris, Galilée, 2016.
- Nancy, J.-L., 2020a, La peau fragile du monde, Paris, Galilée.
- Nancy, J.-L., 2020b, Un trop humain virus, Paris, Bayard.
- Nancy, J.-L., 2021, Cruor, Paris, Galilée.
- Negri, T., 2001, « L’“Empire”, stade suprême de l’impérialisme », Le Monde Diplomatique [en ligne], Janvier 2001. https://www.monde-diplomatique.fr/2001/01/NEGRI/7736?id_article=7736
- Piglia, R., 1980, Respiración artificial, Buenos Aires Sudamericana, col. “Narrativas argentinas” (rééd.1988).
- Ponge, F., 1967, Le parti pris des choses, Paris, Gallimard, col. « Poésie » (rééd. 1989).
- Prigent, C., 1991, Ceux qui merdRent, Paris, P.O.L.
- Quintane, N., 2021, Un hamster à l’école, Paris, La Fabrique.
- Rancière, J., 2017, En quel temps vivons-nous? Conversation avec Éric Hazan, Paris, La Fabrique.
- Sand, S., 2022, Une brève histoire mondiale de la gauche, Paris, La Découverte.
- Stiegler, S., 2019, “Il faut s’adapter”. Sur un nouvel impératif politique, Paris, Gallimard, coll. NRF. Essais.
- Stiegler, S., 2020, Du cap aux grèves. Récit d’une mobilisation, 17 novembre 2018-17 mars 2020, Paris, Verdier.
- Stiegler, S., 2021, De la démocratie en Pandémie, Paris, Gallimard, coll. « Tracts N°23 ».
Notes
- Caparrós, 2014 (2021), p. 662. Toutes les citations de cet ouvrage sont traduites par nos soins.
- Nancy, 2020b, p. 8.
- Fœssel, 2012 (2019). Dans la postface de cet ouvrage (datée de 2019), l’auteur reconnaît l’extraordinaire accélération, en quelques années, des catastrophes climatiques et la multiplication indiquant « que le monde s’est dramatiquement rapproché de sa fin ».
- Nancy, 2020b, p. 78.
- Ibid., p. 103.
- Stiegler, 2020, p. 131-133.
- Nancy, 2016, p. 108.
- Ibid. Le texte de Jean-Luc Nancy fut écrit au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 à Paris (pour le journal L’Humanité), et publié dans L’Humanité des débats des 19-20-21 novembre 2015.
- Lordon, 2021, p. 46.
- « Les forces de l’inconséquence » est le titre de la première partie de Figures du communisme.
- « J’ai la conviction que la messe poétique a lieu dans le vide le plus complet » : Gombrowicz, 1988, p. 27. À noter que le texte de Gombrowicz est issu d’une conférence prononcée par l’écrivain à Buenos Aires en 1947.
- Audi, 2011 (2021), p. 17.
- Stiegler, 2021, p. 9.
- Ibid., p. 21. La philosophe fait ici référence aux nombreux mouvements de grève qui avaient éclaté dans les hôpitaux publics avant le déclenchement de la crise épidémique, et à leur cri d’alerte : « L’État compte ses sous, on comptera les morts ».
- Nancy, 2020b, p. 40.
- Ibid., p. 32.
- La chronique est un genre littéraire à part entière – particulièrement dans la littérature latino-américaine – dont Martín Caparrós est l’un des principaux représentants. Cf. Ferrero, 2024.
- Negri, T., « L’“Empire”, stade suprême de l’impérialisme », Le Monde Diplomatique [en ligne], Janvier 2001. https://www.monde-diplomatique.fr/2001/01/NEGRI/7736?id_article=7736
- Caparrós, 2014 (2021), p. 658.
- Ibid., p. 660.
- Il s’agit de l’acronyme de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (« Food and Agriculture Organization of the United Nations »).
- Caparrós, 2014 (2021), p. 660.
- « L’AutreMonde » (« El OtroMundo ») est le nom donné par Caparrós dans ses livres aux pays les plus pauvres de la planète.
- Une expression qu’il faut prendre ici au pied de la lettre dans les textes que Lyotard consacre à l’avènement du « capitalisme impérialiste libéral » au tournant des années 1990, et sa critique des règles du jeu d’un « système » qui avait substitué à l’humanisme des Lumières une forme de « pragmatisme moins contractualiste qu’utilitariste » qui pouvait, au mieux intégrer les divergences et les désaccords, mais ne permettait en aucune manière d’en discuter les fondements. Lyotard, 1993, p. 175.
- Un constat maintes fois rappelé (et dûment étayé) par l’auteur dans ses analyses des mécanismes de la faim.
- Caparrós, 2014 (2021), p. 637.
- Ponge, 1967 (1989), p. 186.
- Par cette expression, le philosophe Jacques Rancière désigne l’ordre capitaliste qui se généralise à partir de la moitié des années 1980 dans les pays d’Europe Occidentale (souvent résumé par le fameux « No Alternative » de M. Thatcher). Cf. Rancière, 2017.
- Prigent, 1991, p. 125. L’expression est employée par le poète, dans cet essai mémorable, pour caractériser (et défendre) la nature des enjeux théoriques et politiques de l’expérimentation formelle dans le nouveau monde dit de la fin des utopies, au tournant des années 1990.
- Lucbert, 2024, p. 100.
- Lordon, 2021, p. 15.
- Caparrós, 2014 (2021), p. 634.
- Ibid., p. 635.
- Ibid., p. 10.
- Piglia, 1980 (1988). Nous traduisons.
- Il s’agit d’une inversion de la célèbre phrase prononcée par Stephen Dedalus dans Ulysse de Joyce : « L’histoire est un cauchemar dont je cherche à m’éveiller ».
- Caparrós, 2014 (2021), p. 639.
- Ibid., p. 633.
- Nancy et Bailly, 1991 (2007), p. 63.
- Caparrós, 2014 (2021), p. 655.
- Ibid., p. 651.
- Ibid., p. 655.
- Lyotard, 1993, p. 110.
- « Post-scriptum : la France en guerre contre l’épidémie de Covid-19 (2020) », Audi, 2011 (2021).
- Nancy, 2020b, p. 28. Cet ouvrage réunit les chroniques écrites par Nancy pendant les premiers mois du confinement en France. Nombre d’entre elles furent alors lues par le philosophe et diffusées sur plusieurs chaînes et médias en ligne.
- Ibid., p. 10. Citons pêle-mêle, fréquemment cités par Nancy, Husserl, Paul Valéry, Georges Bernanos, Günther Anders, etc.
- Nancy, 2005, p. 19.
- Nancy, 2020b, p. 11.
- Nancy, 2020a.
- L’on pense bien sûr au livre que Derrida consacrera à l’auteur (Derrida, 2000), mais aussi, par analogie, à l’écriture comme ars affectandi, pour reprendre l’expression de Frédéric Lordon dans ses analyses sur la politique comme ars affectandi et le pouvoir affectant des formes (Lordon, 2016).
- Nancy, 2016, p. 108.
- Nancy, 2021, p. 14.
- Nancy, 2020b, p. 102.
- Lordon, 2021, p. 33.
- Nancy, 2021, p. 9.
- Nancy, 2020b, p. 39.
- Nancy, 2021, p. 67.
- Ibid., p.12.
- Ibid., p. 69.
- Ibid., p. 71.
- Nancy, 2020b, p. 109-110.
- Nancy, 2006.
- Nancy, 2021, p. 126.
- Nancy, 1993, p. 11.
- Ibid., p. 44.
- Ibid., p. 15.
- Nancy, 2005, p. 31.
- Assoun, 2012 (2016), p. 3.
- Nancy et Bailly, 1991 (2007), p. 47.
- Nancy, 1993, p. 38.
- Lyotard, 2012, p. 97.
- Caparrós, 2021, p. 665-666. Toutes les citations extraites de cet ouvrages sont traduites par nos soins.
- La pandémie de Covid-19 interrompit l’écriture de plusieurs chroniques qui devaient être inclues dans l’ouvrage, et cet épilogue fut vraisemblablement ajouté aux dernières épreuves de l’ouvrage en juin 2021.
- C’est le nom que l’auteur donne au sous-continent latino-américain, dont l’unité tient en tout premier lieu, pour Caparrós, à une langue commune, dont la lettre « ñ » est le caractère –à la lettre– absolument distinctif.
- « Le continent déchiré » (« El continente partido ») est le titre de l’un des chapitres de ce livre consacré aux inégalités en Ñamérique.
- Que celles-ci s’inscrivissent dans la ligne néolibérale (sauvage) qui était devenue la norme au tournant des années 1990, ou dans l’héritage des gouvernements dits populistes et progressistes du début des années 2000 dont l’écrivain dresse un portrait sans concession dans son livre et ailleurs. Cf. Caparrós, 2021, p. 579-585.
- Caparrós, 2021, p. 643.
- Ibid., p. 631.
- Ibid., p. 625.
- Stiegler, 2020, p. 122.
- Ibid., p. 116-117.
- Ibid., p. 113.
- Ibid., p. 29.
- Ibid., p. 33.
- Ibid., p. 44.
- Ibid., p. 12.
- Ibid., p. 63.
- Stiegler, 2019.
- Stiegler, 2020, p. 111.
- Cette « guerre ordinaire menée aux modes de vie et de travail » dont parle aussi l’écrivaine et poète Nathalie Quintane dans son livre Un hamster à l’école (Quintane, 2021).
- Il s’agit là, selon nous, d’un enjeu éthique et politique majeur de la littérature et de la philosophie contemporaines « contre-hégémonique », pour reprendre l’expression de Sandra Lucbert (Lucbert, 2024).
- Comme le fait par exemple Alexandre Gefen dans sa tentative de théorisation des enjeux politiques de la littérature contemporaine (et d’une « littérature pragmatique »), en reprenant l’opposition (grossière) entre la figure de l’écrivain solitaire (« dans sa tour d’ivoire ») et celle de l’écrivain « dans la cité ». (Gefen, 2021).
- Nancy, 2020a, p. 172.
- Stiegler, 2020, p. 91.
- Ibid., p. 121.
- Ibid., p. 134.
- Stiegler, 2021.
- Audi, 2019, p. 185.
- Ibid., p. 179. L’auteur reprend ici les termes de Frédéric Gros, éditeur des cours de Michel Foucault au Collège de France. Dns son ouvrage, Paul Audi s’intéresse notamment aux « événements de subjectivation » du travail critique chez Foucault, évènements qui sont au cœur de la théorie « esth/éthique » de Paul Audi (et de sa définition de l’éthique), et l’une des clés de ses prolongements politiques.
- Stiegler, 2020, pp. 72-73.
- Caparrós, 2021, p. 659.
- Ibid., p. 660.
- Sand, 2022.
- Nancy, 2020b, p. 84.
- Caparrós, 2021, p. 662.
- Caparrós, 2014 (2021), p. 657.
- Ibid., p. 14.
- Ibid., p. 24.
- Caparrós, 2021, p. 225.
- Ibid., p. 179.
- Ibid., p. 190.
- Ibid.
- Ibid., p. 202.
- Ibid.
- Ibid., p. 187.
- Je renvoie ici à l’une des chroniques de Caparrós consacrée à « la Montagne », nom donné à une décharge d’ordures autour de laquelle se sont créées plusieurs « villas » dans les faubourgs de Buenos Aires. Caparrós, 2021, p. 193-199.
- Il s’agit d’une référence à la célèbre phrase que l’on attribue à Éva Perón (« Volveré y seré milliones »).
- Caparrós, 2021, p. 180.
- Ibid., p. 182.
- Ibid., p. 226.
- Audi, 2005 (2010), p. 213. L’auteur reprend ici la formule de Wittgentsein.