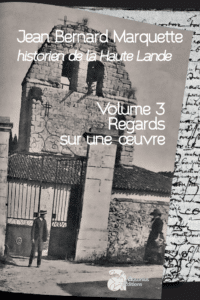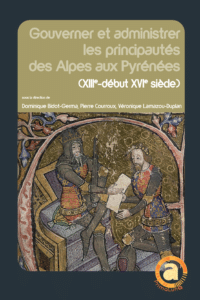UN@ est une plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine
Auteur : Frédéric Boutoulle
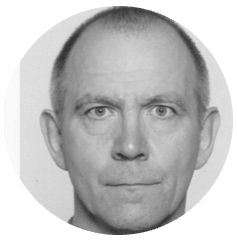
Maison de l’archéologie, Université Bordeaux Montaigne, Esplanade des Antilles, F-33600 Pessac
frederic.boutoulle@u-bordeaux-montaigne.fr
0000-0002-0928-6995
frederic.boutoulle@u-bordeaux-montaigne.fr
0000-0002-0928-6995
Frédéric Boutoulle est professeur histoire médiévale à l’Université Bordeaux Montaigne.
Mots clés
Moyen Âge, pouvoirs locaux, agropastoralisme, paysannerie, sociétés urbaines, Gascogne
Les historiens ayant travaillé sur la société féodale se sont surtout intéressés à l’aristocratie et au monde des seigneurs, à cette partie de la société détenant les pouvoirs, banaux et fonciers, et ayant produit la documentation écrite.
En 1980, alors que l’écomusée de Marquèze célèbre son dixième anniversaire, la direction du Parc naturel régional des Landes de Gascogne charge le Centre de recherches sur l’occupation du sol (CROS) de l’université de Bordeaux III, alors dirigé par Jean Bernard Marquette, et l’Institut de géologie du bassin d’Aquitaine de l’université Bordeaux I de réaliser une série d’études sur la Grande Lande.
De la Haute Lande à la lande maritime, ou de Labrit à Mimizan pour le dire autrement, d’anciennes voies, moins connues que les grands itinéraires méridiens, traversaient le pays landais. Jean Bernard Marquette les a empruntées très tôt et n’a pas manqué de s’intéresser à la lande maritime.
En 1984, Jean Bernard Marquette publie un article, divisé en deux livraisons des Cahiers du Bazadais, portant sur Bazas au XIIIe siècle.
“Nous n’aborderons pas ici l’histoire de ces familles qui reste entièrement à faire. En raison des liens qui les unissaient souvent à des familles de La Réole une telle étude ne saurait d’ailleurs être envisagée que dans le cadre du diocèse. Nous reviendrons sur les personnages que nous avons évoqués ci-dessous”.
Cet article est issu d’une communication faite à l’occasion du 53e Congrès d’études régionales de la Fédération historique du Sud-Ouest tenu à Dax et à Bayonne les 27 et 28 mai 2000, puis édité l’année suivante par la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine.
“Nous n’aborderons pas ici l’histoire de ces familles qui reste entièrement à faire. En raison des liens qui les unissaient souvent à des familles de La Réole une telle étude ne saurait d’ailleurs être envisagée que dans le cadre du diocèse. Nous reviendrons sur les personnages que nous avons évoqués ci-dessous”.
Lorsque le cartulaire de la cathédrale de Dax, le Liber rubeus ou Livre rouge que l’on pensait perdu depuis le XIXe siècle a refait surface dans les années 90, ce fut pour tous les chercheurs travaillant sur les Landes médiévales une aubaine inestimable …
Si depuis longtemps les principautés du royaume de France ont suscité de nombreuses études sur leur relation à la monarchie, leur administration, les princes qui les incarnent, des recherches récentes ont renouvelé les approches, en particulier par l’attention portée à la culture et pratique de l’écrit, aux réseaux et entourages princiers, aux expressions matérielles et symboliques de la puissance du prince.
L’enquête de 1236-1237 sur les excès des baillis royaux en Entre-deux-Mers bordelais a été enclenchée par le roi d’Angleterre Henri III en réponse à des plaintes de ses sujets gascons et du clergé de la région. L’information qui lui est remontée est consignée dans un procès-verbal, élaboré à l’initiative de deux commissaires, reposant principalement sur les dépositions de 120 représentants des paroisses de l’Entre-deux-Mers ducal.
Enquête sur les excès des baillis du roi et sur les coutumes des habitants de l’Entre-deux-Mers conduite par les commissaires d’Henri III, Jean, ancien abbé de la Grâce-Dieu et Hubert Hosat (1236-1237)
Les sources écrites éclairant les sociétés médiévales ont principalement été élaborées par les individus appartenant à la noblesse ou au clergé. La paysannerie, qui représente pourtant l’écrasante majorité de la population au Moyen Âge, n’est donc documentée par les archives que de manière indirecte.