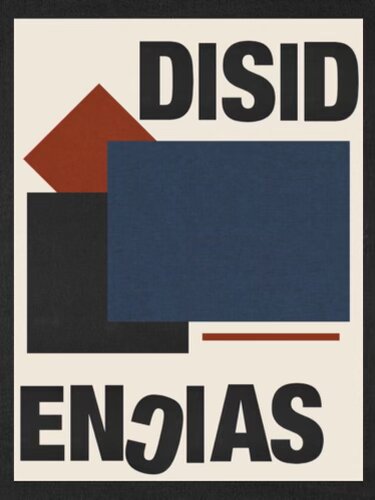Introduction
La politique consiste fondamentalement en une stratégie visant la construction de subjectivité. Du succès de cette opération dépend aussi bien l’efficace de la maîtrise exercée par le pouvoir constitué, que celle des processus de construction d’antagonisme conduits par le pouvoir constituant. Depuis les stratégies homériques – dont nous avons brossé le tableau plus haut – jusqu’aux procédés sophistiqués mis en œuvre par les moyens de communication-formation de masse, il apparaît clairement que le jeu de la politique est indissociable des processus de subjectivation. La politique a toujours su que le sujet est une chose qui demande à être modelée, ajustée aux profils de certains intérêts.
Lorsque nous parlons de “construction du sujet”, nous ne faisons pas uniquement référence à la construction du sujet individuel, mais aussi à celle du sujet collectif. Dans ce champ, les positions du pouvoir et de l’antagonisme diffèrent radicalement. L’intérêt du pouvoir se porte sur la possibilité de court-circuiter les processus de construction du sujet collectif, de nier la réalité de toute entité collective à caractère politique – à une exception près : celle de l’appartenance nationale, qui tend généralement à neutraliser les prétentions antagonistes, en n’intégrant pas la question des différences et des inégalités sociales. Inversement, tout l’effort de l’antagonisme se concentre sur la construction de sujet(s) collectif(s) comme seul et unique moyen d’intervention politique. Aussi le champ du sujet constitue-t-il le champ par excellence du combat politique.
Pouvoir constitué et construction de subjectivité
Nous ne nous étendrons pas ici sur l’analyse des processus de construction de subjectivité tels qu’ils se déploient dans le cadre des sociétés médiatiques postmodernes, car il s’agit là de questions auxquelles nous avons déjà consacrées plusieurs études1. Nous nous contenterons seulement de rappeler, parmi toutes les stratégies existantes, celles qui, selon nous, s’avèrent les plus efficaces. Nous entreprendrons cette tâche de manière globale, sans entrer dans le détail des fluctuations auxquelles est sujette cette efficacité en raison des mutations sociales, elles-mêmes produites par la crise actuelle.
S’il est vrai, comme nous le disions déjà, que la politique a toujours consisté en une lutte pour la construction de subjectivité, on constate qu’au sein des sociétés contemporaines, là où la présence de la technologie s’est massivement intensifiée, la capacité du pouvoir constitué à générer des processus de subjectivation a connu, pour sa part, une croissance exponentielle. On pourrait même dire que nos sociétés ont souvent flirté avec ce que Marx dénommait la “subsomption réelle du travail sous le capital”, ce processus en vertu duquel le sujet s’identifie pleinement à la société dont il est membre, et finit par perdre toute capacité antagoniste. Le capitalisme, dont l’histoire est écrite en lettres de feu et de sang, comme l’annonçait déjà Marx2 dans le cadre de l’analyse qu’il consacre aux processus d’accumulation primaire et à la naissance de l’ordre manufacturier, a donc su produire des formes de domination où la séduction est venue prendre la place de la contrainte ; un processus auquel les médias de masse ont contribué activement, en y tenant un rôle de première importance.
En effet, les médias d’information de masse ont orchestré des dynamiques de domination depuis deux domaines privilégiés. En premier lieu le domaine de l’information, où les médias ont développé une pléthore de stratégies destinées à modeler idéologiquement les sujets. Le monopole de l’information a ainsi donné lieu à une forme de clonage idéologique, qui a rendu presque impossible le développement d’un regard critique. L’autre domaine dans lequel les médias ont, dans ce contexte du capitalisme de consommation, promu des modèles de subjectivité ajustés au millimètre près aux nécessités du système, est celui de la publicité et de l’industrie du divertissement. C’est d’ailleurs ce phénomène qui a conduit Jesús Ibáñez à affirmer que “l’individu est l’objet le plus soigneusement fabriqué par le système capitaliste”3.
Il convient de signaler que les processus de construction de subjectivité à l’œuvre dans les sociétés contemporaines reposent essentiellement sur de puissants mécanismes de séduction. Au sens étymologique du terme, le sujet sé-duit est conduit hors de lui avec une efficacité telle, qu’il finit par s’identifier à ce qui lui est offert, qu’il s’agisse d’un comportement, d’un produit ou d’une idée. Or, c’est bien là que réside toute la puissance politique du capitalisme contemporain : dans sa capacité à produire, chez les sujets, des logiques d’identification. En ce sens, le capitalisme s’est converti, comme l’analyse Frédéric Lordon4, en une machine de production d’affects et de désirs, qui finissent par constituer la subjectivité depuis l’extérieur d’elle-même. Si l’on tient donc à conserver le concept d’aliénation, il nous faudra désormais l’entendre au sens d’un processus de construction de subjectivité orchestré depuis l’extérieur, où se situe à présent cet alienus auquel renvoie le concept, et non plus comme la perte d’une essence supposément originaire.
Il nous faut ajouter à cela, comme l’ont montré Christian Laval et Pierre Dardot5, que le néolibéralisme a imposé une série de “techniques de soi” qui, en faisant endosser au sujet la seule responsabilité de ses succès ou de ses échecs, promeuvent ainsi l’alignement des actions subjectives sur les nécessités du système. Au moyen de concepts comme ceux d’“employabilité” ou de “formation sur la base de compétences”, le néolibéralisme inscrit donc dans le sujet lui-même la nécessité de se modeler conformément à ce que la société, et plus précisément sa configuration socio-économique, attend de lui. C’est ainsi que le sujet s’auto-discipline et se constitue, mais qu’il le fait toujours, que ce soit sous l’effet de la crainte ou de la conviction, avec le sentiment que c’est à lui, et à lui seul, qu’incombe la responsabilité de prendre telle ou telle décision.
Cet ensemble de stratégies débouche sur la construction d’un sens commun qui, sous ses airs de naturalité, ne fait que reconstruire et reconduire les paramètres idéologiques d’une société donnée. G. Lakoff en vient même à poser l’hypothèse selon laquelle ce type de pratiques conduirait à l’érection de cadres cognitifs en dehors desquels les sujets seraient privés de toute réceptivité6.
Il s’ensuit alors une situation passablement paradoxale, dans laquelle le néolibéralisme, tout en s’efforçant de construire un sujet fortement individuel et doté de traits distinctifs très marqués, se fait également un devoir de rendre impossible la construction de sujets collectifs. En ce sens, si le néolibéralisme entend réaliser la fiction libérale du sujet isolé et dépourvu de tout lien, c’est bien parce qu’une telle fiction lui permet de court-circuiter l’action politique antagoniste. Un procédé qui, en ce sens, valide la thèse de A. Matheron selon laquelle “le pouvoir politique est la confiscation par les dirigeants de la puissance collective de leurs sujets”7.
Antagonisme et construction de subjectivité
Si, comme nous l’avons soutenu plus haut, faire de la politique c’est intervenir sur les processus de construction de subjectivité, alors aucun projet antagoniste ne peut faire l’économie d’une connaissance approfondie de ces processus. Comme le souligne F. Lordon, “on ne lutte radicalement contre l’imaginaire néolibéral qu’en s’attaquant à son noyau dur métaphysique, c’est-à-dire à son idée d’homme. L’imaginaire antidote est donc un imaginaire anti-humaniste théorique, un imaginaire anti-subjectiviste”8.
En ce sens, il nous semble indispensable de revenir sur les principales questions qui ont jalonné la longue histoire du dévoilement de la fiction subjectiviste telle qu’élaborée par la tradition idéaliste. La compréhension de ces processus de constitution de la subjectivité nous semble essentielle pour mener à bien la tâche de construction d’une politique à caractère antagoniste.
En premier lieu, intéressons-nous à ce que Deleuze nomme “la splendeur du “ON””9. Face à l’idée selon laquelle le sujet est constitué d’un noyau dur, d’une essence constitutive et propre qui l’accompagne dès sa naissance ; et face à une conception du sujet comme origine, l’approche matérialiste de Deleuze pose que ce sujet est un effet, et le produit de multiples déterminations extérieures. Le sujet est l’effet d’une sorte de cristallisation ou d’un pliage de lignes et de forces qui le précèdent et qui, de cette manière, concourent à sa constitution. De la sorte, pour Deleuze, la subjectivité ne peut, à proprement parler, être conçue comme l’origine pleine et entière de l’énonciation, mais plutôt comme un instrument d’expression de lignes discursives préexistantes, où la singularité doit être entendue comme jeu et variation. Ainsi pouvons-nous comprendre que c’est en fonction de la puissance de ces lignes d’extériorité que la constitution de la subjectivité s’orientera dans une direction ou dans telle autre.
Intéressons-nous dans un second temps à la remise en question radicale de la fiction libérale de l’individu, entendu comme entité autosuffisante possédant des caractéristiques clairement définies. Depuis un positionnement matérialiste, on ne peut que souscrire au caractère relationnel de la subjectivité, et valider la sixième thèse sur Feuerbach, dans laquelle Marx établit, comme il a été dit, que l’essence humaine est l’ensemble des rapports sociaux constitutifs du sujet. Il serait d’ailleurs difficile de trouver dans la nature un être plus dépendant et relationnel que l’être humain. Depuis le moment de sa gestation, la vie de l’être humain est une vie de rapports et relations, une vie imbriquée dans un autre corps, dont elle ne se séparera pas entièrement après la naissance. Plus encore, cette naissance, loin de constituer le moment d’affirmation de l’individualité, marque en fait, pour le sujet, le point de départ d’une démultiplication des liens et rapports du sujet. Il n’y a donc rien de plus fictif que la conception libérale d’un individu isolé, et autosuffisant ; fiction à laquelle Marx donnait le nom de “robinsonnades”. On pourrait même dire que chacun des gestes accomplis par le sujet, depuis le simple fait d’ouvrir un robinet jusqu’à celui de lire un livre, implique un lien, le plus souvent invisible, avec d’autres sujets. Par ailleurs, un lien privilégié et décisif s’est établi, au sein de nos sociétés médiatiques, entre la subjectivité et l’extériorité médiatique. Un lien qui, comme l’explique Jean Baudrillard, transforme le sujet en “terminal de multiples réseaux”10, rompant une nouvelle fois avec la fiction de l’individu isolé. C’est la raison pour laquelle cet individu dont nous parle le libéralisme ne pourrait exister qu’au prix d’un geste radical, impliquant la sortie du sujet hors de la communauté et, ce faisant, son repli dans l’état d’isolement le plus complet. Cependant, il n’est pas certain que l’ermite soit la figure que le libéralisme ait à l’esprit quand il entend théoriser sur l’individu. Buñuel, avec la grâce qui était la sienne, sut poser un regard ironique et perspicace sur cette tentation ascétique dans Simon du désert, un moyen métrage mémorable qui met en lumière les redoutables difficultés que rencontrerait un sujet qui entreprendrait de devenir cet individu isolé dont nous parle le libéralisme.
Revenons à présent sur le sens et l’origine de l’idée qui conçoit la différence comme élément constituant de la subjectivité. En troisième lieu, et en rapport avec ce qui précède, la différence accède au rang d’élément constituant de toute subjectivité. Celle-ci étant constituée, comme le dit Marx, par “l’ensemble des rapports sociaux”, elle possédera nécessairement des profils différentiels qui la distingueront des autres subjectivités. Il n’existe pas deux subjectivités qui possèdent les mêmes rapports sociaux, raison pour laquelle il ne saurait y avoir deux sujets identiques. Ni même un sujet identique à soi, dans la mesure où les rapports sociaux constitutifs du sujet ne cessent de changer au cours du temps. C’est précisément ce caractère différentiel du sujet que Spinoza, dans son Éthique, avait déjà mis en lumière face au courant dominant de la Modernité qui, pour sa part, ne ménageait aucun effort pour faire la théorie d’une nature humaine commune. Ce qui apparaissait ainsi résumé dans la proposition LI de la troisième partie de son Éthique :
Des hommes différents peuvent être affectés de différentes manières par un seul et même objet, et un seul et même homme peut être affecté par un seul et même objet de différentes manières en des moments différents.11
Enfin, en quatrième et dernier lieu, il nous faut insister, face à ce que soutient la tradition, sur le rôle central joué par les éléments non-rationnels dans la constitution de la subjectivité ; une question à tout point de vue cruciale et dont on ne saurait faire l’économie dès lors qu’il s’agit d’œuvrer à la construction d’un discours politique efficace. Et c’est une nouvelle fois à Spinoza que revient le mérite d’avoir compris avant l’heure le rôle fondamental que jouent les affects et les désirs dans la configuration des pratiques subjectives. Marx, encore marqué par l’influence des Lumières et de l’hyper-rationalisme hégélien, ne prêta pas suffisamment attention à ces questions et articula son programme autour de la construction d’une conscience de classe, adossée à la compréhension – éminemment rationnelle – des processus du capital. Or, il ne fut pas le seul à s’engager dans cette voie étroite, et rappelons qu’une partie non négligeable de la tradition marxiste lui emboîta le pas. En revanche, il se trouve que, pour sa part, le capital sut comprendre à la perfection le rôle central que jouent les dynamiques désirantes chez les sujets, ce qui le conduisit très tôt à faire de la séduction, comme nous le disions plus haut, l’une de ses stratégies de domination les plus efficaces : “La séduction, la séduction, tel est notre sacerdoce, il n’y a rien d’autre sur Terre, c’est le seul moteur de l’humanité”12, assène l’un des publicistes mis en scène par l’écrivain F. Beigbeder dans son roman 14,99 €. Comme le soulignèrent fort bien Deleuze et Guattari dans les pages de L’Anti-Œdipe, le désir fait partie intégrante de l’infrastructure sociale, en ce sens qu’il constitue une force (ou un principe) ontologique parcourant toujours déjà le champ social-historique13, ce qui implique de penser une véritable politique du désir nous permettant, comme l’explique José Luis Rodríguez García, de “construire une nouvelle multitudo qui prenne la forme d’une socialisation des machines désirantes”14. C’est pourquoi des penseurs comme A. Gutiérrez-Rubí estiment qu’il est impératif de prêter attention à la forme du message, et non plus seulement aux contenus. Il s’avère en effet fondamental de savoir quelles sont les stratégies les plus efficaces permettant de capter l’intérêt et l’attention du sujet, étant entendu que la rationalité d’un discours n’est en aucun cas gage d’efficacité :
Un intérêt rénové pour les émotions et les perceptions, compris comme des éléments centraux de la communication politique a pris une importance nouvelle en Europe et sur les scènes politiques les plus proches. La politique progressiste, installée d’ordinaire à cheval entre la vanité idéologique et l’arrogance programmatique, semble commencer à interroger ses propres pratiques, à l’intérieur comme à l’extérieur des espaces organiques. Obsédée par le désir d’avoir toujours raison, par l’argument décisif ou la proposition inégalable, elle assiste – incrédule et stupéfaite – à ses défaites face à des adversaires qui ont fait de la simplicité, du radicalisme et de la clarté leurs principaux atouts électoraux. Convaincue d’incarner la “meilleure” option qui soit et d’être porteuse d’un “projet” à haute teneur “sociale”, elle ne comprend pas pourquoi les électeurs ne reportent pas massivement leurs voix sur elle. L’orgueil blessé, qui interdisait jusqu’à présent tout exercice d’autocritique, commence à faire place à une réflexion sereine. À leur grande surprise, les progressistes sont en train de découvrir qu’ils avaient abandonné le terrain de l’émotionnel (valeurs, sentiments, émotions…), et n’avaient jamais tenu compte de la perception citoyenne. D’autres, pour l’instant, occupent le terrain : il s’agit des conservateurs, qui savent bien mieux manier le verbe et les gestes.15
Il est donc indispensable, pour engager la bataille de la construction de subjectivité depuis des positions matérialistes et antagonistes, d’aborder la question médiatique. Nous avons déjà fait allusion à la puissance des médias, conçus comme des instruments de construction de subjectivité. Si l’on peut parler du caractère proprement médiatique de nos sociétés, c’est bien parce que les médias sont devenus de véritables générateurs ontologiques, en cela même – pour paraphraser Bourdieu – qu’ils produisent des effets sur le réel16. C’est pourquoi nos sociétés font l’objet d’une nouvelle fracture, celle-là même qui sépare les producteurs de réalité de ceux qui en sont les consommateurs. La production de réalité, au sein des sociétés capitalistes, est étroitement liée au pouvoir économique, auquel revient la propriété privée des grands groupes de communication et, par suite, le monopole de la production ontologique. Or, sans une production ontologique antagoniste, il sera impossible d’engendrer une conscience antagoniste.
D’autre part, on retrouve dans cette question de la société médiatique la dichotomie relative à cette double condition rationnelle et désirante de la subjectivité. Et c’est la raison pour laquelle une intervention médiatique de type antagoniste doit, comme le sait par ailleurs si bien le capital, s’adresser également à ces deux facettes constitutives de la subjectivité. Comme le note en effet F. Lordon, les médias sont des machines à produire des affects, pour ne pas dire qu’ils sont, de loin, la machine la plus puissante en termes de construction d’affects17. Or, dans le champ de la communication, les forces antagonistes se sont toujours adressées, quant à elles, de manière presque exclusive, à une subjectivité rationnelle. Ainsi ont-elles privilégié la dimension informative et développé de minutieuses et substantielles analyses de la réalité. Mais les effets de subjectivation découlant de cette stratégiese sont révélés fort modestes, et ce, à notre sens, pour deux raisons principales. D’abord et avant tout, parce que la puissance informationnelle de type antagoniste a un champ d’action très limité, et ne peut se mesurer à la puissance informationnelle systémique. Ensuite, parce que la dimension désirante de la subjectivité, et principalement la question de la séduction, dont le consumérisme capitaliste a le secret, ont été amplement négligées.
Et c’est d’ailleurs là où la question de la communication a été abordée avec le plus grand sérieux que les positions antagonistes ont fait leur chemin avec force, comme ce fut le cas en Amérique du Sud. La prise en compte de l’importance cruciale de l’information a ainsi débouché sur la prolifération de médias de type antagoniste, comme la chaîne de télévision vénézuélienne Telesur, mais aussi de législations, comme celle qui, en Equateur, permit à la société civile de créer et de gérer ses propres moyens de communication. Mais on constate aussi l’émergence d’une réflexion orientée vers la nécessité d’agir sur la dimension désirante de l’imaginaire social, et la prise de conscience que pour convaincre, il faut séduire. Les formats de divertissement constituent en ce sens un instrument efficace de production de pratiques subjectives (attitudes, valeurs) qui pourraient être réinvestis avec profit depuis des positions critiques. Tel est d’ailleurs le constat qu’établit l’activiste vénézuélienne Lorena Freitez :
Nous en sommes restés à des formats du type bulletin d’information, alors que l’adversaire avance silencieusement au moyen de formats qui s’avèrent hautement séduisants.
Et de conclure finalement, consciente que la bataille communicationnelle est, au premier chef, un combat politique :
On ne peut pas continuer à voir les téléspectateurs changer aussitôt de chaîne. Il nous faut engager une lutte pour gagner en audience et cela relève, fondamentalement, d’une politique de séduction, nous devons gagner le cœur de notre public.18
Dans cette optique, il s’agit donc d’utiliser la communication pour rendre enfin visibles des voix, des cultures et des positions politiques qui sont invariablement marginalisées par les chaînes des médias dominants. Ce qui est aussi en jeu, notamment au travers d’émissions de divertissement, c’est de pouvoir influer sur les processus de construction de subjectivité, en promouvant des valeurs et des pratiques antagonistes, ou de véritables “contre-conduites”, pour reprendre les termes de Foucault.
En définitive, il s’agit d’imposer l’hégémonie d’une rationalité alternative, de construire un sens commun antagoniste. Or, pour ce faire, et bien que cela puisse paraître paradoxal ou du moins inattendu, il faut impérativement recourir à une politique des affects. La critique du sens commun, compris comme effet ou résultante de l’idéologie, est un lieu commun de la littérature marxiste que la pensée antagoniste contemporaine a très largement développé. Cette critique oscille entre deux propositions : l’une de caractère gramscien, qui fait le pari de la construction d’un nouveau sens commun, et que Sousa Santos s’emploie à développer en parlant de sens commun critique ; l’autre, que l’on trouve dans les écrits de Deleuze19, qui condamne sans détour l’idée même de sens commun. Selon nous, ces deux positions s’accordent sur deux points. En premier lieu, elles pointent l’emploi de la penséecomme instrument de normalisation, de construction d’une subjectivité ainsi soumise aux intérêts dominants. Deuxièmement, elles soulignent le fait que la production d’une pensée alternative est empêchée par l’absence d’un sol ontologique capable d’en assurer l’engendrement. C’est ce qui permet d’expliquer le fait que l’imagination acquière une importance fondamentale dans le champ éthique, étant donné qu’il ne s’agit pas seulement de s’opposer aux pratiques dominantes, mais aussi et surtout d’en produire de nouvelles. C’est d’ailleurs ce que Sartre suggérait déjà dans ses Conférences de Cornell, où l’“invention” apparaît comme une stratégie de production de valeurs, car, poursuit-il, “à toute action pratique correspond un moment éthique qui est celui de l’invention”20. L’ethos de la subjectivité antagoniste est ainsi précédé, comme dirait Nietzsche, d’un “non” ferme adressé à toutes les valeurs établies, mais aussi d’un élan positif et proactif qui ne préexiste dans aucune inscription ontologique originaire, mais demande au contraire à être inventé. Dans cette ontologie du futur, dont les traces ne sont pas encore visibles dans notre présent, toutes les valeurs et les pratiques qui les accompagnent doivent alors être imaginées.
Mais pour en finir avec les inerties liées à l’habitude et aux manières de penser et d’agir promues par le sens commun systémique, la puissance des affects s’avère indispensable. Comme nous l’avons vu, la rationalité et le bien-fondé de la plupart des propositions émanant de positions antagonistes ne fait pas l’ombre d’un doute. Et pourtant, nous ne parvenons toujours pas à faire de ces manières de voir le monde la chose du monde la mieux partagée… Il ne s’agit pas seulement de produire des idées, des projets ou des discours, mais aussi et surtout de chercher à les empuissantiser, c’est-à-dire à les doter de puissance et d’efficacité – en somme, à les rendre hégémoniques. Comme nous le rappelle Bourdieu citant Spinoza : “il n’y a pas de force intrinsèque de l’idée vraie”21. Dans son Traité politique, Spinoza avait déjà mis en exergue le fait que c’est dans le champ des affects que s’ébauchent les processus de construction de subjectivité collective :
Les hommes étant conduits par la passion plus que par la raison, comme on l’a dit plus haut, il s’ensuit que si une multitude vient à s’assembler naturellement et à ne former qu’une seule âme, ce n’est point par l’inspiration de la raison, mais par l’effet de quelque passion commune, telle que l’espérance, la crainte ou le désir de se venger de quelque dommage (ainsi qu’il a été expliqué à l’article 9 du chapitre III).22
Afin de doter ces idées d’une efficace, il s’agit donc avant tout, comme l’explique Lordon, de “faire voir ce que je vois, avec la même intensité que celle avec laquelle je le vois”23. En effet, cette vision collective se transforme en générateur de sympathie et de sentiment d’appartenance commune, lesquels permettront de faire naître à leur tour des pratiques et des aspirations également partagées. Ce qui constitue la base d’une “épidémiologie passionnelle de la sédition”24.
Politique et différence
Il n’est pas surprenant que l’ouvrage qui est peut-être le plus puissant traité matérialiste d’ontologie du XXe siècle, Différence et répétition, de Gilles Deleuze, nous offre les éléments nécessaires à la construction d’une politique antagoniste de longue haleine. Aucun matérialiste ne peut éluder la question du rapport étroit unissant ontologie et politique, car il est impossible d’élaborer une politique sans penser les conditions ontologiques de sa production. En ce sens, lorsque Deleuze, dans un passage mémorable, distingue les deux modes de la différence, il signale en réalité deux modalités indissociables de la politique, “dont l’une est capable de tout changer”25. Ainsi écrit-il:
Considérons les deux propositions : seul ce qui se ressemble diffère ; et seules les différences se ressemblent. La première formule pose la ressemblance comme condition de la différence ; sans doute exige-t-elle aussi la possibilité d’un concept identique pour les deux choses qui diffèrent à condition de se ressembler ; et implique-t-elle encore une analogie dans le rapport de chaque chose à ce concept ; et entraîne-t-elle enfin la réduction de la différence à une opposition déterminée par ces trois moments. D’après l’autre formule au contraire, la ressemblance, et aussi l’identité, l’analogie, l’opposition ne peuvent plus être considérées que comme les effets, les produits d’une différence première ou d’un système premier de différences.26
Que seul diffère ce qui se ressemble, ou que seul puisse se ressembler ce qui diffère, loin d’être un habile jeu de mots, suppose de faire valoir, dans le premier cas de figure, le primat de l’identité sur la différence (selon la ligne dominante de la philosophie occidentale), alors que le deuxième implique, pour sa part, de revendiquer la différence comme origine et, par conséquent, de remettre en cause toute identité.
Nous avons déjà expliqué en d’autres lieux27 que la simple référence au concept de différence ne saurait nullement suffire pour l’élaboration d’une stratégie antagoniste adéquate. Il ne fait aucun doute que le concept de différence a progressivement acquis une importance philosophique de premier rang tout au long du XXe siècle. Nombreux sont les penseurs qui, de Heidegger à Deleuze, en passant par Derrida, Vattimo et Lyotard, lui ont consacré de nombreuses études. A cet égard, Deleuze nous invite à considérer l’existence de ce que l’on pourrait dénommer des “voies de la différence”, que l’on pourrait distinguer en deux grandes tendances. La première, que l’on qualifierait volontiers d’“hégélienne”, se caractérise par sa prétention à dynamiter l’idée d’identité prédominante tout au long de l’histoire de la pensée. Une voie qui, selon nous, demeure prisonnière de son propre geste et de son inertie fondamentale, tous ses efforts d’annihilation de l’identité ne faisant, en dernière instance, qu’en renforcer la présence. Comme si promouvoir la différence revenait paradoxalement à renforcer le primat de l’identité. C’est ce qu’illustre à ce propos le discours lyotardien de la différence, dont nous pensons qu’il constitue l’illustration la plus parfaite de cette manière de faire, et qui se fourvoie dans un exercice de différenciation illimité débouchant sur une ontologie de l’archipel. Si pour en finir avec l’identité, il faut privilégier la différence, et mettre en relief tout ce qui nous sépare d’autrui, alors nous courons le risque d’entrer dans une spirale sans fin où s’engendreront des micro-identités, qui tendront, à leur tour, et par logique interne, à être déconstruites. Le concept lyotardien du “différend” porte en son sein (dans ce “nd” qui en latin exprime indique les formes de l’obligation) l’impossibilité même d’un véritable processus de différentiation. Nous avons besoin de produire de la différence, semble dire Lyotard. Un exercice qui, par ailleurs, s’avère d’une grande simplicité, car quoi de plus facile que de voir tout ce qui nous sépare d’avec notre voisin. Mais cet exercice peut se révéler politiquement désastreux dans la mesure où une telle conception de la différence nous entraîne dans une direction contraire en tout point à cette production du commun que nous voulons défendre, et produit in fine des politiques de l’identité vouées à l’accentuation de nos différences. Enfermés dans leurs idiolectes, les “différends” perdent du même coup toute capacité de dialogue et de rencontre.
La deuxième grande voie de la différence, au contraire, propose de faire de celle-ci une donnée première, soit l’indiscutable réalité qui caractérise le sujet qui, pour reprendre les termes de Marx, est un individu social, ou le produit de l’ensemble de ses rapports sociaux. Cette deuxième voie, et elle seule, est selon nous à même de nous permettre d’entreprendre la recherche ou la construction d’éléments communs permettant à leur tour l’élaboration d’une pratique commune. La différence se tient toujours déjà là, de sorte qu’il n’est nullement besoin de la provoquer ou de la soutirer à une identité préétablie. Il s’agit plutôt de construire, à même une différence constitutive, des identités qui seront nomades et partielles, inéluctablement soumises au devenir du réel. C’est bien pourquoi cette deuxième voie de la différence, comme dit Deleuze, “est capable de tout changer” : elle conduit en effet à une compréhension de la politique où il n’existe plus de sujets politiques (pré-)définis, à l’image de la classe ouvrière traditionnelle28 ; ce qui permet justement d’envisager de nouvelles manières de construire la politique, en se situant au-delà des cadres traditionnels propres aux identités historiquement figées. Telle est donc la politique de la multitude envisagée sous l’angle d’une stratégie du commun.
Production de la multitude, production du commun
Dans les pages qui suivent, nous entreprendrons la critique, radicale dans le premier cas, et plus nuancée dans le deuxième, du concept de “multitude” tel qu’il a été élaboré par Paolo Virno, d’un côté, et par Toni Negri et Michael Hardt, de l’autre. Pour nous, la multitude désigne le sujet politique – à construire – des processus contemporains. Or, pour ce faire, il nous paraît important de préciser ce que nous entendons par multitude, et tout ce qui ne nous semble pas en faire partie. Ce désir de précision conceptuelle ne doit pas être entendu comme la marque d’une quelconque intransigeance politique. Engager une polémique avec ces penseurs ne signifie pas pour autant que nous les considérions comme des adversaires, bien au contraire, c’est à partir d’un positionnement commun qu’il s’agit d’engager la discussion. Parallèlement, même si nous avons adopté le concept de “multitude” pour désigner le sujet antagoniste, nous ne nous sentons en aucun cas tenus de combattre politiquement ceux qui ont fait le choix d’un autre concept. Et ce d’autant moins que nous avons consacré un chapitre aux problèmes que suscite l’adoption de tel ou tel langage. D’une certaine manière, la position que nous adoptons ici reste proche – mais sans doute moins inflexible- de celle Marx, dont on sait qu’il faisait preuve d’une intransigeance sans faille dans le champ théorique (comme en témoignent ses multiples polémiques avec des auteurs de son entourage), mais qu’il pouvait se montrer beaucoup plus conciliant dans le domaine politique, comme l’atteste d’ailleurs sa politique d’alliances, qui débordait largement le strict cadre idéologique qui était le sien.
Comme nous l’avancions plus haut, Virno élabore une conception de la multitude avec laquelle nous sommes en total désaccord. En récupérant – dans le but de l’inverser – la position de Hobbes, Virno en vient à opposer les concepts de “multitude” et de “peuple” et, ce faisant, engage une polémique qui déborde largement le cadre du XVIIe siècle avec des penseurs qui, depuis des positions politiques fort proches (comme c’est le cas de Laclau et Dussel), donnent au sujet politique antagoniste le nom de “peuple”. Mais au-delà de cette question, ce qui nous semble particulièrement inopportun dans la position de Virno, et il en va de même pour Negri, tient au fait de considérer la multitude comme un sujet donné par avance. En effet, pour Virno, la multitude est constituée par les travailleurs post-fordistes, lesquels ont en quelque sorte fait de “l’Intellect Général”, c’est-à-dire du savoir collectif, leur outil privilégié. On le sait, Marx concevait l’Intellect Général comme un capital fixe, c’est-à-dire comme le tissu technologique et productif élaboré par le savoir social et capté par le capital. Pour Virno, en revanche, “l’Intellect Général” désigne également le savoir nécessaire aux travailleurs pour mener à bien leurs tâches :
Il n’est pas difficile aujourd’hui d’élargir la notion de general intellect bien au-delà du simple cercle du knowledge, dont la matérialisation est le capital fixe. L’ “intellect général” englobe ainsi les modèles épistémiques qui structurent la communication sociale et qui innervent l’activité du travail intellectuel de masse, lequel ne saurait être réduit au “travail simple”, c’est-à-dire à une pure dépense de temps et d’énergie. C’est donc au travers de la puissance productive du general intellect que convergent les langages artificiels, les théorèmes de la logique formelle, les théories de l’information et des systèmes, les paradigmes épistémologiques, certains segments de la tradition métaphysique, les “jeux de langage” et les images du monde. Au sein des processus contemporains du travail, nous trouvons des constellations conceptuelles à part entière qui fonctionnent par elles-mêmes comme des “machines” productives, sans avoir, pour ce faire, à adopter un corps mécanique ou des entrailles électroniques.29
Le travailleur post-fordiste, selon Virno, a donc recours à l’Intellect Général pour manier la technologie présente sur son lieu de production ; et c’est en procédant de la sorte qu’il accède simultanément au rang d’intellectualité de masse et de multitude. En d’autres termes, la multitude est une catégorie sociologique, et non politique, au travers de laquelle l’on reconnaît la manière d’être d’une certaine force de travail. Virno considère que le langage est l’instrument fondamental du travailleur post-fordiste ; et comme le langage est pour lui une caractéristique universelle, il fait du travailleur post-fordiste et, du même coup, de la multitude, un sujet universel :
Les “nombreux” sont, aujourd’hui, les travailleurs post-fordistes. Soit ceux qui, en travaillant, mobilisent toutes les facultés génériquement humaines, à commencer par la faculté du langage. Ces facultés sont communes et partagées. Il serait donc erroné de croire que la multitude puisse se réduire à un simple tourbillon d’éclats particuliers. Il s’agit ici de tout autre chose. Alors que, pour le peuple, l’unité est une promesse, c’est-à-dire une fin, l’universalité est, pour la multitude, une prémisse, son point de départ immédiat. L’universel-promesse se confond avec la synthèse étatique ; l’universel-prémisse, pour sa part, désigne le langage.30
On comprend mieux alors que la proposition politique de Virno n’ait d’autre objectif que celui d’éroder l’unité étatique et de promouvoir un processus d’exit, d’exode, ou de fuite, censé permettre le développement de la singularité individuelle. En ce sens, Virno se situe de plain-pied dans cette première voie de la différence à laquelle nous faisions référence auparavant, et dont l’objectif consiste, sur la base d’une unité préalable, et d’une essence partagée, à promouvoir des processus de singularisation. Le trait distinctif de la multitude réside dans sa capacité à amorcer de tels processus, de sorte que “la multitude n’affaiblit pas, mais radicalise le processus d’individuation”31. Or, une fois de plus, Virno se réfère à Marx pour nommer la figure de subjectivation censée résulter de ce processus : l’individu social32. Chez Virno, la multitude se présente donc sous forme d’une force centrifuge, soit comme l’expression de multiples irrégularités politiques33 s’arc-boutant sur un processus d’exode, dont le résultat est une république qui n’a absolument rien à voir avec l’État34.
La proposition de Virno comporte cependant des points dignes d’intérêt, comme cette approche en vertu de laquelle l’exode ou l’exit doit se caractériser par une “invention sans préjugés qui modifie les règles du jeu et rend folle la boussole de l’adversaire”35, ou celle qui fait de la désobéissance radicale la base de toute politique antagoniste36. Toutefois, nous ne partageons aucunement sa conception de la multitude. Et la raison principale en est que, selon nous, une telle conception est empreinte de fortes doses d’idéalisme. Il nous est ainsi difficile de souscrire à la thèse qui fait du langage l’apanage exclusif de la forme-travail telle qu’elle s’incarne chez le travailleur post-fordiste, même si l’on peut bien reconnaître qu’au sein de nos sociétés hyper-technologiques la communication linguistique accuse une présence bien plus marquée que dans les sociétés antérieures. Mais il nous paraît abusif de déduire, à partir de la caractérisation du travailleur fordiste par le langage et de la définition du langage comme caractéristique humaine universelle, que le travailleur post-fordiste et, du même coup, la multitude possèdent un caractère universel. Sans même parler de l’eurocentrisme d’une telle approche, qui fait fi de l’existence de masses de travailleurs fordistes aux quatre coins du globe, et dont le travail garantit notre consommation au quotidien. Les universaux, outre le fait qu’ils n’expliquent rien, comme Deleuze et Guattari leur en font le reproche37, sont de surcroît dépourvus de toute réalité. Et même si nous étions prêts à accepter la thèse du langage comme lieu d’ancrage pour une universalité humaine, cela reviendrait à reconduire une abstraction qui ne tient aucun compte de la multiplicité des langages et des idiomes, y compris au sein d’une même langue. Or, comme nous l’avons souligné dans le chapitre antérieur, nous nous trouvons face à un grand nombre d’idiolectes qui demandent plutôt à être traduits, afin d’ouvrir à un véritable processus de compréhension réciproque.
D’autre part, le fait de comprendre la multitude comme un sujet déjà donné, de l’appréhender, pour ainsi dire, d’un point de vue sociologique, conduit à en désamorcer la charge politique. Il n’est pas certain que la multitude, en tant que sujet d’un processus politique antagoniste, soit déjà présente en nos lieux de travail et dans nos rues. Partir du principe que nous disposerions d’emblée de cet outil revient, de notre point de vue, à oublier la tâche politique fondamentale qui demande à être réalisée dès à présent, et qui n’est autre que la construction d’un tel sujet.
Enfin, comprendre la politique comme un processus d’exode, comme s’il s’agissait d’encourager des processus de promotion de la singularité, implique à nouveau une conception idéaliste du sujet et débouche, de surcroît, sur des politiques identitaires idiotes (du grec idion, qui désigne ce qui est propre à un groupe social, et par suite, le particulier) qui constituent un obstacle à la construction du commun. L’idéalisme d’une telle conception de la subjectivité tient en effet à cela que Virno part d’une abstraction, celle d’un sujet traversé de part en part par le langage ; abstraction qui le conduit à conceptualiser une essence commune, à laquelle seraient adjoints les traits distinctifs dont le sujet se dote en se construisant lui-même, alors que la réalité est précisément inverse, comme nous l’avons montré dans les pages qui précèdent. Nous pensons plutôt, en nous appuyant sur Spinoza et Marx, que le sujet est défini par la différence, et que son caractère social – contrairement à ce que soutient Virno – lui confère d’emblée ces traits distinctifs qui le singularisent. Par conséquent, l’action politique, loin de réaffirmer des différences originaires, se doit au contraire de partir de cette singularité pour construire le commun.
Dans le cas de Negri et Hardt, nos points de désaccord ne sont pas aussi catégoriques, et ce en partie parce que la position qu’adoptent ces deux penseurs au sujet de la multitude et du commun s’avère plutôt ambiguë. Ambiguë en cela que dans certains textes nos deux auteurs défendent, dans le sillage de Virno, l’idée de la multitude comprise comme sujet déjà donné, alors que dans d’autres, cette dernière est présentée comme résultat d’un processus de construction.
L’archéologie du concept chez Negri prend sa source, comme nous le savons, dans l’œuvre de Spinoza, penseur auquel il a consacré de nombreuses et passionnantes études. Cependant, comme chez Virno, Negri fait référence au XVIIe siècle anglais et reprend les critiques formulées à l’encontre de la multitude, notamment par des penseurs comme Hobbes ou Filmer, ainsi que la défense qu’en font les Bêcheux et les Niveleurs38.
Essayons d’abord de déterminer les contours du concept de multitude chez Negri. Comme chez Virno, la multitude est assimilée aux travailleurs post-modernes dont l’outil commun est le langage. Negri accentue l’idée de classe, et comprend la multitude comme une classe qui s’étend au-delà des limites qui correspondent traditionnellement à la classe ouvrière. Le travail immatériel, que Negri considère comme caractéristique de notre époque, la post-modernité, est constitutif de la multitude. Cette multitude, contrairement à la classe ouvrière, se caractérise par la multiplicité, la différence ; elle est donc la somme des singularités qui allient leurs efforts dans le cadre de l’action politique antagoniste :
Nous définissions également la multitude comme un concept de classe ; en d’autres termes, la multitude est la multitude des travailleurs en tant qu’ils sont pris dans un nouveau rapport productif, lequel correspond à un nouveau mode de production qui se caractérise, fondamentalement, par la valorisation au travers du travail cognitif et immatériel. Ceci ne signifie pas que le travail matériel ou physique cesse d’exister. Ce que nous soutenons, c’est que le travail cognitif, l’esprit en tant qu’il est mis au travail, constitue l’axe central autour duquel s’articule et se réélabore actuellement la valorisation du capital. Ce qui veut dire que le concept de multitude, bien qu’il soit un concept de classe, ne consiste pas pour autant en un concept de masse. Bien au contraire, sa définition fait de lui une réunion de singularités […]. Toutefois, la singularité est définie par la coopération, par le fait d’exister au travers de la coopération avec l’autre, d’exister par le biais d’un contact linguistique avec les autres singularités de la multitude. De ce point de vue-là, la production consiste en une production, non seulement de marchandises, mais aussi de subjectivités.39
Face à la transcendance du peuple, la multitude se caractérise, quant à elle, par une immanence radicale qui s’ajuste constamment au devenir social, dont elle est, à titre de pouvoir constituant, la cause et l’effet. Enfin, nous pouvons ajouter que la multitude négrienne entre en résonance avec le concept de “commun” avec lequel il partage de nombreuses caractéristiques.
Ceci étant posé, apparaît pour nous le problème politique majeur, celui relatif à la construction du sujet, à la construction de la multitude. Comment la multitude prend-elle forme ? C’est là une question à laquelle les textes négriens n’offrent pas de réponse très claire, mais plutôt un enchevêtrement de deux propositions souvent contradictoires. Une ambiguïté qui n’est pas même à mettre au compte d’une évolution de sa pensée, car il n’est pas rare de trouver au sein d’un même texte ces deux positions contradictoires. Sans compter, d’autre part, que la question de la multitude demeure étroitement liée à celle du commun, au sujet de laquelle on retrouve les mêmes hésitations et contradictions.
Dans les pages de l’ouvrage dont le titre fait directement référence au problème que nous soulevons ici, Multitude, la conception du commun, (défendue par Negri et Hardt), alterne successivement entre celle qui conçoit le commun comme l’effet de l’action politique de la multitude, et celle qui en fait le présupposé de cette même multitude. “Le commun que nous avons en commun, en fait, n’est pas tant découvert qu’il est produit”40, affirment-ils dans l’introduction à leur livre, avant de revenir sur leurs pas une dizaine de pages plus loin et d’ajouter de manière contradictoire que :
En revanche, la multitude désigne un sujet social actif, qui agit à partir de ce que les singularités ont en commun. La multitude est ainsi un sujet multiple, intérieurement différencié, qui ne se construit pas et n’agit pas à partir d’un principe d’identité ou d’unité (et moins encore d’indifférence), mais à partir de ce qui lui est commun.41
Il s’agit donc là de deux conceptions distinctes du commun qui impliquent à leur tour deux conceptions différentes de la genèse de la multitude. Dans le premier cas, le commun est compris comme la conséquence du processus politique, comme le résultat des luttes, en fonction desquelles il croît ou s’amenuise proportionnellement ; et qui sera tantôt mis en déroute par le pouvoir, ou qui grandira dans l’action politique antagoniste. Dans cette perspective, on comprend mieux l’importance de la question de la propriété communale des terres lors de la révolution anglaise du XVIIe siècle, et l’opposition qui en résulta entre la privatisation et la clôture des forêts et des landes communales défendue par la bourgeoisie naissante et l’aristocratie, et la revendication de l’élargissement des biens communs portée par les classes populaires:
Les mouvements des levellers, des diggers, le mouvement démocratique qui aspirait à faire de la nature et donc de la propriété des terres un commun, furent éliminés militairement et les normes de la propriété privée s’imposèrent comme des normes essentielles à la constitution de l’État.42
Le sujet politique, la multitude, comme l’attestent d’ailleurs les débats de Putney de 164743, se construit autour d’un programme politique partagé,dont la vocation est d’exprimer les ambitions et les désirs communs. C’est pourquoi, comme le soutient Negri à l’occasion d’une interview :
Construire est une possibilité qui nous est toujours offerte. Nous sommes l’expression de ce désir du commun, et personne ne peut nous y faire renoncer.44
Une telle position a le mérite de synthétiser ce que Negri nomme les “impératifs de la démesure”, dont l’un des énoncés est le suivant : “construis le commun”45. Cependant, il existe au sein des textes de Negri une autre lecture du commun qui conçoit ce dernier comme quelque chose de donné, de préalablement constitué, et en quelque sorte soustrait à l’espace et au temps, ainsi qu’aux luttes politiques. Et, à l’instar de Michel-Ange qui, selon ses propres dires, se limitait à extraire du bloc de marbre blanc de Carrare la statue qui y était enclose, la multitude se présente alors comme l’expression de ce commun qui nous constitue toujours déjà. Au même titre que chez Virno, le commun est donc conçu comme une donnée préalable à laquelle correspond un sujet constitué. Et de même que chez Virno, il nous est impossible de ne pas voir dans une telle approche la trace encore palpable d’un certain idéalisme déshistoricisant.
Toutefois, au sein même de ce qui peut nous apparaître comme une contradiction, s’esquisse une possible voie d’explication de la logique négrienne, même si elle peut sembler inutilement alambiquée. À la lecture des textes du philosophe italien, il s’avère que ceux où le commun est compris comme production s’avèrent être les plus nombreux ; ce qui pourrait laisser penser que telle est bien sa position à ce sujet. Quant à la question portant sur la construction de la multitude, les choses nous semblent beaucoup plus claires, et c’est Negri lui-même qui en clarifia les termes dans la réponse qu’il apporta à notre question à l’occasion d’un colloque à l’Université de Saragosse en 2015 : la multitude est un collectif constitué. Ce qui, mis en parallèle avec d’autres textes où il est dit que “le passage de la multitude de singularités à la constitution du sujet politique se produit au travers du “militantisme du commun” tel qu’il est conduit par ces mêmes singularités”46, vient ratifier l’idée selon laquelle la multitude, en dépit du fait d’être déjà donnée et constituée, ne peut pour autant pas encore être identifiée à la catégorie de sujet politique. C’est pourquoi Negri fait allusion au “devenir-Prince de la multitude” comme processus par le biais duquel la multitude en vient à acquérir la dimension politique qui, jusqu’alors, lui faisait encore défaut : “Le “devenir-Prince” est le processus par lequel la multitude apprend l’art de s’autogouverner et invente des formes démocratiques d’organisation sociale durables”47, écrivent Negri et Hardt dans Commonwealth. Néanmoins, la solution négrienne nous paraît problématique pour deux raisons, l’une politique, et l’autre théorique. La première tient au fait que cette manière de poser le problème nous rappelle par bien des aspects la distinction marxienne, au demeurant classique et peu opérationnelle, entre classe “en soi” et classe “pour soi” ; distinction en vertu de laquelle la multitude serait assimilée à la première (la classe “en soi”), et le Prince à la seconde (la classe “pour soi”). En procédant à pareille redistribution, nous nous enlisons à nouveau dans un sociologisme regorgeant d’un certain essentialisme, et aux yeux duquel il y aurait des sujets déjà donnés, mais dépourvus de conscience et d’opérativité. Quant à la deuxième raison, théorique cette fois-ci, elle tient au fait que Negri, afin d’effectuer pareille opération, fusionne ses deux sources privilégiées, ses bien-aimés Spinoza et Machiavel, qu’il semble lire à travers un prisme gramscien, et selon une torsion argumentative qui, comme nous tenterons de le montrer plus avant, pourrait sans doute être résolue par le biais exclusif de l’appareil conceptuel spinozien.
Désir de multitude
Après avoir analysé les deux principales définitions du concept de multitude, nous voudrions tenter de développer, dans le cadre d’un dialogue critique avec ces dernières, notre propre conception de la multitude.
Notre réflexion sur la multitude part de l’idée que cette dernière est un sujet politique qui demande à être construit. Contrairement aux sujets politiques traditionnels, comme la classe dans la tradition marxienne, ou les nouveaux sujets sociaux de la tradition “soixante-huitarde”, nous pensons que la multitude ne se réduit pas à la figure d’un sujet aux profils prédéfinis mais encore non conscient de soi. En ce sens, elle n’est pas cette sculpture encore contenue à l’état occulte dans le marbre, comme ont pu la théoriser, dans le sillage de traditions passées, des penseurs tels que Virno o Negri. La multitude désigne au contraire un sujet ouvert, en construction, nomade, qui croît et décroît, qui se nourrit de multiples singularités et s’articule autour d’un programme et d’un désir : le désir d’une nouvelle vie dont le programme renverse de manière radicale l’ordre des priorités dont se prévaut le capital. Cette multitude étant un sujet en construction, il s’avère alors essentiel d’aborder le processus de sa constitution en tant que sujet antagoniste à part entière ; un processus qui doit prendre appui sur des stratégies que nous détaillerons dans les pages qui suivent.
En premier lieu, la construction du sujet antagoniste, auquel nous donnons le nom de “multitude”, doit permettre de relativiser l’importance que l’on attache à la question de sa dénomination. Virno et Negri misent sur le concept de multitude, alors que Laclau et Dussel lui préfèrent celui de peuple. Il ne fait aucun doute que le XVIIe siècle fut le théâtre d’un débat politique passionné entre ceux qui, comme Hobbes, se firent les avocats du concept de peuple et ceux qui, à l’image de Spinoza, défendirent plutôt celui de multitude. La tradition antagoniste postérieure utilisa pour sa part indistinctement ces deux dénominations, sans abandonner pour autant son ambition de définir clairement un sujet révolutionnaire. Cette tradition antagoniste a d’ailleurs longtemps fait montre de sa propension à discuter jusqu’à satiété du bien-fondé des concepts, alors que, selon nous, tout l’intérêt devrait porter sur les pratiques. “La preuve du pudding, c’est qu’on le mange”, disait Engels. De la même manière, le pudding-peuple et le pudding-multitude peuvent bien avoir des goûts différents, ils sont tous deux les ingrédients indispensables d’une même cuisine révolutionnaire. Les polémiques théoriques sont sans nul doute nécessaires, mais elles doivent savoir s’effacer devant les exigences pratiques. En ce sens, et contrairement à ce que soutient Negri48, nous ne croyons pas qu’il soit nécessaire de considérer que la multitude est l’expression de l’immanence, alors que le peuple serait, pour sa part, la manifestation de la transcendance ; la première conception impliquant la différence, et la seconde demeurant exclusivement rivée sur l’unité. Nous pensons, bien au contraire, qu’il est des manières immanentes et transcendantes de comprendre ces deux concepts. Nous préférons utiliser ici le concept de multitude, mais tout en gardant à l’esprit la possibilité de partager un espace politique commun avec tous ceux qui lui préfèrent le concept de peuple. Plus encore, nous souscrivons pleinement aux propos de Santiago Alba Rico lorsque ce dernier, dans l’introduction au livre de Fernández Liria En defensa del populismo, soutient que, pour élaborer une politique en accord avec les intérêts de la majeure partie de la population, ce qu’il s’agit de faire, c’est bien de “construire un peuple en tant que tel, par le biais d’un projet commun”49. Néanmoins, nous ne partageons pas la tonalité platonicienne qui caractérise la réflexion de ces deux penseurs, et qui les conduit à opérer un dénigrement féroce d’auteurs tels que Negri ou Deleuze. Il y aurait beaucoup à dire sur la manière, pour le moins surprenante, selon laquelle Fernández Liria rabat la devise de la Révolution française “Liberté, égalité, fraternité” sur la philosophie platonicienne réactionnaire50 ; ou sur l’interprétation que propose Alba Rico du concept rousseauiste de “volonté générale” (entendu comme l’expression de cette politique de la majorité51) ; ou encore à propos de la stratégie de Liria visant à présenter les intérêts de la majorité sociale, c’est-à-dire d’une partie de la société, comme s’il s’agissait d’intérêts universels52. Nous sommes enclins à une certaine méfiance envers un arsenal théorique et conceptuel qui entretient des rapports si étroits avec l’idéalisme, et nous considérons que, pour fonder une politique antagoniste, il s’avère bien plus efficace de dénoncer les racines platoniciennes du pouvoir constitué, ou de remettre en cause un universalisme qui n’a que peu à voir avec les véritables dynamiques sociales et qui, une fois de plus, contribue à masquer la question de la différence. Cependant, toutes ces polémiques théoriques, aussi intéressantes soient-elles, et quelles que soient leurs implications politiques, ne devraient pas nous faire oublier qu’il existe une volonté commune de construire un sujet politique antagoniste, indépendamment par ailleurs du nom que les différentes traditions philosophiques ont bien voulu lui donner.
D’autre part, construire la multitude suppose au préalable de considérer que celle-ci n’a toujours pas été construite. Affirmer cela, convenons-en, est une lapalissade, mais qu’il est nécessaire de rappeler à la lecture des textes de Negri et de Virno. Le fait de comprendre la multitude en l’espère d’un corps prédéfini qui resterait dans l’attente d’être activé comporte de nombreux inconvénients. Tout d’abord, cela nous obligerait à définir préalablement un tel corps, avec le risque concomitant d’exclure de cette définition tous les possibles constituants pratiques qui pourraient y prendre part. En effet, si la multitude est censée renvoyer, comme le soutient Negri, à la classe des travailleurs exploités par le capital, qu’en est-il alors de tous ces sujets qui, sans appartenir à la sphère du travail, font le choix de la lutte politique ? Que faire de ceux qui, objectivement, et pour le dire en un langage classique, appartiennent à des strates sociales privilégiées mais qui, toutefois, décident d’intervenir et d’agir à l’encontre de ce qui pourrait relever de leurs intérêts ? Ensuite, une telle conception de la multitude nous met d’entrée de jeu face à cette distinction toujours si délicate et embarrassante entre le sociologique et le politique (l’en-soi et le pour-soi), dont on sait combien elle a pu peser sur nos traditions. Enfin, pareille conception octroie à nouveau un poids déterminant à la théorie ; or, s’il est bien un lieu dans lequel la pratique doit pouvoir se transformer en critère de vérité, ainsi que Marx le réclamait53, c’est sans nul doute celui de la politique. Plus encore, les nouveaux types de mobilisations dont nos sociétés font aujourd’hui l’expérience, mettent en évidence la pluralité du sujet, son caractère parfois inhabituel et inattendu, à tel point qu’il semble même permis d’affirmer que le sujet se construit au travers d’un processus, comme le soutient Montserrat Galcerán54, ou de comprendre, pour pousser le raisonnement jusqu’au bout, comme le font les membres du Comité Invisible, que “ce n’est pas “le peuple” qui produit le soulèvement, [mais que] c’est le soulèvement qui produit son peuple, en suscitant l’expérience et l’intelligence communes, le tissu humain et le langage de la vie réelle qui avaient disparu”55. Car, tel que précisé quelques lignes plus bas, “nul ne saurait dire ce que peut une rencontre”56, comme nous avons d’ailleurs pu en faire l’expérience lors du Mouvement 15-M sur les places et dans les rues de notre pays. Par conséquent, et conformément au caractère multiple de la multitude (et maintes fois théorisé), il s’agit non pas de restreindre la définition de la multitude à un quelconque a priori, mais de considérer plutôt l’importance déterminante des processus pratiques eux-mêmes.
Concernant l’importance de Spinoza au regard de la question de la multitude, il nous semble important de souligner un point dont Negri, grand spécialiste au demeurant de l’auteur de l’Éthique, ne tient pourtant pas compte. En effet, Spinoza oppose la catégorie de multitude à celle de foule (vulgus, plebs), tout en faisant de la première le résultat de la politisation de la seconde. Tandis que Negri, qui se saisit du concept de multitude de manière descriptive, se voit contraint, moyennant un revirement problématique, de recourir au concept machiavélien de prince, et d’évoquer par suite un “devenir-Prince de la multitude”. Or, il nous paraît bien plus simple et opportun de nous en tenir au texte spinozien, et de comprendre la multitude comme le fruit de la transformation politique de la foule. Cette dernière, pour sa part, est en dernière instance toujours soumise aux passions individualisantes, lesquelles l’empêchent d’acquérir une dimension politique active, la joie personnelle primant pour Spinoza sur l’intérêt collectif, comme le souligne leTraité théologico-politique où l’on peut lire que “ce n’est pas en effet la raison, mais les passions seules qui gouvernent la foule, livrée sans résistance à tous les vices et si facile à corrompre par l’avarice et par le luxe”57. En outre, et ce parce qu’elle accuse, comme le montre Spinoza, une absence de rationalité, la foule est en proie à la superstition58, et ses fins et ses objectifs en viennent même à contredire la caractéristique humaine par excellence (individuelle aussi bien que collective), à savoir, la permanence dans l’être :
Tous ces objets que poursuit la foule, pouvons-nous lire dans le Traité de la réforme de l’entendement, non seulement n’apportent aucun remède pour conserver notre être, mais ils y font même obstacle et, souvent cause de la perte de ceux qui les possèdent, ils sont toujours cause de la perte de ceux qui en sont possédés.59
Face à la dispersion d’une foule exclusivement rivée sur ses intérêts particuliers, la multitude est présentée en diverses occasions dans le Traité politique comme un collectif œuvrant sous l’égide d’un seul esprit60. La politique spinozienne confère une place de choix à la raison, puisqu’elle entend qu’il s’agit là d’un instrument privilégié afin de promouvoir l’accord entre les sujets, afin de les rendre libres et heureux. La raison permet, non seulement de prendre des décisions qui rapprochent les êtres humains les uns des autres, en cela que “c’est dans la seule mesure où les hommes vivent sous la conduite de la Raison qu’ils s’accordent toujours nécessairement par nature”61, mais aussi de les rendre libres – “je dis que l’homme est parfaitement libre en tant qu’il est conduit par la raison”62 –, en plus de moduler leurs passions afin de les orienter vers la joie, et non vers la tristesse et la confrontation, comme cela arrive fréquemment avec la foule. Cette dernière question, relative à la modulation des passions et des affects, nous semble d’une importance cruciale dès lors qu’il est question d’élaborer une politique qui ne s’articule pas exclusivement autour de la dimension rationnelle de l’être humain.
À ce stade, et dans le but de mettre l’accent sur cette dimension constructive du sujet politique, il nous paraît intéressant de nous référer à la théorie des groupes de J.-P. Sartre, au sein de laquelle il est possible de dénicher des points faisant écho à la démarche spinozienne, notamment en ce qui a trait au passage d’un collectif dépolitisé à un sujet politique doté de caractéristiques antagonistes. Il se trouve en effet que, dans le premier des deux épais volumes de la Critique de la raison dialectique, Sartre élabore une théorie des “ensembles pratiques” qui traite de ces processus politiques collectifs, de leur origine et leur développement.
Sartre envisage ces processus à partir de trois concepts fondamentaux qui répondent respectivement aux différents moments de la concrétion des collectifs humains : la série, le groupe et l’institution. La série désigne un collectif dont l’être provient d’un élément qui est extérieur à ladite série, et qui permet de la reconnaître en tant que telle. Il s’agit en ce sens d’un collectif objectif, reconnaissable, mais auquel fait défaut la conscience de soi. Plus encore, la solitude y apparaît comme un trait caractéristique des individus qui composent la série, et peut même parfois en devenir l’objectif. C’est le cas dans l’exemple que donne Sartre de l’arrêt de bus, où l’individu a toujours la possibilité de s’abîmer dans la lecture du journal pour s’abstraire du monde alentour, de sorte que “la solitude est un projet”63. Au sein d’autres types de collectifs, comme celui auquel appartiennent les auditeurs d’une émission de radio, la solitude est d’emblée présente et constitutive64. En tant qu’ils en sont les composantes, les membres d’une même série sont interchangeables ; ils sont identiques et n’ont pas de singularité ni de spécificité, ils jouent tous le même rôle par rapport à l’objet extérieur qui est celui qui les rassemble en une série65. La dimension politique fait donc défaut à la série qui se révèle lourde d’une passivité qui découle de sa propre inconsistance. Sartre assimile ainsi la série à la classe en-soi marxienne, c’est-à-dire à un collectif sociologique exempt d’une quelconque virtualité politique.
Au contraire, le groupe désigne un collectif doué d’une conscience de soi, et dont l’unification se fait précisément au travers de l’instauration d’un projet commun. Sartre distingue cependant le groupe en fusion du groupe proprement dit. Le groupe en fusion renvoie au collectif en tant qu’il commence à prendre conscience de soi ; une prise de conscience qui découle d’une intuition collective qui les réunit autour d’une finalité partagée, bien qu’encore non précisée, et qui débouchera sur une pratique commune. En ce sens, le groupe en fusion demeure subordonné aux élans d’un “tiers régulateur”, c’est-à-dire d’un sujet qui, pour des raisons souvent méconnues, parfois parce qu’il dispose par hasard des moyens requis (une chaise sur laquelle se tenir debout, un mégaphone…), est alors capable de déclencher un mouvement collectif. Les mobilisations qui eurent lieu autour du Mouvement du 15-M adoptèrent la forme d’un groupe en fusion, forme qu’elles parvinrent à conserver pendant des mois. De nombreux “tiers régulateurs” orientaient alors les pratiques (mais dans une atmosphère instable) qui prirent des formes capricieuses avant de finir par se volatiliser. Le groupe proprement dit suppose, pour sa part, la concrétion d’un projet qui permette de définir les limites et les pratiques du collectif qui demeurent subordonnées à un processus de constante reconfiguration. Chez Sartre, comme on peut le voir dans ses derniers écrits théoriques66, il s’avère que le groupe repose sur la “fusion ontologique”67 de sujets qui se caractérisent par des projets individuels différents, mais qui sont toutefois capables de trouver des points de convergence à partir desquels élaborer une pratique commune. En ce sens, le groupe, au même titre que la multitude, est la somme des singularités qui, tout en conservant leur différence, s’engagent en même temps sur la voie d’une production du commun. C’est pourquoi nous considérons que la théorie des groupes de type sartrien s’accorde parfaitement avec les approches spinoziennes, comme l’a d’ailleurs déjà souligné Hadi Rizk68, et qu’elle constitue un instrument idoine pour articuler une proposition politique antagoniste. Plus encore, comme semble le montrer la dernière version de sa théorie des ensembles pratiques, Sartre nous met en garde contre le risque que le groupe évolue vers ce qu’il dénomme l’institution, c’est-à-dire vers un collectif qui a perdu de vue ses objectifs initiaux, et qui ne s’intéresse désormais plus qu’à sa propre reproduction et conservation. Tel est donc le moment où le pouvoir constituant se solidifie en un pouvoir constitué. Or, il nous paraît indispensable de mettre en lumière cette tendance qui travaille habituellement les collectifs et les processus révolutionnaires, et avoir à l’esprit que pareille analyse nous lance un défi majeur : celui qui consiste à articuler une pratique politique de type “liquide” ; concept développé par Zygmunt Bauman, mais que nous utilisons ici pour désigner ce juste milieu entre le caractère éthéré des groupes en fusion et les textures solides du groupe institutionnalisé.
Car la multitude, tout comme la marée, croît et décroît. Ses caractéristiques sont difficilement définissables, et fluctuent au gré des luttes et des processus sociaux. La multiplicité constitutive de la multitude, ne peut elle-même se constituer qu’au travers de la pratique, laquelle lui confère en retour son pouvoir constituant. Et c’est une véritable clé qui permet de comprendre les présupposés sur la base desquels la multitude doit être construite. Le premier d’entre eux tient à la définition d’un projet politique qui permette de faire émerger la multiplicité constituante au travers d’une pratique partagée. Et ce projet passe par la construction du commun. Cette idée du commun, récemment récupérée par la théorie politique, s’avère indispensable pour définir un projet politique de caractère matérialiste. Une idée du commun, disions-nous, où ce dernier est défini collectivement au sein de la multitude, faisant en sorte que leurs territoires respectifs se confondent : l’extension de la multitude sera définie par le commun, et les limites du commun seront le fruit d’un accord au sein de la multitude. C’est pourquoi nous souscrivons pleinement à la formule de Montserrat Galcerán qui ouvre le dernier chapitre de son ouvrage Deseo (y) libertad:
Pourquoi nous faut-il réinterpréter la politique, non plus comme un “art de gouverner”, mais comme un “art de construire le commun”.69
Le commun possède des particularités historiques, il est le fruit de luttes, de victoires et de défaites. Lorsque Marx, par exemple, consacre une série d’articles au vol de bois dans les forêts allemandes, il n’a pas d’autre intention que de se faire l’avocat de l’exploitation communale de ces forêts face à ce qui constituait la politique des classes dominantes, qui, depuis le XVIe siècle, tentaient de privatiser les propriétés communales. Une telle opération politique de privatisation du commun va de pair avec une opération théorique, menée à bien par le libéralisme, qui consiste à faire de la propriété privée la seule forme possible de propriété. Se joue alors une bataille pour l’appropriation du commun, dont le néolibéralisme, obsédé par la privatisation des biens et des services, a su reconduire la logique et redoubler l’intensité. Le combat actuel pour l’éducation, la santé ou l’eau, définit le champ où se livre aujourd’hui la lutte pour le commun et pour une caractérisation de la multitude strictement inverse à ce que C. Laval et P. Dardot appellent la “seconde vague d’enclosures”70, en référence à la politique d’expropriation du commun par imposition de clôtures (enclosure) qui fut à l’origine de la guerre civile qui déchira l’Angleterre du XVIIe siècle. Le commun, loin de désigner une chose donnée par nature, et contrairement à ce que soutient Virno avec un aplomb idéaliste certain, relève d’une décision politique. Aussi pourrions-nous dire, en des termes plus spinoziens, que l’extension du commun dépendra de la puissance de la multitude. Une référence à l’auteur du Traité politique dont la célèbre formule tantum iuris quantum potentiae, contient la clé de la définition du commun et de la multitude. Comme le soulignent à nouveau Laval et Dardot :
Bien plutôt convient-il de l’abandonner et de renoncer une fois pour toutes à l’idée qu’il existe des choses par nature inappropriables pour fonder vraiment et entièrement en droit l’inappropriabilité.71
Plus le sujet politique sera puissant ; plus la puissance de la multitude augmentera, et plus il pourra développer un droit du commun. En ce sens, l’instauration du commun comme programme politique de la multitude devient l’élément rationnel au fondement d’une politique matérialiste antagoniste. Il ne fait aucun doute qu’une telle politique doit être forte d’une dimension rationnelle, capable de s’exprimer au travers d’un projet, d’un programme. Un programme qui doit en quelque sorte porter et exprimer le conatus de la multitude72, soit la possibilité, pour la majorité sociale, de persévérer dans son être, de survivre. Si chez Spinoza le concept de conatus possède une dimension strictement individuelle, il nous paraît cependant impératif d’en proposer une lecture sociale, et ce dans le but de soutenir toutes les pratiques, éthiques et politiques qui s’avèrent bénéfiques pour la survie de l’espèce. C’est là qu’apparaît le commun, le koinon, au travers de ce processus d’élaboration d’un projet collectif, d’une praxis politique partagée. Même si, comme nous le verrons par la suite, cette nouvelle politique antagoniste ne peut en aucun cas être fondée sur la seule et unique dimension rationnelle du sujet.
En effet, comme nous en faisions déjà état plus haut, l’être humain n’est pas constitué exclusivement d’éléments rationnels, et l’un des grands points faibles de la politique révolutionnaire tient depuis longtemps à son mépris historique pour les composantes affectives et désirantes de la subjectivité. La phase inaugurale de la Révolution russe fait peut-être exception, car les avant-gardes comprirent vite la nécessité de faire appel à l’émotionnel pour la conduite d’une politique révolutionnaire. Par exemple, tandis que Vertov, défendait, avec sa théorie ô combien naïve du “ciné-œil”, une conception documentaire du cinéma qui prétendait recueillir et faire connaître le réel (pour générer une conscience de classe), Eisenstein élaborait de son côté un “ciné-poing”, capable d’impacter le spectateur, et le forcer à voir une réalité nouvelle en s’adressant aux profondeurs intimes de son être. Le capitalisme a parfaitement compris que la politique doit impérativement prendre en considération cette dimension subjective et passionnelle des individus. Pourquoi continuons-nous de voter pour des projets qui, objectivement, portent atteinte à nos intérêts ? Tout comme nous achetons de manière compulsive et irréfléchie des produits qui nous déplaisent (ou dont nous n’avons pas l’usage), nous agissons en politique selon des paramètres qui font davantage appel à l’émotionnel ou à l’esthétique qu’à la raison.
Le capitalisme est à cet égard, pour le dire en termes bourdieusiens73, le règne d’une violence symbolique qui constitue et normalise les sujets dans toutes ses dimensions (rationnelle et subjective). Et c’est ce qui explique sa redoutable efficacité, et le fait qu’il puisse déboucher sur cette subsomption réelle dont Marx, de manière prémonitoire, nous parlait déjà dans le chapitre six du Capital. A l’image d’un capitalisme oppresseur -amplement véhiculée par toute une tradition- il faut opposer celle d’une domination obtenue par le consentement exprès d’une population qui, à l’époque du fordisme, s’est retrouvée prise dans les filets séducteurs de la consommation et qui, par la suite, a adopté insensiblement les pratiques et les techniques de soi propres au néolibéralisme74. Et comme le souligne Lordon, s’il a pu en être ainsi, c’est bien parce que “la société marche aux désirs et aux affects”75. Ou, comme le signale à son tour Jon Beasley-Murray, parce que “l’ordre social est garanti par des habitudes et des affects”76. Ce que Spinoza avait déjà décrit dans l’Éthique, où le sujet y est défini comme nécessairement soumis aux affects et aux désirs qui le constituent, et qu’en aucune manière il ne saurait être conçu comme “un empire dans un empire”77, soit comme un être jouissant d’une autonomie lui permettant de se déterminer librement.
On peut ainsi déduire de tout ce qui précède qu’il convient à présent de miser sur une politique des affects, tout d’abord parce que, comme le rappelle Spinoza dans la proposition VII de la quatrième partie de l’Éthique :
Un affect ne peut être ni réprimé ni supprimé si ce n’est par un affect contraire et plus fort que l’affect à réprimer78.
Ensuite, parce que l’indignation constitue le moteur de toute action politique collective79. Et finalement, parce que la joie augmente la puissance d’agir du sujet80 et qu’elle est, pour Spinoza, consubstantiellement liée à la facette rationnelle de l’être humain81. Rien n’est donc plus éloigné de la réalité que cette idée selon laquelle l’être humain se laisserait uniquement guider par la raison. Ainsi Spinoza l’explique-t-il dans le Traité politique :
S’imaginer qu’on amènera la multitude ou ceux qui sont engagés dans les luttes de la vie publique à régler leur conduite sur les seuls préceptes de la raison, c’est rêver l’âge d’or et se payer de chimères.82
Générer des affects de joie est, sinon le plus sûr moyen, du moins un puissant instrument de production de multitude, comme nous avons d’ailleurs pu en faire l’expérience sur les places de nos villes lors du 15-M. C’est cette joie du commun, ou cette joie en commun, qui nous a fait entrevoir et comprendre la force de notre processus d’empuissantisation, sa puissance potentielle. Et c’est peut-être ce que veut dire aussi le Comité Invisible lorsqu’il affirme que “l’intelligence stratégique vient du cœur et non du cerveau”83. Ainsi, le matérialisme immanentiste radical de Spinoza nous met-il décidément sur la voie de la construction d’une politique antagoniste.
Construire une subjectivité antagoniste en s’appuyant sur le désir et les affects de joie nous semble d’une importance centrale dans la bataille politique de notre temps. L’esprit de sérieux, la pesanteur et la rigidité qui ont accompagné jusqu’à présent nos militantismes, doivent laisser la place à la joie du nouveau monde que l’on se propose d’édifier. Nous devons apprendre que la joie d’un sourire peut être révolutionnaire.
Pour clore ces considérations relatives à la stratégie de construction de la multitude, nous voudrions insister sur la nécessité de prendre nos distances avec notre propre tradition révolutionnaire, et notamment avec ce que nous pourrions appeler son “désir de Vérité”. On pourrait sans doute établir ici un lien étroit entre l’hyper-rationalisme des politiques révolutionnaires et leur désir de se hisser au rang de discours vrais, voire scientifiques, comme l’illustre à merveille la prétention bogdanovienne d’édifier une “science prolétarienne”. Et nul doute que pareille “volonté de Vérité” – et est-ce un hasard si l’organe de presse du PCUS répondait justement au nom de Pravda, “La Vérité” ? – gît au plus profond du sectarisme qui a également accompagné notre propre histoire politique. Rien de plus logique, par ailleurs : pour qui prétend être détendeur de la Vérité, quiconque ne partageant pas son opinion est automatiquement dans le faux, et devient un ennemi à combattre. Une telle idée de Vérité, est pourtant, comme nous avons tenté de le montrer, fort éloignée des positions matérialistes qui défendent l’idée d’une réalité soumise au devenir et au processus historique, et considèrent la subjectivité comme étant constituée d’une multiplicité de déterminations qui la singularisent. D’un point de vue matérialiste, la Vérité, notamment en matière de politique, ne saurait en aucun cas constituer une donnée a priori ; bien au contraire, elle est un effet, l’effet d’une rencontre entre des singularités. C’est pourquoi nous considérons qu’à ce “désir de Vérité” doit se substituer un “désir de multitude” où la volonté de rencontre l’emporte sur la prétention d’être dans le vrai. Ce désir de multitude, de rencontre, et de construction d’espaces qui ne soient pas fracturés par nos divergences, implique de respecter certaines conditions préalables. À commencer peut-être par ce que les grecs appelaient la parrêsia, ou le dire vrai, et que Michel Foucault reprend et développe dans ses tout derniers travaux. Ce dire-vrai, – où la vérité s’écrit en minuscules –, est celui qui implique de considérer la dimension subjective de la vérité, et suppose aussi (et surtout), de la part du sujet, ce que Foucault nomme “le courage de la vérité”84, qui désigne la faculté d’assomption et de partage ou de confrontation de sa vérité avec celle des autres. Notre tradition est traversée de trop nombreux silences révérenciels ; et l’absence de telles confrontations ou de remises en cause de nos dogmes aura été fatale à bien des égards. L’horizontalité à laquelle nous aspirons ne peut être construite sans prendre en considération la multiplicité des voix et des vérités singulières. Or, pour qu’une telle prolifération existe véritablement, cela implique aussi, dans un deuxième temps, de faire droit à une pratique souvent négligée dans l’histoire de la pensée et de la politique, celle de l’écoute. L’Antiquité nous avait déjà montré la voie en instaurant des politiques iségoriques d’accès à la parole. Un accès qui s’est révélé largement insuffisant, notamment dans une perspective matérialiste qui pose en son centre la question de la singularité, et doit développer des processus d’écoute qui permettent d’assembler et d’harmoniser la multiplicité des regards. Ces processus d’écoute doivent enfin, et comme nous le disions plus haut, aller de pair avec un processus de traduction entendu comme la tentative d’engendrement d’un langage commun qui permette de dépasser les désaccords, dont on sait qu’ils ne portent généralement que sur des questions accessoires. On pourrait dire que les différentes “tribus” antagonistes qui ont vu le jour dans les dernières décennies, se sont construites en privilégiant chaque fois un aspect donné de la réalité (les questions de genre, l’écologie, le mouvement ouvrier, les luttes culturelles), ou certaines dimensions de l’humain, et ont chaque fois donné lieu à des langages spécifiques qu’il faudrait à présent tenter de soumettre à un processus de traduction ou de syntonisation, capable à son tour de donner à voir les accords par-delà les différences formelles. Les raisons politiques, mais aussi épistémologiques, ne manquent pas pour comprendre l’impérieuse nécessité de ces processus de traductions ; des processus sans lesquels nous trébucherons immanquablement à nouveau sur la pierre de ce solipsisme politique qu’est le sectarisme.
Notes
- À ce sujet, voir Aragüés, J.-M., Líneas de fuga…, op. cit., ainsi que De la vanguardia al cyborg…, op. cit.
- Marx, K., Le capital, Paris, PUF, 1993.
- Ibáñez, J., op. cit., p. 58. Nous traduisons.
- Lordon, F., La Société des affects. Pour un structuralisme des passions, Paris, Seuil, 2013.
- Laval, C., Dardot, P., La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, Paris, Éditions La Découverte, 2009.
- Lakoff, G., Don’t Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate, Chelsea Green Publishing Co, 1990.
- Matheron, A., Individu et communauté chez Spinoza, Paris, Les Éditions de Minuit, 1969 [1988, p. 20].
- Lordon, F., op. cit., p. 296.
- Deleuze, G., Différence et répétition, p. 4.
- Baudrillard, J., L’autre par lui-même, Paris, Éditions Galilée, 1987, p. 15.
- Spinoza, B., op. cit., p. 245.
- Beigbeder, F., 14,99 €, Paris, Grasset, 2002, p. 79.
- Deleuze, G., Guattari, F., L’Anti-Œdipe, Paris, Minuit, 1972.
- Rodríguez García, J.-L., Mirada, escritura, poder, Barcelona, Bellaterra, 2002. Nous traduisons.
- Gutiérrez-Rubí, A., Micropolítica. Ideas para cambiar la comunicación política, p. 10. Disponible en ligne : www.gutierrez-rubi.es. Nous traduisons.
- Bourdieu, P., Sur la télévision, Paris, Liber, 1996, p. 20.
- Lordon, F., Les affects de la politique, Paris, Seuil, 2016, p. 61.
- Disponible en ligne : http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2012/11/Lorena-Freitez.pdf.
- Deleuze, G., Nietzsche…, op. cit., pp. 118-126.
- Sartre, J.-P., “Morale et histoire”, Les Temps Modernes, 2005, nº 632-634, p. 370.
- Bourdieu, P., Interventions, 1961-2001, Marseille, Agone, 2002., p. 325.
- Spinoza, B., Traité politique. Disponible en ligne : http://www.spinozaetnous.org/telechargement/TP.pdf.
- Lordon, F., Les affects…, op. cit., pp. 64-65.
- Ibid., p. 125.
- Deleuze, G., Différence et…, op. cit., p. 154.
- Ibid., pp. 153-154.
- Aragüés, J.-M., De la vanguardia al cyborg…, op. cit.
- Il convient cependant de rappeler ici qu’il y a chez Marx de nombreux fragments où la classe sociale est comprise comme l’effet d’un processus de lutte, comme se constituant au travers de la lutte ; ce qui nous éloigne donc d’une conception plate et sociologique de cette catégorie.
- Virno, P., Virtuosismo y revolución, Madrid, Traficantes de Sueños, 2003, p. 58. Nous traduisons.
- Virno, P., Gramática de la multitud, Madrid, Traficantes de Sueños, 2003, p. 19. Nous traduisons.
- Ibid., p. 81.
- Ibid., pp. 81-82.
- Virno, P., Virtuosismo…, op. cit., p. 107.
- Ibid., p. 100.
- Ibid., p. 102.
- Ibid., p. 101.
- Deleuze, G., Guattari, F., Qu’est-ce que la philosophie ?, op. cit.
- Faction protestante (1649) considérée comme précurseur de l’anarchisme moderne (note de l’éditeur).
- Negri, A., El devenir Príncipe de la multitud, Sevilla, Ediciones en Huida, 2014, pp. 25-26. Nous traduisons.
- Negri, A., Hardt, M., Multitude. Guerre et démocratie à l’âge de l’empire, Montréal, Boréal, 2004, p. 9.
- Ibid., p. 126.
- Negri, A., El devenir Príncipe…, op. cit., p. 38. Nous traduisons.
- The Levellers, Los debates de Putney. En las raíces de la democracia moderna, Madrid, Capitán Swing, 2010.
- Negri, A., “Producir lo común”, in AA. VV., Pensar desde la izquierda, Madrid, Errata Naturae, 2012, p. 157. (Voir version originale, Collectif, Penser à gauche. Figures de la pensée critique aujourd’hui, Paris, Éditions Amsterdam, 2011. (NdT)
- Negri, A. Fábricas del sujeto, op. cit., p. 426. Nous traduisons.
- Ibidem.
- Negri, A., Hardt, M., Commonwealth, Paris, Stock, 2012, Préface. Dans El devenir Príncipe de la multitud Negri ajoute: “Il s’agit de s’interroger sur la possibilité, ou plutôt, sur la virtualité qu’une multitude se constitue de manière efficace. Nous nous demandons pourquoi, comment, autour de quels axes, à partir de quels éléments constitutifs, en fonction de quelle puissance constituante, la multitude peut ou doit surgir. Il n’est pas anodin que nous formulions la question en un sens constitutif, en faisant usage de termes machiavéliens, dans le bon sens de Machiavel. En d’autres termes, comment la multitude peut-elle devenir Prince ? Comment la multitude peut-elle faire sienne une figure subjective qui la force, qui la pousse à s’orienter dans le sens d’une transformation de la réalité ? Ou plutôt, comment la multitude peut-elle se convertir en un Prince au sein même de l’Empire ?”. Op. cit., p. 28. Nous traduisons.
- Negri, A., Guías, Barcelona, Paidós, 2004, pp. 131-132, et Negri, A., Hardt, M., Multitude, op. cit., p. 127.
- Fernández Liria, C., En defensa del populismo, Madrid, Catarata, 2016, p. 12. Nous traduisons.
- Ibid., p. 143.
- Ibid., p. 12.
- Ibid., pp. 50-52.
- Marx, K., “Thèses sur Feuerbach”, op. cit.
- Galcerán, M., Deseo (y) libertad, Madrid, Traficantes de Sueños, 2009, p. 102.
- Comité Invisible, À nos amis, Paris, La Fabrique, 2014, p. 43. En ce sens, l’analyse que propose Éric Hazan des processus révolutionnaires s’avère des plus intéressantes, dans la mesure où il défend la thèse que ces derniers, dans la majorité des cas, ne sont pas le résultat d’une préparation au millimètre orchestrée par des organisations politiques, mais que ce sont à ces mêmes organisations qu’incombe la tâche d’orienter des processus sociaux indépendants. À ce sujet, voir Hazan, E., La dynamique de la révolte, Paris, La Fabrique, 2015.
- Ibid., p. 44.
- Spinoza, B., Traité théologico-politique, pp. 147-148. Disponible en ligne : http://www.spinozaetnous.org/telechargement/TTP.pdf.
- Ibid., pp. 5-6.
- Spinoza, B., Traité de la réforme de l’entendement, in Spinoza, B., Œuvres complètes I. Premiers écrits, Paris, PUF, 2009, p. 69.
- Spinoza, B., Traité politique, op. cit., II, 16.
- Spinoza, B., Éthique, op. cit., p. 312.
- Spinoza, B., Traité politique, op. cit., p. 10.
- Sartre, J.-P., Critique de la raison dialectique, Paris, Gallimard, vol. I, 1985, p. 364.
- Sloterdijk, P., El desprecio de las masas, Valencia, Pre-Textos, 2002.
- Sartre, J.-P., Critique…, op. cit., p. 367.
- Aragüés, J.-M., El viaje del Argos. Derivas en los escritos póstumos de J. P. Sartre, Zaragoza, Mira, 1995.
- Sartre, J.-P., Cahiers pour une morale, Paris, Gallimard, 1983, p. 95.
- Rizk, H., La constitution de l’être social, Paris, Kimé, 1996.
- Galcerán, M., op. cit., p. 169. Nous traduisons.
- Laval, C., Dardot, P., Commun, Paris, La Découverte, 2014, p. 19.
- Ibid., pp. 35-36.
- À propos du conatus de la multitude, voir Aragüés, J.-M., Líneas de fuga…, op. cit., pp. 153-172.
- Voir Lordon, F., La société des affects, Paris, Seuil, 2013, pp. 18-19.
- Ibid., pp. 247-249.
- Ibid., p. 7.
- Beasley-Murray, J., Poshegemonía, Buenos Aires, Paidós, 2010, p. 11.
- Spinoza, B., Éthique, op. cit., p. 195.
- Ibid., p. 289.
- Spinoza, B., Traité politique, op. cit., IV, 4.
- Spinoza, B., Éthique, op. cit., p. 234.
- Ibid., p. 257.
- Spinoza, B., Traité politique, op. cit., p. 6.
- Comité Invisible, op. cit., p. 16.
- Foucault, M., Le courage de la vérité, Paris, PUF, 2002.