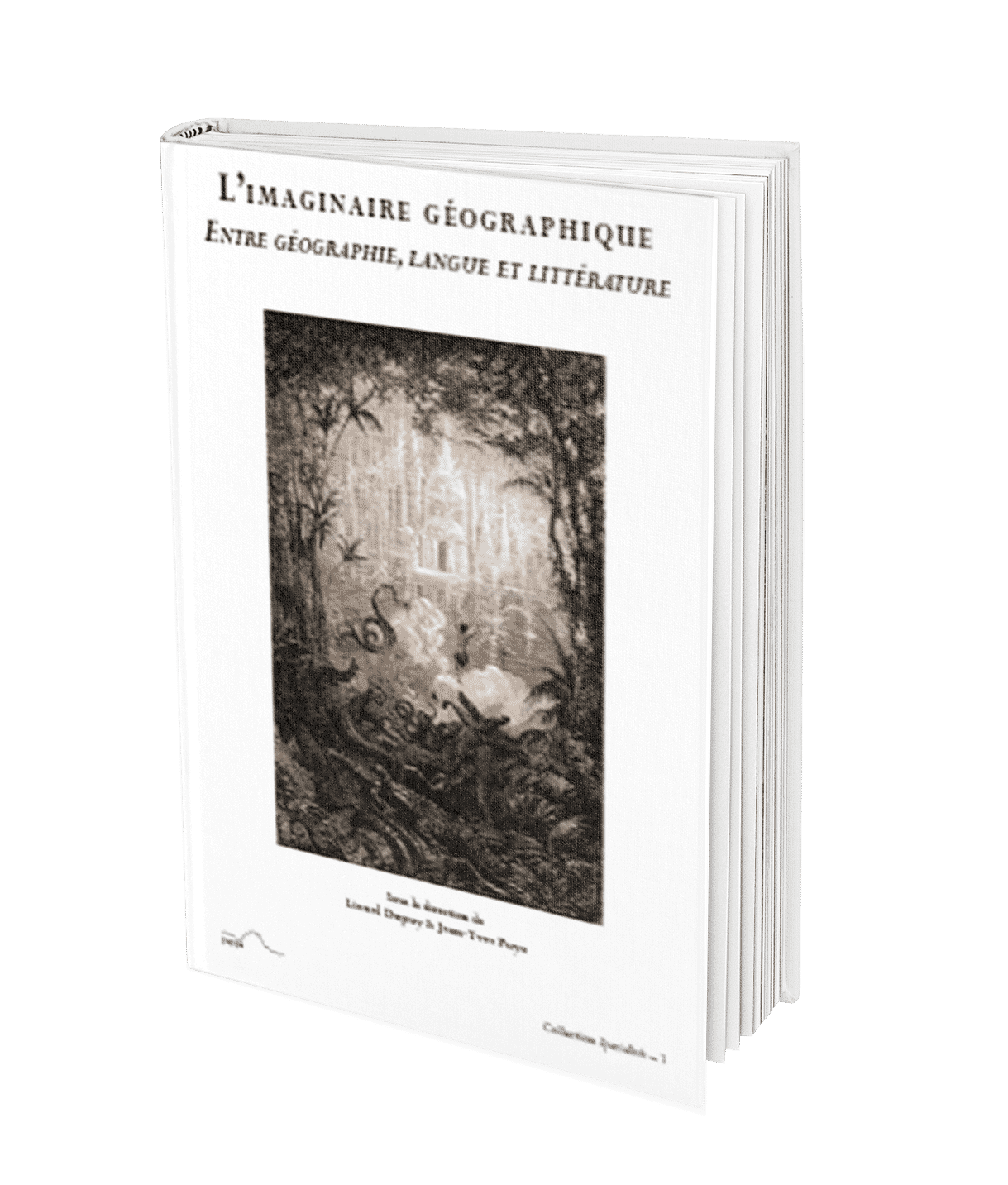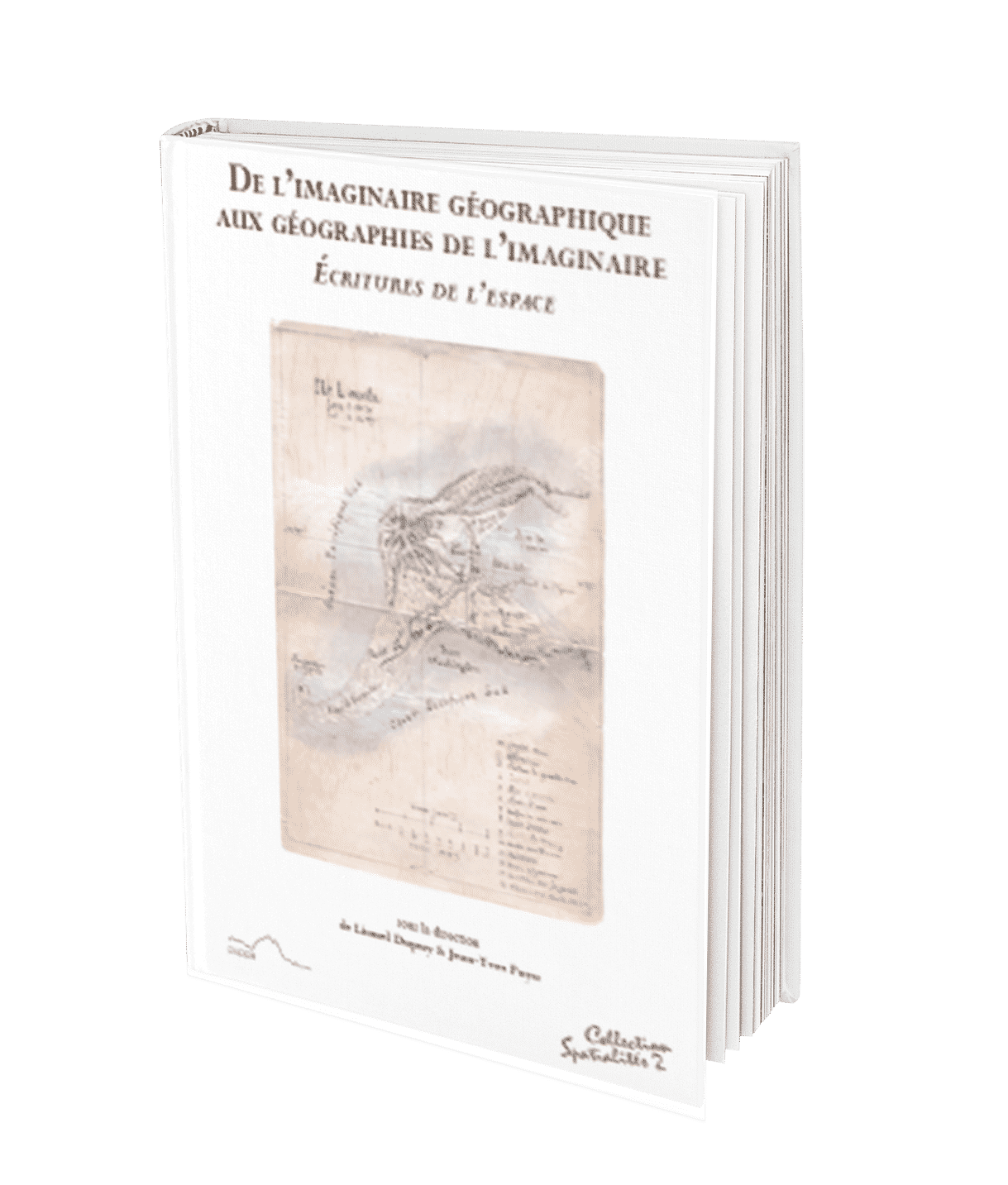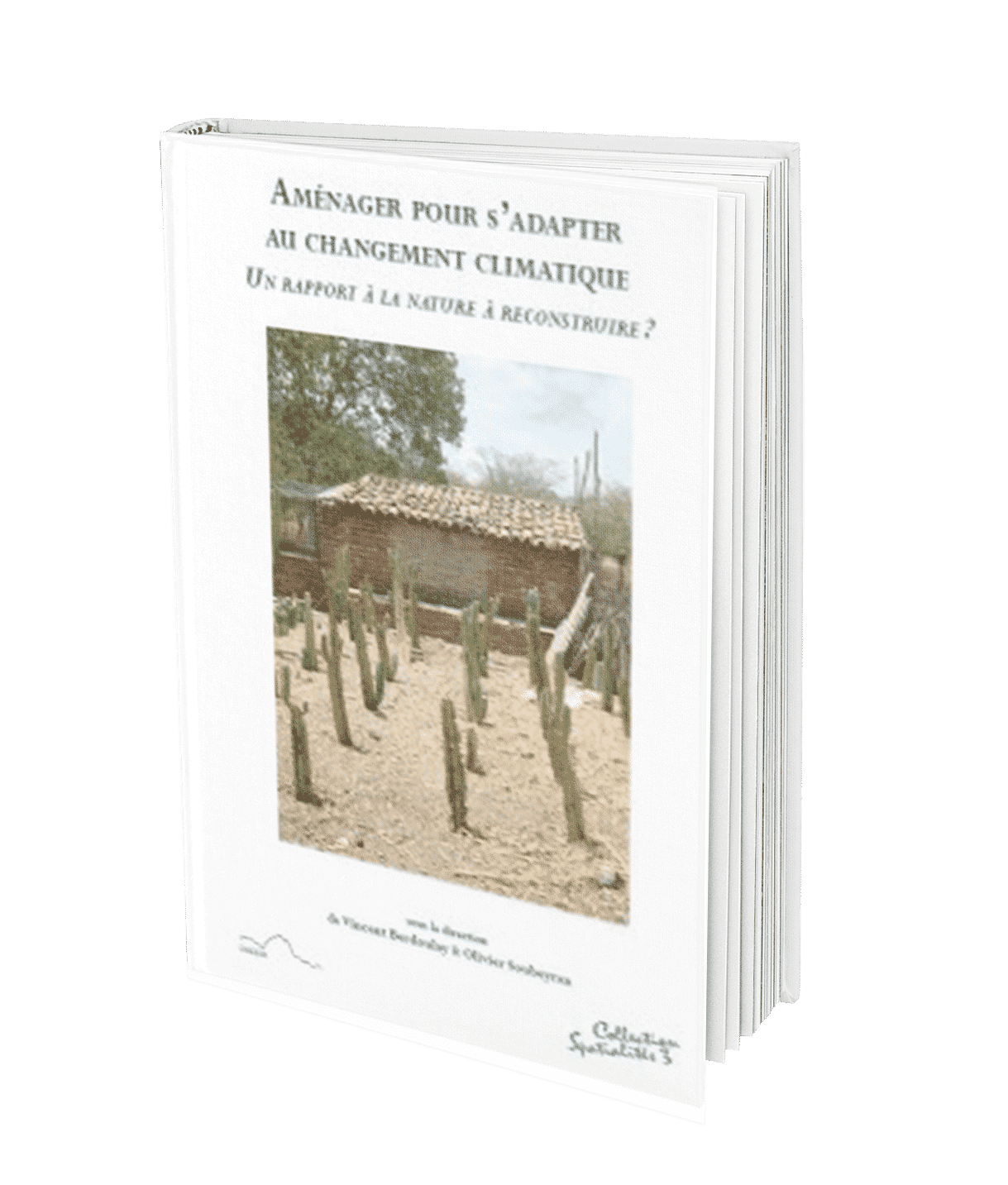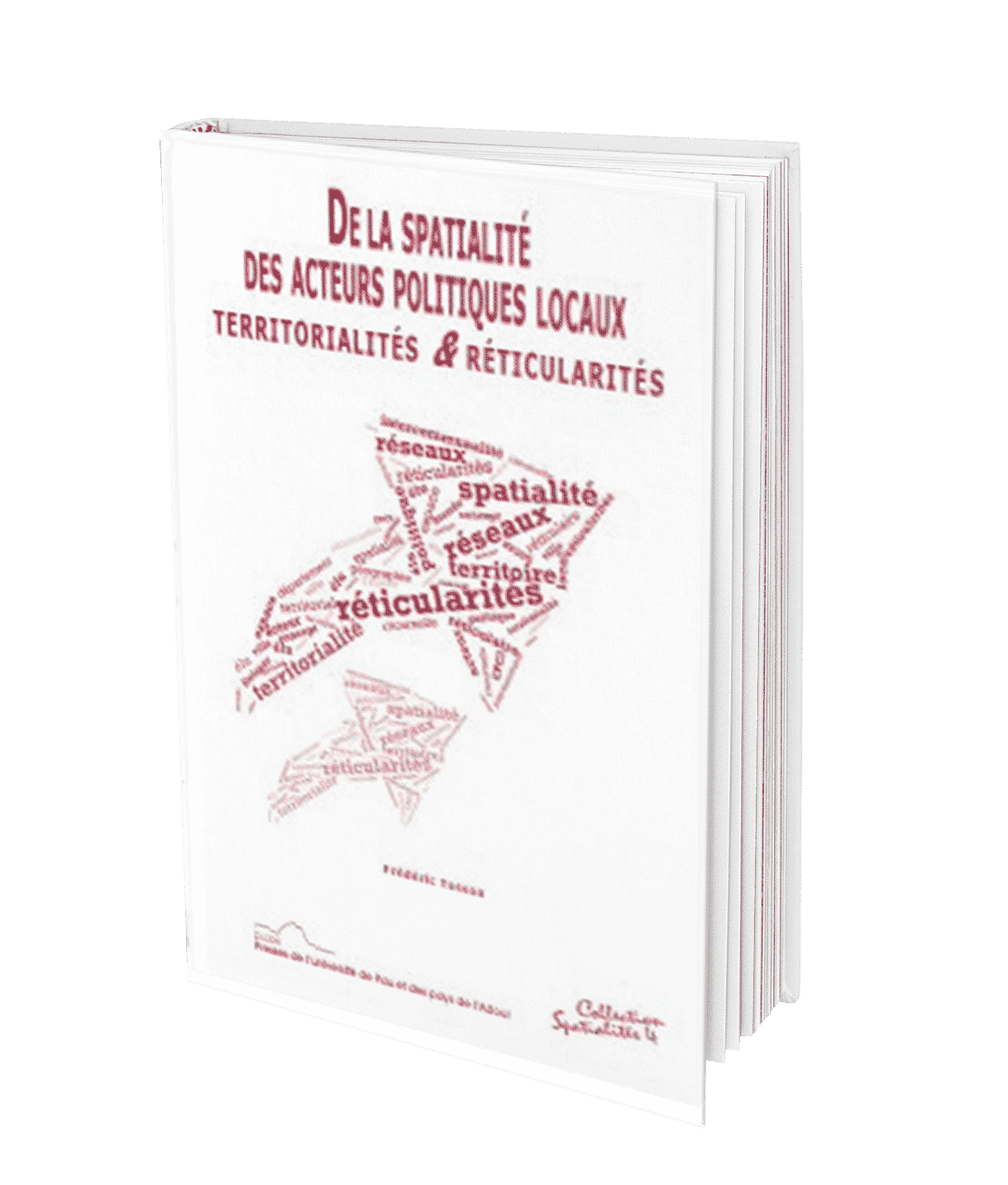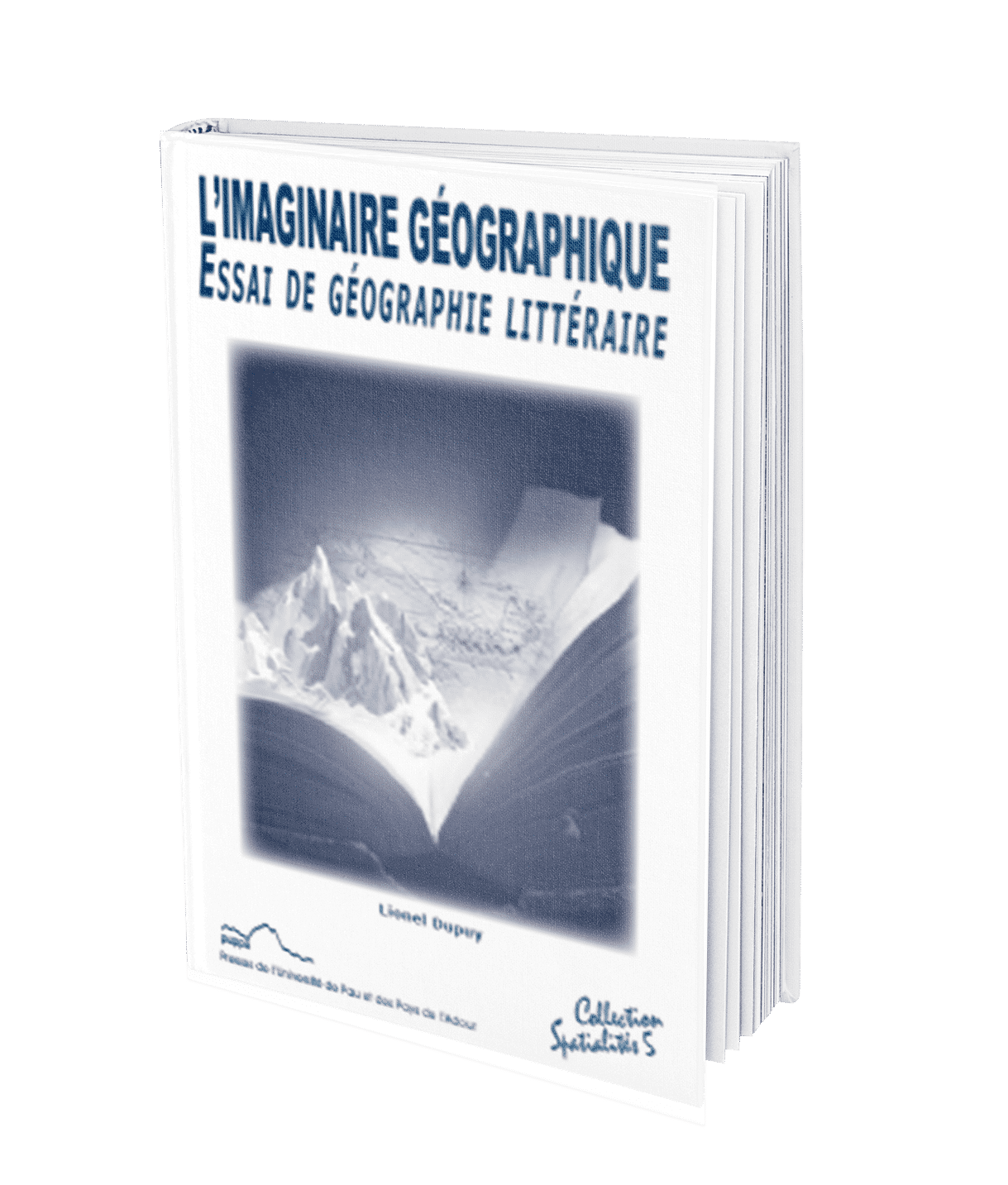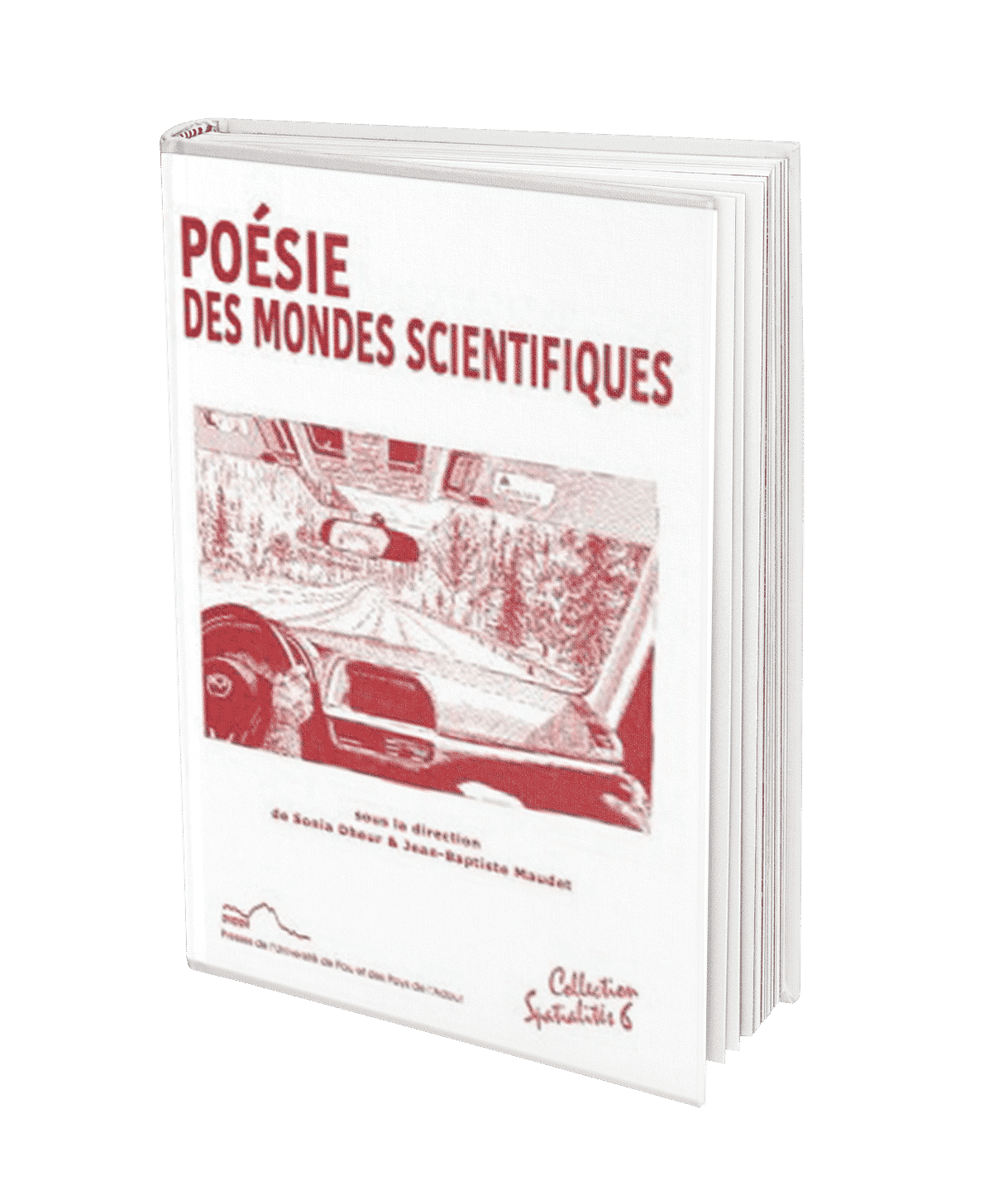Le fait de savoir si j’ai bien traité de mon sujet doit être laissé au jugement du lecteur éduqué. Toutefois, je ne peux qu’espérer que mon essai d’y parvenir puisse être un encouragement pour quelque autre plume capable d’y arriver avec plus de succès.
Jonathan Swift, A Tritical Essay upon the Faculties of the Mind, 1711.
Ce livre cherche à retracer les activités et les pensées de géographes à travers une période d’incertitude et de changement à un moment clef de l’histoire de leur discipline. Ce n’est pas un espace ou un temps discursif façonné par un ou même par un certain nombre de grands penseurs. Ce n’est pas un temps de croissance surprenante ou d’approfondissement durable. Pourquoi, alors, se soucier de l’étudier ? En 1989, j’ai publié un article qui comparait la géographie telle qu’elle était pratiquée par les Français lors de l’expédition française d’Égypte – en gros en 1798 – avec celle qui était mise en œuvre au milieu du XIXe siècle lors de l’expédition française en Algérie. La différence est surprenante. Au milieu du XIXe siècle, les géographes, s’ils n’ont pas encore réinventé la géographie, s’ils n’ont pas encore transformé ses méthodologies et sa curiosité, sont en train de le faire. Pourtant, personne ne semble connaître la géographie du début du XIXe siècle en France, ou en avoir le souci. Des historiens de la géographie parfaitement raisonnables et éduqués m’ont informé qu’à cette époque, la géographie n’existait pas et qu’il n’y avait pas de géographes. Tout se passe comme si seules les périodes considérées comme héroïques ou fondatrices, des périodes au cours desquelles des individus peuvent être identifiés comme des pierres de touche de la discipline soient capables de susciter la recherche. Mais le monde marche avec ou sans héros et, on peut le soutenir, les héros – au-delà de l’héroïsme quotidien de la plupart des vies – sont inventés plus qu’ils ne sont nés tels.
Mon contexte était aussi important pour le choix de cette période. Travaillant dans les sciences sociales et les humanités à la fin du XXe siècle, je suis consciente de ce que cette époque partage quelque chose avec le début du XIXe siècle. Si les formations discursives ont des bords déchiquetés et sont fluides au début de ce siècle, aujourd’hui, après un siècle de hautes et fortes murailles disciplinaires, les murs tombent de nouveau, laissant beaucoup de personnes dans le monde académique de la fin du XXe siècle avec le sentiment que les disciplines sont moins pertinentes, que les réseaux intellectuels sont complexes et que les lignes de pouvoir sont en train d’être redessinées selon des voies qui ne sont pas nécessairement prédictibles et qui peuvent menacer le statut – et peut-être l’existence – de nombre de disciplines établies dans les sciences, les sciences sociales et les humanités. J’ai le sentiment que nous pouvons apprendre beaucoup d’un temps de plus de fluidité discursive que celui d’aujourd’hui, et, je le soutiendrais, du temps relativement sur-étudié de la période de « formation de la discipline » de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Cela ne veut pas dire que l’histoire doive refléter « nos croyances et nos hypothèses courantes » pour avoir une signification pour nous1. C’est simplement que le temps est depuis longtemps venu de regarder au-delà de la disciplinarité étroite qui a conduit à une telle fixation, en particulier en France, sur la fin du XIXe siècle et le début du XXe.
Qu’est ainsi la géographie au XVIIIe siècle et que lui est-il arrivé entre, en gros, entre 1760 et le milieu du XIXe siècle ? En France, la géographie du XVIIIe siècle est presqu’entièrement dévorée par le problème intellectuel très réel de comment décrire le monde. À cette fin, de grands pas sont effectués dans le courant du XVIIIe siècle vers le développement d’un langage de la représentation à la fois textuel et graphique. La cartographie topographique acquiert en particulier une définition, une cohérence et une régularité sans précédent. Le souci d’exactitude dans la représentation s’exprime en termes de précision plus grande des cartes topographiques, de variété et de nombre croissant d’échelles de rendus disponibles pour permettre tous les usages dont les cartes sont désormais l’objet, et de techniques améliorées de mesure, de compilation et de reproduction. Au cours de cette période, les géographes publient dans un nombre restreint de genres. En dehors de quelques relations de voyage, souvent écrites par des non-géographes, les publications des géographes comprennent des géographies universelles (structurées régionalement ou alphabétiquement), des manuels de compilation, des manuels de levers et de cartographie, des cartes établies par comparaison critique de sources écrites ou dessinées et des cartes réalisées à l’aide d’observations de terrain. La géographie structurée par ce souci de décrire est une formation discursive institutionnalisée qui est représentée à la fin du XVIIIe siècle à la fois à l’Académie des Sciences et à l’Académie des Inscriptions. Ses institutions essentielles, au XVIIIe siècle, ne sont pas les universités, mais les collèges secondaires, en particulier ceux tenus par les Jésuites ou les Oratoriens, et les collèges militaires. En dehors de ces institutions, la géographie à la fois littéraire et mathématique, est enseignée par apprentissage et tutorat. En dehors de sa présence dans ces institutions, et dans l’Encyclopédie, la preuve de l’existence de la formation discursive doit être trouvée dans une communauté, des critères partagés, le sentiment d’un secteur professionnel et le souci de continuité évident dans la correspondance et les publications des géographes. Que les géographes du XVIIIe siècle en soient conscients ou non, le débat qui prend place en France (et dans une grande partie de l’Europe) sur la taille et la forme de la terre, entre d’un côté les Cassini et de l’autre Newton, montre les limites de la représentation. Au cours de ce débat, les géographes découvrent pour la première fois les limites de la mesure directe et de l’observation de la surface de la terre pour parvenir à sa description. Ils découvrent que la compréhension de la manière dont l’univers fonctionne peut conduire à une description plus complète et plus vraie de l’univers. C’est une leçon à assimiler et à réassimiler à plusieurs échelles au cours des 150 années suivantes.
Durant la dernière décennie du XVIIIe siècle, la perte d’orientation et de statut de la géographie prend la dimension d’une crise. Nous avons eu la chance d’identifier deux incidents qui suggèrent fortement la nature et la sévérité de cette perte d’orientation. (i) Le premier réside dans la manière dont le cours de géographie proposé et donné à l’École normale par deux des géographes alors les plus en vue en France est reçu. Des critiques tranchantes viennent à la fois des étudiants qui suivent ce cours, d’autres professeurs de cette institution élitaire vite disparue, et de la Décade philosophique, le porte-voix des intellectuels et des personnalités publiques qui se considèrent comme les héritiers des Lumières. Le consensus semble être que la géographie enseignée à l’École n’a rien à offrir à la science moderne et montre peu de sens de ses propres finalités relativement à des sciences-sœurs ou beaucoup plus éloignées. (ii) La carrière scientifique de Cassini IV et sa fin dans les années qui suivent la Révolution offrent une autre fenêtre sur la perte d’orientation et de statut de la géographie. Un temps un des plus puissants et des plus privilégiés des géographes/astronomes de haute stature du XVIIIe siècle, Cassini IV est jeté hors de la science par les forces combinées de la Révolution, par un mouvement pour démocratiser la science, par la bureaucratisation de la cartographie à grande échelle, par la mathématisation de l’astronomie et par son rapprochement de la physique explicative. Face à des forces de cette magnitude, Cassini IV ne peut guère d’autre que fulminer contre l’injustice et les conspirateurs de la Révolution dont le but principal, à ses yeux, est la destruction de la société française.
Il y a trois « réactions » principales à cette perte d’orientation et de statut. (i) Malte-Brun représente l’une des réactions les plus conservatrices. Peut-être est-ce l’arrière-plan de sa vie et sa formation aux études littéraires et historiques qui le conduisent à croire que la solution des problèmes géographiques peut se trouver dans le rajeunissement des plus anciennes traditions de la géographie. Il trouve son inspiration dans Strabon et bannit de sa géographie universelle la théorie, l’explication et l’aspect le plus technique de la géographie : la cartographie. Il croit que grâce à des lectures largement interdisciplinaires, à la comparaison critique des sources et à une forme d’expression poétique et belle, on pourra de nouveau rendre attirante pour le grand public la géographie descriptive, ou la description du monde. Dans le genre de la géographie universelle, Malte-Brun établit les standards pour au moins un siècle. Bien que son travail soit pourtant apprécié par les générations suivantes de géographes, il souffre des faiblesses inhérentes au genre et à son ancienneté même. À une époque où les sciences théoriques et explicatives arrivent au premier plan, il est exclusivement descriptif. Il fait face au volume croissant de la recherche en histoire naturelle, en géologie, en botanique et dans les sciences sociales naissantes en résumant des travaux menés par d’autres et dont le volume croît. Et il ne délimite aucun secteur original de recherche pour les géographes. Le genre demande pour sa mise en œuvre un temps considérable, le rassemblement de sources volumineuses et leur lecture. Il occupe tellement l’attention de beaucoup de géographes qu’ils ont peu de temps et d’inclination pour prendre en considération certaines des questions posées par les géographes militaires ou des personnages travaillant sur les marges de la formation discursive en géographie sociale, naturelle ou historique. Plus sérieusement peut-être, les géographies universelles telles qu’elles sont écrites par la plupart des géographes, manquent d’un argument cohérent et unificateur, un argument qui pourrait faire de la géographie universelle davantage qu’une compilation ordonnée d’information plus ou moins digérée. Les lacunes du genre sont plus visibles et plus énormes dans les géographies universelles de Guillaume Delisle, d’Edme Mentelle et de l’Abbé Jean-Joseph Expilly. La Science de la géographie du Père François et le Cosmos de Humboldt montrent à l’évidence qu’avec beaucoup de réflexion et de méditation, la géographie universelle peut s’élever au-dessus de l’énumération ordonnée des traits et caractéristiques des peuples et des gouvernements. Mais pour ceci, il est nécessaire de disposer d’un but plus large que de décrire la terre observable ou de cataloguer toute la connaissance relative à la surface de la terre.
(ii) Un second type hautement conservateur de géographie est représenté par la pensée et la carrière d’Edme Jomard. Alors que Malte-Brun est attaché au texte descriptif comme définissant la géographie, Jomard considère que la carte et la métaphore cartographique sont le cœur et l’âme de la géographie. La carte, les mesures et la mise en ordre de l’information qu’elle implique, jouent un rôle dans toutes ses publications majeures et limitent le degré auquel il peut correctement identifier les problèmes qui ne sont pas sujets à résolution par des moyens cartographiques ; elles l’empêchent d’imaginer des méthodes appropriées à leur résolution. Alors que l’expérience de Jomard en Égypte et son intérêt permanent pour ce pays caractérisent sa vie et son expérience vécue, son engagement pour la cartographie des monuments, pour l’exploration cartographique, pour la production et l’étude de cartes de la civilisation occidentale et pour la science de la cartographie et de la catégorisation des peuples, qui doit devenir l’ethnographie, sont typiques du type d’activités dans lesquelles s’engagent les géographes tout au long du XIXe siècle. Ce sont des activités qui dérivent directement de la carte comme métaphore et du sentiment que la fonction primaire du géographe est de cartographier les phénomènes. En un sens, donc, la conception de la géographie de Jomard a une postérité aussi forte que la tradition de description géographique littéraire de Malte-Brun.
(iii) La géographie au service de l’État est une tradition établie bien avant les périodes révolutionnaire et napoléonienne. Pourtant, pour une variété de raisons militaires, sociales, politiques et économiques complexes, cette relation s’intensifie sous le règne de Napoléon. La militarisation de la société française, en particulier, a un large impact, moins sur les chercheurs déjà établis et relativement aisés, que sur les hommes encore jeunes espérant faire une carrière dans la science. Comme résultat, les carrières de deux géographes militaires, André de Férussac et Jean-Baptiste-Geneviève-Marcellin Bory de Saint-Vincent, sont suggestives de l’impact de la pression des besoins et des intérêts de l’État – le service public essentiellement – sur l’activité scientifique. L’impact n’est pas entièrement négatif. Les hommes sont exposés à des opportunités et influences qu’ils n’auraient vraisemblablement pas rencontrées s’ils n’avaient pas servi comme officiers. La formation qu’ils reçoivent et la nature de la géographie militaire pratiquée par leurs collègues ingénieurs-géographes, telle qu’elle est dirigée par les généraux Pierre-Alexandre-Joseph Allent et Pascal Vallongue, les encouragent à pratiquer une analyse du paysage humain et naturel qui n’est pas du tout évidente dans les géographies de cabinet d’hommes comme Edme Mentelle, Jean-Nicolas Buache de la Neuville ou même Conrad Malte-Brun. La sensibilité aux paysages et à la société qu’ils développent dans leurs fonctions en tant qu’officiers de renseignement influence leur pensée et leurs écrits, même lorsqu’elles se situent loin de ce que nous considérons aujourd’hui comme caractéristiques de la géographie. Sur le long terme, il y a peu d’engagement de la part de l’État (et de ses régimes changeants) en faveur de la recherche géographique même la plus évidemment utile. Si on ne juge pas indispensables les cartographes travaillant à la carte de France, combien alors les officiers de renseignement peuvent sembler sacrifiables en temps de paix relative ! De Férussac et Bory de Saint-Vincent font tout de même partie du personnel militaire chanceux qui garde une relation forte et substantielle avec une armée qui, plus d’une fois, les aide à se tirer d’affaire. En l’absence d’un financement constant de l’État pour les universités et d’un nombre raisonnable d’institutions d’enseignement et d’étude supérieurs, l’emploi direct de géographes par la bureaucratie militaire, dans les campagnes militaires, dans les voyages maritimes et dans les expéditions coloniales leur offre quelques-uns des seuls moyens de financer une nouvelle expédition et une recherche dispendieuse et excitante. Les coûts sont d’une nature plus personnelle : la santé, la liberté de poursuivre des questions qu’eux-mêmes jugent d’intérêt et la cohérence idéologique sont toutes susceptibles d’être compromises. L’intérêt de l’État pour la recherche ne disparaît pas avec Napoléon. Les géographes peuvent être appelés lors de chaque guerre, de la conquête de l’Algérie aux guerres du présent, par la France ou par les puissances occidentales en général. La relation entre le pouvoir de l’État et la géographie est une relation ancienne qui ne montre pas de signe de déclin, bien que les rôles particuliers joués par les géographes varient considérablement.
Alors que les géographes luttent pour adapter leurs approches traditionnelles à la nouvelle situation, des chercheurs sur les marges de la géographie sont en train d’explorer les nouvelles possibilités du sujet. Dans les sciences sociales, le Comte Constantin-François de Chassebœuf de Volney déchiffre l’impact relatif du climat, du sol et du gouvernement en Égypte, Syrie et Corse, et dans une mesure limitée, aux États-Unis, comme résultat de son intérêt pour les influences des facteurs extérieurs sur « l’homme », que ces facteurs soient naturels ou viennent du gouvernement. Bien que son travail soit incomplet et provisoire, Volney commence à développer une approche couvrant à la fois la nature et la société humaine, et plus particulièrement les relations entre elles, une approche que les géographes de l’époque auraient pu trouver libératrice s’ils lui avaient accordée une attention suffisante. En particulier, la signification que Volney attache avant 1802 au fait d’être présent sur les lieux et de voir par soi-même, ne trouble pas la plupart des géographes de cabinet français du début du XIXe siècle. Les géographes ont quelque opportunité de prendre note des idées de Volney lorsqu’il enseigne parallèlement à Mentelle et à Buache de la Neuville à l’École normale. Volney est l’un des guides principaux utilisés par les officiers durant l’expédition napoléonienne d’Égypte et par le Dépôt de la Guerre, si bien que les ingénieurs-géographes consultent Volney à nombre d’occasions, en particulier sur l’Égypte et ses noms de lieux. Volney semble avoir abandonné son travail de géographe à la suite de l’hostilité de Napoléon pour le type de critique sociale mené par les Idéologues. La fermeture de la « Classe des Sciences morales et politiques » de l’Institut provoque quelque chose comme une interruption dans les études civiles sur la société et les problèmes sociaux. À ce moment, Volney semble avoir perdu l’intérêt pour, ou l’incitation à étudier, de telles questions.
Les sources de l’intérêt de Chabrol de Volvic pour la société et les problèmes sociaux sont militaires et étatiques, comme le montrent son expérience et ses activités en Égypte, à Napoléonville et à Montenotte. Dans les deux dernières régions, il fait des expériences sur la circulation des gens et des biens et cherche à aménager l’espace pour mieux mettre en accord la région avec le nouveau territoire national/impérial. La géographie de Chabrol de Volvic est alors une géographie pratique, conçue et mise en pratique sur le terrain. Son travail est également un travail intellectuel et théorique novateur. C’est dans la ville de Paris et avec l’aide de géographes et du mathématicien Jean-Baptiste Fourier que Chabrol de Volvic organise et réalise un des premiers levers statistiques urbains dans le monde occidental. Cela implique bien plus que la collecte de statistiques : les Recherches statistiques sur la ville de Paris et le département de la Seine mettent en œuvre une analyse statistique sophistiquée, une forme de présentation supérieure de l’information quantitative et un type de pensée essentiels pour planifier l’usage futur d’espaces publics lourdement utilisés et parfois contestés.
Écrivant dans les années 1820 et 1830, le géographe Adrien Balbi semble n’avoir rien absorbé du travail et de la pensée de Volney et fort peu des publications de Chabrol de Volvic. Et ce, en dépit du fait qu’il est au courant du travail des deux. Balbi est limité dans ses travaux régionaux et statistiques par une compréhension simpliste des statistiques comme un corps de faits hiérarchiquement structurés, et dans son travail ethnographique par une tendance à collationner l’information de sources parfois contradictoires. Il semble avoir été réticent ou inapte à s’engager dans la réflexion nécessaire pour développer et présenter les idées et les arguments qu’il esquisse dans ses publications en vue de bâtir une démonstration théorique basée sur l’observation et sur l’analyse, et pour mener son travail au-delà de la description et de l’accumulation des vues de diverses autorités. Son intérêt pour la statistique et son exploration de l’ethnographie montrent néanmoins la voie que devaient prendre un certain nombre de géographes de la fin du siècle.
Le début du XIXe siècle connaît un autre grand novateur dans le domaine de la géographie naturelle, Alexandre de Humboldt. Il fonctionne principalement dans le domaine des sciences naturelles, répondant à la théorie et à la recherche conduites en géognosie, en géologie, en botanique, en zoologie et en astronomie. Il doit en conséquence être considéré comme en marge du courant principal de la géographie française. Formé comme ingénieur des mines à Göttingen, Humboldt apporte à l’étude du règne de la nature une approche et une philosophie informées par la philosophie naturelle. Quand on les compare aux publications des géographes de cabinet du début du XIXe siècle comme Balbi, ou même à celles des géographes naturels militairement formés, les écrits de Humboldt se distinguent comme quelque chose de tout-à-fait différent. Il y a dans son corpus une consistance de propos et une cohérence qui constituent peut-être les caractéristiques les plus saillantes de son travail. Intéressé durant toute sa vie par le monde naturel, il est responsable de contributions importantes à l’étude systématique des roches, des plantes, des animaux et du climat. L’intérêt réel de Humboldt réside cependant dans la physique de la nature, ou dans les interactions et interconnexions entre les phénomènes naturels. L’exploration de ceux-ci l’amène au-delà d’obstacles qui dissuadaient la plupart des géographes : le problème d’équilibrer l’empirisme par l’élaboration de la théorie ; la réconciliation de la description avec l’exploration de l’explication et de la cause ; l’observation de la force externe et en même temps le fonctionnement interne ; le problème d’étudier le mouvement, le changement et la distribution des phénomènes… Son travail dans ces domaines l’encourage à chercher de nouvelles formes d’investigation et d’expression qui pourraient faciliter le mouvement entre les formations discursives, y compris l’observation de terrain et la mesure, l’utilisation de l’expression mathématique et la cartographie thématique. En addition à son engagement pour la recherche scientifique empirique et théorique, Humboldt a une sensibilité esthétique qui, jointe à son intérêt pour la nature et pour les sociétés humaines, le conduit à se focaliser sur les paysages de dimension humaine tout autant que sur les roches, les plantes individuelles etc. Les géographes français sont au courant des voyages de Humboldt en Amérique du Sud. Ils le citent, apprécient son travail d’édition et son appartenance à leurs principales institutions – et certains correspondent même avec lui. Il y a toutefois peu de signes qu’avant le milieu du XIXe siècle, quiconque parmi les géographes français ait pris Humboldt, ses idées, et son approche de la science naturelle d’une manière en aucune façon aussi sérieuse que ne le fit Mary Somerville. L’homme, ses explorations et son aura semblent avoir retenu l’attention des géographes au détriment de la prise en considération de sa façon de penser et conduire la recherche.
Au début du XIXe siècle, la géographie historique est encombrée et limitée par la tradition dans laquelle elle est écrite, et elle souffre d’une pénurie d’imagination. Les figures principales, Pascal-François-Joseph Gosselin et Jean-Denis Barbié du Bocage, entreprennent un travail si étroit dans sa conception et dans sa portée qu’il n’a qu’un intérêt limité pour les non-géographes comme pour les géographes. Charles Athanase Walckenaer, en revanche, semble partager avec André de Férussac et Bory de Saint-Vincent une incapacité à concentrer son attention sur un champ ou un type d’enquête. Quand il tourne son attention vers la géographie plutôt que vers l’écriture de romans, l’histoire naturelle de l’homme ou la flore et la faune de Paris, il a aussi tendance à se poser des questions limitées à la détermination de la localisation des activités, des événements, des personnages ou des villes du passé. Le seul travail de géographie historique d’Alexandre de Humboldt est novateur grâce à sa très contextuelle histoire de la science et à son identification personnelle avec les premiers explorateurs des Amériques. C’est toutefois un morceau d’érudition auto-complaisante, dans laquelle il donne tellement libre cours à sa tendance à la méditation et à la digression qu’il a peu d’impact aussi bien sur les contemporains que sur la recherche à venir.
Parmi les spécialistes de géographie historique, un seul se détache comme vraiment novateur, Jean-Antoine Letronne, qui est un penseur original et indépendant ; en dépit de sa première formation en géographie et de publications clairement géographiques, les géographes ne le reconnaissent pas comme faisant partie du bercail. L’originalité de Letronne est une conséquence à la fois de sa fertile imagination, qui lui ouvre une des majeures préoccupations de l’époque et le conduit de question en question jusqu’à révéler l’histoire et la nature de la présence grecque en Égypte, et une rigueur et discipline d’approche et de méthode qui assurent à son travail le type de cohérence et d’intégrité que l’on peut trouver dans les écrits d’Alexandre de Humboldt sur le monde naturel. La curiosité et la compétence de Letronne s’étendent bien au-delà de la géographie mais restent fermement enracinées dans des questions géographiques qui semblent constituer le liant qui cimente l’ensemble de ses différentes enquêtes. Avec des géographes vraiment inconscients du sens et de la pertinence de son travail pour le leur, il y avait peu de chance que la pleine puissance de l’imagination de Letronne soit reconnue par ses contemporains comme par ses successeurs immédiats.
Quelle est alors la formation discursive à la fin du XVIIIe siècle et comment a-t-elle changé au milieu du XIXe ? Quels sont les objets d’étude géographique et comment ont-ils évolué ? Au début de la période, la terre est une mince surface avec des frontières et des limites, à la fois humaines et physiques, et c’est la tâche des géographes que de les localiser, de les tracer et de décrire ces bordures et limites et ce qu’elles contiennent. Au milieu du XIXe siècle, la terre a acquis un relief et une profondeur qui portent leur sens bien au-delà de ce que les capacités des géographes peuvent élucider. Le monde végétal et animal, autrefois simplement enclos dans des limites qui ont peu à voir avec leur nature ou avec leur évolution, a acquis une signification spatiale les liant aux débats sur l’histoire de la terre et des mouvements et des changements de la vie à sa surface. Au XVIIIe siècle, la société humaine et les comportements étaient aisément caractérisables et s’accordaient avec les frontières et les limites décrites par les géographes. Au milieu du XIXe siècle, les sociétés elles-mêmes sont considérées comme un objet d’étude, et leur complexité, diversité et histoire sont en train de devenir un objet d’attention. Quelles sont les opérations et les méthodologies dans lesquelles les géographes peuvent s’engager ? On peut soutenir qu’au début de la période, la géographie pouvait revendiquer la carte comme son invention propre, son outil fondamental et le produit le plus important de ses efforts. À la fin de la période, elle a à partager la carte non seulement avec les cartographes commerciaux, mais aussi avec un nombre croissant de savants et de chercheurs que leur intérêt pour les processus sociaux et scientifiques pousse à créer le nouvel espace de la carte thématique. Dans les années 1760, les textes géographiques expliquant les décisions prises par les cartographes n’étaient pas rares et étaient considérés avec estime. Au milieu du XIXe siècle, de tels travaux ont presque disparu, sinon comme manuels techniques accompagnant des cartes, et qui sont considérés comme secs et ennuyeux. Au XVIIIe siècle, les géographies universelles étaient considérées comme utiles et savantes. À la fin du XIXe siècle, elles ont grossi jusqu’à revêtir des tailles de mammouths mais ont perdu la cohérence qu’elles avaient à une époque antérieure. Même un des penseurs les plus synthétiques de l’époque, Alexandre de Humboldt, ne peut faire fonctionner ce genre. Quel impact tout ceci a-t-il sur la place de la géographie dans la hiérarchie des sciences ? De toute évidence, la géographie a perdu du statut aussi bien que de l’orientation au cours de cette période ; elle n’a pas réussi à se réinventer et avance en trébuchant sous la force de l’inertie.
Note