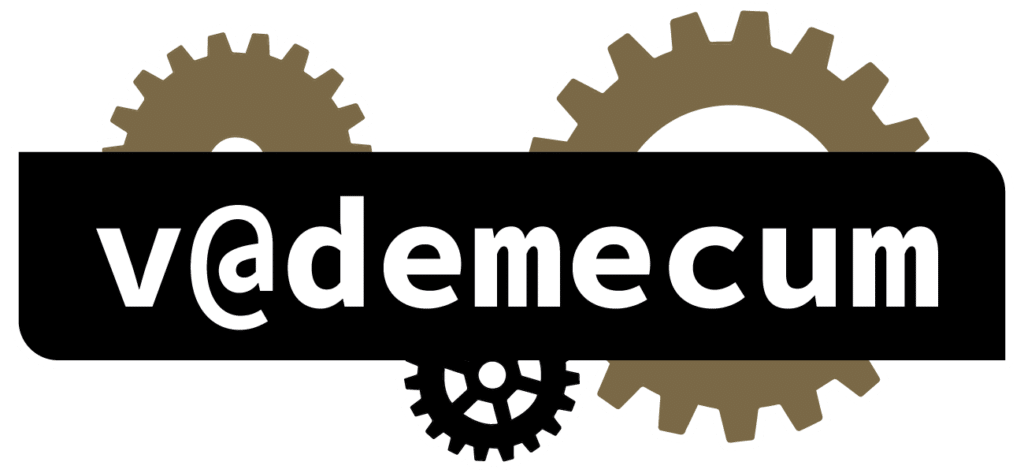Mettre en question un présupposé, ce n’est pas du tout s’en débarrasser,
mais c’est bien plutôt l’affranchir de son ancrage métaphysique
afin de comprendre quels intérêts politiques sont garantis
par ce positionnement métaphysique […]1.
Judith Butler
Penser le « terrain » sans en être spécialiste, ni en user dans ses propres travaux, au sein de ses champs d’action que sont la recherche et la recherche-création en arts de la scène, relève du défi, sinon de la gageure. Notre approche esthétique et politique des arts, attachée aux formes et à l’histoire des formes et des dispositifs artistiques dans leur spécificité, en articulation dialogique2 avec les études de genre ou les études queer, par exemple, mais aussi avec d’autres sciences humaines et sociales, pourrait néanmoins nous permettre, à l’occasion de cet article, d’approcher le terrain selon une modalité singulière, comme concept utile et inspirant, mais aussi, d’un point de vue critique, comme idée à la mode, voire comme dogme contemporain. Nous chercherons, en effet, dans ce qui revendique a priori le réel contre l’idéologie, la part d’idéologie dans les significations et usages actuels du vocable de terrain, qualifiables de postmodernistes3, au sein des arts et de la recherche en art.
Nous devrons donc, dans un premier temps, établir les conditions de possibilité d’une telle réflexion en distinguant l’enquête de terrain comme méthodologie de recherche en ethnoscénologie de ce que nous appellerons l’« idéologie du terrain ». En opposant le concept de terrain à celui de corpus, auquel il tend à se substituer de plus en plus dans les arts vivants, nous montrerons ensuite en quoi il peut devenir une valeur et même une norme de la recherche et de la création d’aujourd’hui.
Enfin, à l’issue de cette analyse esthético-politique préalable, nous serons en mesure de proposer une autre conception de la recherche, de la création et de la recherche-création en arts. Le dialogisme, en effet, à condition de définir précisément les critères qui le rendent possible, suppose qu’une distance critique soit prise avec tout usage détourné ou abusif des sciences humaines et sociales comme modèles idéalisés des arts et des études sur l’art.
Ce n’est donc qu’en se faisant relation dialogique que la recherche-création en arts, qu’elle soit disciplinaire, interdisciplinaire ou transdisciplinaire, qu’elle use de l’enquête de terrain ou d’autres méthodes issues ou non des sciences humaines et sociales, devient légitime. Non seulement elle est alors véritablement autonome face aux desiderata postmodernistes de la société ou du marché contemporains, mais elle peut échapper enfin aux biais subjectifs et aux appropriations dont elle est accusée, parfois à juste titre, alors même qu’elle se revendique à cor et à cri du terrain4.
L’enquête de terrain en ethnoscénologie vs l’idéologie du terrain
Il s’agit moins de lancer ici une polémique contre le « terrainisme5 » que de tenter de cerner les usages idéologiques du terrain du point de vue d’une enseignante-chercheuse en études théâtrales, qui encadre ou évalue des mémoires de master professionnalisants, de recherche, de recherche-création, ainsi que des thèses en arts de la scène, fondés en totalité ou en partie sur des entretiens et des terrains d’enquête, qui développe la recherche-création inter-artistique collective dans son laboratoire et pratique depuis longtemps, dans un dialogue de plus en plus théorisé avec ses recherches universitaires, l’écriture dramatique et la mise en scène théâtrale.
Pourquoi une recherche en arts ou une création artistique fondée sur un terrain ou impliquée dans un terrain serait-elle a priori plus légitime qu’une autre en contexte contemporain ? Qu’est-ce qui rend le terrain si séduisant aujourd’hui, en arts et dans la recherche en arts, une mode presque inquiétante, y compris aux yeux des disciplines comme l’ethnoscénologie6, où, à travers la méthode de l’enquête, il est absolument nécessaire, quoique non suffisant ? Pour répondre à ces questions, sans doute nous faut-il d’abord comprendre ce que veut dire travailler à partir d’un terrain en articulant sciences humaines et sociales (SHS) et objets relevants des arts vivants. Dans son article sur l’ethnoscénologie comme transdiscipline, Nathalie Gauthard nous y aide, en définissant ainsi l’enquête de terrain :
[L’] ethnoscénologie a intégré une méthode concrète via l’enquête de terrain qui consiste à circonscrire un objet de recherche qui peut parfois paraître insaisissable (son caractère vivant) et qui est sans cesse renouvelé (le côté éphémère de la représentation ou de la performance), même dans un cadre codifié. Elle a permis de saisir dans sa spécificité anthropologique un art vivant et de contribuer à l’intelligibilité d’un genre ou d’une forme (de théâtre, de danse, de musique, de procession, de fête) à partir de l’observation des pratiques et des discours qui le concernent7.
En lisant ce point épistémologique sur une discipline qui se situe explicitement au carrefour des recherches en arts (vivants) et en sciences humaines et sociales (ici l’anthropologie), et alors même que nous y sommes étrangères dans notre propre pratique scientifique, nous entendons que l’enquête de terrain en ethnoscénologie est une méthode de recherche exigeante. Elle suppose, en effet, problématique, postulats et hypothèses explicites, circonscription argumentée du terrain (ou champ d’exploration), qui sera confronté à ces hypothèses, procédures d’observation, parfois d’observation participante, entretiens et analyse d’entretiens en suivant des règles strictes (éthiques et scientifiques), sans compter la maîtrise associée, dès lors que l’objet appartient aux arts vivants, des exercices disciplinaires comme l’« analyse de spectacle/de performance8 ». Cela implique qu’un.e chercheur.e ou artiste lambda ne peut pas s’improviser ethnoscénologue.
Si elle est une méthode de recherche, il appert que l’enquête de terrain n’est ni plus ni moins légitime, d’un point de vue extérieur comme le nôtre, que d’autres modalités de travail rigoureux en arts vivants, qui ont aussi leurs règles, par exemple l’analyse dramaturgique, l’analyse de spectacle, l’approche historique – tout dépend de l’objet étudié –, mais qu’elle peut leur être utilement associée. Enfin, l’approche ethnoscénologique dans son ensemble, telle que Nathalie Gauthard la présente à travers la métaphore du « réseau mycélien » a, dans ses principes épistémologiques, de nombreux points communs avec l’approche esthétique et politique que nous préconisons, puisqu’elle articule sensibilité à la spécificité formelle de ses objets, et à leur histoire, et anthropologie en l’occurrence, mais aussi, par exemple, études de genre ou études queer, voire, selon les nécessités et sans exclusive, philosophie, psychanalyse, sociologie, etc.
Se fonder sur une enquête de terrain, y compris au sein des recherches en arts, ce serait d’abord « partir du concret, du particulier contre les généralisations […] et du réel contre les idéologies9 ». Nous ne pouvons qu’applaudir à un axiome qui permet, toujours selon les mots de Nathalie Gauthard, de « contribuer à l’intelligibilité d’un genre ou d’une forme », même si notre objet n’est pas un « terrain » mais, plus traditionnellement, un « corpus », qui ne requiert pas nécessairement des entretiens avec les artistes ou les publics : pièces qu’on lit, spectacles qu’on voit, processus qu’on suit. Partir comme individu-récepteur autonome d’un corpus d’œuvres est a priori aussi concret que s’ancrer dans des entretiens ou des observations sociales ou culturelles ; les objets étudiés sont différents, ou sont saisis différemment, mais ils sont, en soi, tout aussi essentiels aux deux formes d’approches de l’art, ethnoscénologique et esthético-politique parce que ce qu’elles partagent, en termes de rigueur scientifique, est l’attention réelle portée à leurs objets en tant qu’ils relèvent de l’art, à leur autonomie et à leur irréductibilité, par rapport à tout préalable idéologique, préjugé ou biais non explicité. Soucieux et soucieuses de ne pas plaquer une grille théorique univoque sur des œuvres et des pratiques censées au mieux déborder les grilles existantes ou en inspirer de nouvelles, nous ne les traitons pas comme de simples illustrations d’une thèse préalable sur la société ou comme de simples exemples permettant de la justifier a posteriori. Un jeu dialogique a lieu, nécessairement, entre l’objet et le sujet de la recherche, entre le terrain ou corpus et l’hypothèse d’interprétation qu’il inspire au chercheur ou à la chercheuse. Nous appréhendons nos objets d’étude en contexte, d’un point de vue partiel et situé10, et faisons feu de tout bois, en termes de savoirs culturels ou méthodes disciplinaires, pour mieux entendre ces objets dans leur altérité. Sans nier nos présupposés éventuels, et en essayant de les transformer en postulats conscients, nous les laissons d’abord parler eux-mêmes à nos sens et à notre intelligence et, puisque nous sommes dans le champ de l’art, nous les pratiquons éventuellement11. Conscient.e.s de leurs spécificités comme arts12, comme formes, ayant une histoire et une historicité, nous tentons de les décrire et de les comprendre, y compris politiquement13, bref, de dialoguer réellement avec eux. Cela signifie que nous nous interdisons de nous les approprier et de les instrumentaliser, ou de les idéaliser à l’inverse, comme de passer distraitement à côté d’eux en évitant qu’ils ne nous transforment ou encore de nier le fait que notre regard observateur ait pu quelque peu les transformer. Nous gardons à l’esprit que nous sommes en régime nécessairement relationnel.
Cela posé, nous constatons que la notion de terrain n’est pas réductible à l’enquête de terrain comme méthode mais qu’elle relève d’usages plus flous et extensifs en contexte postmoderne, et sans doute beaucoup moins exigeants, ce qui n’est pas sans raison ni, peut-être, sans danger.
Nous allons donc retravailler le vocable de terrain et ses usages actuels en relation avec un autre terme, corpus, qui lui est parfois opposé, parce que nous avons constaté que le premier tendait à remplacer le second, comme s’il avait davantage de valeur scientifique ou politique aujourd’hui, au point de confiner à la mode, voire à la norme – soit à une (re)production de vérité dominante non questionnée, quasi naturalisée. Le terrain serait devenu un « incontournable » de la recherche en arts et de la création contemporaine, une sorte d’évidence que nous ne serions plus en droit d’interroger ni de critiquer. Nous allons toutefois tenter de le faire.
Corpus ou terrain ?
À première vue, terrain est une métaphore spatiale alors que corpus a des connotations à la fois plus abstraites et plus biologiques, traduisant dans la sphère académique l’idée d’un rassemblement d’objets de même nature qui seront à étudier selon un angle problématique que l’on a tiré de leur connaissance/observation/analyse initiale : une hypothèse d’interprétation. C’est le corps de la thèse, du master, de l’essai de recherche, que cet ensemble supposé quasi organique d’œuvres ou pratiques. Difficile de parler d’un corpus de sujets humains, comme d’artistes ou de compagnies, même si d’aucun.e.s s’y risquent par extension dans certains travaux. Corpus présuppose en effet que l’on travaille sur le produit artistique de l’humain plutôt que sur le ou les sujets psychologiques et sociaux (individu, groupe, culture) à l’origine de la production. Terrain est un terme géographique ; corpus, comme latinisme, sonne plus historique, évoquant une forme de tradition qui a fait catégorie, comme le mot théâtral de répertoire. Terrain connote le concret, voire le populaire, le quotidien et l’ordinaire, et même le trivial et le bas, à la façon dont le célèbrent Mikhaïl Bakhtine ou Tadeusz Kantor. Pour ces raisons, il paraît plus démocratique que corpus, voire un peu anti-autoritaire, ce qui signifie aussi qu’il court le risque du détournement démagogique ou populiste. Il est alors presque synonyme de base : notre idée « vient du terrain » veut dire qu’elle « vient de la base », non des autorités, ni de l’académie, et que, par conséquent, elle est en soi plus vraie, plus juste, plus réelle, que les autres idées possibles. On utilise également volontiers le mot dans certaines relations socio-politiques en milieu professionnel : le terrain contre la bureaucratie, contre les décisions prises verticalement dans des ministères ou des officines, contre des lois et des décrets dits « hors sol ». Terrain est un terme propre à légitimer une recherche (et une posture) militante avec beaucoup plus d’efficacité et de séduction que corpus.
Le terrain suggère de même, quand il nous aide à délimiter un objet d’étude, une pluralité, une diversité, de son contenu. Il serait par essence vivant, composite, anarchique, incontrôlable, conflictuel, mouvementé : on pense alors à l’espace du combat sportif ou à la sociologie de Pierre Bourdieu. Le terrain rompt avec le corpus, « bel animal » aristotélicien, supposé cohérent et équilibré. Il paraît aussi plus autonome et rebelle, référant moins à un principe organisateur transcendant qui le justifierait. C’est qu’il pourrait bien être, au bout du compte, un sujet bien davantage qu’un objet. Ainsi subjectivisé, nous pouvons dès lors aisément le fantasmer comme pur de toute corruption et libre de toute autorité.
On le constate déjà à ce stade de notre analyse comparée des deux concepts : opposé à corpus, terrain est devenu si flatteur en contexte postmoderne pour ceux et celles qui s’en réclament qu’il peut leur inspirer assez vite une forme d’idéalisation, voire de sacralisation, et donc d’auto-sacralisation, très en rupture avec sa tradition scientifique, méthodologique, de neutralité (suspension du préjugé) et d’objectivité (refus de l’instrumentalisation personnelle ou du relativisme).
Ce serait ces infléchissements du sens et des connotations du vocable qui expliqueraient en premier lieu son hypostase et son déplacement hors de ses champs disciplinaires initiaux (SHS), où l’on tente d’avoir des discours objectifs, quoique situés, sur des phénomènes (inter)subjectifs et directement humains, vers les recherches en arts, lettres et langues (ALL), où l’on tolère davantage les discours subjectifs, même s’ils sont nécessairement argumentés, sur des ensembles d’objets qui sont des productions ou des représentations humaines de l’humain. Là, dans les champs ALL, espaces de savoir différents, et différemment rigoureux, mais soupçonnables par tradition de manque de scientificité, d’impressionnisme ou d’inutilité, le terrain est de plus en plus appelé à l’aide, et il l’est sans doute parce qu’il peut y prendre aussi un sens plus social et militant que scientifique, plus subjectif qu’objectif, plus applicatif que méthodologique. Que l’on préfère terrain à corpus est en effet logique si l’on veut croire que la vérité va monter de la terre et non descendre du ciel. Il est valorisant, sous un angle progressiste soluble dans le néo-libéralisme, de se réclamer du terrain et assez « porteur » aussi, dans un champ délégitimé à l’université, celui des arts, où l’antirationalisme et l’anti-intellectualisme sont en outre très puissants depuis les années 1980. Face à des sciences plus ou moins dures ou technologiques, dominantes sur le plan économique, on modélisera volontiers, au sein d’activités estimées ornementales et, au mieux, communicationnelles, parce que peu objectives, peu quantifiables et pauvres en applications monnayables à court terme, les recherches et les créations sur les SHS ou sur les sciences du vivant pour les draper de « scientificité ». Cette scientificité sera fondée sur l’idéal inductif de l’enquête, de l’expérience ou de l’observation des faits. La déduction logico-mathématique, en revanche, souvent jugée inhumaine alors qu’elle requiert intuition et imagination et qu’elle permet de tenir un discours rationnel et argumenté, demeure comme par essence hors de portée des esprits « artistes ».
L’idéologie du terrain dans le postmodernisme culturel
C’est aussi le particulier, et même le singulier, qui se dresse aujourd’hui, à travers le mantra du terrain, contre l’universel abstrait – Satan du postmodernisme culturel. Ce qui est direct et frontal, spontané, pulsionnel, « ressenti » et « vécu », paraît plus légitime, et donc plus vrai, que ce qui passe par des intermédiaires, des médiations, des détours ou des rationalisations, souvent en effet producteurs de biais idéologiques, mais aussi, si nous pensons ici à l’art de la fiction ou à la poésie, d’altérité critique et utopique féconde.
Terrain n’est pas le seul terme à subir un destin expansif en régime néo-libéral postmoderniste : d’autres concepts porteurs d’exigences scientifiques ou démocratiques, comme politique, féminisme et même queer, peuvent se réifier en labels, voire se retourner, en devenant des valeurs instrumentales du marché, contre leur sens initial14. Car le terrain, c’est aussi souvent l’idéalisation paradoxale de la proximité par rapport à la distance, de la présence par rapport à la représentation, de l’action participante par rapport à la contemplation et à la réception (accusées d’être forcément consommatrices), du réel vécu (vrai réel et réel vrai !) par rapport à l’invention fictionnelle distanciée et créatrice de possibles.
Pourquoi ces tendances dans la nouvelle recherche mais aussi dans la nouvelle création qui s’en inspire en préférant à la fiction assumée le documentaire tiré de l’enquête en territoire, mot également à la mode, sinon de la véritable enquête de terrain ? Ces tendances reposent sur l’idée que le terrain parlerait de lui-même à travers « l’impact », autre formule magique néo-libérale, qu’il a sur le chercheur/la chercheuse « témoin » du réel, autre position vertueuse à adopter à l’âge postmoderne. Le terrain étant vrai en soi, on ne peut que s’en faire le narrateur/transcripteur/témoin, mais on constate paradoxalement au même instant que ce témoin supposé humble de son objet est en fait le héros ou l’héroïne de l’enquête. En effet, il arrive souvent qu’en arts et en recherche sur les arts, le sujet se mette en scène lui-même bien davantage que les personnes interrogées, souvent citées sur un mode fragmentaire, sans commentaire critique ni contextualisation, ce qui nous en donne un écho caricatural ou simplifié, ou que les performances étudiées, dont on ne retient que ce qui va dans « notre » sens initial et qui sont utilisées comme simples illustrations d’une théorie initiale.
Lorsqu’on porte ainsi témoignage de son objet de recherche, on appelle ce témoignage art ou recherche en arts. On ne s’en fait pas, en l’occurrence, l’analyste, ni le critique, ni l’interprète, parce que ce dont on fait alors état, c’est avant tout du mouvement de sa propre enquête, de l’image de soi-même enquêtant. L’objet n’est plus l’Altérité mais le processus de sa (non) découverte de l’Altérité. Dans cette narration du Réel, on reproduit la parole sacrée (et pourtant trahie) du terrain, et cette reproduction non travaillée, non distanciée, s’avère finalement très réductrice pour les voix et les corps des sujets humains complexes qui occupent le terrain en question.
Le terrain, terme si concret et objectivant a priori, passe alors dans un monde opposé à la recherche scientifique, celui de la mystique, de l’indicible et de l’impensable, autrement dit de l’idéologie, qui recouvre le fondement occulte de ses actions quotidiennes et de ses choix de formes de vie et d’art, dès lors que l’on présuppose que l’objet de l’étude est impossible à mettre à distance de soi et à critiquer. Ainsi finit de s’imposer une « idéologie du terrain », dont certains effets esthétiques et politiques peuvent se repérer dans de nombreux travaux de recherche et spectacles contemporains. Y manque de manière inquiétante l’écart de la connaissance – Brecht parlerait de l’effroi15 –, parce que le terrain y est devenu un objet-sujet idéalisé, porteur par essence de la vérité, qu’on ne saurait comprendre rationnellement mais que l’on s’approprie en revanche sans trop de scrupules dans ses productions scientifiques ou artistiques afin de se légitimer soi-même dans son identité de chercheur.e, d’artiste, ou les deux.
Mystique du terrain et recyclage verbal
Une vraie rencontre avec le réel des arts vivants comme Altérité est « peu saisissable16 », écrit Nathalie Gauthard, mais « peu » n’est pas du tout « pas ». Ce « peu » excite justement le désir de connaissance et de compréhension, qui commence avec le regard, l’écoute, la discrétion, le retrait curieux et pensif, face au complexe, au mobile, à l’étrange, à l’étranger. Plus cette rencontre est délicate et risquée, plus elle nous intéresse, justement, et plus nous devons la fonder en raison et dompter nos préjugés comme nos fantasmes. Si nous aimons les arts vivants, n’est-ce pas parce qu’une analyse de spectacle « de base » est déjà une rencontre difficile et qu’il n’y a rien de plus malaisé que de faire des retours constructifs et interprétatifs sur un jeu d’acteur, en sortant du simple « ressenti » ?
Mais d’énigme (politique) à mystère (métaphysique), il n’y a qu’un pas que franchit allègrement l’idéologie du terrain. Alors, le terrain, comme tenant lieu de pensée et de travail, accompagné de la théorie de l’artiste, dont on se contente de redire les avis d’autorité (ou publicitaires) sur son œuvre, est souvent opposé, pour la décourager, à toute vraie critique esthétique, politique, scientifique, d’un fait ou d’une pratique artistique. Il permet aussi comme justification ad hoc, et là est la ruse du postmodernisme dans ses jeux de recyclage verbal, d’imposer une idée reçue médiatique, par exemple sur le « genre », la « sexualité », la « transgression », sans autoriser sa mise en discussion au sein des œuvres et des pratiques (on se rend aveugle à leur dialogisme éventuel) ou par la critique externe (rejetée comme malveillante ou froide). Cette réception complexe est délégitimée par l’autorité du terrain. C’est ainsi qu’il devient difficile d’appréhender (et de créer) des œuvres polyphoniques, qui, parce qu’elles confrontent des points de vue contradictoires, mettent en échec leur réduction à une thèse digeste ou à un produit comestible.
C’est la confusion postmoderniste17, entre l’être et l’action, entre l’être et la production, et non le trouble queer auquel on l’assimile à tort, qui est une stratégie idéologique. Souvent inconsciente, elle sert à simplifier la relation esthétique, ce qui rend difficiles la réception dialogique des œuvres d’art et de la pensée comme leur polyphonie intrinsèque.
Confusionnisme, identité de l’artiste et crise de la réception critique
Dans le champ artistique contemporain, l’œuvre-processus, souvent associée à la modélisation des spectacles sur une science humaine, est un allié objectif de l’idéologie du terrain. Une œuvre, soit un spectacle ou une performance qui se délimitent dans l’espace-temps en se disant achevés ou plutôt enfin disposés à être achevés par une réception, peut être étudiée et critiquée. Se refuse en revanche à l’étude critique le vécu irréductible d’un sujet artiste témoin d’un terrain qu’il s’approprie, par exemple, dans un exercice docu- ou autofictionnel. Quand il faudrait que l’artiste laisse l’œuvre s’autonomiser de lui et se taise face à la réception, dans nombre de productions postmodernes, on constate qu’il ne lâche pas l’affaire. Pourquoi ? Parce que ce n’est pas de ce qu’il produit, et change ou ne change pas en nous, qu’il faut que nous parlions, mais de son identité d’artiste. À l’âge postmoderne, l’art se déplace de l’œuvre (objectivable et critiquable) au sujet de l’œuvre (non objectivable) et de même la recherche tend-elle à se déplacer du résultat scientifique produit (thèse, mémoire, essai, article…) à son acteur.ice, à son vécu et à son identité. Cela engendre moins d’échanges rationnels possibles et de la ré-essentialisation : l’être est confondu avec la place qu’il occupe.
En France, l’essor du terrain et de la recherche-création en arts du spectacle coïncident dans le temps et ce n’est pas un hasard : les années 2000-2010. Le terrain fait symptôme comme idée (comme objet de désir) d’une certaine crise du rapport de la recherche avec la culture, autrement dit avec la réception elle-même artistique ou scientifique (exigeante) de l’art.
La recherche est d’abord réception. Mais cela n’est plus satisfaisant à une époque où la réception est dévalorisée comme consommation par essence et niée dans sa créativité spécifique : il faut donc que la recherche soit d’abord création, voire uniquement création, car la réception, seule, bien que censée être délicate et généreuse, est estimée sans valeur. Pourquoi un tel désintérêt pour l’activité critique ? Parce qu’en termes de temporalité néo-libérale, l’on a de moins en moins le temps de recevoir et d’étudier avant de produire ou en même temps que l’on produit.
À défaut d’intérêt pour les œuvres, on s’attache donc aux personnes, à leur vie. L’identité de l’artiste a plus de valeur que l’activité artistique elle-même, qui inspire pléthore de fantasmes mais dont la réalité est austère, risquée, précaire, répétitive, impure, et de longue haleine. C’est le paradoxe, effet d’une démocratisation qui ne s’assume pas dans toutes ses conséquences égalitaires, d’une époque où les mêmes auteurs qui inondent le marché de leurs écrits se plaignent du fait qu’il y a trop d’auteurs, de livres publiés, et pas assez de public pour acheter leurs œuvres ni de critiques pour les lire vraiment. Ce que l’on désire ne reste désirable qu’à condition que l’Autre n’y ait pas accès. L’identité de « créateur » demeure enviable mais à condition que les autres ne créent pas de leur côté, reçoivent positivement nos créations et valident notre identité artiste.
Mais pourquoi le feraient-ils et elles, quand c’est si peu valorisé aujourd’hui18 ?
Le mythe néo-libéral binaire de la recherche-création
Le développement de la recherche-création depuis les années 1980 en Occident repose en partie sur le mythe universitaire néo-libéral de la formation d’artistes à utilité sociale qui devrait précéder, et finalement supplanter, l’érudition, taxée de conservatisme, et même l’analyse critique, souvent accusée de disséquer inhumainement les œuvres19 : la théorie comme perte de temps est alors binairement opposée à la pratique utile, la culture comme domination à un art actuel par essence émancipateur, l’esprit froid et ratiocineur au corps libre et spontané, etc. La binarité hiérarchique si critiquée par les pensées queer caractérise l’âge postmoderne, qui se contente d’inverser la hiérarchie : supériorité de l’affect sur la raison, du concret sur l’abstrait, du corps sur l’esprit, de la présence sur la représentation, du réel sur la fiction, de la création sur la recherche, du terrain sur la problématique, etc. La norme d’hier n’est plus celle d’aujourd’hui, mais il faudrait, pour s’en apercevoir, sortir de la superstructure culturelle postmoderniste, où règnent binarisme, présentisme, confusionnisme et relativisme.
Nous pouvons néanmoins peut-être échapper à la conception néo-libérale de la recherche-création qu’on peut étroitement associer au déplacement postmoderniste de l’idée de terrain : mais, pour en être capable, il nous faut mettre en cause la confusion actuelle entre le sujet de la recherche/de l’art et l’objet de sa recherche/son art ainsi que la fusion, souvent préconisée dans l’institution universitaire et dans le marché institué des œuvres, de la recherche et de la création, à travers le mythe de la recherche comme création et surtout de la création comme recherche (qui se suffit à elle-même). Nous devons maintenir fermement, sinon dans le sujet humain, idéalement non scindé, mais dans l’activité de recherche-création et dans son évaluation critique, le tiret de la différence entre recherche et création. Le tiret est aussi garant, pour chacune de ces activités, de son autonomie et donc de sa valeur spécifique, et, entre elles, de l’égalité dans l’inter-performativité. Ainsi pourra-t-on cultiver, entre notre part créative et notre part réceptive, et loin du binarisme hiérarchisant, de l’essentialisme et du séparatisme, ce que nous appelons le dialogisme.
La recherche-création comme relation dialogique
La notion même de « dialogue » est culturellement spécifique et historiquement située, car tandis qu’un interlocuteur ou une interlocutrice peut être persuadé.e d’avoir une conversation, un.e autre peut être convaincu.e du contraire. Il faut commencer par interroger les rapports de pouvoir qui conditionnent et limitent les possibilités dialogiques20.
Judith Butler
Une recherche-création non problématisée, non argumentée, non contextualisée, dénuée d’articulation avec une Altérité, soit d’autres cultures que la sienne, une culture passée (ce que les autres ont fait) et une culture contemporaine (ce que les autres font), ne nous offrira aucun recul critique ni aucun outil d’émancipation. On ne créera pas, sans relation dialogique entre présent et passé, entre présent et futur, entre ici et ailleurs, de mondes à venir, qu’ils soient théoriques ou pratiques. On s’adaptera seulement à l’état de fait dominant et à ses évolutions soi-disant naturelles dans une modalité métaphysico-tragique (c’est comme ça !) plutôt qu’éthico-politique (cela pourrait être autrement, alors, que pourrait-on faire pour que ce soit autrement ?).
Notre réflexion critique jusqu’ici, somme toute assez brechtienne, sur le contexte postmoderniste contemporain, où l’idéologie du terrain joue son rôle, ne nous condamne pourtant pas, bien au contraire, au pessimisme et au rejet de la recherche-création. Elle nous permet simplement de la penser autrement, comme la place de l’enquête de terrain en son sein. Pourquoi, en effet, au lieu d’être un risque esthétique, politique et scientifique, la recherche-création ne pourrait-elle pas être une stratégie anti-postmoderniste dans nos disciplines ? Pourquoi le terrain n’y reprendrait-il pas son sens le plus rigoureux, méthodologique, et n’y incarnerait-il pas, loin de tout effet d’annonce ou d’autorité, ses valeurs les plus émancipatrices ?
La recherche-création peut être un espace de dépassement de la binarité qui a fait autrefois d’une certaine rationalité et de la culture classique l’alpha et l’oméga de l’humain civilisé et qui en fait de même, maintenant, du corps, du vécu et des affects. Il est vrai qu’en arts, le corps, le vécu et les affects sont très engagés (quel que soit l’art, quoique spécifiquement à chaque fois) mais toujours autant, en réalité, que la pensée rationnelle : dans le meilleur des cas, on procède à une mise en relation, justement, du corps et de l’esprit, du fantasme et de la critique. Une œuvre, à tout le moins une œuvre politique au sens émancipateur, peut produire ainsi un écart réel avec les choses telles qu’elles sont et vont, nous engluent et nous conditionnent, à commencer par les normes contemporaines ; mais c’est à condition que corps et esprit, présence et représentation, affect et pensée, y dialoguent au sens fort, au sens non du dialogue trivial qui n’est souvent qu’un faux dialogue aveugle à ses propres conditions de possibilité, mais au sens exigeant du dialogisme bakhtinien. Un art ne peut créer son autonomie critique, expérimentale, utopique, fantasmatique, philosophique que s’il se conçoit comme une relation dialogique et comme relation dialogique avec la réalité (monde et moi)21.
Le dialogisme n’est donc pas un simple dialogue mou et superficiel. Il n’est pas non plus synonyme de dialectique : ni synthèse surplombante, ni téléologie. Il est une philosophie démocratique de la relation. Idéal artistique, mais aussi scientifique et politique, il suppose entre les parties qui dialoguent autonomie (respect de la spécificité et de l’altérité), égalité (refus de la hiérarchie), effectivité (ou inter-performativité) et dynamisme22 (sens du temps, du mouvement et de l’historicité). Entre recherche et création, entre artiste, œuvre et public, entre sujet de l’enquête et objet de l’enquête, entre problématique et terrain (ou corpus), entre théorie et pratique, entre regard esthétique et regard politique sur l’art ou sur le monde, etc., c’est cette exigence dialogique qu’il convient d’opposer, dans tous les systèmes relationnels présents dans nos travaux de recherche et de création, aux tentations simplificatrices, présentistes, dogmatiques, confusionnistes et relativistes, des idéologies postmodernistes – dont l’idéologie du terrain.
Nous avons esquissé ici une approche décentrée et critique, non de la pratique du terrain comme méthode ni de sa légitimité, qui ne fait aucun doute, mais des usages extensifs et problématiques du vocable de terrain dans nos mondes scientifiques et artistiques en contexte postmoderne. En l’opposant au terme de corpus, nous avons fait apparaître certains de ces usages actuels les plus déviés ou problématiques, sans prétention à l’exhaustivité, et avons tenté de les interpréter sous un angle esthétique et politique, en lien avec une idéologie plus générale dite « postmoderniste », où règnent le présentisme, le confusionnisme et le relativisme, ainsi qu’un certain nombre de binarismes reconduits à travers leur simple inversion. Ainsi avons-nous pu dégager une idéologie du terrain dont nous avons tenté de cerner les présupposés métaphysiques et de dénoncer certains des effets négatifs sur la recherche et la création contemporaines.
À une vérité néo-naturaliste du ressenti, du vécu ou du docu, labellisée en terrain, nous opposons en effet l’idée que ce qui se construit en recherche comme en création, qui sont des actions productives d’objets et des relations avant d’être des identités, est un discours sur le monde, une représentation idéalement la plus juste possible du monde, non le monde lui-même. Si l’on veut procéder à une enquête pour se rapprocher du vrai, autrement dit d’un rapport juste avec la réalité, par les moyens distincts, quoique parfois alliés, des arts et des sciences, nous posons que sont requis chez le sujet de la recherche la conscience de ses postulats et de sa position située, l’argumentation rationnelle, la rigueur de méthode, la clarté conceptuelle, la sensibilité à la spécificité des formes et la culture de leur histoire, la pertinence problématique, l’esprit critique (et avant tout de soi), le respect du terrain justement, qui suppose qu’on ne l’idéalise pas plus qu’on ne le méprise ou ne l’instrumentalise, la communicabilité de ses résultats et l’acceptation de la réception libre des publics.
Pour la pratique artistique, il y a d’autres critères, peut-être plus exigeants encore, à déduire du dialogisme, mais la rigueur et la pertinence, la conscience éthique et politique face à ses inspirations, la capacité de l’artiste à proposer de l’écart sans prétendre reproduire le réel, et à être son premier critique, en se distanciant de sa propre production, pour ne pas l’idéaliser, ni chercher à la légitimer grâce à un quelconque mantra idéologique, nous semblent, dans cette activité idéalement expérimentale qu’est la création, des nécessités parfois trop oubliées.
Notes
- Butler Judith, Ces corps qui comptent, De la matérialité et des limites discursives du « sexe », traduit de l’américain par Charlotte Nordmann, Éditions Amsterdam, 2009, p. 42.
- Dialogique, du concept de « dialogisme », inspiré du théoricien Mikhaïl Bakhtine, que j’ai redéfini et élargi dans ses champs d’application notamment dans Théâtre et politique. Modèles et concepts, Paris, Orizons, « Comparaisons », 2014 : « Le dialogisme […] constitue à notre sens un des critères fondamentaux de la politicité du théâtre contemporain, voire le critère principal et générique, en définissant une relation donnée (par exemple entre l’art et la réalité, entre le politique et le métaphysique, entre l’œuvre et son auteur, entre l’œuvre et son spectateur, entre le metteur en scène et l’acteur, entre les arts sur la scène, entre les voix, discours ou styles dans le poème dramatique) comme effective et transformatrice mais également capable de préserver l’autonomie des éléments de la relation ainsi que l’égalité entre eux » (p. 19, note 2).
- Dans la continuité de Fictions queer. Esthétique et politique de l’imagination (Dijon, EUD, 2018), où je théorise à mon tour le « postmodernisme » à partir de l’ouvrage de Fredric Jameson, Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif (traduit de l’américain par Florence Nevoltry, Paris, Beaux-Arts de Paris éditions, « D’art en questions », 2011 [1991]), je qualifierai de « postmoderniste » une idéologie contemporaine identifiable par certaines valeurs sociales, culturelles et artistiques dominantes, devenues des normes, dans une période qui s’étend, pour la France, des années 1980 à 2020.
- Voir l’appel à communication du colloque international organisé par Nathalie Gauthard et Éléonore Martin, Le terrain en arts vivants. Récits, méthodes, pratiques (Université Bordeaux Montaigne, 20, 21 octobre 2022). URL : https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/recherche/le-terrain-en-arts-vivants-recits-methodes-pratiques.html.
- Comme j’ai pu le faire ailleurs pour le « vécuisme », le « docuisme », le « ressentisme » et même le « performativisme » autant de concepts en « isme » promus par mes soins pour montrer comment une pratique ou une idée devient une valeur dominante en contexte postmoderne et se transforme en norme du marché institué de la création ou de la recherche. Voir Fictions queer. Esthétique et politique de l’imagination, op. cit.
- Appel à communication, op. cit. : « Peut-on parler de “terrain” quand le/la chercheur·e – et artiste – travaille sur sa propre compagnie ? Quelle méthodologie est alors appliquée ? Quels sont les biais générés par une telle implication ? Comment ne pas être pris dans “l’encliquage” (Sardan 1995) quand le/la chercheur·e-artiste est partie prenante ? Comment est-il/elle perçu·e et quelle place lui assigne-t-on ? Les choix méthodologiques concernant la réflexivité sont également cruciaux : quelle place pour le “je” ? Comment s’opère la description de soi et des autres ? ».
- Gauthard Nathalie, « L’Ethnoscénologie et le réseau mycélien. Une écologie des liens », L’ethnographie, 5-6, 2021. URL : https://revues.mshparisnord.fr/ethnographie/index.php?id=1033.
- Ibid.
- Appel à communication, op. cit.
- Voir Donna Haraway, « Savoirs situés », in : Manifeste Cyborg et autres essais, Sciences, Fictions, Féminismes, Anthologie établie par Laurence Allard, Delphine Gardey, Nathalie Magnan, Exils, Essais, 2007, p. 123) : « […] la politique et l’éthique sont au fondement, qu’on le reconnaisse ou pas, des luttes en matière de recherches dans les sciences exactes, naturelles, sociales et humaines. […] Comment voir ? D’où voir ? Quelles limites à la vision ? Pourquoi voir ? Avec qui voir ? Qui arrive à soutenir plus d’un point de vue ? Qui est borné ? Qui porte des œillères ? Qui interprète le champ visuel ? Quels autres pouvoirs sensoriels souhaitons-nous cultiver en plus de la vision ? Le discours moral et politique devrait être le paradigme du discours rationnel dans l’imagerie et les technologies de la vision ».
- Nathalie Gauthard, « L’Ethnoscénologie et le réseau mycélien. Une écologie des liens », op. cit. : « L’étude des contenus, des textes, des conventions scéniques et du jeu des acteurs nécessite une introduction théorique à l’analyse du spectacle et à l’étude en esthétique des arts de la scène, ce qui différencie l’ethnoscénologie de l’anthropologie culturelle ».
- Ibid., « L’ethnoscénologue, conscient.e de la spécificité des arts vivants et performatifs, pratique son terrain selon plusieurs étapes. La première, commune à toute recherche, consiste en un recensement de l’état des connaissances. Et si le terrain est “éloigné”, en un traitement des questions linguistiques, des sources locales et des documents iconographiques ou audiovisuels. La seconde étape aborde les modes de production des données de l’enquête car les sources d’informations peuvent être multiples : acteur/trice.s, danseur/euse.s, musicien.ne.s, responsables locaux, chef.fe.s de troupe, apprenti.e.s, etc. ont tou.te.s un savoir global et précis de leur art ».
- Ibid. « De même que la place des pratiques scéniques ou performatives dans la société étudiée nécessite le recours à l’anthropologie ou à l’histoire culturelle : dans quelle trame culturelle la forme étudiée est-elle insérée ? Quels sont les liens sociologiques qui s’y nouent ? Quels sont les enjeux sociopolitiques ? ».
- Le concept de « dialogisme » lui-même prend parfois ce chemin aussi. Par le contresens, par exemple, à travers la confusion avec le vieux « dialectique » auquel Bakhtine l’a pourtant clairement opposé, ou par la simplification et la réduction, quand on assimile « dialogisme » à simple « dialogue » ou « dialogie ».
- Brecht Bertolt, L’Art du comédien, Écrits sur le théâtre, traduit de l’allemand par Jean Tailleur et Guy Delfeil, traduction des inédits, choix des textes, préface et notes de Jean-Louis Besson, nouvelle édition révisée et augmentée sous la direction de Jean-Marie Valentin, Paris, Éditions de l’Arche, 1999, p. 19 : « Le spectateur et le comédien devraient non pas se rapprocher, mais au contraire s’éloigner l’un de l’autre. Chacun devrait s’éloigner de soi-même. Sinon, c’en est fini de l’effroi nécessaire à la connaissance ».
- « L’Ethnoscénologie et le réseau mycélien. Une écologie des liens », op. cit.
- Voir Corcuff Philippe, La grande confusion. Comment l’extrême-droite gagne la bataille des idées ?, Paris, Textuel, 2021.
- Depuis Balzac, elle est communément associée à la frustration et à l’envie de « l’artiste raté ».
- L’idéologie du terrain et de la recherche en création (qui remplace la recherche par la création) rend en outre la recherche universitaire esclave de la demande sociale (les enjeux « sociétaux ») et empêche sa créativité. On peut comprendre cette relation en usant de l’analogie avec l’éducation, où parfois la pédagogie remplace la transmission de contenus, et avec le monde de l’art, où communiquer sur l’œuvre et la vendre en amont et en aval de sa production prend plus de temps et d’énergie aux artistes que la fabriquer.
- Butler Judith, Trouble dans le genre, Le féminisme et la subversion des identités, Préface d’Éric Fassin, traduit de l’américain par Cynthia Kraus, Paris, La Découverte/Poche, 2006, p. 81.
- Plana Muriel, Théâtre et politique I. Modèles et concepts, Paris, Orizons, « Comparaisons », 2014.
- Karine Saroh a ajouté à la théorie du dialogisme, à l’occasion de sa recherche sur le théâtre musical, le critère du dynamisme, inspiré des écrits théoriques de Luigi Nono. Voir Saroh Karine, Le théâtre musical au XXe siècle, une expérience politique, Arras, Presses Universitaires d’Artois, 2022.