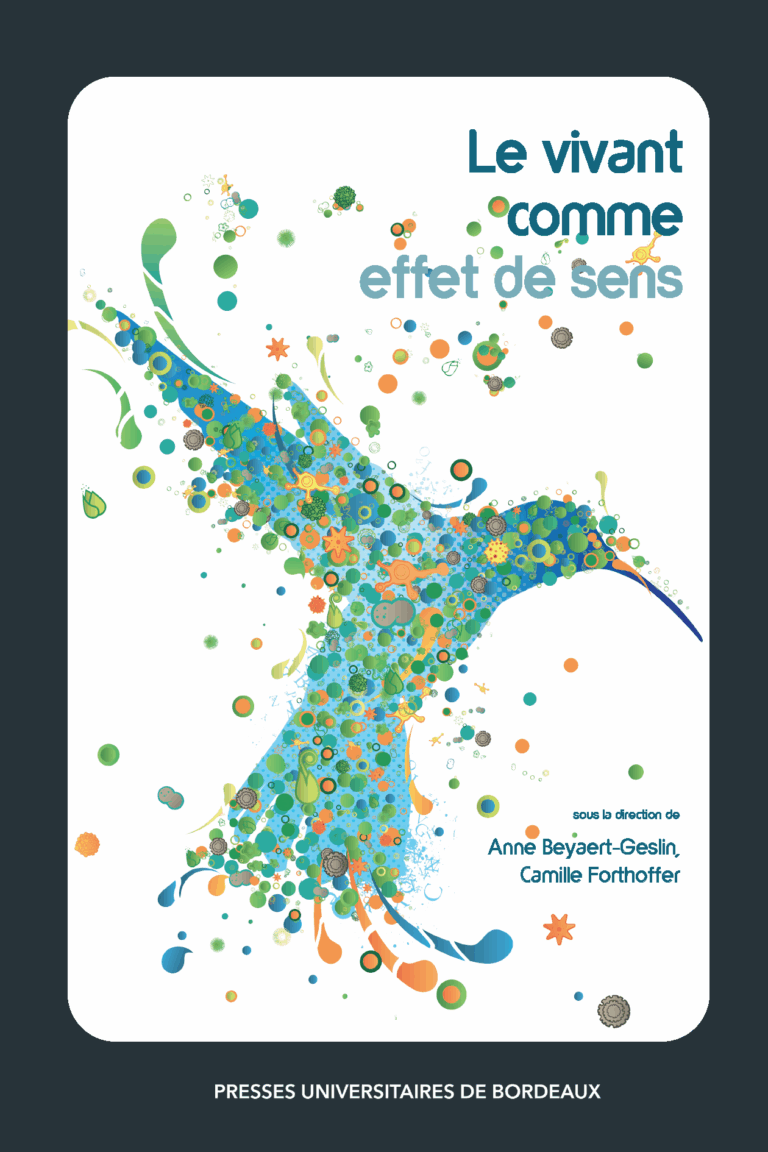Il s’agit de vérifier la manière dont des œuvres d’art impliquant le recours à la technologie peuvent produire des effets de vivant(s). L’article se penche d’abord sur le cas des scanogrammes de Luzia Simons, en montrant notamment que le végétal est lui-même doué d’agentivité, ensuite sur certaines œuvres de Miguel Chevalier, qui mettent en avant les notions de sur-natures ou de méta-nature (« Trans-Nature »), et, enfin, sur les « portraits-fleurs » composites de Reynald Drouhin (métissages), où l’humain peut se sentir « en tant que végétal » et le végétal « en tant qu’humain ».
effets de vivant(s), œuvre d’art, technologie, méta-nature, compositing
This article examines the way in which works of art involving the use of technology can produce living effects. The article looks first at Luzia Simons’ scanograms, showing in particular that plants are themselves endowed with agentivity; then at certain works by Miguel Chevalier, which put forward the notions of super-natures or meta-natures (“Trans-Nature”); and finally at Reynald Drouhin’s “flower portraits” (compositing), in which the human can feel “as plant” and the plant “as human”.
effects of the living, work of art, technology, meta-nature, compositing
Introduction
« J’entendais aussi les voix des arbres : les surprises de leurs mouvements, leurs variétés de formes et jusqu’à leur singularité d’attraction vers la lumière m’avaient tout d’un coup révélé le langage des forêts » : Théodore Rousseau (Sensier 1872) choisit de représenter la forêt en la hissant au rang de l’acteur principal, au détriment de l’humain enfoui dans le décor naturel, sous un dôme végétal. La forêt est représentée, mais en même temps, grâce notamment à l’absence de perspective géométrique, aux transitions chromatiques, des tons jaunes, bruns ou ocres au vert, grâce aux dissymétries produites, notamment, par la torsion des arbres et une composition à la fois régulière et irrégulière, grâce aux variations subtiles de la lumière et de la technique, qui produisent un effet de texture – le hachuré alterne avec le flouté, l’empâté, le dessiné… –, le tableau invite à la contemplation haptique. Grâce au mouvement inhérent à la composition1, le spectateur est appelé à s’y plonger, à la « pénétrer » (Moujan 2013), voire à s’y perdre.
Cette entrée in medias res n’a d’autre objectif que de nous permettre de circonscrire un champ de questionnement : si le panthéisme romantique annonce ici une perspective proprement écologique – l’exposition au Petit Palais à Paris au printemps 2024 présente Rousseau comme un écologiste avant l’heure –, il choisit la voie de l’humanisation de la nature. Or, est-ce la seule manière de dépasser la dualité nature vs culture ? Sous quelles conditions, et selon quelles modalités, l’art, en particulier ici l’art qui met à contribution la technologie, peut-il opter pour le paradigme de la continuité entre humains et non-humains, qui préserve les spécificités des uns et des autres plutôt que de privilégier le point de vue anthropocentré ?
Les enjeux théoriques sont importants : faut-il, dans ce dernier cas, choisir entre un objectivisme positiviste privilégiant l’ancrage dans la biologie et prônant une naturalisation du sens à partir de prégnances biologiques et la position de ceux qui mettent en avant les « contiguïtés des natures-cultures », c’est-à-dire l’entrée en contact d’« existants biotiques et abiotiques (animaux, plantes et rochers) » avec des « collectifs humains » (Fontanille, Zinna 2019, p. 12) ? Il s’agira de vérifier l’hypothèse d’un continuum2 accueillant différents types d’existants biotiques – l’œuvre d’art se hisse-t-elle au rang d’un organisme « vivant » ? –, l’attention se portant sur la manière, également sensible et intuitive, dont un humain peut faire l’expérience vive du végétal.
En quoi cette expérience est-elle intensifiée par le geste de création, c’est-à-dire par la construction d’un monde signifiant « fictionnel » ? Au-delà de la représentation de la nature dont on parle, est-il possible de parler selon elle, avec elle, voire de la parler, plus intimement ? Surtout ici, en quoi le recours par les artistes à la technologie (scanner, génération par l’intelligence artificielle…) permet-il un surcroît d’intensité ? Dans quelle mesure l’art numérique peut-il non seulement témoigner de la socialisation/culturalisation des non-humains érigés en objets de la représentation, mais encore permettre au spectateur de collaborer avec le végétal, voire de se faire végétal ; mieux, de s’expérimenter en tant que végétal ? Formuler la problématique de cette manière un peu provocatrice, c’est, d’emblée, attirer l’attention sur un paradoxe, qui semble de taille : en quoi la technologie serait-elle à même moins de diminuer le poids des médiations que de mettre celles-ci au service de l’« intimité » avec la nature ?
Concrètement, en quoi l’œuvre d’art numérique fabriquée à partir de bases de données se prêtant à des discrétisations, des extractions de traits, des transformations en vecteurs de nombres (embeddings) et des combinaisons, le tout à la faveur d’une « rationalité » algorithmique privilégiant a priori le discontinu et le quantitatif, peut-elle produire un effet de vivant(s) ? La tâche paraît malaisée, ne fût-ce que parce que l’art numérique est volontiers taxé d’immatériel : ne serait-il pas condamné, d’emblée, à invalider toutes les tentatives d’interrelation et d’échange avec le végétal (Coccia 2016), et, a fortiori, d’in(ter)corporation ?
Les hypothèses seront vérifiées en trois temps : la médiation technologique contribue à produire des effets de vivant(s) impliquant le spectateur vivement, (i) en unissant (collaboration) (première partie), (ii) en créant un lieu excentré, méta-, peut-être utopique (deuxième partie) et (iii) en procédant au métissage qui permet à l’humain d’être joint au végétal par la relation prédicative en tant que (troisième partie). Il s’agira, dans tous les cas, de se demander comment la technologie permet de renforcer le mouvement à la base, d’une part, de la collaboration de l’artiste, de la machine et du végétal, d’autre part, du « comme si », gage d’artificialité, et, enfin, de la projection de l’humain vers le végétal, et inversement.
La collaboration « artiste-machine-végétal agi/agissant »
Le spectateur peut créer des effets de vivant(s) en agissant sur la nature par machine interposée. Considérons Pissenlits, une installation interactive d’Edmond Couchot et de Michel Bret de 20063. Le souffle du spectateur dirigé sur l’écran cause l’éparpillement de neuf ombelles de pissenlit, c’est-à-dire la mise en mouvement des graines qui partent dans tous les sens et retombent, dans l’attente de la formation de nouvelles ombelles. Dans ce cas, il ne s’agit pas seulement d’« apprendre à voir » (Zhong Mengual 2021), mais d’apprendre à modifier l’état du végétal, artificiellement, en produisant des effets de vivant(s). Si l’effet est garanti, c’est parce que la simulation respecte les affordances naturelles du végétal, sa propension à être mû par un facteur externe (comme la brise qui passe au-dessus du champ de blé).
Formulons alors l’hypothèse que, non sans paradoxe, la médiation machinique entraîne une exacerbation conjointement de l’artificialité – c’est du fabriqué, du hautement fabriqué, grâce à une « énonciation » conjointement humaine et machinique – et de l’effet de vivant(s) produit : grâce à la machine, le spectateur ferait l’expérience du vivant simulé, présentifié de ce fait même. L’effet de vivant(s) serait décuplé par l’artificialité, de la même manière –mutatis mutandis– que chez Husserl (Parret 2006, p. 15), le souvenir du souvenir conduit à une forte sémiotisation du noème. Le corrélat thymique -le plaisir du spectateur, mais aussi l’admiration pour la prouesse technique mêlée d’inquiétude devant ce qui résiste à la compréhension- serait fonction de la tension extrême qui se noue ainsi.
La participation du spectateur serait donc fondamentale. Elle l’est dans le cas des scanogrammes de Luzia Simons, par exemple de Stockage 182 (177 x 122 cm, 2019)4. En effet, si l’artiste dispose des fleurs, des feuilles… sur une plaque de verre, le résultat du scannage étant imprimé directement sur une feuille en aluminium, la visualisation de l’œuvre sur écran est compatible avec des manipulations par l’internaute : grâce à la technologie, ce dernier peut assortir la vision haptique, quand il se plonge dans l’œuvre qui le happe littéralement, de la vision par le toucher, c’est-à-dire de la tactilité visuelle, quand il s’approprie l’œuvre. À cet effet, il met à contribution la souris et le pointeur ou le doigt, dans le cas d’un écran tactile. Ou encore – pour ne retenir que quelques-unes des manipulations possibles5 –, il peut sonder les profondeurs de l’œuvre à travers des zoomings avant, sur un détail ou un élément représentatif de l’image, ou l’embrasser du regard, grâce à un zooming arrière (vision surplombante)6.
Si la mise à contribution du récepteur agissant constitue un facteur d’intensification supplémentaire, l’essentiel, cependant, réside dans l’entrejeu de l’artiste, de la machine et de la plante (re)présentée7.
Soit donc l’excès d’artificialité technique. Non seulement l’artiste contrarie-t-il toute tentative de « naturalisation » de l’exposition du vivant à travers des choix esthétiques (cadrage, composition florale, l’aluminium comme surface d’inscription avec un grain particulier…) qui exhibent une opacité énonciative (Basso Fossali, Dondero 2011), mais encore le scanner ajoute à la dramatisation en injectant une dose d’aléatoire. Si le choix d’un fond noir renforce la production d’effets de profondeur (image texturale stratifiée), Luzia Martins laisse tomber du pollen sur la plaque de verre du scanogramme pour créer une impression à la fois de mystère, les contours s’estompant, et de tridimensionnalité, un effet vaguement sculptural. Il est ainsi hautement significatif qu’un débrayage impersonnalisant (implication de la machine) soit responsable de l’altération, sous l’effet de la chaleur produite par le scanner, des pétales et des tiges « stockés » sur le verre, qui fleurissent ou se fanent et tombent. Ainsi, des configurations toujours imprévisibles entrent en concurrence avec les compositions finies, stabilisées, voulues par l’artiste. En deçà ou au-delà des interventions de ce dernier, cela se fait sur la plaque de verre : les plantes réagissent à une différence de température à défaut de devenir des agents pléniers. Ainsi, ce que le scanner rend possible, c’est une remontée vers une expérience surmédiée, l’agentivité étant en partie déléguée à la machine, et en même temps paradoxalement immédiate. Quelque chose se passe, se hasarde, qui défie l’objectivation dont est responsable la représentation artistique. Comme une vibration associée à des effets de vivant(s) que le spectateur peut ressentir.
Cette dramatisation par la machine s’ajoute à la tension (re)présentée entre la nature et la culture qui peut se chercher une échappatoire dans l’hybridation productrice des termes complexes « nature culturalisée » et « culture naturalisée », entre réalisme, illusion et imaginaire. Ces œuvres non seulement cherchent à engager un dialogue avec d’anciennes peintures réénoncées du XVIIe siècle, convoquant en filigrane le thème mort-temps-espace et le motif de la vanitas, mais encore jouent sur la teneur hautement symbolique de la fleur – en particulier de la tulipe commercialisée dans le monde entier ; à travers ses migrations, celle-ci est supposée constituer un trait d’union entre les peuples.
Surtout, les plantes (re)présentées sont elles-mêmes douées de vie et donc susceptibles de produire des effets de vivant(s). La série des scanogrammes Lustgarten (Jardin des Délices)8 donne à voir une image-texte énoncée, c’est-à-dire débrayée, dont la cohérence et la cohésion internes sont fonction des relations qui se nouent « directement » entre les fleurs : de l’emmêlement des tiges, du fouillis finit par surgir un ordre « naturel » ou « naturalisé », qui est immédiatement combattu par des forces entropiques et par la possibilité de la perturbation. Ainsi, la composition florale la plus maîtrisée – « domptée » –, la mise en scène des formes qui obéit à des règles et des conventions, se trouve confrontée à ce qui résiste, à ce qui semble se soustraire en partie à l’emprise de l’artiste, s’émanciper en faisant valoir un foisonnement joyeux, plus débridé, qui se joue des codes9.
La plante produit-elle des effets de vivant(s) parce qu’elle crée ? Répondre par l’affirmative, c’est franchir un pas, notamment à la suite de A. N. Whitehead (1939)10, qui considère des modèles de créativité à la fois biologiques et sociaux. La création est alors fonction de l’action d’un organisme sur son environnement. Luzia Martins nous introduit-elle « à un monde vivant aux significations autochtones » (Zhong Mengual 2021, p. 194) ? Autochtones dans la mesure où les végétaux sont engagés dans un « drame entre vivants » (ibid, p. 193) ? Nous venons de le suggérer : les végétaux interagissant au sein d’un réseau, se cachant derrière d’autres plantes ou faisant irruption dans l’image, semblent dotés d’une agentivité propre.
Cette analyse peut être défendue : Zhong Mengual (ibid., p. 191) invite à se placer « du point de vue de la fleur » et à adopter « un point de vue pour un vivant » (ibid., p. 45), c’est-à-dire à constituer un « centre configurateur », qui « façonne l’environnement physique autour de lui en son milieu vécu ». L’on reste cependant enfermé dans un point de vue anthropocentrique : reconnaître une forme même minimale d’attention épisémiotique, de conscience réflexive, voire une capacité embryonnaire à développer des stratégies – on pensera à la plante carnivore ou, plus communément, à la plante vivace qui, pour se répandre dans la plate-bande, cherche à éliminer ses voisins –, déceler ainsi une forme de « subjectivité » du végétal, est-ce se laisser tenter par une humanisation indue ? Celle-là même que nous souhaitons dépasser ? Des investigations supplémentaires sont nécessaires.
Des « Sur-Natures » à la « Méta-Nature »
Partons d’une interview donnée par l’artiste Miguel Chevalier qui, récemment, a eu recours à la génération d’images de végétaux grâce à l’intelligence artificielle (IA) :
Les processus de vie de chacune de ces œuvres sont calqués sur des modèles scientifiques développés par l’INRA [Institut national de la recherche agronomique], par exemple. Aujourd’hui, on peut parler de « postnature » ou de « Trans-Nature ». L’art contemporain qui m’intéresse et auquel je travaille reflète, réfléchit, thématise, ce monde où réel et virtuel, nature et artifices s’interpénètrent de plus en plus (Chevalier et al., 2018).
Du concept de « Sur-Natures » à celui de « Méta-Nature » (pluralisation des natures et déhiscence entre les niveaux) et aux concepts de « postnature » et de « Trans-Nature », il y a, pour Chevalier, une continuité évidente, mais aussi un défi technique à chaque fois renouvelé, au fur et à mesure que les algorithmes deep learning et les réseaux convolutionnels neuronaux voient le jour autour de 2010, avant l’advenue des IA génératives début 2022. Depuis 2004, date de l’installation interactive Sur-Natures, Paradis Artificiels, Chevalier explore les relations entre la nature et l’informatique, créant des générations d’herbiers virtuels, jusqu’à cette projection monumentale sur Dongdaemum design Plaza, intitulée Meta-Nature AI, dans le cadre de Séoul Light 2023 « Digital + Nature : Nouvelles expériences naturelles réalisées avec la technologie numérique ». À partir d’une base de données comprenant différentes espèces d’arbres, de feuilles et de fleurs, en 2D et 3D, réalistes ou plus abstraites, des images de fleurs et de feuilles produites par l’IA, Miguel Chevalier pousse ses recherches plus avant en y mêlant, cette fois-ci, des images générées à partir de textes. Le végétal imaginaire se métamorphosant selon les quatre saisons est doté de vie : les fleurs luxuriantes naissent aléatoirement, s’épanouissent et meurent, le tout porté par la musique. Les processus « physiques » sont mis en avant, quand le langage mathématique rencontre la morphogenèse.

Tout porte à croire que notre hypothèse d’une exacerbation des effets de vivant(s) produits, qui serait fonction, d’une part, du végétal agissant, et, d’autre part, de la mise à contribution de la technologie, est validée. Les œuvres de Chevalier nous invitent, cependant, à franchir un pas.
Si Méta-Nature produit des effets de vivant(s), c’est également parce que l’œuvre est intrinsèquement vivante, parce qu’elle constitue un organisme vivant qui connaît des métamorphoses, comme sous l’effet de forces convergentes et divergentes se déployant dans une morphologie (Bordron 2019). Cela avant même l’émergence d’une forme plus ou moins stabilisée, quoique toujours précaire et sujette, à son tour, à des déformations. Nous proposons d’introduire la notion d’œuvre d’art-écosystème. La définition de la temporalité d’un écosystème est éloquente :
Le temps d’un écosystème est un tissu de rythmes et de fréquences en interaction : en déformant ces interactions ou leurs tissus, les rythmes, les fréquences et leur accord changent ; en retour, une déformation des rythmes ou des fréquences et de leur accord modifie le tissu, le temps de l’écosystème (apud Longo 2022 ; nous traduisons).
D’où des processus de différenciation et d’adaptation-ajustement, en fonction d’isochronies et d’hétérochronies (ibid.). Ces mutations sont impliquées dans une dialectique toujours relancée entre ruptures et (ré)intégrations dans un tout mouvant. On peut étudier la genèse de l’œuvre d’art-organisme vivant qui vérifie le principe d’une variabilité et d’une mobilité incessantes.
En même temps, arraché à tout processus déterministe linéaire, le végétal « artificiel », la « méta-nature », peut explorer de nouvelles relations avec son milieu, qui attestent des changements au niveau des affordances naturelles.
Pour ces deux raisons, on verra dans Méta-Nature un bel exemple de biomorphisme, c’est-à-dire de cette « dynamique du vivant » décrite, entre autres, par Jean Arnaud (2023). Il n’est pas anodin que dans la série Pas vu, ce dernier (ibid., p. 29, p. 32) cherche à dépasser une attention aux formes du vivant « exagérément anthropocentrée », appelant à une « restauration de notre regard sensible sur le monde naturel ». Ainsi, il défend l’idée de l’indistinction plastique de la figure de son environnement, au-delà de la différence entre l’Umgebung et l’Umwelt selon Uexküll. Plus que jamais, avec Carlos Lobo (2023), on peut chercher à « comprendre la production de [la] forme imprimée, qui se développe en vivant (Goethe) » à partir du « niveau physico-chimique, entendu non comme réalité fondamentale et ultime, conditionnant de manière linéaire (selon le schématisme réductionniste dominant) mais comme potentiel », en accord, d’une part, avec la théorie des catastrophes de René Thom (prégnances et saillances) et, d’autre part, avec la phénoménologie husserlienne.
Dans ce contexte, la notion d’élan vital privilégiée par le point de vue vitaliste à la suite de Bergson est précieuse ; à condition que nous nous défassions de l’idée d’un « finalisme » comme « mouvement évolutif dirigé vers le perfectionnement progressif des êtres » (Bertrand, Canque 2011).
En même temps, si l’œuvre d’art-écosystème produit des effets de vivant(s), c’est aussi parce que la nature n’est pas reflétée comme un pré-donné, mais reconstruite sous la forme d’une méta-nature et sous celle de sur-natures. Il ne s’agit pas d’instituer la nature en objet du faire voir, comme pourrait le laisser entendre le préfixe « méta », mais, tout au contraire, de transporter le spectateur ailleurs, au-delà : c’est à partir d’un lieu étranger, excentré, qui nous oblige à renégocier notre rapport au monde, qu’il est désormais possible non point de parler de la nature, mais de parler avec elle. Non sans paradoxe, c’est la déhiscence entre niveaux qui provoque une ex-territorialisation se traduisant par un transport dans un lieu imaginaire, utopique, qui rend la production d’effets de vivant(s) spectaculaire. Spectaculaire parce que la nature a « muté ».
Peut-on passer de la notion de « sur-nature » à celle de « surréel » avec Baudrillard (1981) ? La sur-nature « cartographie » la nature, en la faisant advenir d’une certaine manière, autrement. L’écart -entre la nature « naturelle » et la méta-nature ou les sur-natures artificielles- serait premier et lui-même un facteur d’intensification. L’artifice irait alors de pair avec la fictionnalisation de la nature, renforcée par le caractère fabriqué de l’œuvre d’art-écosystème numérique. Certes, la fictionnalisation est le propre de tout art qui « établit diverses relations inédites entre visible et invisible, entre figuration et non-figuration, entre réel et fiction » (Arnaud 2023, p. 385). Dans le cas du numérique, l’artificialité exacerbée provoquerait un renforcement de l’imaginaire11, en accord avec une spectacularisation aiguisant la production d’effets de vivant(s) : comme si le végétal représenté et présenté, c’est-à-dire mis en présence, était vivant ; il serait vivant et il ne le serait pas, ce qui nous rappellerait la métaphore selon Ricoeur (1975). Tout tient dans la fragilité de ce « comme si », qui peut s’accompagner d’une resensibilisation et d’un renouvellement des valeurs (esthétisation accrue).
Comme si l’œuvre d’art-écosystème était un organisme vivant, aussi : si d’aucuns considèrent l’image comme une « forme de vie non organique » (Arnaud 2023), serait-il plus juste de dire que l’œuvre d’art-écosystème est conçue sur le modèle d’un organisme vivant ? Serait-on alors face à une fictionnalisation au carré (celle du végétal (re)présenté et celle de l’œuvre d’art) ? Paradoxalement, l’artefact numérique permet au spectateur de surmonter la « crise de la sensibilité » (Morizot 2020, p. 21) à travers un « style d’attention complet » (ibid., p. 144). On pourra alors reconnaître aux œuvres de Chevalier un pouvoir d’emphatisation, voire d’empathisation, une Einfühlung, un sentir avec (une nature transfigurée).
Cependant, la question de l’impact des IA génératives sur la production de ces effets de vivant(s) reste encore pendante. Est concerné au premier chef le pouvoir des nombres : si ces derniers peuvent jouer un rôle essentiel dans la production d’œuvres d’art non numériques12, les opérations algorithmiques, par exemple dans l’espace dit « latent », qui se soustrait au regard, nous interpellent. L’espace latent accueille et se constitue à travers les transformations en vecteurs numériques (embeddings) et le calcul, à travers des discrétisations et des discontinuités, à travers l’extraction de traits caractéristiques et des distributions en fonction des critères de similarité et de dissimilarité. La dématérialisation et la quantification l’emportant sur le qualitatif produiraient-elles un effet de « déréalisation » à l’opposé du vivant ? Les technologies de la vision de la machine (machine vision) sont responsables d’une « transformation ontologique » (Somaini 2023). Notamment en raison de la projection de « grilles orthogonales de pixels », avec des coordonnées et des valeurs (ibid.).
À s’en tenir là, l’on pourrait croire qu’il n’y a pas d’« immédiateté naturalisante » dans Méta-Nature. Pourtant, ces positions méritent d’être débattues. Ne fût-ce que parce que, comme le montrent de nombreux travaux en IA, l’œuvre d’art numérique a une matérialité « autre » ; elle est dotée d’une texture (Colas-Blaise 2024). Ensuite, convoquer les théories deleuziennes, c’est fournir au discret et au quantitatif une base continue. Enfin, quand la rationalité algorithmique s’assortit d’une dose de sensible, nous entrevoyons la possibilité non seulement d’une esthétique, mais encore d’une esthésie digitale (Munster 2006). On peut ainsi étayer théoriquement l’idée d’une expérience médiée par la machine non seulement du vivant – du végétal (et de l’œuvre d’art numérique) –, mais elle-même vivante : d’une « in(ter)corporation » sensible au mouvement qui s’empare des formes plastiques qui se relaient, s’échangent, disparaissent et renaissent autrement.
Une dernière étape consistera à scruter la capacité de composites nature-humain à produire des effets de vivant(s) autrement. L’écart ne sera plus « vertical » (vers un niveau méta-), mais vécu « horizontalement » : le « comme si » sera réévalué sous la forme de la relation prédicative « en tant que ».
L’humain en tant que végétal et le végétal en tant que humain
Considérons l’installation interactive Des Fleurs de Reynald Drouhin (2005)13. Un ensemble de portraits se composent d’une mosaïque de fleurs qui donne à voir des matrices « visages » défilant les unes après les autres ou projetées sur le sol, où elles peuvent être foulées par le visiteur. Ces portraits-fleurs sont en évolution permanente. Pour faire émerger une combinatoire générée aléatoirement de sept portraits, l’artiste utilise une base d’environ 400 images, mais aussi de 400 sons et de 400 mots : l’installation offre ainsi une expérience synesthésique « complète » – à l’instar d’un Gesamtkunstwerk repensé par le numérique – en accompagnant l’image du grouillement des insectes ainsi que de la récitation de mots formant des phrases aléatoires : « à la folie acarien accouple actualise adore agite agonie aime allume anus [..] végète vend verge vide viole virginité vit voit vole vous vulve ». L’artiste commente son œuvre en ces termes :
Des Fleurs, c’est une défragmentation du réseau internet, par l’intermédiaire du mot « fleur ». Il existe une multitude d’informations sur la toile ; ce projet permet de les faire coexister dans une même image finale, soit une matrice (visage(s)) qui sert de repère global aux différents éléments qui la composent. Par l’appropriation d’une matière première présente sur le réseau, la mémoire archivée est réactivée en une matière vive éphémère et générative (Drouhin 2001)14.
D’où un voir doublement complexe, à l’origine d’une image offrant un mélange humain-végétal soumis à des variations : voir l’humain à travers la plante et, inversement, voir la plante à travers l’humain. Le spectateur est vivement impliqué dans la production sémiosique. La perception et la trajectoire tracée constituent les premiers générateurs d’un mouvement à l’origine de la production d’effets de vivant(s).
Ensuite, dans quelle mesure l’œuvre est-elle elle-même parcourue de tensions ? En quoi décelons-nous une dynamique inhérente qui permet – en dernière instance – de « parler la nature » (plutôt que de la représenter ou de parler avec elle) ?
Ces « portraits végétaux » cultivent et exhibent l’« entre » ou encore l’écart qui met en tension (Jullien 2012). La tension combat immédiatement le statisme pur. De notre point de vue, le « à travers », qui ne renvoie pas qu’à la perception du spectateur qui interprète l’œuvre, se résout dans un « en tant que », qui proclame le pouvoir de l’écart, plutôt que celui de la différence « surplombante » (ibid.). Le « en tant que » noue une relation nécessairement double, qui est de l’ordre de l’être « en tant que végétal » et « en tant qu’humain ». Dans ce cas, aucune assimilation, mais une interrelation entre la plante et l’humain, grâce à la technique, qui modifie leurs modes d’existence respectifs.
Cela présuppose le processus de l’entrepossession (Colas-Blaise 2023) de l’humain et du végétal qui prend la forme d’un devenir plante de l’humain et d’un devenir humain de la plante qui, cependant, n’aboutissent jamais tout à fait (aspect imperfectif). Adaptons à notre propos le concept de trajection, développé par Augustin Berque (2014), qui refuse le dualisme du moderne occidental. Un tiers peut alors être considéré à travers le rapport à, le en tant que, qui est trajection ; la relation « r » résulte d’une relation prédicative vivante entre un sujet et une extériorité. Nous avançons que, tendu entre l’environnement supposé totalement objectif et une (re)présentation qui en est une reconstruction, le milieu naturel est transfiguré à travers une trajection qui se reformule en une projection de l’humain vers le végétal, et inversement, sans qu’il y ait collusion des deux entités. Par l’entremise de la machine, le « je » humain peut se projeter vers le végétal, son autre, se penser en tant que végétal, et entrer avec lui dans la composition d’un tiers toujours sous tension.
Aucune collusion, avons-nous dit : précisément, le mouvement producteur d’effets de vivant(s) trouve une de ses origines dans le processus du compositing (Arnaud 2022) d’œuvres « composites » qui gardent les traces du collage numérique. Aussi l’hybridation qui produirait une unité inédite par fusion cède-t-elle sa place au métissage (Colas-Blaise 2023) : l’œuvre métissée invite à pencher tantôt du côté de la plante, tantôt du côté de l’humain, sans faire émerger de nouvelle unité homogène.
Finalement, ce que les « portraits végétaux » donnent à voir, c’est cet entre l’humain et le végétal, l’écart ne devant pas se réduire sous peine d’une assimilation de l’un à l’autre ou d’une superposition de l’un et de l’autre. C’est aussi une projection incessante d’un côté et de l’autre d’une frontière qui n’est jamais abolie. À la faveur de l’attraction exercée par l’autre (le végétal, l’humain) et par le retour à la position de départ. Grâce à une métastabilité, voire une oscillation sans fin. À condition que le soubassement soit tensionnel et continu et que des polarités soient à la fois maintenues et dépassées.
Est-il possible de parler la nature, tout interstice étant résorbé ? Serait-ce alors (re)trouver l’« inouï » (Jullien 2019) ? Une telle intensité ne serait-elle atteignable que rarement ? La technologie y contribuerait-elle ? Les œuvres de Drouhin rendent plutôt sensibles au mouvement incessamment entretenu à la base de l’interaction, qui peut s’assortir d’une in(ter)corporation, jamais totale.
Conclusion
Nous avons voulu vérifier les conditions de possibilité et les modalités de la production d’effets de vivant(s) par des œuvres d’art impliquant la technologie. Trois points semblent se dégager.
D’abord, il faut que la « collaboration » de l’artiste avec la machine confère à cette dernière une certaine autonomie, qui n’est pas incompatible avec l’aléatoire et l’indétermination au sein même du discret. Ils sont à la base de la variabilité intrinsèque des images numériques.
Ensuite, il est important que le végétal, pris dans cette même « collaboration », ne soit pas seulement (re)présenté, mais encore doué d’agentivité, voire d’un degré de créativité. Ce trait caractéristique, présent chez Luzia Martins, prend une importance toute particulière dans le cas de l’œuvre d’art-écosystème évolutive, qui exemplifie la vie. On a pu constater à quel point l’ex-territorialisation de la nature, qui est accueillie par un lieu utopique sous la forme de « sur-natures » ou d’une « méta-nature », est responsable d’une fictionnalisation de la nature présentifiée, à laquelle la fabrication technique n’est pas étrangère. D’où le déplacement de l’accent sur l’« effet » (de vivant(s)), c’est-à-dire sur l’impression d’un méta-réel -d’un « surréel »- qui ne reflète pas une nature objectivée et ordonnée une fois pour toutes, mais en propose une reconstruction spectaculaire affectant le spectateur.
Enfin, si l’effet de vivant(s) peut s’autoriser de l’élection d’un lieu extra-ordinaire, l’écart – le en tant que, peut-être le als heidéggerien – peut prendre ailleurs la forme de l’entre-deux du « portrait végétal » composite, qui n’est ni portrait ni végétal tout à fait, ni les deux à la fois, mais l’un ou l’autre, successivement et imparfaitement, en un jeu de renvois incessant. La production d’effets de vivant(s) incombe alors à l’oscillation sur un fond de tensions, d’attractions et de rejets, de projections vers l’autre et de replis.
Les études de cas successives donnent-elles à voir une intensification progressive, une amplification du mouvement à la base de la production d’effets de vivant(s) ? Dira-t-on que les effets de vivant(s) décuplés par l’art numérique, plus puissants, tirent plus à conséquence que ceux produits par la nature non esthétisée ni artistisée, d’une part, par des peintures telles que celles de Rousseau, d’autre part ? Sans doute ne s’agit-il pas de déceler un « plus » ou un « moins », mais d’être sensible à des manières de produire des effets de vivant(s) d’une autre manière. Si tel est le cas, force est de constater que le mérite en revient, en dernier lieu, aux œuvres d’art numériques elles-mêmes et à la prouesse technique qu’elles supposent.
Notes
- Cf. également Beyaert-Geslin (2024).
- Cf. Bertrand et Canque (2011) au sujet d’un « continuum logique, c’est-à-dire d‘une identité partagée, entre les processus biologiques élémentaires qui prennent place à l’échelon cellulaire et les modes de production et d’organisation du langage en acte, mis en œuvre dans le discours du sujet parlant ».
- Cf. [http://variation.paris/artists/couchot-bret/] (programme informatique (logiciel spécifique Anyflo, langage de programmation Javascript, Pseudo C). En 1990, l’installation a nécessité un PC (système d’exploitation : Windows 7), le logiciel Anyflo, un moniteur et un microphone. Le son de la respiration a été transformé en la simulation digitale d’une brise.
- Cf. [https://galeriearcturus.com/artiste/luzia-simons/].
- Cf. Reyes-Garcia (2015).
- Pour une discussion des notions de vision haptique et de tactilité visuelle, cf. Colas-Blaise (2024).
- La plante est à la fois représentée, dans la mesure où l’œuvre « parle » d’elle, et présentée, c’est-à-dire mise en présence de l’énonciataire à travers une mise en scène plus ou moins spectaculaire.
- Cf. [https://galeriearcturus.com › luzia-simonsdp-2024].
- Cf. la prédominance des lignes courbes ou diagonales, considérées comme plus dynamiques que les lignes horizontales et verticales, ainsi que la direction prise par les végétaux.
- Cf. des conférences données à l’Université de Chicago en 1933.
- Cf. la double étymologie de « fiction » : fabrication et imaginaire.
- Cf. Arnaud (2023, p. 387) au sujet de Paul Klee.
- Cf. [https://red.reynalddrouhin.net/archive/desfleurs/] (consulté le 14/01/2026).
- Cf. Des Frags Recherches Esquisses Documents : [https://red.reynalddrouhin.net/archive/desfrags/] (consulté le 14/01/2026). Le projet web : 2001-2003 ; [http://www.incident.net/works/desfleurs/]. Quadrillage de la matrice : 16 x 24 x 7 n. (visages) = 2688 fleurs. Voir Chatonsky (2007, p. 96) au sujet de l’interactivité et de la génération.