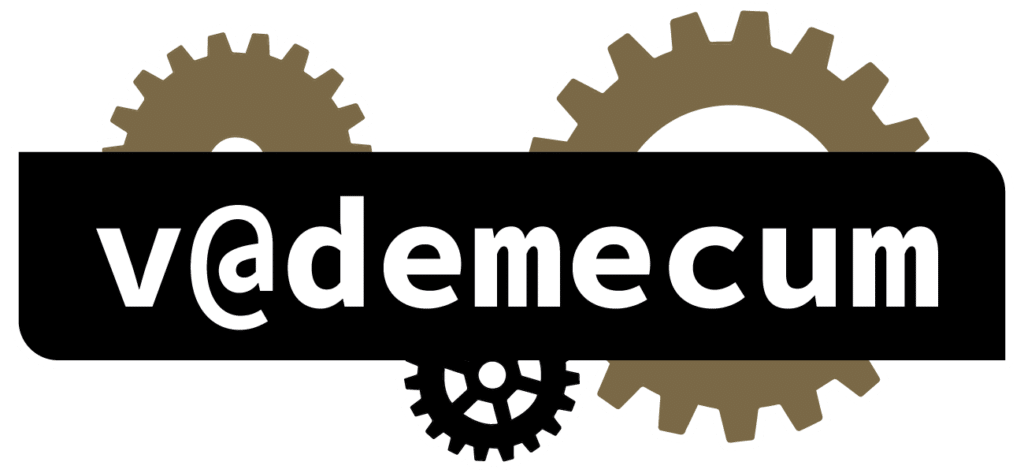En arts du spectacle, il n’est pas rare que la/le chercheur·euse soit également praticien·ne et possède une double posture, comme pour les dramaturges, scénographes, metteur·se·s en scène, musicien·ne·s, danseur·euse·s, etc. La formation artistique précède souvent la formation scientifique. Ainsi les deux casquettes se complètent et la/le praticien·ne-chercheur·euse devient alors un·e théoricien·ne de la pratique en gommant les espaces entre théorie et pratique. Dans ce cas de figure, la/le chercheur·euse-artiste est un·e expert·e dans les deux domaines (artistique et scientifique). Dans ce chapitre, je propose de réfléchir, à partir d’un récit réflexif sur les terrains que j’ai effectués, à la posture de la chercheuse-artiste quand il y a un décalage de niveau d’expertise : novice du côté de la pratique artistique et expert du côté de la recherche.
En effet, à partir d’enquêtes de terrain menées à Taiwan et en Chine continentale (2005 ; 2006-2007 ; 2009 ; 2010-2011 ; 2013), j’ai été confrontée à cette question lorsque j’ai dû apprendre la pratique artistique sur laquelle portent mes recherches. Une des stratégies que j’ai mises en place pour entrer sur le terrain a été d’apprendre le Yuju 豫劇 (« opéra du Henan ») et le Jingju 京劇 (traduit communément par « opéra de Pékin ») dans plusieurs contextes : universitaire, associatif, en cours particuliers et en écoles spécialisées. Cette posture est ambivalente, car elle repose sur un décalage entre position de « savante », celle de chercheuse, et position d’apprenante, de débutante dans l’apprentissage d’un savoir-faire artistique. Ma posture d’artiste novice a parfois été difficile à articuler avec celle de chercheuse, considérée sur le terrain comme « experte » dans son domaine.
Comment ces deux postures se négocient-elles sur le terrain ? Selon quels degrés d’implication et d’engagement ? Qu’engendrent ces deux postures comme conséquences dans la pratique artistique et dans la production des données scientifiques chez le/la chercheur·euse ? Selon le système d’apprentissage de type « maître à disciple », très présent dans les pratiques chinoises dites « traditionnelles », la posture de l’apprenti artiste – du disciple – nécessite un engagement et une implication forte, à la fois physique, personnelle et affective. Quels sont les biais générés par une telle implication ? Comment ne pas être pris dans « l’encliquage »1 quand le/la chercheur·e-artiste est partie prenante ? Cette « démarche expérientielle » permet d’acquérir un savoir incarné. Mais comment ne pas généraliser une expérience singulière et sensible ? Et comment, inversement, s’effectue la montée en généralité et en conceptualisation que nécessite aussi le travail de recherche ?
Le travail d’enquête que j’ai mené s’est inscrit dans une perspective ethnoscénologique. Cette perspective critique, créée dans les années 1990 dans le champ des études théâtrales, emprunte les méthodologies de terrain à l’ethnologie et à l’anthropologie. Les outils méthodologiques de l’anthropologie réflexive sont particulièrement opérants pour réfléchir à la place du « je », à la description de soi et des autres.
Se former pour « entrer sur le terrain » : engagement, reconnaissance et légitimité
Les pratiques asiatiques spectaculaires sont nombreuses à être des genres très codifiés qui nécessitent un apprentissage dès l’enfance comme le nô, le kyôgen, le kathakali, le terrokutu, les xiqu 戲曲 (ou « opéras chinois »)2, etc. Ce sont des formations très exigeantes physiquement et elles requièrent souvent un entraînement quotidien. Un·e chercheur·euse, qui n’a pas été formé·e depuis l’enfance et qui veut se former à ces pratiques pour mener une enquête de terrain, est de facto novice quand il « entre » sur le terrain. Cela a été mon cas lorsque j’ai commencé mes recherches sur le Yuju à Taiwan3.
J’ai d’abord été introduite auprès de la troupe Henan bangzi : Taiwan Yuju 河南梆子台灣豫劇團 comme jeune chercheuse, étudiante d’échange à l’Université Sun Yat-Sen de Kaohsiung (Gaoxiong Zhongshan daxue 高雄中山大學), par une professeure de l’Université qui avait travaillé précédemment avec la troupe. J’étais donc chaudement recommandée par une personne de confiance. La première réaction de la troupe a été de mettre à ma disposition, voire de m’offrir, une somme importante de documents (DVD de spectacles, ouvrages commémoratifs, CD-Rom produits par la troupe, etc.). Ce don était une aubaine mais cela a été un peu déconcertant, car une fois la documentation fournie, ma présence n’était plus justifiée parmi la troupe. Pour ses membres, je n’avais qu’à me contenter d’explorer la documentation et, éventuellement revenir plus tard, si j’avais des questions. Mon objectif était d’observer leur travail au quotidien (répétitions, créations, enseignement, tournées, etc.) pour produire une recherche de terrain, ce qui n’avait pas été compris comme tel. Cette place, que j’imaginais prendre, n’était pas très évidente, car j’étais à l’époque encore en formation, puisque j’étais étudiante en master 2. Il s’agissait d’un premier terrain et je n’étais pas encore certaine de ce que j’allais observer. J’étais face à une autre difficulté, celle de la maîtrise de la langue : à l’époque je parlais très mal le chinois, je ne parlais ni le taiwanais (taiyu 台語), la langue locale, ni le henanais (henan hua 河南話), langue dans laquelle est joué et chanté le Yuju. Comment produire un savoir d’expert alors que j’étais débutante dans la pratique, dans la recherche et que je découvrais la vie à Taiwan ? Il me fallait donc trouver une place qui pouvait me permettre d’assumer mon ignorance, celle d’apprenante s’est vite imposée comme solution.
Ainsi, pour pouvoir négocier ma venue régulière au sein de la troupe, j’ai suivi un camarade taiwanais de l’université qui prenait des cours particuliers de Yuju. Ma demande a été acceptée et j’ai ainsi pu me rendre deux fois par semaine pour apprendre les bases de la gestuelle codifiée de rôles masculins auprès d’une des artistes. J’apprenais l’enchaînement que me montrait ma professeure, dehors dans la cour, pendant que les artistes répétaient à l’intérieur. J’étais seule et isolée ; parfois, les quelques artistes, en pause, me regardaient avec curiosité. C’est après plusieurs semaines de persévérance que j’ai pu être intégrée et que tous les membres de la troupe ont été attentifs à mon apprentissage et prêts à répondre à mes questions. Ils ont alors bien voulu me transmettre leur savoir-faire. Je m’y rendais alors presque tous les jours et je participais à de nombreuses activités (répétitions générales, cérémonies diverses, etc.). J’avais fini par trouver une place parmi eux : j’étais leur élève française qui s’intéressait et s’initiait à leur art.
En somme, il a été plus facile pour la troupe de comprendre mon engagement – corporel – et ma persévérance dans l’apprentissage de Yuju que ma position de chercheuse qu’ils ont eu du mal à reconnaître puisque j’étais étudiante et donc en formation, à la fois dans le monde académique et dans la pratique du Yuju.
Par la suite, forte de l’expérience taiwanaise, j’ai construit mon projet de thèse avec l’idée d’aller sur le terrain pour compléter mon apprentissage technique. Wang Hailing 王海玲, « l’impératrice du Yuju » à Taiwan, m’avait conseillé d’aller sur le continent et de me former au Jingju afin que je puisse progresser dans l’acquisition technique et dans la compréhension des pratiques spectaculaires et performatives traditionnelles chinoises. Le Jingju est considéré comme un genre majeur et plus sophistiqué que le Yuju, un genre régional réputé plus commun4. Ainsi, pendant la thèse, je suis partie apprendre le Jingju dans une école spécialisée, une école de niveau lycée, le Beijing opera and arts college (北京戏曲艺术职业学院) à Beijing. En suivant ce conseil et faisant ce « détour », j’ai pu bénéficier d’un accès privilégié au milieu du xiqu et j’ai pu affiner ma compréhension incarnée de cette forme artistique. Je me suis présentée d’une manière différente. Cette fois-ci, j’ai mis l’accent sur le fait que j’étais une élève-artiste qui effectuait une recherche sur les xiqu. L’ordre des casquettes chercheuse/artiste était inversé : j’ai mis l’accent sur la pratique artistique et j’ai présenté la recherche comme secondaire. J’allais dans cette école spécialisée pour me former à un « nouveau » langage artistique, puisque j’avais déjà eu une formation de comédienne en France. En me présentant ainsi, le rapport de mes interlocuteurs était différent, car si j’étais novice concernant le xiqu, je ne l’étais pas dans le milieu du spectacle. Pour l’école, il y avait donc une possibilité d’échange de compétences entre eux et moi, ce qui n’était pas le cas à Taiwan.
Pour mon apprentissage qui était prévu sur une période relativement courte de dix mois (la formation en Jingju dure entre cinq et huit ans5), plusieurs dispositifs ont été mis en place : cours particuliers, cours avec les enfants débutants d’une dizaine d’années, cours avec les plus âgés (17-18 ans) (bien que débutante en technique gestuelle, je pouvais travailler l’interprétation des rôles avec ces derniers).
Parce qu’il y avait des décalages d’âge, de niveau et d’espace, les dispositifs ont fait l’objet de négociations entre l’école et moi. Les enseignants ont ainsi testé mon engagement et ma volonté afin de définir le type d’enseignement et le contenu du savoir qu’ils allaient me transmettre. J’ai pu bénéficier de l’enseignement de Cheng Rong 程荣, spécialisée dans les rôles de huadan » 花旦, (traduit littéralement par « jeunes filles en fleurs ») et une des rares à maîtriser la technique des qiao 跷, échasses qui imitent les pieds bandés. Cette fois-ci, la perception du décalage entre chercheuse et artiste par les personnes de l’école était moins grande qu’à Taiwan : en pratiquant et en me « frottant » à cet apprentissage fastidieux et douloureux, je devenais une des « leurs », praticienne avant tout et seulement, ensuite, théoricienne. Autrement dit, la casquette de praticienne a permis de faire accepter la casquette de chercheuse. Cette légitimité acquise par la pratique a permis de dépasser les querelles entre praticiens d’un côté et théoriciens de l’autre, querelles qui ne sont, par ailleurs, pas spécifiques au xiqu et que l’on retrouve aussi en France, dans le monde du spectacle.
Cette légitimité par la pratique est essentielle, car elle facilite l’accès aux artistes, aux chercheur·euse·s spécialisé·e·s. Le cas d’Elisabeth Wichmann actuellement professeure à l’Université de Honolulu, est exemplaire à cet égard. En effet, elle a acquis une grande légitimité dans le milieu du xiqu après s’être formée au Jingju pendant trois années complètes à Beijing dans les années 1980. Elle n’a cessé, par la suite, de compléter son apprentissage, et elle est considérée aujourd’hui comme une chercheuse de renom sur le xiqu, comme en témoigne la place qu’elle occupe dans les différents colloques organisés par l’Académie nationale de xiqu (中国戏曲学院).
Que ce soit au contact d’une troupe ou dans une école, mon travail de recherche a été conditionné par l’apprentissage de la pratique artistique, apprentissage sans lequel j’aurais dû me contenter des documents que l’on m’avait fourni. Le contact humain, les échanges, les interactions sociales se sont construites dans l’espace artistique pendant les entraînements, pendant les pauses, pendant les répétitions. Une certaine proximité avec les artistes s’est ainsi nouée. Cette forme de participation observante m’a permis d’avoir accès à certaines situations du domaine « privé » de la troupe comme les coulisses, les concours, les rituels, les tournées. Cette proximité a permis une parole plus libre des artistes sur le métier, puisque, d’une certaine manière, j’en faisais partie. Cette posture « intérieure » a favorisé la pluralité des rencontres avec des personnes différentes, des artistes aux responsables administratifs et artistiques. J’ai ainsi pu avoir accès à une multiplicité de points de vue, ce qui n’aurait pas été le cas avec une posture « extérieure » d’observation. Du moins, ce type de relations plurielles et quotidiennes, si je n’avais pas été élève, aurait nécessité un terrain très long qui n’aurait pas cadré avec les contraintes qui étaient les miennes : économiques, institutionnelles, administratives, etc.
Après avoir abordé les négociations pour trouver une place entre chercheuse et artiste sur le terrain, la deuxième partie de ce chapitre se consacre plus spécifiquement à l’apprentissage de la pratique auprès d’un maître en montrant les enjeux et les limites que cela présente pour le/la chercheur·euse.
La relation maître-disciple : enjeux et limites
L’apprentissage des pratiques spectaculaires traditionnelles se fait, en général, de manière orale, et se construit sur une relation de « maître à disciple », dans un rapport de piété filiale. C’est le cas des xiqu. Le maître (ou professeur) est celui qui transmet son savoir pendant plusieurs années au disciple (ou élève). Ce rapport de « maître à disciple » engendre une lignée d’artistes, une filiation, une école ou encore une « tradition » artistique. Quand il joue, l’artiste n’engage pas seulement sa personne mais aussi celle du maître, il a donc une certaine responsabilité envers l’héritage qui lui a été transmis6. Ce rapport filial implique des devoirs et des obligations, ainsi qu’une forte dimension affective. Outre l’implication dans le métier, le/a professeur·e s’implique également dans la vie personnelle de l’élève : ses fréquentations et relations, son hygiène de vie (nourriture, loisirs), sa santé (fatigue, blessures, maladie), son avenir professionnel, etc. Ce rapport filial, j’ai surtout pu l’observer lorsque j’étais à Beijing : tous les professeur·e·s7 qui enseignent le répertoire suivent les élèves durant toute leur scolarité, développent une relation forte avec eux et en sont responsables. Ils prennent le relais des parents qui vivent souvent loin : en effet, les élèves viennent de toute la Chine et vivent en internat. Excepté les enfants originaires de Beijing, tous ne rentrent chez eux que deux fois par an : pendant le Nouvel An et pendant les vacances d’été.
Dans cette organisation, la transmission s’opère de manière verticale dans le sens où le maître décide du savoir transmis et définit à quel moment l’élève est prêt à prendre plus d’autonomie. Les premières années d’apprentissage du xiqu sont consacrées à l’acquisition technique. L’élève passe par une phase de reproduction des mouvements et par l’incorporation des techniques. Puis, au fur et à mesure, le/la professeur·e lui donne plus de liberté dans l’interprétation des personnages et des pièces du répertoire8.
Quand le/la professeur·e considère que l’on a acquis un savoir-faire, une technique, il demande de le transmettre aux plus jeunes et moins expérimentés. Cette pratique permet de se situer dans son apprentissage et de prendre la mesure de ses acquis, ou au contraire, de ce qui n’est pas encore maîtrisé. C’est également une autre manière d’intégrer la technique par son enseignement. L’enseignement nécessite parfois de passer par la verbalisation et permet à l’élève de conscientiser le savoir corporel (positionnement du corps dans l’espace, poids/contrepoids, muscles sollicités, etc.) et d’être plus précis. Ce procédé correspond à une forme de validation du savoir, de reconnaissance de la part du professeur du savoir-faire de l’élève et de son expertise. Par exemple, la validation de mes compétences sur l’acquisition de la technique du bandage et des connaissances autour des qiao s’est faite en deux étapes. La première étape a consisté à enseigner le bandage des échasses aux jeunes élèves d’une dizaine d’années qui commençaient leur apprentissage et à vérifier le bandage, une fois celui-ci terminé. Lorsque ma professeure Cheng Rong me l’a demandé au bout d’un mois d’apprentissage, cela m’a étonnée. En effet, il s’agit d’une grande responsabilité, car si cela n’est pas fait correctement, les élèves peuvent se blesser. La seconde étape a été de m’envoyer participer à un colloque international de spécialistes de xiqu pour y présenter les techniques des qiao, en tant que praticienne. Ma professeure m’a libéré du temps sur mon apprentissage pratique pour que je puisse effectuer des recherches et préparer ma communication. Selon elle, bien qu’étrangère, j’étais tout à fait légitime pour présenter ce travail, car peu de théoriciens connaissent vraiment le travail technique des qiao. Selon Cheng Rong, j’étais une praticienne à part entière, et elle me présentait ainsi. J’étais reconnue comme artiste grâce à mon investissement par l’acceptation de la douleur (étirements, souplesse, pratique des qiao) et reconnue comme chercheuse, et je participais à légitimer ou relégitimer une pratique de moins en moins usitée par la jeunesse en Chine. Ma professeure savait que mon objectif n’était pas de devenir une artiste professionnelle de jingju, et que je venais faire des recherches, il était donc important pour elle, en tant que « maître », de me « mettre le pied à l’étrier » et de me lancer dans le milieu académique chinois. La réflexion sur les débouchés est aussi une prérogative du maître qui conseille l’élève sur la suite de sa formation : aller à l’université, continuer dans le xiqu soit en pédagogie, soit en mise en scène, régie, etc. À la fin de mon séjour, grâce à la pratique, j’avais acquis une triple reconnaissance : par ma professeure, par l’école et enfin par le monde académique.
Cet engagement dans une relation de maître à disciple a été un formidable atout pour être initiée à la pratique, bénéficier d’une certaine légitimité, et d’une « entrée » dans le milieu professionnel et académique, mais il a aussi comporté certaines limites. Le maître intervient à plusieurs niveaux de la vie du disciple, il est parfois difficile de s’en échapper, et cela peut entraver la recherche. Je propose ici de m’appuyer sur trois exemples, du plus banal au plus délicat.
Le premier exemple concerne l’intervention du maître dans la gestion de l’aspect physique. Le maître surveille le poids, l’aspect physique des élèves en lien avec les rôles qu’ils/elles interprètent. Chaque semaine, pour les jeunes adolescentes, il y a la pesée afin que les jeunes filles qui jouent les rôles féminins ne prennent pas trop de poids. Ce type de pratique peut être comparé au ballet classique. Si j’ai échappé à la pesée – à proprement parler – je devais également surveiller mon poids et ma silhouette. J’étais particulièrement surveillée pendant le déjeuner à la cantine. Mais ce qui a été le plus difficile à accepter pour moi alors que je ne souhaitais pas devenir artiste professionnelle a été de ne pas avoir le droit de discuter du fait de raser ma frange et le haut de mon crâne lorsqu’il a fallu que je présente la pièce pour mon évaluation en costume et maquillage. Cheng Rong me traitait comme ses élèves et c’était un honneur qu’elle me faisait. Refuser aurait mis en péril la confiance et l’investissement de ma professeure dans son enseignement à mon égard. Bien que cela touchait à mon intégrité physique, il m’était impossible de refuser sans mettre mon terrain en péril.
Le deuxième exemple concerne les questions que l’on peut ou non poser, car elles peuvent être reçues comme un manque de respect, notamment tout ce qui touche à la vie privée du maître, les questions économiques9. Selon son niveau d’initiation, il n’est pas possible d’importuner certains « vieux maîtres » avec des questions trop naïves, c’est pourquoi je n’ai pas pu discuter avec Sun Yuming, directrice de l’école Beijing opera and arts college, ou encore avec un vieux maître du Yuju rencontré au Henan.
Enfin, le troisième exemple concerne les questions de filiation. En effet, le maître cherche à faire école en transmettant son art pour créer une filiation artistique. Il est donc très délicat, et parfois impossible d’aller apprendre auprès d’autres maîtres, et il n’est parfois pas possible de les interroger, alors que cela pourrait nourrir le travail de recherche. Le/la chercheur·euse en anthropologie a besoin de confronter les points de vue, les discours, les pratiques mais lorsqu’il/elle est également artiste, il/elle n’a pas cette liberté et doit négocier ce positionnement entre artiste et chercheur·euse. Si le maître refuse et que l’on décide d’y aller quand même, on risque alors de briser la relation de confiance avec lui et de compromettre notre place sur le terrain. Le/la chercheur·euse se retrouve pris·e dans le phénomène d’« encliquage »10 et cela nécessite de bien comprendre les enjeux des relations entre les différentes écoles, personnes, etc. Pour ma part, j’ai dû renoncer à interroger certains artistes lorsque j’étais en Chine continentale, notamment lorsque j’ai séjourné au Henan. Je n’avais pas ce problème à Taiwan, étant donné qu’il n’y avait qu’une seule troupe de Yuju.
Après m’être interrogée sur les postures chercheur·euse/artiste sur le terrain, la troisième partie propose de réfléchir au « terrain » de la recherche, j’entends par là, la question de la production des données à partir de la démarche expérientielle.
Multiplicité des points de vue et savoir incarné : co-construction d’une recherche
La formation pratique du chercheur, outre des enjeux d’accès au terrain et de postures, permet également de faire apparaître de nouveaux sujets de recherche, comme l’évoque Philippe Hert dans son article « Le corps du savoir : qualifier le savoir incarné du terrain » : « [d’] » une part, ce corps éprouvant fait émerger un monde à connaître, et d’autre part il est ce qui résiste aux discours surplombants sur une situation au nom d’une rationalité́ abstraite »11.
En effet, pratiquer le genre artistique que l’on étudie permet d’avoir conscience des savoirs implicites, non verbalisés et de les mettre en corrélation avec les savoirs explicites, mis en discours. En ce sens, l’apprentissage de la pratique permet de faire apparaître de nouveaux objets de recherche. Par exemple, j’ai pu proposer dans un article publié en 201912 une réflexion sur les dénominations des gestes techniques de base du jingju comme « yunshou 雲手 (main-nuage) », « shanbang 山膀 (épaule-montagne) » et « lanhua zhi 蘭花指 (doigt-orchidée) » et leur valeur effective et métaphorique. Or, dans les manuels d’apprentissage et d’enseignement, ces gestes sont curieusement absents alors qu’ils représentent les premiers gestes que l’on apprend. Par ailleurs, ma double posture de chercheuse/artiste m’a permis de comprendre ces gestes dans leur dimension culturelle : les références à l’environnement comme le nuage, la montagne et les fleurs d’orchidée font partie des modèles récurrents des arts traditionnels chinois comme la peinture, la calligraphie, la musique mais aussi les pratiques martiales. Puisque ces gestes sont absents des livres, c’est grâce à la pratique que j’ai pu les comprendre (mieux que si je les avais seulement observés). Ainsi à partir de ce qui est un détail du spectacle, en l’occurrence un « simple » geste, j’ai pu proposer une analyse esthétique des xiqu que j’ai adossée à une réflexion plus globale sur l’esthétique traditionnelle, la perception du corps, les liens avec la pensée cosmologique traditionnelle, la perception de l’espace, etc.
C’est également en passant par l’apprentissage technique qu’il m’a été possible de montrer la part d’interprétation des artistes, loin du préjugé qui assigne les artistes des pratiques codifiées à de simples exécutants, prisonniers d’une forme millénaire et désuète ! Par ailleurs, je déconstruis également ce préjugé dans ma pratique pédagogique, auprès des étudiants de Licence 2 Théâtre de l’Université Bordeaux Montaigne pour qui j’assure un cours d’initiation au jingju. Avec eux, je fais le même constat : les étudiant·e·s perçoivent davantage cette question de la créativité de l’artiste de forme codifiée par la pratique et l’expérience que par le cours théorique et le discours.
Ainsi pratiquer soi-même la forme artistique étudiée permet incontestablement de nourrir la réflexion et d’offrir de nouveaux points de vue. C’est ce que l’ethnoscénologie a encouragé, dès sa fondation en 1995 à l’instar de l’ethnomusicologie. En effet, sur le modèle des ethnomusicologues qui sont musiciens et chercheurs, l’ethnoscénologue est chercheur·euse et praticien·ne. L’ethnoscénologue a suivi une formation initiale de pratique spectaculaire (théâtre, danse, chant, cirque, etc.) et s’il/elle étudie une pratique différente de celle qu’il/elle a apprise auparavant, il convient de la pratiquer : non pas pour devenir un·e artiste professionnel.le mais pour éprouver par le corps – sensible – la forme artistique et permettre de mettre en lumière certains savoir-faire implicites. Une pratique spectaculaire fait partie du domaine sensible, de l’imaginaire. Éprouver par le corps et les sens permet d’accéder à des connaissances qui ne sont pas forcément mises en discours13.
Cette perspective qui donne de l’importance à la pratique s’inscrit dans la lignée du travail de Jerzy Grotowski, metteur en scène polonais, et d’Eugenio Barba, metteur en scène italien installé au Danemark, sur l’anthropologie théâtrale. L’anthropologie théâtrale s’intéresse aux techniques de l’acteur afin de créer un savoir spécifique et scientifique des arts mondiaux de la scène. Et ce travail passe par un apprentissage des techniques corporelles étudiées.
Ainsi, l’articulation entre les différentes postures d’artiste et de chercheur·euse nécessite des négociations sur le terrain selon les contextes. Lorsqu’on est novice dans la pratique sur laquelle porte sa recherche, devenir élève ou disciple semble assez évident. Cette place d’apprenti·e permet d’assumer pleinement son ignorance et d’occuper un espace clairement défini dans le tissu social. Être en formation sur le terrain devient une forme d’initiation. Celle-ci nécessite un fort engagement de la part du/de la chercheur·euse qui se retrouve impliqué·e dans les jeux des relations sociales, lesquels orientent de facto ses recherches. L’immersion et le temps long permettent parfois de dépasser certains « interdits » et de bénéficier d’un changement de place sur le terrain. Aujourd’hui je peux par exemple rencontrer plus facilement des artistes de différents styles.
Éprouver par le corps, partager les douleurs, la fatigue et les difficultés de l’entraînement avec les artistes et/ou les apprenti·e·s artistes permet d’être reconnu·e et d’obtenir une certaine légitimité. Par ailleurs, cette proximité réduit la distance entre enquêté·e·s et enquêteur·euse et permet un accès plus étroit à la vie quotidienne, aux conversations ordinaires, à la densité des jours. Passer par l’apprentissage sensible de la pratique permet d’accéder à une connaissance tacite et à des savoirs implicites, notamment sur les « tours de main », les processus d’apprentissage, les vocabulaires spécialisés, etc. Les savoirs implicites permettent de comprendre certaines articulations entre choix esthétiques et résonances culturelles et d’effectuer des rapprochements que l’observation seule ne permettrait pas. De surcroît, le passage par la pratique permet de comprendre de manière concrète certains documents de recherche qui pourraient paraître abstraits, comme par exemple, la compréhension fine des métaphores dans l’enseignement de la gestuelle codifiée, leurs significations et leurs fonctions pour l’artiste.
Notes
- Olivier de Sardan Jean-Pierre, « La politique du terrain », Enquête, 1995. URL : http://journals.openedition.org/enquete/263.
- Sur la traduction du terme xiqu, je me permets de renvoyer à deux travaux : Martin Éléonore, « La traduction du terme xiqu 戏曲 par “opéra” : quels malentendus ? », in L’évolution de la langue et le traitement des « intraduisibles » au sein de la recherche, Arianna De Sanctis, Aeran Jeong, Hyunjoo Lee, Éléonore Martin (dir.), Paris, Éditions des Archives Contemporaines, 2016, p. 111-118 ; Martin Éléonore, « Nommer et comprendre les arts acrobatiques chinois : une approche ethnoscénologique », L’Ethnographie. Création. Pratiques. Publics, 6, 2021, URL : https://revues.mshparisnord.fr/ethnographie/index.php?id=1020.
- Afin de préparer l’entrée sur le terrain, j’avais suivi une initiation (chant + gestuelle) au Kunqu 崑曲 à l’association Vent de Chine.
- Voir Wang Shaojun 王绍军 (dir.), 中国地方戏曲发展论坛文集 [Actes du colloque sur le développement des Difangxi chinois], Beijing, Zhongguo Xiju, coll. « Zhongguo juzhong yanjiu wenji », 2012.
- Voir Pimpaneau Jacques, Chine : l’opéra classique. Promenade au jardin des poiriers [1981], Paris, Les Belles Lettres, 2014 ; Martin Éléonore, « L’apprentissage du Jingju », Horizons/Théâtre, Ethnoscénologie : Les incarnations de l’imaginaire, 4, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2014, p. 105-112.
- Voir notamment Qi Rushan 齊如山, 齊如山国剧论丛 [Discussion sur le Guoju], Beijing, Shangwu yin shuguan, 2017 ; Wu Kaiying 吴开英, 梅兰芳艺事新考 [Nouvelle étude sur l’art de Mei Lanfang], Beijing, Zhongguo xiqu chubanshe, 2012 ; Quillet Françoise, L’opéra chinois contemporain et le théâtre occidental. Entretiens avec Wu Hsing-kuo, Paris, L’Harmattan, 2011.
- Les professeur·e·s qui enseignent le solfège, les techniques de gestuelles codifiées, les acrobaties et le renforcement musculaire sont considérés comme des professeurs·e·s qui viennent compléter, renforcer et soutenir l’enseignement principal du/de la professeur.e de répertoire, qui est porteur·euse d’un style de jeu, qui « fait école ».
- Voir Martin Éléonore, « L’apprentissage du Jingju », art. cit. ; Martin Éléonore, « L’apprentissage du Jingju (ou opéra de Pékin) au Beijing Opera and Arts College北京戏曲艺术职业学院 », in Des formations en arts du spectacle – Amérique, Asie, Europe, Françoise Quillet (dir.), Presses Universitaires de Franche-Comté, 2016, p. 79-94. LI Yanhua 李艳华, « 戏曲表演教学之我见 [Observations sur l’enseignement du Xiqu] », in Du Changsheng 杜长胜 (dir.), 京剧与现代中国社会 [Le Jingju et la société chinoise moderne], Actes du 3e colloque international (2009), Beijing, Wenhua yishu, 2010, p. 856-865.
- Par exemple, Chiu Fang-Hsuan, Taiwanaise formée au Gezaixi, lors de son travail doctoral, m’a rapporté qu’elle n’a pas pu poser certaines questions liées aux salaires à ses professeurs, car c’était considéré comme un manque de respect. Voir Chiu Fang-Hsuan, L’Évolution du Gezai-xi à Taiwan : l’institutionnalisation de la tradition, thèse sous la direction de Jean-Marie Pradier, Université Paris VIII, 2013.
- Olivier de Sardan Jean-Pierre, « La politique du terrain », art. cit.
- Hert Philippe, « Le corps du savoir : qualifier le savoir incarné du terrain », Études de communication, 42 | 2014, consulté le 19 avril 2019. URL : https://journals.openedition.org/edc/5643.
- Martin Éléonore, « Le nom du geste dans le jingju : entre technicité et fonction métaphorique », in : Alexandre-Journeau Véronique (dir.), Penser l’art du geste en résonance entre les arts et les cultures, Paris, L’Harmattan, coll. « L’Univers esthétique », décembre 2017, p. 135-148.
- Voir Laplantine François, Le social et le sensible, introduction à une anthropologie modale, Paris, Téraèdre, 2005, coll. « L’anthropologie au coin de la rue ». ; Laplantine François, « Questions de méthode : penser le sensible », in : Laplantine François (dir.), Penser le sensible, Pocket, 2018, p. 17-30. Voir également Hert Philippe, « Art, Anthropologie et corps : la réflexivité du chercheur… et celle du clown », Espaces réflexifs [carnet de recherche]. URL : http://reflexivites.hypotheses.org/815.