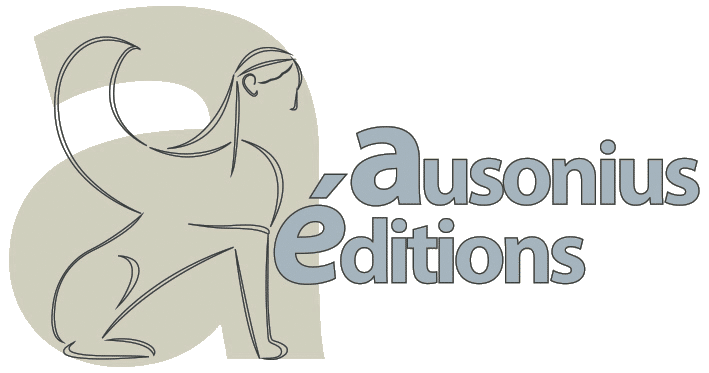Cet article propose un bilan des agrafes de ceinture du Premier âge du Fer découvertes sur un vaste territoire couvrant les régions de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie. Il s’appuie sur un corpus de 77 agrafes ou boucles de ceinture issues de découvertes anciennes et récentes. L’objectif de cette étude est de mettre en lumière la valeur symbolique et le rôle des agrafes dans les dynamiques sociales et culturelles des populations protohistoriques régionales. La méthode repose sur une analyse typologique et chronologique des agrafes, enrichie par les découvertes réalisées lors des fouilles d’archéologie préventive de ces dernières décennies. Ces résultats permettent de discuter de la place des agrafes de ceinture dans le costume funéraire. Les données montrent que ces objets, souvent réparés et utilisés sur de longues périodes, étaient des marqueurs de statut social et politique. L’adoption des agrafes de ceinture dès la fin du VIIe s. a.C. coïncide avec une augmentation du nombre de tombes à panoplie militaire dans les nécropoles régionales. L’hypothèse avancée est que les porteurs d’armes jouent un rôle actif dans l’adoption et la diffusion des agrafes de ceinture, notamment celles de type “ibéro-languedocien”, sur un vaste territoire englobant les aires culturelles navarro-aquitaine et catalano-languedocienne. Ce phénomène, qui mène à une standardisation de la panoplie militaire, perdure au moins jusqu’au Ve s. a.C.
This article provides an overview of Early Iron Age belt buckles discovered in a vast area covering the regions of Nouvelle-Aquitaine and Occitanie. It is based on a corpus of 77 belt staples or buckles from old and recent finds. The aim of the study is to shed light on the symbolic value and role of belt buckles in the social and cultural dynamics of protohistoric populations in the region. The method is based on a typological and chronological analysis of the staples, enriched by the discoveries made during the preventive archaeology excavations of recent decades. The results provide a basis for discussing the place of belt buckles in funerary costume. The data shows that these objects, often repaired and used over long periods, were markers of social and political status. The adoption of belt buckles from the end of the 7th century BC coincides with an increase in the number of graves with military panoply in regional necropolises. The hypothesis put forward is that weapon bearers played an active role in the adoption and spread of belt buckles, particularly those of the « Ibero-Languedocian » type, over a vast territory encompassing the Navarro-Aquitaine and Catalan-Languedocian cultural areas. This phenomenon, which led to the standardisation of military weaponry, lasted at least until the 5th century BC.
Agrafe de ceinture ; premier âge du Fer ; costume funéraire ; typo-chronologie ; panoplie militaire
Les agrafes de ceinture, tout comme les fibules, ont très tôt suscité l’intérêt des chercheurs. Malgré le manque d’objets disponibles et l’absence quasi-totale de contextes fiables, les premières études régionales sont à attribuer à J.-P. Mohen, réalisées dans le cadre de sa thèse et dont les résultats publiés en 1980 ont durablement marqué l’étude du premier âge du Fer dans le sud-ouest de la France1. Son analyse des agrafes de ceinture s’inspire des travaux de la chercheuse espagnole Ma.-L. Cerdeño, réalisés quelques années auparavant et exclusivement consacrés aux agrafes de ceinture de la Meseta espagnole2. Ainsi, dès le début, la recherche sur cette catégorie d’objets mobilise des réflexions et des résultats à l’échelle d’un vaste territoire, dépassant les frontières nationales.
Par la suite, les études sur les agrafes de ceinture se sont principalement concentrées sur des typologies de plus en plus détaillées, tout en développant un discours sur leur origine et leur diffusion3. Au cours des vingt dernières années, la recherche a pu s’appuyer sur les résultats de l’archéologie préventive, qui ont considérablement enrichi les corpus régionaux tout en améliorant la qualité des données disponibles. Ainsi, un nouveau bilan sur les agrafes de ceinture dans le sud-ouest de la France était nécessaire
Cadres et contextualisation de l’inventaire
Le sud-ouest de la France, tel que défini ici, englobe partiellement les régions de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie, couvrant une superficie d’environ 110 000 km². Les départements de Charente-Maritime, Charente et Haute-Vienne marquent la limite septentrionale, tandis que le Lot, le Tarn, la Haute-Garonne et l’Ariège constituent les franges orientales (fig. 1). Ce territoire présente une diversité de paysages, caractérisés notamment par la présence de deux chaînes de montagnes. Au nord-est s’étend le Massif central et ses contreforts, tandis qu’au sud, les Pyrénées forment une frontière physique avec la péninsule Ibérique selon un axe est-ouest. De plus, les fleuves Garonne et Aude, qui traversent le centre de cette région, offrent une voie de liaison idéale entre les zones atlantiques et méditerranéennes.
Chronologiquement, cette étude se fonde sur les découvertes régionales datées entre le VIIIe et le Ve s. a.C., couvrant ainsi le Premier âge du Fer et le début du Second. Ces bornes chronologiques permettent de discuter de la place des agrafes de ceinture dans la caractérisation des panoplies militaires de LT A ancienne.
Le corpus repose sur une documentation révisée provenant des collections anciennes du XIXe siècle ainsi que des opérations récentes4. À la suite de ce travail d’inventaire, le nombre total d’éléments de ceinture, incluant agrafes et boucles, s’élève à seulement 77 individus, ce qui peut sembler peu au regard de la superficie du territoire étudié. Malgré ce nombre restreint, plusieurs observations peuvent être formulées.
D’un point de vue spatial, le port d’éléments de ceinture n’est pas spécifique à une région, cette catégorie se retrouvant de manière indifférenciée du nord au sud de la zone étudiée (fig. 2a). On relève toutefois l’absence de découvertes connues pour les départements de Charente et de Dordogne, pourtant riches en vestiges du Premier âge du Fer. Le cas du département du Gers, vierge de toute mention, étonne moins tant le département compte très peu de sites pour la période. Concernant l’année de découverte de ces objets, le corpus se répartit de manière quasi égale entre les éléments de ceinture mis au jour lors de fouilles anciennes, soit avant 1950, et ceux provenant d’interventions plus récentes, ce qui nous donne un indice sur la qualité des données disponibles (fig. 2b). En termes de contextualisation, la donnée la plus marquante concerne le type de site dont sont issues les agrafes de ceinture. Sans surprise, la quasi-totalité des informations provient de sites funéraires, puisque sur l’ensemble du corpus, seules trois agrafes ont été découvertes en contexte d’habitat et une seule dans un dépôt (fig. 2c).

En approfondissant l’analyse des données, plusieurs observations tendent à démontrer la rareté de ce mobilier sur les sites régionaux. Tout d’abord, la distribution des agrafes de ceinture n’est pas homogène au sein de la seule catégorie des sites funéraires (fig. 3). La majorité du contingent se concentre en réalité dans quelques rares nécropoles, telles que celles du Camp de l’Église à Flaujac-Poujols (Lot), du Causse à Labruguière (Tarn) et du Frau à Cazals (Tarn-et-Garonne) 5. Le reste des sites ne livre qu’une ou deux pièces. À ce constat s’ajoute le fait que parmi les 250 sites ayant livré de la parure, seuls 33 comptent des éléments de ceinture, soit un peu moins de 12 %. À l’échelle des seuls ensembles funéraires, qu’ils soient pourvus en parure ou non, il est intéressant de constater que ce type de mobilier apparaît dans à peine 1 % des sépultures. C’est le cas, par exemple, pour le département du Lot-et-Garonne, dont seules deux tombes sur les 179 connues ont livré des agrafes de ceinture. La situation est encore plus marquée dans le Tarn, département pourtant richement doté en ensembles funéraires, puisque cette catégorie ne concerne que 0,38 % des 2 108 sépultures régionales.
Il se dégage de ce tour d’horizon que les éléments de ceinture sont des parures vestimentaires rarement rencontrées sur les sites régionaux, même funéraires. Cette rareté ne doit en aucun cas être attribuée à la conservation de cette catégorie de mobilier, mais bien à la valeur symbolique qui leur était attribuée ainsi qu’à la détermination statutaire de leur porteur au sein de la population, comme nous le verrons.
Outil typologique et de classement
Afin de trier le corpus, nous utilisons un outil de classement typologique que nous avons déjà testé sur un contingent plus large et varié (fig. 4)6. Cet outil tient compte à la fois des typologies préexistantes et de l’état de conservation du mobilier, afin de classer le maximum d’individus. Il n’est pas question ici de détailler les choix qui ont présidé à l’élaboration de cette typologie, mais simplement de mentionner que la première étape de tri repose sur des critères de morphologie générale de la plaque7. Celle-ci peut être de forme subtrapézoïdale (Ag.1) ou quadrangulaire (Ag.2), avec échancrures ouvertes (Ag.3), partiellement fermées (Ag.4), avec évidements (Ag.5), ajourée (Ag.6) ou munie d’un simple crochet (Ag.7). Chacune de ces grandes catégories est ensuite subdivisée selon des critères spécifiques, tels que le nombre de crochets et/ou la présence d’évidements, ou encore d’éléments décoratifs.

Pour les boucles de ceinture, c’est-à-dire la pièce qui sert à recevoir le crochet, le faible nombre d’individus mis au jour ne permet pas de créer un outil plus détaillé qu’un simple classement fondé sur leur morphologie générale. Enfin, il convient de noter que la répartition des types au sein du corpus est loin d’être homogène, une grande partie des agrafes de ceinture régionales se classant dans seulement deux ou trois types (Ag.4, 5 et 6).
Synthèse typo-chronologique des agrafes et boucles de ceinture régionales
Le classement typologique et les datations des contextes d’origine permettent de dresser un panorama de la distribution chronologique et spatiale des types d’agrafes et de boucles de ceinture régionales (fig. 5)8. L’usage des premières agrafes sur le territoire peut être daté au minimum vers la fin du VIIe s. a.C., comme en témoigne l’exemplaire de la sépulture 140 de la nécropole de Gourjade (Tarn)9. Cette agrafe présente une plaque subtrapézoïdale inornée, un talon court et un long crochet unique. Ce type connaît plusieurs points de comparaison en Espagne, mais l’exemplaire tarnais s’en distingue par sa fabrication en fer, signe probable d’une production locale10.
Par la suite, le VIe siècle est principalement marqué par plusieurs types et variantes partageant tous l’emploi d’un unique crochet. On peut mentionner l’agrafe de la tombe 1066 du Causse (Tarn), à plaque rectangulaire non décorée et en alliage cuivreux (Ag.2), datée de la phase V de la nécropole, soit entre 575 et 475 a.C. Ce siècle voit également l’apparition des exemplaires de type dit “Acebuchal” (Ag.3), abondamment traités dans la bibliographie, toujours en alliage cuivreux et dont la plaque présente des échancrures ouvertes11. Deux exemplaires sont connus dans la région, l’un avec un décor estampé (variante C) et l’autre avec un décor moulé (variante D). Tout en conservant le système de fixation à un crochet, la morphologie des plaques évolue au cours du deuxième quart du VIe s. a.C.. Les échancrures tendent peu à peu à se refermer et les extrémités du bras de l’agrafe peuvent être pourvues d’appendices, comme c’est le cas des modèles dits de “Mailhac” (Ag.4.A), tels que les deux pièces provenant de la nécropole du Camp de l’Église nord, à Flaujac-Poujols (Lot)12. Cette tendance s’accentue peu avant le milieu du VIe s. a.C. avec la fermeture complète des échancrures, formant alors des évidements de part et d’autre de la plaque (Ag.5.B et D).
Le milieu du VIe s. a.C. marque la multiplication du nombre de crochets sur des plaques à échancrures ayant tendance à se refermer (Ag.4) ou pourvues d’évidements (Ag.5). Ces types d’agrafes et leurs variantes sont de loin les plus nombreux sur le territoire. Le phénomène se manifeste par des modèles à deux crochets de type “Ampurias” (Ag.4.C), qui trouvent de nombreux points de comparaison dans plusieurs tombes du Grand Bassin II à Mailhac et qui, régionalement, se distribuent le long de la vallée de la Garonne, à Rocamadour (Lot) et à Saint-Pey-de-Castets (Gironde) 13. La seconde moitié de ce siècle, et surtout le dernier quart, voit l’introduction des modèles à trois crochets, comme en témoigne l’exemplaire (Ag.4D.2) provenant de la sépulture de Cablanc (Lot-et-Garonne) ainsi que les quelques exemplaires (Ag.5.F) issus des sépultures fouillées en 2010 au Causse à Labruguière (Tarn), ou dans la nécropole d’Ibos Bois des Hès (Hautes-Pyrénées) 14. La chronologie de ces modèles, centrée sur la fin du VIe et le début du Ve s. a.C., est encore une fois validée par des pièces comparables mises au jour dans des tombes de la nécropole du Grand Bassin II à Mailhac15.
La multiplication du nombre de crochets n’implique pas pour autant la disparition des modèles pourvus d’un système à un seul crochet. En effet, quelques exemplaires semblent perdurer (Ag.5.A et Ag.5.D), à l’instar de l’agrafe découverte dans la tombe 155 de la nécropole de Loustalet à Pouydesseaux (Landes), dont la déposition peut être située au cours du Ve s. a.C16. En revanche, le marqueur typologique de ce siècle est l’abandon des agrafes à échancrures au profit de la circulation exclusive des modèles dits “ibéro-languedociens” à évidements, dont la répartition se concentre exclusivement sur le sud de la vallée de la Garonne et le piémont pyrénéen. C’est sur cette base morphologique que se développent des agrafes toujours plus richement décorées. Suivant cette logique d’exubérance ornementale, phénomène observé sur toutes les catégories de parures produites entre la fin du VIe et le Ve s. a.C., les agrafes se voient dotées de quatre ou six crochets (Ag.5.H et Ag.5.I). Seuls sept exemplaires sont connus dans la zone étudiée et proviennent malheureusement de fouilles anciennes mal documentées. Cependant, les éléments comparables attestés en Espagne situent leur apparition au milieu du Ve s. a.C.17.
Parallèlement à ces changements, dès le deuxième quart du Ve s. a.C., commencent à circuler sur le territoire régional des types d’agrafes de morphologie très éloignée des modèles dits “ibéro-languedociens”. Exclusivement réparties sur les sites situés au nord de la vallée de la Garonne, ces agrafes sont pourvues d’une plaque triangulaire aux côtés dessinant des courbes sinusoïdales et concaves, et comportent un ou plusieurs ajours (Ag.6). On dénombre une petite série de cinq individus, en alliage cuivreux ou en fer, qui renvoient à des productions caractéristiques de l’est de la France et de l’Allemagne, où elles sont considérées comme des marqueurs de l’émergence de la culture laténienne18. Ce panorama est complété par des agrafes de facture très simple, uniquement composées d’une tige plate en fer dont les deux extrémités appointées sont repliées de manière à former des crochets (Ag.7). Le mode d’utilisation de ces agrafes demeure sujet à interrogation. Plusieurs exemplaires, comme celui découvert dans la sépulture A du tumulus 51 de la nécropole du Frau à Cazals (Tarn-et-Garonne), étaient accompagnés d’un anneau, suggérant une association mécanique avec ce dernier19. Dans tous les cas, le mobilier associé à ces agrafes invite à dater leur usage durant le Ve s. a.C. et le début du siècle suivant.
Enfin, il est plus délicat de formuler une synthèse typochronologique pour les boucles de ceinture, dans la mesure où l’on ne compte que sept exemplaires identifiés dans la région. Seuls deux types semblent être employés sur le territoire. Il y a tout d’abord les modèles dits serpentiformes, faits d’une tige en alliage cuivreux dessinant des circonvolutions imitant l’apparence d’un serpent (Bl.5). Un unique individu a été découvert anciennement dans le tumulus 3 de la nécropole de Pied-de-Prune à Rocamadour (Lot)20. Les parallèles découverts en contextes sépulcraux en Espagne, où ces boucles sont couplées notamment à des agrafes de type “Acebuchal” (Ag.3), permettent de proposer une datation couvrant le VIe et la première moitié du Ve s. a.C.21. Le second type, représenté par six pièces, renvoie aux boucles faites d’une plaque quadrangulaire pourvue de multiples évidements ménagés en deux séries de quatre ou six ajours (Bl.4). La disposition des ouvertures est liée au nombre de crochets qu’elles recevaient. Ces contre-plaques étaient donc employées pour les agrafes à trois, quatre ou six crochets, raison pour laquelle on peut raisonnablement formuler l’hypothèse que leur chronologie est centrée sur la toute fin du VIe jusqu’au milieu du IVe s. a.C., en dépit de l’absence de découvertes provenant d’ensembles clos fiables.
Contexte culturel
Les agrafes de ceinture en circulation dans le sud-ouest de la France trouvent de nombreux points de comparaison dans un espace géographique bien plus large. Aucun indice ne permet d’isoler des éléments régionaux caractéristiques, à l’exception peut-être de l’emploi fréquent du fer comme matériau de conception. Cependant, plusieurs synthèses récentes ont démontré que la région est soumise à diverses influences culturelles matérielles, notamment structurées par un groupe navarro-aquitain à l’ouest du département de la Haute-Garonne et un groupe catalano-languedocien à l’est (fig. 6).

Ainsi, les agrafes de ceinture transcendent l’emprise géographique de ces faciès culturels. La majorité des morphologies en circulation appartient à la famille des agrafes dites “ibéro-languedociennes”, d’Ampurias ou de type Acebuchal, des types connus sur un vaste territoire couvrant grosso modo les zones proches de l’axe Aude/Garonne, les Pyrénées, la Catalogne et la Meseta22. On peut dès lors s’interroger sur les raisons de cette distribution, alors que d’autres catégories de mobilier, comme les torques, les bracelets ou les fibules, pour rester dans le domaine de la parure, reflètent de manière plus affirmée ces partitions culturelles établies23.
Ce phénomène peut s’expliquer par la valeur symbolique associée à cette catégorie fonctionnelle précise, qui génère un mode de diffusion singulier.
Les porteurs d’agrafes : La place des agrafes de ceinture dans le costume funéraire
Il est toujours délicat de définir la place accordée à une catégorie d’objet, c’est-à-dire sa valeur symbolique, tant les clés de compréhension nous manquent. Paradoxalement, l’état d’usure des pièces mises au jour en contexte funéraire peut constituer, d’une certaine manière, une porte d’entrée.
Dans la moitié sud de la France et le nord de l’Espagne, on dénombre plusieurs exemplaires d’agrafes de ceinture ayant subi des réparations. Dans la majorité des cas, la cassure est apparue sur les points sensibles à la tension, c’est-à-dire soit sur la plaque, au niveau où l’échancrure est la plus prononcée, soit au niveau des bras dessinés par les évidements, soit enfin vers le départ du crochet. L’exemplaire provenant de la nécropole du Frau à Cazals (Tarn-et-Garonne) présente une réparation par l’ajout d’une plaque en fer, assurant le maintien des deux fragments en bronze de la plaque à l’aide des rivets également en fer (fig. 7).

Ces indices de réparation suggèrent que ces agrafes, loin d’être de simples artefacts fabriqués pour un usage ponctuel (à vocation rituelle), étaient utilisées sur une période relativement longue, bien que difficile à mesurer. En prolongeant leur durée de vie, leurs propriétaires leur accordaient une valeur qui dépassait leur simple fonctionnalité. Autrement dit, plutôt que de les remplacer par des pièces identiques en meilleur état, ils optaient pour des réparations, probablement moins coûteuses. La valeur économique, notamment le poids du métal utilisé dans les grandes pièces et le travail de décoration, pouvait également limiter leur remplacement. En outre, ces agrafes pouvaient revêtir une signification symbolique et démonstrative pour leurs propriétaires, témoignant peut-être de hauts faits, d’une généalogie ou d’un statut social spécifique. Bien que les valeurs exactes restent inconnues, ces indices soulignent l’importance accordée non seulement à la représentation matérielle de ces objets (leur morphologie et leur décoration), mais surtout à chaque objet individuel en tant qu’entité unique, sans laquelle il aurait pu être aisément remplacé.
À ce constat, il faut ajouter que la déposition d’une agrafe de ceinture en contexte funéraire demeure un geste rare. On peut raisonnablement poser l’hypothèse qu’il ne s’agit pas d’une parure anodine et qu’elle rend compte d’un statut particulier de son porteur. Si l’on s’intéresse à l’âge au décès des porteurs, on constate que cette catégorie d’objets reste réservée aux individus adultes, ou considérés comme tels (adolescents) (fig. 8)24. On peut dès lors affirmer que les agrafes matérialisent une différenciation statutaire de classes d’âges, hypothétiquement acquise, par exemple, à l’issue d’un événement particulier ou dans le cadre d’un “rite de passage”.
Changements dans la représentation des guerriers ?
L’adoption des agrafes de ceinture dès le VIe s. a.C. dans le costume funéraire régional coïncide avec d’autres phénomènes touchant plus largement le sud de la France et le nord de l’Espagne. La fin du VIIe et le début du VIe s. a.C. sont marqués par une forte augmentation du nombre de tombes à panoplie militaire en Méditerranée occidentale. En Languedoc occidental, ce type de dépôt funéraire représente en moyenne un quart des sépultures dans les nécropoles, mais parfois bien plus, comme à Grand-Bassin à Mailhac (33 %), à La Peyros à Couffoulens (40 %) ou à Saint-Julien-de-Pézenas (30 %)25. Cette visibilité accrue des tombes à armes se répand progressivement vers l’ouest, touchant les Pyrénées et le sud-ouest de la France dès le milieu du VIe siècle, puis la Celtibérie au Ve s. a.C. Ce phénomène, désormais bien documenté, se manifeste par la diffusion contemporaine des épées à antennes et des soliferreums sur un même territoire, menant à une standardisation de la panoplie guerrière durant le VIe et le Ve s. a.C. sur un vaste espace compris entre le sud de la France et le nord de l’Espagne.
Jusqu’à présent, il était admis que cette standardisation s’exprimait à travers la convergence typologique et stylistique du seul mobilier militaire et son mode de déposition, impliquant parfois des ploiements sacrificiels des armes. Or, il apparaît que la parure joue un rôle tout aussi significatif en tant que marqueur du statut social et politique des défunts armés. Cela s’observe particulièrement bien avec les fibules. Au début du VIe s. a.C., la dichotomie culturelle entre le faciès navarro-aquitain et le faciès catalano-languedocien est bien marquée typologiquement par l’usage des fibules “navarro-aquitaines” à l’ouest et des fibules du Golfe du Lion à l’est. Puis, au cours du siècle, ces types montrent un rapprochement typologique marqué par un allongement de leur ressort ou de l’axe, sur lequel sont ajoutés de riches éléments décoratifs tels que des perles ou des disques. On peut penser que les porteurs d’armes jouent un rôle majeur dans ce phénomène de convergence stylistique pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, cette convergence est synchrone de celle de la panoplie militaire et s’exprime sur un même espace géographique. Il est possible qu’elle profite des mêmes canaux de diffusion que l’armement, mettant en lumière des relations étroites tissées entre ces deux faciès au cours du VIe s. a.C., facilitant ainsi la circulation des biens de prestige et leurs représentations symboliques. Ensuite, il est frappant de constater qu’à chaque fois qu’une fibule “navarro-aquitaine” est déposée dans une tombe languedocienne, il s’agit toujours d’une sépulture à arme. De plus, ces tombes comptent à chaque fois une agrafe de ceinture de type “ibéro-languedocienne” (Ag.5). De manière générale, en dressant un inventaire des tombes à armes et à parures du VIe et début Ve s. a.C., entre la moitié sud de la France et le nord de l’Espagne, on observe une répétition des mêmes catégories de mobilier déposées dans ces tombes, à savoir un équipement militaire comprenant une épée à antenne et/ou une lance en fer (simple ou soliferreum) accompagnés d’une agrafe de ceinture “ibéro-languedocienne” et/ou d’une fibule (fig. 9). Ainsi, le triptyque : équipement militaire, agrafe de ceinture, fibule, peut être considéré comme un marqueur d’un statut bien distinct du reste de la population et constitue un référentiel culturel partagé sur un large territoire. Enfin, bien que ces agrafes de ceinture ou ces fibules ne soient pas exclusives des seules tombes à armes, il a été observé qu’à la même période dans le sud-ouest de la France, les sépultures sans armes et pourvues en parures annulaires sont plutôt porteuses de traditions stylistiques régionales26. Cela laisse penser que les costumes funéraires à parures annulaires se réfèrent préférentiellement à des modes symboliques plus locaux et distincts entre les faciès navarro-aquitains et catalano-languedociens.

À l’issue de ces quelques observations, il est possible de formuler l’hypothèse que les porteurs d’armes constituent une classe d’individus détenteurs d’un pouvoir politique particulier impliquant des contacts pérennes à longue distance. C’est à travers ces contacts que des biens ont pu transiter plus efficacement entre les cultures matérielles de l’ouest et de l’est des Pyrénées. Ces personnages sont probablement à l’origine de l’introduction et de la diffusion des agrafes “ibéro-languedociennes”. Bien qu’ancrés dans leurs paysages culturels locaux, ils témoignent, par leur costume funéraire, de leur volonté de se référer à des symboles et à une idéologie qui concernent un territoire bien plus vaste. Cela se traduit par une harmonisation de leur panoplie dont les porteurs devaient partager la signification symbolique. Ces signaux pouvaient être assimilés ou métissés à un fond culturel local sans en trahir le sens. Ce rôle de “passeurs” de culture exogène semble se poursuivre au Ve s. a.C., lorsque apparaissent les témoins de types dits “laténiens”, dont les agrafes de ceinture (Ag.6) et les fibules à ressort de schéma laténien sont des marqueurs typologiques forts (fig. 10). La tombe 21 de la nécropole de Flaujac-Poujols (Lot) illustre ce phénomène27. Datée du milieu du Ve s. a.C., elle est considérée comme l’une des panoplies militaires celtiques les plus précoces d’Europe occidentale. En plus de l’imposant équipement militaire de tradition laténienne comprenant épée, couteau et bouclier, sa parure vestimentaire est représentée par une agrafe de ceinture ajourée et une fibule “navarro-aquitaine”. Ainsi, le défunt témoigne-t-il à la fois de l’intégration précoce de morphologies nouvelles et exogènes par sa panoplie et son agrafe de ceinture, et dans le même temps, de la conservation de codes endogènes connus auparavant, qui s’expriment ici par sa fibule.
Conclusion
Les découvertes issues de l’archéologie préventive, ainsi que les travaux de recherche réalisés ces dernières années, ont permis de réactualiser et d’affiner les chronologies des agrafes de ceinture dans le sud-ouest de la France. Ces résultats offrent l’opportunité de situer les populations protohistoriques régionales dans un espace culturel plus vaste. En se répartissant sur un large territoire pendant près de deux siècles, les agrafes de ceinture deviennent d’excellents témoins des relations entre les peuples établis de part et d’autre des Pyrénées.
L’analyse des costumes funéraires permet d’appréhender la place symbolique accordée à ces parures. Elle suggère que les agrafes jouent un rôle actif dans la distinction des individus. Nous émettons l’hypothèse que ces agrafes sont préférentiellement associées aux porteurs d’armes, ce qui pourrait expliquer leur diffusion à travers un vaste territoire. La panoplie de ces individus témoigne de leur volonté de se référer à des symboles dépassant leur propre culture, mettant en évidence leur statut social singulier et le pouvoir qu’ils détiennent. Ces contacts à longue distance, activés par des déplacements réguliers, constituent un réseau de relations élitaires. Ce réseau sert de socle pour le transit d’idées, de biens et de symboles, qui peuvent être assimilés tels quels ou métissés avec le fond culturel local.
Une fois introduites dans une région, il est plausible que les nouveautés stylistiques de ces agrafes soient réinterprétées et partagées à nouveau au sein de cet espace culturel étendu. Cette proposition expliquerait la grande variété de formes et de décorations observées sur les agrafes “ibéro-languedociennes”, tout en maintenant leur aspect général relativement stable. Contrairement à l’idée précédemment répandue, qui mettait en avant des lieux de fabrication d’origine suivis d’une diffusion à grande échelle, nous pouvons envisager un modèle plus dynamique fondé sur un réseau multipolaire, où chaque zone de France et d’Espagne contribue potentiellement à des innovations locales qui se diffusent à leur tour.
Bibliographie
Barral, P.,Guillaumet, J.-P., Roullière-Lambert, M.-J., Saracino, M. et Vitali, D., dir. (2014) : Les Celtes et le Nord de l’Italie. Premier et Second âge du Fer, Actes du XXXVIe colloque de l’AFEAF, Vérone, 17-20 mai 2012, REA Suppl. 36, Dijon.
Baray, L., Sarrazin, J.-P., Valentin, F. et Moulherat, C. (2013) : “La sépulture à char de La Tène ancienne des ‘Craises’ à Molinons (Yonne)”, RAE, 62, 5-52.
Beylier, A. (2012) : L’armement et le guerrier en Méditerranée nord-occidentale au Premier âge du Fer, Monographie d’Archéologie Méditerranéenne 31, Lattes.
Buffat, L., Brunet, V., Cadeilhan-Kérébel, J., Masbernat-Buffat, A., Rivalan, A. et Sérée, F. (2012) : La nécropole protohistorique du Causse (partie orientale), Labruguière/Tarn, Rapport d’opération, DRAC-SRA Midi-Pyrénées, Toulouse.
Castiella Rodríguez, A. (2005) : “Sobre los ajuares de la necrópolis de La Atalaya. Cortes, Navarra”, CUAN, 13, 115-210.
Castiella Rodríguez, A. et Bienes Calvo, J.-J. (2002) : La vida y la muere durante la protohistoria en El Castejón de Arguedas (Navarra), CAUN, 10, Pampelune.
Cerdeño, M.-L. (1978) : “Los broches de cinturón peninsulares de tipo céltico”, Trabajos de Prehistoria, 35, 279- 306.
Collet, A. (2013) : Armement et élites du bas Quercy aux VIe et Ve siècles avant J.-C. : La nécropole tumulaire du Camp de l’Église Nord (Flaujac-Poujols, Lot), Mémoire de master 2, Université Lumière Lyon 2, Lyon.
Constantin, T. (2023) : Cultures transpyrénéennes. Les parures du sud-ouest de la France et du nord-ouest de l’Espagne au Premier âge du Fer (VIIIe-Ve s. a.C.), Pessac, Ausonius Éditions, collection DAN@ 7. [URL] https://una-editions.fr/cultures-transpyreneennes
Demangeot, C., dir. (2024) : Pindères (47), Le Papetier 2 et 3, RFO Hadès, Rapport d’opération, DRAC-SRA Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux.
Dumas, A., Dautant, A., Constantin, T. et Beschi, A. (2011) : “La sépulture du premier âge du Fer de Cablanc (Barbaste, Lot-et-Garonne)”, Aquitania, 27, 7-17.
Farnié Lobensteiner, C. (2012) : Las aristocracias de la Primera Edad del Hierro en el Mediterráneo noroccidental : la espada como instrumento de guerra y símbolo de poder (ss. VIII-VI a.C.), Thèse de doctorat, Universidad Autónoma de Madrid.
Girard-Millereau, B. (2010) : Le mobilier métallique de l’âge du Fer en Provence (VIe-Ier av. J.-C.). Contribution à l’étude des Celtes de France méditerranéenne, Thèse de doctorat, Université de Bourgogne, 3 vol.
Giraud, J.-P., Pons, F. et Janin, T., dir. (2003) : Nécropoles protohistoriques de la région de Castres (Tarn), Le Causse, Gourjade et Le Martinet, DAF, Série Archéologie préventive, 3 vol., Paris.
Janin, T., Taffanel, O., Taffanel, J., Boisson, H., Chardenon, N., Gardeisen, A., Herubel, F., Marchand, G., Montecinos, A. et Rouquet, J. (2002) : “La nécropole protohistorique du Grand Bassin II à Mailhac, Aude (VIe-Ve av. n. è.)”, DAM, 25, 65-122.
Lorrio, A.-J. (2005) : Los Celtíberos, Bibliotheca Archaerlogica Hispana 25, Madrid
Maitay, C. (2015) : La nécropole à incinération de Loustalet à Pouydesseaux, Landes. Rituels et pratiques funéraires du Premier âge du Fer en Aquitaine, Rapport de fouille, DRAC-SRA Aquitaine, Bordeaux.
Millet, E. (2008) : Parures et accessoires vestimentaires : les costumes funéraires dans les régions du Rhin moyen et supérieur du Ve au IIIe siècles avant J.-C., Thèse de doctorat inédite, Université de Bourgogne/Dijon et Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Mohen, J.-P. (1980) : L’âge du Fer en Aquitaine du VIIe au IIIe siècle avant J.-C., mémoire de la SPF, 14, Paris.
Py, M. (2009) : Lattara, Lattes, Hérault, Comptoir gaulois méditerranéen entre Étrusques, Grecs et Romains, Éditions Errance, Paris.
Rivalan, A. (2011) : Typologie et chronologie des objets métalliques du Bronze Final IIIB à la fin du Premier âge du Fer en France méridionale (900-450 av. n. è.), Thèse de doctorat inédite, Université Paul Valéry – Montpellier III, Montpellier.
Parzinger, H. et Sanz, R. (1987) : “Zum Ostmediterranen Ursprung einer Gürtlhakenform der Iberischen Halbinsel”, Madrider Mitteilungen, 27, 169-195.
Schüle, W. (1969) : Die Meseta-Kulturen der Iberischen Halbinsel. Mediterrane und Eurasische Elemente in Früheisenzeitlichen Kulturen Südwesteuropas, Deutsches Archäologisches Institut Abteilung Madrid, Berlin.
Stöllner, T. (2014) : “Mobility and cultural change of the early Celts : La Tène openwork belt-hooks north and south of the Alps”, in : Barral et al., dir. 2014, 211-230.
Notes
- Mohen 1980.
- Cerdeño 1978.
- Parzinger & Sanz 1987.
- On remerciera C. Demangeot pour avoir partagé les résultats récents de la fouille de Pindères, le Papetier 2 et 3 (Lot-et-Garonne) qui permettent de fournir ici un inventaire à jour : Demangeot, dir. 2024.
- On signalera que la mention “Région de Mont-de-Marsan”, qui est celle qui compte le plus d’éléments de ceinture, ne renvoie pas à un site précis mais au mobilier découvert anciennement, déposé dans les collections du musée de Mont-de-Marsan (Landes) et dont les origines précises ne sont pas connues.
- Cet outil typologique a été mis en place afin de trier un corpus comprenant à la fois les découvertes du sud-ouest de la France mais aussi du nord-ouest de l’Espagne : Constantin 2023, 96-109.
- Ibid.
- Pour une présentation détaillée de chacun des types et des exemplaires connus dans la région, voir : Constantin 2023, 96-109.
- Giraud et al. 2003, 169, fig. 256.
- Constantin 2023, 100.
- Parzinger & Sanz 1987, 171, abb. 2 ; Lorrio 2005a, 216.
- Collet 2013, 13
- Parzinger & Sanz 1987, non paginé, abb. 1 n° 13 ; Janin et al. 2002, 77, fig. 18 n° 4h, 82, fig. 24 n° 10d, 84, fig. 26 n° 12a, 100, fig. 38 n° 30a ; Constantin 2023, 103-104.
- Dumas et al. 2011, 9, fig. 3 n°5 ; Buffat et al. 2012, 74-75 ; Constantin 2023, 838, pl. 148.
- Janin et al. 2002, 86, fig. 27 n° 14b et 90, fig. 30 n° 15n.
- Maitay 2015, 173.
- Correspond aux types D.III.4 et D.III.5 de Ma-L. Cerdeño : Cerdeñó 1978, 283.
- Stöllner 2014, 219, fig. 7 ; Millet 2008, 185-186 ; Baray et al. 2013, 19-22.
- Constantin 2023, 629.
- Ibid, 809, pl. 119.
- Dans la nécropole d’El Castejón (Navarre) ou de la Atalaya basse (Navarre) : Castiella Rodríguez & Bienes Calvo 2002, 155, fig. 197 ; Castiella Rodríguez 2005, 139, fig. 35.
- Rivalan 2011, 282, fig. 155.
- Constantin 2023, 250, fig. 84.
- Dans un contexte dominé par le rite funéraire de la crémation, la détermination de l’âge des défunts par l’analyse ostéologique est bien plus répandue que la diagnose sexuelle et constitue l’une des rares données anthropologiques exploitables.
- Beylier 2012, 249 ; Farnié Lobensteiner 2012, 482.
- On peut citer l’exemple du port des torques qui est en forte augmentation au VIe s. a.C. dans la culture matérielle navarro-aquitaine alors qu’il décroît fortement dans l’aire catalano-languedocienne : Constantin 2023, 309-310.
- Collet 2013, 45.