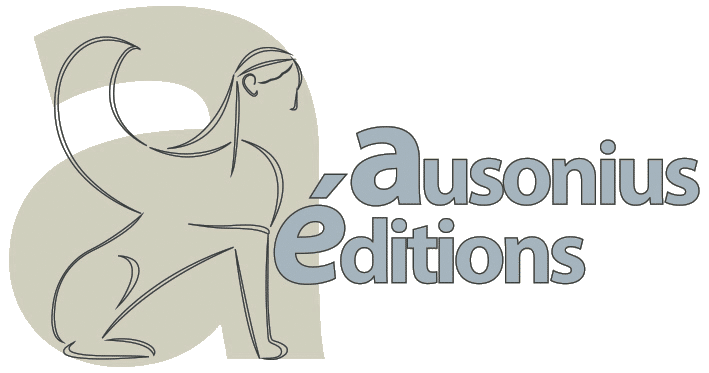Officiellement créé en 1860, le musée d’Annecy a été fondé à l’instigation de l’Académie florimontane1 avec la volonté de documenter l’histoire régionale par la constitution de collections d’histoire naturelle, d’archéologie, de beaux-arts et d’ethnologie. Louis Revon (1833-1884), premier conservateur du musée, fut particulièrement sensible à sa vocation pédagogique et à l’importance de l’éducation du peuple, voyant le musée comme une “leçon de choses” ouverte à tous, du paysan à l’élève en passant par le scientifique et le bourgeois2. Durant sa carrière au musée, il fit l’acquisition de nombreuses découvertes archéologiques de Savoie et de Haute-Savoie qui forment le fonds historique des collections actuelles, ainsi que de découvertes d’autres régions françaises par le biais d’échanges et d’achats lors de voyages. Au XXe siècle, les opérations archéologiques dans les limites du département ont continué à enrichir les collections.
Les éléments de ceinture sont relativement peu nombreux dans les Alpes françaises par rapport à d’autres catégories de mobilier comme la parure annulaire. Le Musée-Château d’Annecy en conserve un échantillon représentatif (tab. 1) qui permet, une fois replacé dans son contexte général, d’aborder les aspects sociaux et culturels liés à ces parties du costume. L’archéologie préventive apporte également des pistes de compréhension supplémentaires non négligeables grâce aux ceintures mises au jour à Saint-Pierre-en-Faucigny (Haute-Savoie3) et à Lanslevillard (Savoie4
En raison de la continuité des formes de la culture matérielle dans les régions voisines, le choix a été fait d’intégrer les éléments de ceinture de l’extrême fin de l’âge du Bronze à la présente synthèse. Les modèles du début du Premier âge du Fer des environs de la confluence Saône-Rhône5, de l’ouest de la Suisse6 et de Franche-Comté montrent en effet une forte parenté stylistique avec ceux du BFIIIb. Le parti a donc été pris de considérer que cette lente évolution des formes concerne également les Alpes françaises, bien qu’aucune découverte ne permette de le confirmer pour l’instant.
| No inv. | Site | Structure | Datation | Objet | Description | Associations |
| 18005.1 à 4 | Thonon-les-Bains, port de Rives | Tombe de janvier 1862 | BFIIIb / Ha B2 ou B3 | Agrafe de ceinture et trois anneaux de fermeture | de type Mörigen avec réparation d’une patte de fixation par un rivet | Une pendeloque triangulaire, deux anneaux de cheville à décor incisé |
| 18935.1 | Seyssel, Vens, grotte de la Sarrazinière | Structure inconnue | BFIII / Ha B | Pendeloque | triangulaire décorée de chevrons incisés | Inconnues |
| 4924.80 et 110 | Lac du Bourget | Structure inconnue | BFIIIb / Ha B2 ou B3 | Applique rectangulaire à griffes | décorée de lignes verticales et de courts traits transversaux incisés | Inconnues |
| 4924.81 | Lac du Bourget | Structure inconnue | BFIIIb / Ha B2 ou B3 | Applique rectangulaire à griffes | décorée de lignes verticales de courts traits au repoussé | Inconnues |
| 4924.82 | Lac du Bourget | Structure inconnue | BFIIIb / Ha B2 ou B3 | Applique rectangulaire à griffes | décorée de lignes verticales et de courts traits transversaux incisés | Inconnues |
| 4924.83 | Lac du Bourget | Structure inconnue | BFIIIb / Ha B2 ou B3 | Applique rectangulaire à griffes | décorée de nervures verticales et de lignes de points au repoussé le long des bords | Inconnues |
| 4924.109 | Lac du Bourget | Structure inconnue | BFIIIb / Ha B2 ou B3 | Applique rectangulaire à griffes | décorée de lignes verticales et de courts traits transversaux incisés | Inconnues |
| 4924.105 | Lac du Bourget | Structure inconnue | BFIIIb / Ha B2 ou B3 | Applique circulaire à griffes | bombée aux griffes repliées | Inconnues |
| 4924.106 | Lac du Bourget | Structure inconnue | BFIIIb / Ha B2 ou B3 | Applique circulaire à griffes | bombée aux griffes ouvertes | Inconnues |
| 4924.107 | Lac du Bourget | Structure inconnue | BFIIIb / Ha B2 ou B3 | Applique circulaire à griffes | bombée aux griffes repliées | Inconnues |
| 7755.1 | Gruffy, Frésy | Sépulture | Ha moyen / Ha D1 ou D2 | Plaque de ceinture | à décor au repoussé de type Créancey | Inconnue |
| 7755.2 | Gruffy, Frésy | Sépulture | Ha moyen / Ha D1 ou D2 | Plaque de ceinture | à décor au repoussé | Inconnue |
| 7755.3 | Gruffy, Frésy | Sépulture | Ha moyen / Ha D1 ou D2 | Plaque de ceinture | à décor au repoussé | Inconnue |
| 13170.1 | St-Ferréol, L’Autaret | Sépulture | Ha moyen / Ha D1 | Disque ajouré | type Wohlen-Murzelen | Trois ou quatre bracelets |
| 711.1 à 7 | Talloires, Perroix | Sépulture ? | Ha moyen / Ha D1 | Anneaux mobiles | type Wohlen-Murzelen | Deux objets en fer dont un poignard ou une pointe de lance |
| 5103.1 | Jausiers, Les Sanières | Sépulture | LT moyenne / LT B ou C1 | Passant de ceinture | à deux renflements | Bracelets, chaînette |
| 5103.2 | Jausiers, Les Sanières | Sépulture | LT moyenne / LT B ou C1 | Passant de ceinture | à deux renflements | Bracelets, chaînette |
| 5103.3 | Jausiers, Les Sanières | Sépulture | LT moyenne / LT B ou C1 | Passant de ceinture | à deux renflements | Bracelets, chaînette |
| 5223.30-31 | Jausiers, Les Sanières | Sépulture | LT moyenne / LT B ou C1 | Passant de ceinture | à deux renflements | Inconnue |
Les éléments de ceinture du Musée-Château d’Annecy
Âge du Bronze final (BFIIIb) 900-850
Agrafes de ceinture de type Mörigen et anneaux (18005.1 à 4)
L’agrafe de ceinture de Thonon-les-Bains (fig. 1) appartient à une forme connue entre le Rhône et l’ouest de la Suisse caractérisée par une partie proximale en demi-cercle, séparée d’un corps en amande par une constriction plus ou moins marquée dont l’extrémité distale forme un crochet servant de système de fermeture. La partie proximale comporte trois à cinq attaches de fixation rectangulaires ; sur l’exemplaire de Thonon, l’une de ces attaches est associée à un trou matérialisant une réparation. Le décor est composé de paires de nervures parallèles décorées d’incisions obliques au centre et le long des bords du corps de l’agrafe ; ces nervures peuvent être isolées ou laissées lisses. Une agrafe découverte récemment à Saint-Pierre-en-Faucigny (Haute-Savoie) présente également des demi-cercles soulignés d’incisions sur le corps et la partie proximale7, tout comme à Saint-Georges-de-Reneins (Rhône)8, et rappelle la variante proche nommée d’après le dépôt de Larnaud (Jura9).

Les principales études sur ces objets sont celles de F. Audouze10 et I. Kilian-Dirlmeier11. Ils correspondent au type Mörigen de cette dernière, divisé en deux sous-types par F. Audouze : le sous-type 5, distribué entre le Rhône et l’ouest de la Suisse, et le sous-type 6, de plus petite taille, dont la répartition est plus occidentale (dépôts du Petit Villatte (Cher) et de Vénat (Charente)). Ces travaux intègrent une agrafe provenant de Verzé (Saône-et-Loire) qu’il convient toutefois d’exclure en raison de son décor fait de frises de triangles au trémolo qui correspondent à un modèle plus tardif et, dans une moindre mesure, de ses petites dimensions et de celles de l’anneau associé. Des découvertes récentes à Quincieux (Rhône, St. 364312) et Saint-Vulbas (Ain, F800913) confirment une datation de ce modèle au tout début du Premier âge du Fer.
Ces agrafes sont obtenues par coulée directe, comme l’atteste un moule en grès de la station lacustre de Grésine (Savoie ; fig. 2)14. La face opposée de ce moule comporte le négatif d’un manche massif d’épée qui la rattache à l’extrême fin de l’âge du Bronze. Cette datation est soutenue par la céramique de la sépulture 113 de Saint-Pierre-en-Faucigny et ses anneaux de cheville décorés de profondes incisions obliques15. La coulée dans un moule monovalve est proposée par F. Audouze16 en raison de l’aspect plat et uniforme de la face arrière de ces agrafes ; cette hypothèse est confortée par l’exemple des agrafes en cours de fabrication découvertes dans l’habitat de Cascina Riviera-Castelletto Sopra Ticino (Piémont) qui sont cependant rattachées à la culture de Golasecca et plus tardives, puisque datées de la fin du 6e siècle au premier quart du Ve siècle a.C. (GII B)17.

À Thonon, l’agrafe a été découverte sur des restes de cuir et en association avec trois petits anneaux fermés qui complètent le système de fermeture mais dont l’organisation sur la ceinture demeure inconnue. L’association à un anneau est connue dans le dépôt du Petit-Villatte (Cher) et la tombe plus tardive de Verzé (Saône-et-Loire18). Jusqu’à la découverte de Saint-Pierre-en-Faucigny, il s’agissait du seul exemplaire de type Mörigen provenant clairement d’un contexte funéraire, les comparaisons provenant des palafittes du lac du Bourget, d’un dépôt ou de contextes indéterminés. La description de la découverte dépeint une position non fonctionnelle, l’agrafe étant posée sur le front de l’inhumé·e et le reste de la ceinture en diagonale sur la poitrine19. De même, dans la sépulture 113 de Saint-Pierre-en-Faucigny, la ceinture n’enserrait pas seulement la taille mais également les bras de l’inhumée ; cette observation questionne sur la fonction de cet objet dans la tombe comme fermeture d’un vêtement porté sur les habits, d’un linceul ou d’un élément de constriction du corps.
Les exemples en contexte funéraire étant peu nombreux et ayant rarement fait l’objet d’analyses anthropologiques, il n’est pas possible de proposer une identité de genre à ces agrafes. À Saint-Pierre-en-Faucigny, l’agrafe de la sépulture 113 appartient à un adulte de sexe féminin et un second exemplaire à un individu masculin (sépulture 193)20, tandis que la variante plus tardive de Saint-Vulbas (F8009) est portée par une femme adulte21.
Pendeloques triangulaires (18935.1)
L’agrafe de ceinture de Thonon était associée à une pendeloque triangulaire (fig. 3, A) qui n’est pas conservée au Musée-Château d’Annecy mais au musée du Chablais. Une tombe découverte à proximité a livré une pendeloque similaire, cette fois conservée au Musée Cantonal d’Archéologie et d’Histoire de Lausanne22. Ces parures sont formées d’un corps triangulaire plat lisse ou à décor incisé, terminé par un anneau de suspension de section semi-circulaire à triangulaire.
La même association d’une pendeloque triangulaire avec une agrafe de ceinture de type Mörigen est connue dans le dépôt de Chézenas (Rhône), daté du BFIII23. Ailleurs, elles participent à la composition de ceintures articulées complexes comme à La Ferté-Hauterive (Allier), Broye-lès-Pesmes (Haute-Saône) et La Loubière (Hautes-Alpes), ce qui confirme leur fonction principale. Dans la grotte de la Roche Chèvre à Barbirey-sur-Ouche (Côte-d’Or), cette utilisation est renforcée par leur association avec des appliques de ceinture à griffes24.
Les dimensions allongées et le décor de cercles concentriques de la pendeloque du musée du Chablais l’apparentent aux productions des lacs suisses25. La pendeloque conservée au musée de Lausanne possède un décor plus largement diffusé, associant des chevrons à des demi-cercles soulignés de points. Ce dernier motif est connu dans les stations lacustres suisses, à titre d’exemple à Auvernier (Neuchâtel26), sur un exemplaire du Musée dauphinois (no 67.11.8) provenant de Suisse sans plus de précision27 et à Larnaud (Jura28).
Les collections du Musée-Château d’Annecy conservent une pendeloque triangulaire apparentée (fig. 3, B) découverte dans les couches remaniées de la grotte de La Sarrazinière (Haute-Savoie), un abri sous roche surplombant la vallée du Rhône29. De petites dimensions (long. 53 mm), elle possède des bords incurvés, un caractère typologique non discriminant observé également dans le dépôt de Larnaud (Jura) et à Barbirey-sur-Ouche (Côte-d’Or30). Son décor comprend des chevrons incisés rappelant la pendeloque triangulaire de Thonon conservée à Lausanne.
En Savoie, le lac du Bourget a fourni plusieurs pendeloques triangulaires, lisses ou décorée de nervures31 ; à l’heure actuelle, aucune autre comparaison n’est connue dans les Alpes du nord32.

Appliques en tôle (4924.80 à 83, 105 à 107, 109-110)
Au moins cinq appliques rectangulaires et trois appliques circulaires bombées à griffes sont conservées dans les collections (fig. 4). Elles proviennent d’un échange fait en 1872 avec le musée de Chambéry et sont issues du lac du Bourget, sans que le site de provenance ne soit précisé. Les collections anciennes des musées accueillant des appliques comparables pointent vers les principaux palafittes du BFIIIb : Châtillon33, Grésine34 et le Saut de la Pucelle35.

Ces éléments sont rarement conservés lorsqu’ils sont issus de découvertes anciennes en contexte terrestre en raison de leur fragilité. Hormis les exemplaires lacustres, ils sont connus dans plusieurs dépôts (Petit Villatte, Chézenas, Vénat, Choussy36). Dans la Station du Coin à Collonges-sous-Salève (Haute-Savoie), un exemplaire provient d’un contexte fortement perturbé de nature funéraire comme le suggère la présence d’ossements humains37.
Les deux exemplaires entiers (4924.81 et 83) des collections d’Annecy possèdent huit griffes de fixation et sont décorés de lignes verticales de points au repoussé qui, sur l’exemplaire 4924.83, encadrent une nervure verticale. Les autres sont décorées de traits verticaux accompagnés de lignes de courts traits obliques ou horizontaux. Les découvertes récentes de Saint-Pierre-en-Faucigny (Haute-Savoie) montrent l’association de ces appliques à griffes entre elles et avec une agrafe de type Mörigen dans la composition de ceintures en matériau périssable intégralement recouvertes d’appliques décoratives38.
Autres éléments de ceinture des Alpes françaises
Le nord des Alpes françaises (départements de la Haute-Savoie, de la Savoie et de l’Isère) présente peu d’autres types de pendeloques ou d’appliques décoratives associées aux ceintures (fig. 5). Hormis des fragments d’agrafes en fil et quelques autres appliques du lac du Bourget, datés plus largement des étapes moyenne et finale du Bronze final39 , on connaît une pendeloque en forme de rasoir à La Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie40) et une chaînette à maillons plats et barrettes à Grésine (Savoie41). Ce tableau tranche avec les Alpes du sud, où le BFIIIb est caractérisé par de grandes ceintures articulées dans les dépôts des Hautes-Alpes à Guillestre, La Loubière, Réallon et Ribiers42.
Premier âge du Fer
Plaques de ceinture à décor estampé (7755.1 à 3)
Trois plaques de ceinture en tôle de bronze estampée (fig. 6) proviennent d’un tumulus à Gruffy (Haute-Savoie). Il s’agit de l’un des quelques tertres observés en Haute-Savoie, malheureusement connu par sa destruction en 1867 et 1878 lors de travaux de voirie, occasionnant la découverte de mobilier du Premier âge du Fer, du début du Second âge du Fer et du haut Moyen Âge. Une partie des objets est entrée par lots dans les collections du Musée-Château d’Annecy au fil des ans sans qu’aucun ensemble ne puisse être reconstitué.

Les plus grands fragments permettent de reconstruire une plaque de type Créancey43, dont le décor est caractérisé par un bandeau horizontal divisé par des bandes verticales de croix et de traits obliques. Les deux extrémités sont rivetées et aucun crochet ou autre dispositif de fermeture n’a été retrouvé. Les deux autres plaques découvertes à Gruffy sont trop incomplètes pour être attribuées à un type. Ces plaques sont datées du Ha D1 ou D2, ce que confirme la présence de brassards en roche noire sédimentaire de forme moyenne (ou “en rond de serviette”) dans le tertre, avec lesquels elles sont concentrées dans l’ouest de la Suisse et en Franche-Comté44 (fig. 7). Des fragments de plaques de ceinture en tôle estampée sont également connus en Provence et dans le Languedoc en contexte d’habitat et de dépôt45. À l’heure actuelle, les Alpes françaises n’ont livré aucun autre exemplaire de plaque de ceinture estampée du Premier âge du Fer.
En Franche-Comté, dans le tumulus de Courtesoult (Haute-Saône), un genre a été proposé pour trois tombes à plaque de ceinture. L’individu de la sépulture 28 est de sexe féminin, tandis les sépultures 13 et 48 sont attribuées au genre féminin sur la base de leur assemblage funéraire. À l’inverse, aucun des défunts de sexe masculin identifiés ne portait d’élément de ceinture métallique, allant dans le sens d’un genre féminin pour ces accessoires vestimentaires46. Ce genre est également attribué aux individus portant des plaques de ceinture sur le Plateau suisse, où elles sont régulièrement associées à des boucles d’oreille et des brassards en tôle47.
Dans la sépulture 48 de Courtesoult, la ceinture n’était pas en position fonctionnelle mais déposée en diagonale sur le haut du corps, recouvrant une fibule et les avant-bras. Cette pratique est également connue dans le tumulus contemporain du Magdalenenberg (Bade-Wurtemberg) dans les sépultures 110, 117 et 12248.
Disques ajourés à anneaux mobiles (711.1 à 7 et 13170.1)
Parmi les éléments de ceinture du Premier âge du Fer se trouvent un disque ajouré (fig. 8) et un ensemble d’anneaux mobiles étamés décorés d’incisions (fig. 9) appartenant à des découvertes faites à Saint-Ferréol (Haute-Savoie) et à Talloires (Haute-Savoie). Le disque de Saint-Ferréol était associé à trois ou quatre bracelets en alliage cuivreux49 ; le compte-rendu de la découverte ne mentionne pas si des anneaux mobiles étaient associés au moment de la découverte sans être ensuite entrés dans les collections du musée. Pour leur part, les anneaux mobiles de Talloires furent découverts dans un éboulis par un berger ; deux anneaux manquent, ayant été vendus à un particulier avant l’achat du reste par le musée d’Annecy. La description de la découverte mentionne deux objets en fer dont ce qui pourrait être une pointe de lance ou un poignard50, mais aucun disque ajouré habituellement associé à ces éléments.


En 1878, au moment de la première publication des anneaux de Talloires, la fonction de ces objets était inconnue ; L. Revon proposait une utilisation comme décor de bouclier ou, en raison de leur association à des anneaux de suspension dans les tombes jurassiennes, comme enseigne militaire, ornement de poitrine d’un chef ou du poitrail de sa monture. Plus tard, leur position sur le bassin, dans des sépultures attribuées à des femmes en raison de leur riche parure, porta à les surnommer “boucliers de pudeur”51.
Bien que cette interprétation symbolique ne soit pas démontrable, les disques ajourés à anneaux mobiles sont effectivement portés dans la région du bassin et fréquemment associés à un crochet ou à un élément de suspension52. Ils sont caractéristiques du Ha D1 du massif jurassien et du Plateau suisse (fig. 10), où ils découlent de modèles plus anciens du Ha C composés de petites rouelles à anneaux mobiles avec un même décor d’incisions géométriques53. Les découvertes de Talloires et Saint-Ferréol sont les points les plus au sud de la distribution actuelle et peuvent être attribués au type Wohlen-Murzelen, caractéristique de l’ouest de la Suisse et de la Franche-Comté54. Peu de matériel anthropologique est disponible pour chercher une éventuelle corrélation avec le sexe de la ou du porteur, en raison de l’ancienneté des découvertes et de l’acidité du sédiment ; comme les plaques de ceinture à décor estampé, les disques ajourés sont attribués aux femmes sur la base des assemblages55.
Autres éléments de ceinture des Alpes françaises
Hormis les éléments cités précédemment, la partie sud des Alpes françaises recèle quelques autres éléments de ceinture au Premier âge du Fer. En règle générale, cette période demeure relativement méconnue par rapport à la fin de l’âge du Bronze ou au début du Second âge du Fer, une tendance liée à sa sous-représentation, les Alpes française faisant figure de “parent pauvre” vis-à-vis des régions voisines comme la Suisse et la Franche-Comté.
On remarque néanmoins que les éléments de ceinture représentés dans les collections du Musée-Château d’Annecy, provenant tous de Haute-Savoie, se distinguent de la culture matérielle des Alpes du sud (fig. 11). Dans la vallée de l’Ubaye, la sépulture de Saint-Ours (Alpes-de-Haute-Provence) a livré une agrafe de ceinture rectangulaire (fig. 12, A) apparentée aux fragments connus en Ligurie intérieure de la deuxième moitié du VIe siècle56 et à l’exemplaire hors contexte découvert à Zanica au XIXe siècle de la fin du VIe au début Ve siècle a.C.57. Cette parenté avec l’Italie nord-occidentale se répète dans la tombe par sa fibule à navicella et son bracelet à extrémités repoussées58. L’agrafe de Lans “Les Gréoux” (fig. 12, B) pointe également vers le nord de l’Italie ; elle peut être associée au type Golasecca variante A59, équivalent au type Castelletto Ticino de Rubat Borel60 et au type 261.

Dans les Hautes-Alpes, huit boutons à barrette auraient été cousus par paires sur une ceinture en cuir dans la sépulture 10 du tumulus 5 de Chabestan62. Dans la sépulture 4 du tumulus 23, où fut également retrouvé un collier de perles en ambre, ce sont 260 clous en alliage cuivreux à tige et petite tête hémisphérique (fig. 12, C) qui ont été retrouvés en rangées parallèles sur le bassin et l’abdomen, et attribués à un plastron en raison de leur présence jusque sur les flancs et la poitrine de l’inhumé·e63, mais sans association avec un système de fermeture.
Second âge du Fer
Passants à renflements (5103.1 à 3 et 5223.30-31)
Les collections du Musée-Château d’Annecy conservent un petit nombre d’objets du Second âge du Fer. Parmi ceux-ci se trouvent des passants de ceinture à deux renflements (fig. 13), aussi appelés “appliques de ceinture en forme de violon”, provenant de tombes découvertes à Jausiers “Les Sanières” (Alpes-de-Haute-Provence). Les trois premières, entrées dans l’inventaire en 1872, étaient associées à une chaînette et une série de bracelets décorés, tandis que l’assemblage de la quatrième est inconnu. Bien qu’elles soient entrées en collection grâce à un échange avec le Dr A. Ollivier, à l’origine de la plupart des découvertes dans les environs, elles ne sont pas mentionnées dans le compte-rendu qu’il fait de ses activités en 186864 ; il n’est donc pas possible d’attester leur association au sein de la tombe. Les objets découverts au XIXe siècle à Jausiers et plus généralement dans la vallée de l’Ubaye ayant fait l’objet d’une grande dispersion partout en France65, on retrouve des appliques de même provenance au Musée dauphinois66.

Quelques assemblages fournissent une datation de ces éléments. Dans la tombe des Mats à Jausiers, l’association à une bague en spirale et une bague coudée tend vers LT C1, ces deux types de parure étant bien connus dans les Alpes du nord67. À Guillestre “Peyre Haute” (Hautes-Alpes), dans la sépulture III, un bracelet à méandres de type 2 se rapporte à LT B1 et était associé à quatre passants68.
La fonction de passants de ceinture peut être confirmée grâce à la variante à trois renflements connue en Savoie. Au Villeret, à Aussois, des passants furent retrouvés parmi les restes perturbés d’une sépulture où les rares os conservés présentent des traces d’oxydation sur l’os coxal et la tête du fémur69. Toujours dans la vallée de la Maurienne, 69 passants à trois renflements furent découverts au niveau du bassin dans la sépulture 7 de Lanslevillard “L’Adroit”70, totalisant une longueur estimée à 1,10 m pouvant correspondre à celle d’une ceinture. En 2024, des exemplaires de la même variante ont été découverts, à nouveau sur le bassin, dans la sépulture 10 du Rocher des Amoureux à Villarodin-Bourget (Savoie)71. Ces exemples savoyards sont contemporains ou plus tardifs que les passants de Jausiers. Au Rocher des Amoureux, l’association à des fibules de schéma La Tène II confirme une datation à LT C72. L’ensemble du Villeret est daté de LT C2, en raison de la présence d’une fibule en fer à pied fixé sur l’arc par une fausse bague (type 22 de Manching), tandis que celui de Lanslevillard est rattaché à LT D1 ou D2 par la présence d’une fibule fusionnant les caractéristiques des types Nauheim/Grosse Giubasco et Cenisola73.
Dans la vallée de l’Ubaye, les informations sont plus partielles mais concernent des passants à deux renflements similaires à ceux conservés au Musée-Château d’Annecy. Dans la tombe des Mats à Jausier, 50 de ces passants étaient associés à une boucle de ceinture en forme de huit et à une agrafe rectangulaire à crochet. Leur position n’est pas précisée lors de leur ramassage par le Dr. A. Ollivier74 qui les interprète comme des éléments de colliers, tandis qu’ils sont dits découverts “sur le tronc” par F. Arnaud en 190575 ; dans les deux cas, ces appliques n’ont pas été retrouvées en position fonctionnelle, ou “portées en ceinture” comme publié récemment76. À La Rochette (commune de Jausiers, Alpes-de-Haute-Provence), une sépulture a livré des passants similaires ; découverts dans les environs du cou, ils ont dernièrement été réinterprétés comme des éléments de collier77. Cependant, les exemples précédents de Thonon-les-Bains et Saint-Pierre-en-Faucigny montrent qu’il faut éviter l’amalgame entre la position d’un objet dans la tombe et sa fonction initiale, y compris pour les accessoires vestimentaires. La mise en scène funéraire du corps peut impliquer une série de gestes qui brouillent la lecture du costume, notamment par le dépôt d’accessoires vestimentaires sur ou à côté du corps.
Aucune donnée anthropologique ne permet de lier ces parures à des tombes féminines, y compris en Savoie, où les ossements sont dans un mauvais état de conservation et ne peuvent indiquer que l’âge adulte des inhumé·es78. Dans les Alpes du sud, elles sont associées au genre féminin sur la base de comparaisons extrarégionales qui sont elles-mêmes fondées sur l’étude des assemblages79.
Autres éléments de ceinture des Alpes françaises
Contrairement aux périodes précédentes, les collections du Musée-Château d’Annecy ne conservent pas d’éléments de ceinture du Second âge du Fer provenant de Haute-Savoie ou même, plus généralement, des Alpes du nord. Longtemps méconnus, ces éléments sont désormais attestés dans la région lémanique, dans la nécropole des Léchères à Chens-sur-Léman (Haute-Savoie) ; actuellement en voie de publication80 et appartenant aux collections du musée du Chablais, ils trouvent des comparaisons sur le Plateau suisse et l’est de la France et ne feront pas, ici, l’objet d’une présentation.
Le reste des Alpes montre une grande diversité dont la Haute-Savoie, tournée vers la Suisse et l’est de la France, se distingue. Ces éléments sont rassemblés par P. von Eles81 dans une planche récapitulative (fig. 14, A) rassemblant des agrafes triangulaires et rectangulaires ainsi que des boucles en huit, montrant à nouveau une nette distinction de la culture matérielle entre la Savoie et les Alpes du sud.
Publiée après cette synthèse, une tombe découverte en 1972 au Mur des Sarrasins à Lanslevillard (Savoie) comportait une ceinture décorée d’appliques circulaires à griffes et rectangulaires en tôle repoussée, fermée par une agrafe rectangulaire à nervure centrale et crochet ornée de cercles oculés et de motifs géométriques au trémolo (fig. 14, B82). Bien qu’aucun parallèle exact n’ait été retrouvé à l’heure actuelle, cette pièce montre des parentés avec la zone de Golasecca où les cercles oculés et les décors au trémolo font partie du répertoire ornemental ; sa forme sub-rectangulaire l’apparente au type Cerinasca d’Arbedo connu à Golasecca (tombe Ca Morta VIII, 1926), Zanica et Brembate83 ainsi que dans les tombes 51 et 61 d’Arbedo Cerinasca, et Castaneda, tombe 62, plus tardive84 mais également aux productions d’Émilie occidentale du type Sant’Ilario85, datés de la première moitié du Ve siècle a.C. Cependant, la longue nervure centrale traversant la plaque dans la longueur et se prolongeant par un crochet long et étroit ne trouve pas de comparaisons précises avec les productions nord-italiques et tessinoises. Seule la plaque de Crissolo, avec un décor de quatre cercles oculés et une nervure allant jusqu’au milieu de la plaque, s’en approche86. De plus, les exemplaires italiens ont souvent un système de fixation composé de griffes repliées, parfois associées à des rivets, tandis que l’agrafe de Lanslevillard ne comporte pas de griffes et ne pouvait qu’être rivetée à la ceinture. Par sa morphologie et l’agencement de son décor, il est possible que cette agrafe appartienne à une production régionale caractéristique des Alpes savoyardes méconnue en raison du petit nombre de découvertes de cette période. À Lanslevillard, son association à une fibule tardo-alpine de variante C datée du GIIIA A387, ou LT A2, permet de proposer une datation plus récente que les exemplaires italiens cités précédemment mais proche de ceux de Cerinasca. Cette proposition est également soutenue par la découverte récente d’appliques circulaires et rectangulaires similaires à quelques kilomètres en aval, dans la sépulture 26 du Rocher des Amoureux à Villarodin-Bourget (Savoie), en association avec un bracelet à tenon88.
Le rôle des ceintures à éléments métalliques dans la représentation sociale
Les éléments de ceinture métalliques des collections du Musée-Château d’Annecy peuvent être mis en relation avec des schémas de représentation des individus au sein d’une société, sortes de “cultures sociales” fondées sur des critères d’identité comme le genre et le statut.
Identifier la place des individus portant une ceinture à éléments métalliques implique de connaître la composition de la société ; en d’autres termes, il est nécessaire d’avoir une base de référence suffisamment solide pour pouvoir comparer les porteurs de ceinture aux “autres”. Dans les Alpes françaises, cette information est lacunaire : certaines régions comme la Haute-Savoie ne sont représentées que par un très faible nombre de sépultures, tandis que d’autres ont connu une quantité importante de découvertes au XIXe et au début du XXe siècle mais avec une documentation insuffisante, à l’image de la vallée de l’Ubaye. Dans les deux cas, les corpus funéraires à disposition dans les Alpes françaises ne sont pas de qualité suffisante pour émettre des hypothèses sur la composition sociale. On peut cependant utiliser les exemples des régions voisines en supposant que ces grandes lignes s’appliquent également aux sociétés alpines.
L’utilisation des éléments de ceinture comme objet d’étude implique un autre biais : celui de la non-conservation des éléments organiques et, de ce fait, la représentation exclusive des éléments métalliques. Comme dans toute étude sur le costume, la part de l’invisible qui échappe à l’analyse archéologique est difficilement quantifiable et correspond à une grande partie de la population qui demeure méconnue.
Statut
À la fin de l’âge du Bronze, trop peu de tombes sont connues dans les Alpes françaises pour associer les agrafes de ceinture et les pendeloques triangulaires à un groupe social précis. Leur présence dans les habitats et les dépôts indique que ces objets ne sont pas cantonnés au costume funéraire et que leur port devait être relativement fréquent. De plus, aucune des sépultures ne possède d’objets traditionnellement associés à l’élite tels que de l’armement, des importations, de la vaisselle métallique ou des éléments liés à la cavalerie (char et harnachement). Au contraire, lorsque les assemblages sont connus, ils concernent plutôt des formes régionales de la parure annulaire et de la céramique. Il s’agit certes d’individus suffisamment aisés et socialement considérés pour posséder des accessoires vestimentaires complexes et des bijoux en bronze, pour avoir droit à une tombe sous tumulus et à des offrandes funéraires, mais rien n’indique qu’il s’agisse de membres de l’élite ou d’une classe sociale spécialisée, par exemple religieuse ou guerrière. Si la ceinture métallique possède un rôle symbolique précis à ce moment dans les Alpes, aucun indice ne permet de le confirmer pour l’instant.
À l’âge du Fer, les éléments de ceinture sont généralement retrouvés avec tout un assemblage d’autres objets métalliques dans des tombes souvent dites “riches” : fibules, parures pectorales, parures annulaires en grand nombre… Même si les associations des objets des collections du Musée-Château d’Annecy sont inconnues, les comparaisons alpines et des régions voisines montrent que les éléments de ceinture métalliques font partie d’un costume complexe qui se répète assez fréquemment pour avoir une signification sociale. La participation des ceintures à l’opulence de certaines tombes, à l’image de celles des Mats à Jausiers ou de Courtesoult, renvoie cette fois à une classe sociale privilégiée dont la représentation passait visiblement par la somptuosité du costume et où le “paraître” rejoint l’aspect utilitaire de ces éléments.
La position des ceintures dans la tombe, au Premier âge du Fer, va dans le sens de cette interprétation. En effet, les ceintures des sépultures 48 de Courtesoult (Haute-Saône89) et des sépultures 110, 117 et 122 du Magdalenenberg (Bade-Wurtemberg90) n’étaient pas portées mais déposées sur le corps. Cette position non fonctionnelle peut être interprétée comme une “offrande”91 mais peut également indiquer que cet objet, bien que n’étant pas porté au moment de l’enterrement, avait une signification sociale trop importante pour ne pas accompagner son ou sa propriétaire dans l’au-delà. Une autre possibilité, dans le cas des ceintures non portées, est qu’elles soient une offrande au sens strict et n’aient pas appartenu à l’individu dans la tombe ; dans ce cas, elles revêtent également une signification sociale suffisamment forte pour participer à la cérémonie funéraire. Pour l’instant, cette hypothèse ne peut pas être étendue au Second âge du Fer faute d’observations taphonomiques.
Genre
Le faible nombre de sépultures fouillées récemment dans les Alpes rend également difficile l’attribution d’un genre aux ceintures à éléments métalliques. Pour la fin de l’âge du Bronze, les sépultures 113 et 193 de Saint-Pierre-en-Faucigny (Haute-Savoie) montrent que les agrafes de type Mörigen pouvaient être portées par des hommes et des femmes, dont le sexe biologique n’était pas forcément corrélé au genre92. Un corpus de plus grande taille serait donc nécessaire pour répondre à cette question.
Pour le Premier âge du Fer, les comparaisons dans le massif jurassien et la Suisse indiquent que les plaques de ceinture métalliques et les disques ajourés appartiennent à des tombes féminines, y compris lorsque le sexe biologique est connu93. Par extension, on peut supposer que cette attribution féminine touche également les Alpes françaises, en marge de la répartition. L’exercice est similaire pour les passants de ceinture du Second âge du Fer, attribués aux tombes féminines par comparaison des assemblages dans la vallée de l’Ubaye avec ceux de la Ligurie94.
Conclusion
En conclusion, malgré l’état lacunaire des connaissances, les éléments de ceinture présentés peuvent être replacés dans leur contexte social grâce aux comparaisons avec les régions voisines. Ils appartiennent à une classe aisée de la société, plus particulièrement à l’âge du Fer, où la ceinture participe des costumes opulents associés au genre féminin. Au Premier âge du Fer, l’importance sociale des ceintures est confirmée par leur présence dans la tombe même lorsqu’elles ne sont pas portées par l’inhumée.
Ces accessoires vestimentaires indiquent également de nettes distinctions au sein de la culture matérielle selon les régions alpines. La Haute-Savoie et les environs du lac du Bourget sont résolument tournés vers la Suisse et la Franche-Comté, tandis que les zones montagnardes situées à l’est de la combe de Savoie ont une culture matérielle distincte partageant des traits communs avec le nord de l’Italie et les Alpes du sud. La partie française des Alpes du sud est, pour sa part, apparentée avec la Ligurie ainsi qu’avec la région de Golasecca.
Bibliographie
Audouze, F. (1974) : “Les ceintures et ornements de ceinture de l’âge du Bronze en France. Ornements et agrafes des ceintures en matière périssable”, Gallia Préhistoire, 17-1, 219-283.
Audouze, F. (1976) : “Les ceintures et ornements de ceinture de l’Âge du Bronze en France (suite). Ceintures et ornements de ceinture en bronze”, Gallia Préhistoire, 19-1, 69-172.
Barral, P., Guillaumet,J.-P., Roulière-Lambert, M.-J., Saracino, M. et Vitali, D., dir. (2014) : Les Celtes et le Nord de l’Italie (Premier et Second âges du fer), Actes du XXXVIe colloque international de l’AFEAF, Vérone, 17-20 mai 2012, Revue archéologique de l’Est Suppl. 36, Dijon.
Bellon, C., Blaizot, F., Perrin, F. et Rahatsötz, M. (2002) : “Nouvelles sépultures à inhumation de La Tène à Lanslevillard (Savoie)”, Documents d’Archéologie Méridionale, 25, 233-244.
Bintz, P., Griggo, C., Martin, L. et Picavet, R., dir. (2019) : L’Homme dans les Alpes de la pierre au métal : actes de la table-ronde AVDPA, Villars-de-Lans, EDYTEM, Chambéry.
Bocquet, A. (1969) : Catalogue des collections préhistoriques et protohistoriques. 1. Texte, Musée dauphinois, Grenoble.
Bocquet, A. (1970) : Catalogue des collections préhistoriques et protohistoriques. 2. Planches, Musée dauphinois, Grenoble.
Caramella, L. A. R. (2023) : Dall’acqua alla terra : cambiamenti nell’occupazione del territorio, Sibrium Atti, 1, Golasecca.
Casini, S. (1998) : “Ritrovamenti ottocenteschi di sepolture della cultura di Golasecca nel territorio bergamasco”, NAB, 6, 109-161.
Chantre, E. (1880) : Études paléoethnologiques dans le bassin du Rhône. Premier âge du Fer. Nécropoles et tumulus, Lyon.
Chappuis, C. (1862) : Étude archéologique et géographique sur la vallée de Barcelonnette à l’époque celtique, Besançon.
Chemin, R. (2013) : Archéologie de la Maurienne, Travaux de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne, tome XLVII, St-Jean-de-Maurienne.
Chemin, R. et Prieur, J. (1972) : “Découverte d’une sépulture de l’Âge du Fer à Lanslevillard (Savoie)”, Bulletin d’études préhistoriques alpines, IV, 89-92.
Cicolani, V. (2017) : Passeurs des Alpes. La culture de Golasecca : entre Méditerranée et Europe continentale à l’âge du Fer, Histoire et Archéologie, Paris.
Cicolani, V. (2021) : “Piccoli bronzi e metallurgia in lega di rame”, in: Venturino & Giaretti, éd. 2021, 527–550.
Collectif (1991) : Archéologie dans les Hautes-Alpes, Musée départemental de Gap, Gap.
Collectif (2010) : Héritage public. Musée d’Annecy – 150 ans d’histoire des collections, catalogue d’exposition (22 juin 2010 au 28 mars 2011), Lieux Dits, Lyon.
Combier, J. (1972) : Bronze en Savoie en dehors des stations palafittiques, Albertville.
Courtois, J.-C. (1968) : “Recherches dans les nécropoles du bassin du Buëch”, Bulletin de la Société d’Études des Hautes-Alpes, 34-118.
Courtois J.-C. et M. Willaume (1991) : “La nécropole tumulaire de Chabestan” : in Collectif, 1991, 156-173.
Damiani, I., Maggiani, A., Pellegrini, E., Saltini, A. C. et Serges, A. (1992) : L’età del Ferro nel Reggiano. I Materiali delle collezioni dei Civici Musei di Reggio Emilia, Reggio Emilia.
De Marinis, R. (1981) : “II periodo Golasecca III A in Lombardia”, Studi Archeologici, I, 43-284
Delnef, H. (2003) : “Les bracelets méandriformes en Europe (IVe – IIIe s. av. J.-C.)”, Archeologia Mosellana, 5, 271-300.
Drack, W. (1966-1967) : “Anhängeschmuck der Hallstattzeit aus dem schweizerischen Mittelland und Jura”, JbSGU, 53, 29-61.
Dunning, C. (2005) : Le Premier âge du Fer sur le versant méridional du Jura. Chronologie, typologie et rites funéraires, thèse de doctorat, Université de Genève.
Faudino, V., Ferrero, L. Giaretti, M. et Venturino Gambari, M. (2014): “Celti e Liguri. Rapporti tra la cultura di Golasecca e la Liguria interna nella prima Età del Ferro”, in : Barral et al., éd. 2014, 125-144.
Gabayet, F. et al. (en cours) : Saint-Pierre-en-Faucigny – Les Molettes (Haute-Savoie). Rapport final d’opération, Inrap, Bron.
Garcia, D. (2003) : “Les dépôts d’objets en bronze protohistoriques en Provence-Alpes-Côte d’Azur”, Documents d’archéologie méridionale, 26, 277-284.
Girard-Millereau, B. (2010) : Le mobilier métallique de l’âge du Fer en Provence (VIe– Ier av. J.-C.). Contribution à l’étude des Celtes de France méditerranéenne, Thèse de doctorat, Université de Bourgogne, 3 vol.
Hodson, F. (1968) : The La Tène Cemetery at Münsingen-Rain : Catalogue and relative chronology, Acta Bernensia, 5, Bern.
Isoardi, D. et Mocci, F. (2019) : “Spécificités des pratiques funéraires dans la vallée de l’Ubaye et du Guillestrois durant l’âge du Fer : réflexion sur le genre et les parures dans le domaine funéraire, solutions pour mesurer l’implication d’une vallée intra-alpine des Alpes du sud dans les mouvements socio-économiques européens ?”, in : Bintz et al., éd. 2019, 343-376.
Kaenel, G. (1990) : Recherches sur la période de La Tène en Suisse occidentale : analyse des sépultures, Bibliothèque historique vaudoise, Lausanne.
Kerouanton, I. (2002) : “Le lac du Bourget (Savoie) à l’Âge du Bronze final : les groupes culturels et la question du groupe du Bourget”, Bulletin de la Société préhistorique française, 99/3, 521-561.
Kerouanton, I. (2023) : Les stations littorales immergées du lac du Bourget (Savoie) à l’âge du Bronze final : Collections anciennes, APRAB 11, Dijon.
Kilian-Dirlmeier, I. (1972) : Gürtelhaken, Gürtelbleche und Blechgürtel der Hallstattzeit in Mitteleuropa, Prähistorische Bronzefunde, XII/1, München.
Kilian-Dirlmeier, I. (1975) : Gürtelhaken, Gürtelbleche und Blechgürtel der Bronzezeit in Mitteleuropa : Ostfrankreich, Schweiz, Süddeutschland, Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn, Nordwest-Jugoslawien, Prähistorische Bronzefunde, XII/2, München.
Landry, C., dir. (2017) : Le Chablais au second âge du Fer : la nécropole des Léchères à Chens-sur-Léman, troisième année, rapport de PCR, Bron.
Landry, C., dir. (2018) : Le Chablais au second âge du Fer : la nécropole des Léchères à Chens-sur-Léman, quatrième année, rapport de PCR, Bron.
Landry, C., dir. (à paraître) : Le Chablais au second âge du Fer : la nécropole des Léchères à Chens-sur-Léman.
Landry, C., dir. (2024) : Villarodin-Bourget (Savoie), Rocher des Amoureux (Les Tufs). Rapport de diagnostic, Inrap, SRA Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon.
Landry, C. et Lemaître, S. (2022) : Sépultures et nécropoles de l’âge du Fer en région Auvergne-Rhône-Alpes (VIIIe – Ier s. av. J.-C.), Documents d’Archéologie Méridionale, 43, Lattes.
Landry, C., Tremblay Cormier, L., Lempereur, O. et Rouzic, M. (à paraître) : “Les éléments de ceinture du second âge du Fer en Maurienne (Savoie)”, Documents d’Archéologie Méridionale.
Le Roux, M. (1899) : “Séance du 11 octobre 1899”, Revue savoisienne, 225-226.
Marin, S. (2010) : “Annecy et son musée : 150 ans d’histoire”, in : Collectif 2010, 7-17.
Martin, D. (1902) : “Fouilles opérées dans les tumuli 9 et 23 de Champ-Cros”, Bulletin de la Société d’Études des Hautes-Alpes, 339-358.
Muller, A. (1991) : “L’âge du Bronze dans les Hautes-Alpes”, in : Collectif, 1991, 103-131.
Oberkampf, M. (1997) : Age du bronze de Haute-Savoie. Tome 1, En dehors des stations littorales, Annecy.
Ollivier, A. (1882) : “Vallée de Barcelonnette. Simple relation sur quelques monuments celtiques découverts dans cette vallée”, Annales des Basses-Alpes, 304-321.
Piningre, J.-F. (dir.) (1996) : Nécropoles et société au Premier âge du fer : le tumulus de Courtesoult, Haute-Saône, Documents d’archéologie française, 54, Paris.
Piningre, J.-F. et Ganard, V. (2004) : Les nécropoles protohistoriques des Moidons et le site princier du Camp du Château à Salins, Jura : les fouilles récentes et la collection du Musée des Antiquités nationale, Documents préhistoriques 17, Paris.
Piroutet, M. (1900) : “Contribution à l’étude du Premier âge du Fer dans les Départements du Jura et du Doubs”, Anthropologie, 11, 369-400.
Prieur, J. (1981) : L’âge du Fer, Catalogue des collections des Musées de Chambéry, Chambéry.
Ramponi, C., Lenda, S. et Treffort, J.-M. (2022) : “Un ensemble funéraire du Premier âge du Fer à Saint-Vulbas au sein du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain”, in : Landry et Lemaître, 2022, 45-80.
Ramponi, C., Remy, A.-C. et Segain, E. (2018) : Grange Rouge – A 46N – section Anse-Genay (Quincieux, Rhône) : rapport de fouille, Inrap, Bron.
Rebour, G. (1867) : “Découverte d’une fonderie celtique (Âge du Bronze) dans le village de Larnaud, près de Lons-le-Saunier (Jura), en 1865. Rapport, procès-verbal et inventaire”, Mémoires de la Société d’émulation du Jura, 223-246.
Revon, L. (1878) : La Haute-Savoie avant les Romains, Paris/Annecy.
Rochna, O. (1962) : “Hallstattzeitlicher Lignit- und Gagat-Schmuck, zur Verbreitung, Zeitstellung und Herkunft”, Fundberichte aus Schwaben, 16, 44-83.
Rouzeau, N., dir. (2020) : Nécropoles gauloises des Alpes du sud : projet collectif de recherche, Mirebeau-sur-Bèze.
Rubat-Borel, F. (2009) : “Note di tipologia su alcuni elementi di parure dei ripostigli bronzei di Chiusa Pesio”, QuadAPiem, 27, 9-27.
Ruffa, M. (1999) : “Tre fermagli di cintura da Castelletto Ticino”, QuadAPiem, 16, 29-36.
Ruffa, M. (2023) : “Un accessorio femminile: i fermagli di cintura golasecchiani in bronzo triangolari e rettangolari. Studio preliminare”, in : Caramella 2023, 458-479.
Rychner, V. (1979) : L’âge du bronze final à Auvernier : lac de Neuchâtel, Suisse : typologie et chronologie des anciennes collections conservées en Suisse, Bibliothèque historique vaudoise, Lausanne.
Sabatier, M. (1985) : Les vallées de la Haute-Durance et de l’Ubaye à l’époque protohistorique, mémoire de maîtrise de l’École du Louvre, Paris.
Schmid-Sikimić, B. (1995) : “Wo sind die Männer geblieben ? Bemerkungen zur Geschletchsspezifischen Ausstattung hallstattzeitlicher Gräber”, in : Schmid-Sikimić & Della Casa, éd. 1995, 169-186.
Schmid-Sikimić, B. (1996) : Der Arm- und Beinschmuck der Hallstattzeit in der Schweiz : mit einem Anhang der Gürtelhaken und Gürtelgehänge der Hallstattzeit im Schweizerischen Mittelland, Jura and Wallis, Prähistorische Bronzefunde, X/5, Stuttgart.
Schmid-Sikimić, B. et Della Casa, P. (1995) : Trans Europam. Beiträge zur Bronze- und Eisenzeit zwischen Atlantik und Altai. Festschrift für Margarita Primas, Bonn.
Spindler, K. (1976) : Magdalenenberg : der hallstattzeitliche Fürstengrabhügel bei Villingen im Schwarzwald. 4 Band, Villingen.
Tremblay Cormier, L., Isoardi, D. et Cicolani, V. (2019) : “Voisins ou cousins ? Comparaison de deux régions alpines à la frontière franco-italienne à l’âge du Fer”, Bulletin d’études préhistoriques et archéologiques alpines, 147-168.
Trémeaud, C. (2018) : Genre et hiérarchisation dans le monde nord-alpin, aux âges du bronze et du fer, BAR 2912, Oxford.
Venturino, M. et Giaretti, M., dir. (2021) : Villa Del Foro. Un Emporio Ligure Tra Etruschi e Celti, Genova, 527-550.
von Eles, P. (1967-1968) : “L’Età del ferro nelle Alpi occidentali francesi”, Cahiers rhodaniens, XIV, 1-223.
Zamboni, L. (2018) : Sepolture arcaiche della pianura emiliana. Il riconoscimento di unasocietà di frontiera, Roma.
Notes
- Ce n’est qu’en 1955 qu’il prit le nom de « Musée-Château”, au moment de son transfert de l’ancien hôtel de ville au château d’Annecy.
- Marin 2010.
- Gabayet et al. en cours.
- Bellon et al. 2002.
- Ramponi et al. 2022, 53.
- Schmid-Sikimić 1996, 161.
- Gabayet et al. en cours.
- Audouze 1974, 258.
- Rebour 1867.
- Audouze 1974, 239.
- Kilian-Dirlmeier 1975, 79-82.
- Ramponi et al. 2018, 142.
- Ramponi et al. 2022.
- Audouze 1974, 228, fig. 1.
- Gabayet et al. en cours.
- Audouze 1974, 234.
- Ruffa 1999 ; 2023.
- Audouze 1974.
- Revon 1878, 40.
- Gabayet et al. en cours.
- Ramponi et al. 2022, 47. Ces identifications ont été obtenues par l’analyse des critères ostéologiques, comme l’ensemble de celles qui sont présentées dans cet article, et non grâce à l’ADN.
- Oberkampf 1997, 187.
- Audouze 1976, 155.
- Audouze 1974, 271 ; 1976, 155.
- Audouze 1976, 107.
- Rychner 1979, pl. 98/18.
- Bocquet 1969, 196 ; 1970, pl. 63/1019.
- Audouze 1976, 158-159.
- Oberkampf 1997, 181-183.
- Audouze 1976, 106.
- Audouze 1976, 161-163.
- Bocquet 1969 ; Combier 1972.
- Kerouanton 2023, pl. 10/2-9.
- Id., pl. 85/7-10, 12-15 et 18-19.
- Id., pl. 122/2.
- Audouze 1974, 246-250.
- Oberkampf 1997, 97, pl. 16/5.
- Gabayet et al. en cours.
- Kerouanton 2002, 528-529.
- Oberkampf 1997, 85.
- Audouze 1976, 137.
- Audouze 1976, 77 ; Muller 1991, 108-109 ; Garcia 2003.
- Kilian-Dirlmeier 1972, 51-54, pl. 26/317.
- Rochna 1962, 53 ; Piningre & Ganard 2004, 270.
- Girard 2010, 443-456.
- Piningre, dir. 1996, 132.
- Schmid-Sikimić 1996, 13.
- Spindler 1976.
- Le Roux 1899, 226.
- Revon 1878, 37.
- Piroutet 1900, 376.
- Schmid-Sikimić 1996, 161.
- Drack 1966-1967, 31 ; Piningre & Ganard 2004, 289.
- Schmid-Sikimić 1996, 194.
- Dunning 2005, 115-117 ; Schmid-Sikimić 1995.
- Faudino et al. 2014, 138-139 ; Cicolani 2021, 538-539.
- Casini 1998, 126, fig. 10.6.
- Chappuis 1862, 54-57 ; Tremblay Cormier et al. 2019, 18.
- Casini 1998, 136.
- Rubat-Borel 2009, 9 -27.
- Ruffa 1999 ; ce vol. fig. 14.
- Courtois 1968, 84 ; Courtois & Willaume 1991.
- Martin 1902, 352.
- Ollivier 1882.
- Sabatier 1985, 22-36.
- Bocquet 1970, pl. 46/865 et 867.
- Hodson 1968, 40 ; Kaenel 1990, 243 et 249 ; Landry dir. 2018, 24.
- Chantre 1880, pl. IV/2 ; von Eles 1967-1968, 94-100 ; Delnef 2003, 280.
- Landry et al. à paraître.
- Bellon et al. 2002.
- Landry, dir. 2024. Pour une synthèse détaillée des passants de ceinture à renflements, voir Landry et al., à paraître.
- Id.
- Landry et al., à paraître.
- Ollivier 1882, 315-315.
- Arnaud 1905 in : Sabatier 1985, 80 et 82.
- Rouzeau, dir. 2020, 172.
- Id.
- Landry et al., à paraître.
- Isoardi & Mocci 2019.
- Landry, dir. 2017, 32-34 ; Landry, dir., en cours.
- von Eles 1967-1968, pl. 14.
- Chemin & Prieur 1972 ; Prieur 1981, 32 ; Chemin 2013, 161-163.
- de Marinis 1981, 235 ; Casini 1998, 126, fig. 10.6.
- Casini 1998, 157-158.
- Damiani et al. 1992, 333-334 ; Zamboni 2018, 177-181?
- Faudino et al. 2014, 138, fig. 15.5. Merci à V. Cicolani pour son aide dans la recherche de comparaisons italiennes.
- Cicolani 2017, 115.
- Landry dir. 2024.
- Piningre, dir. 1996, 132.
- Spindler 1976.
- Piningre id.
- Trémeaud 2018.
- Schmid-Sikimić 1995 ; Dunning 2005.
- Isoardi & Mocci 2019.