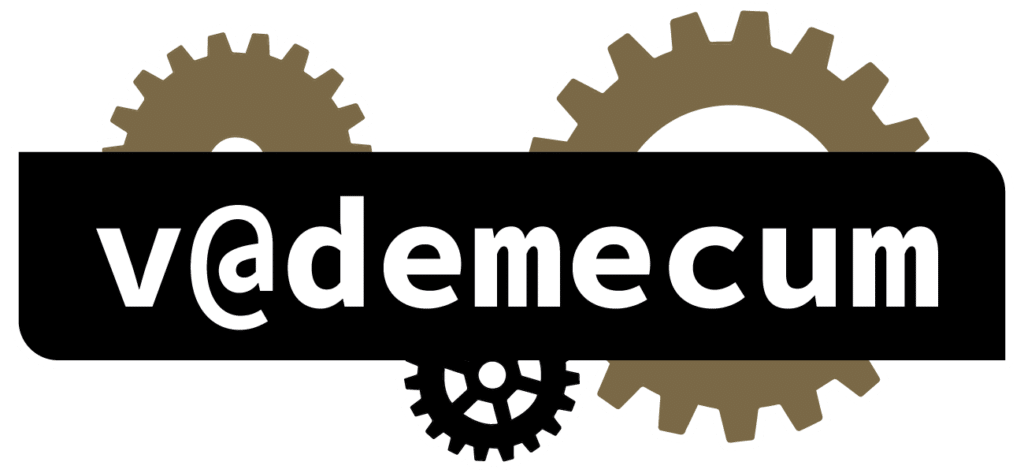Le terrain s’impose, en anthropologie, comme une nécessité méthodologique et, par-là, il établit les conditions mêmes de notre connaissance des phénomènes sociaux et des savoirs académiques qu’il contribue à fonder ou à mettre en débat. Toutefois, le terme désigne une variété de pratiques qui, allant de l’enquête rapide à l’adoption du mode de vie d’une communauté durant plusieurs années, supposent des fondements épistémologiques très différents. Par « fondements épistémologiques », j’entends ici les « accès » que nous nous ménageons, en tant que chercheurs, pour saisir et comprendre les phénomènes que nous souhaitons étudier, mais aussi pour élaborer et restituer les connaissances dont le terrain est une source du fait de l’expérience qu’il nous procure.
Ces accès au social sont dessinés à partir de méthodes (historiographie, observations, catégorisations, problématisation…), de théories et d’hypothèses qui délimitent et structurent nos objets, en organisent la description et l’analyse. Toutefois, ils empruntent aussi nécessairement le chemin des relations sociales que le chercheur se ménage sur son lieu d’enquête et auxquelles on lui donne accès. Ces accès sont donc conditionnés par la position que l’on trouve sur le terrain, consciemment ou non, délibérément ou non. Dans cette perspective, la « relation d’enquête »1 est importante en ce qu’elle permet la médiation d’interlocuteurs explicitant ou témoignant des réalités qu’ils vivent. Ce cadre, à la fois méthodologique et éthique, focalise l’attention sur l’expérience des interlocuteurs et leur réflexivité. Il produit, avec le recueil d’un discours énoncé « de l’intérieur » (émique) une documentation tangible des faits sous forme de paroles enregistrées, publiées verbatim et/ou conservées sous forme d’archives. Il offre à l’analyse, qu’elle soit ethnologique, sociologique ou historique, une entrée discursivement construite et cohérente, méthodologiquement essentielle. Cet intérêt pour la parole des interlocuteurs sollicités fait droit à leur perception et à leur conception des enjeux de l’action, mais aussi aux représentations collectives que ces dernières peuvent mobiliser et véhiculer, notamment les catégories organisant le monde et les habitudes de pensée collectives. Toutefois, cette entrée discursive – donc représentationnelle – sur la vie et la pensée des interlocuteurs ne suffit pas. Pour que les processus d’induction propres à la discipline soient pleinement opérants, s’y adjoint la nécessaire enquête que l’ethnologue doit mener sur le terrain auprès d’eux, suivant l’organisation et le cours des actions afin d’éclairer par les pratiques ce qui est dit – ou non-dit – et de comprendre ainsi la complexité des faits sociaux. Cette enquête ne peut qu’être immersive, la présence – déclarée ou non – de l’enquêteur participant toujours – avec des effets variables – de l’organisation des phénomènes étudiés in situ. Si elle interdit un point de vue surplombant, la participation plus ou moins intense donne un accès direct et une perspective maitrisée à l’observation. Pour Jean-Pierre Olivier de Sardan2 :
Tout le problème est que cette compétence relève d’un savoir-faire, et que la formation y est de l’ordre de l’apprentissage. Autrement dit l’enquête de terrain ne peut s’apprendre dans un manuel. […] C’est que l’enquête de terrain est d’abord une question de “tour de main”, et procède à coups d’intuition, d’improvisation et de bricolage. […] Il faut avoir appris à maîtriser les codes locaux de la politesse et de la bienséance pour se sentir enfin à l’aise dans les bavardages et les conversations impromptues, qui sont bien souvent les plus riches en informations3.
C’est au prix de cette habituation, mais aussi, comme le défend John Dewey dans sa philosophie de la connaissance4, des récurrences, des variations, des dissonances qu’il y décèle, que l’ethnologue peut éventuellement identifier les routines, les normes et les règles, ainsi que tout ce qui s’en écarte du point de vue des acteurs, selon les enjeux et les situations. Cette méthode seule permet de restituer la densité, l’épaisseur, la complexité de ce qui constitue les faits sociaux.
Dans ce cas, la description et l’appareil analytique ne répondent pas seulement aux principes méthodologiques et théoriques retenus pour l’étude ; ils intègrent la perspective plus personnelle que le chercheur trace à partir des contraintes rencontrées et des choix qu’il opère. Cette dernière se nourrit de son histoire, de ce qui fonde son intérêt pour un sujet, des formes qu’il donne à son engagement dans le travail, mais résulte aussi de ses capacités à observer des phénomènes, à comprendre leurs interconnexions, donc à alimenter les processus analytiques reposant de façon plus ou moins directe sur l’intuition et l’induction5. Son expérience est ici centrale. Dans les développements qui suivent, je présenterai mon positionnement pour ensuite rappeler certains aspects importants de l’expérience. Je commencerai par les acquis les plus communément admis de l’observation participante pour aborder ensuite les « savoirs tacites » et la familiarité qu’ils supposent. Parmi ces derniers, les compétences sociales d’une part, l’accès à l’idéologie sémiotique6 d’autre part, sont importants pour ce qui relève des enquêtes ethnographiques en général, mais sont essentielles pour ce qui concerne l’étude des phénomènes particulièrement denses et complexes que sont les rites et les dimensions cérémonielles de la vie sociale7.
Une interminable étude ethnographique
Mon parcours d’ethnologue et mon histoire personnelle m’ont amenée à partager le quotidien de mes hôtes, à Wallis, et des membres de la communauté wallisienne à Nouméa et en métropole sur plus de trente années. L’observation participante, la familiarité ainsi développée et mon intégration progressive au sein des relations où l’on me donna place m’ont conduite à porter une attention toute spéciale aux circulations cérémonielles et au système rituel propres à la société wallisienne. L’étude de ces pratiques en connexion très étroite avec les définitions locales de la personne et du cosmos, l’organisation des groupes sociaux et celle de la chefferie, m’a permis de mieux saisir les enjeux du rituel dans ce type de société, mais aussi de comprendre les conceptions du monde où il trouve place, c’est-à-dire les théories de l’action et les questions de méthode que posent leur accès et leur observation.
Mon accueil à Wallis a comporté plusieurs phases, mais un seuil décisif fut franchi lorsque mes hôtes entreprirent de m’éduquer afin de me conférer une position dans le réseau social au sein duquel leur maisonnée était insérée. J’ai donc bénéficié, sans bien m’en rendre compte sur le moment, d’une forme de socialisation secondaire faisant de moi un membre de la maisonnée et de la communauté, sans toutefois être, à proprement parler, « indigénisée ». Les étrangers ont une place valorisée dans le système social wallisien, et très généralement ils y restent, à moins de s’établir très durablement sur l’île et de développer leur propre réseau relationnel. Le terme correspondant à cette position est matāpule (« face de chef »), qui désigne plus généralement un médiateur rituel, à l’interface entre le dedans et le dehors sans pleinement relever de l’un ni de l’autre. Telle fut donc la place que l’on m’a conférée, avec les droits et les devoirs que cela comporte.
Ces précisions données, je peux revenir à la question initiale : quels sont les fondements épistémologiques de l’expérience ? Qu’y a-t-il donc en jeu, dans l’expérience, qui permette d’élaborer des connaissances à valeur scientifique alors que, précisément, aucun protocole de collecte raisonnée et de vérification systématique ne peut y être appliqué ? Les réponses que je propose dans la suite de ce chapitre s’appliquent à l’étude de tous les phénomènes sociaux, mais la dimension rituelle de toute action efficace, à Wallis, m’a obligée à lui porter une attention spéciale, tant pour ce qui concerne le Pacifique que pour le reste du monde. Concernant le rôle de l’expérience sur le terrain, l’étude des rites offre, selon moi, un cas paradigmatique. Je développerai donc la question de la plus-value méthodologique du recours à l’expérience afin de montrer ce qu’elle peut apporter dans la compréhension des phénomènes sociaux en général, des rituels en particulier, et que n’apporterait pas une observation plus distanciée, même réitérée.
Participation et acquisition de l’expérience
Depuis les travaux pionniers de Bronislaw Malinowski, dire qu’en bonne méthode la « participation » doit compléter l’observation et les entretiens dans toute enquête ethnographique est un lieu commun. Les conditions de cette « participation » ne vont toutefois pas de soi8 et cette dernière présente différents aspects qui méritent d’être soulignés.
Le concept d’« observation participante » a fait l’objet de différentes critiques, à commencer par le fait que les deux activités seraient incompatibles – ce qui ferait de l’expression un oxymore9. Tout dépend, me semble-t-il, de ce qui est entendu dans « participation », mais aussi dans « observation ». Si ce dernier terme désigne une attention aiguë aux phénomènes sociaux tels que nous sommes amenés à les vivre – et ce, quel que soit notre degré d’exposition –, observation et participation vont de pair dans toute action consciemment organisée et menée. Alors, l’observation participante – ou la participation observante, ce qui revient au même dans cette perspective – permet, une entrée directe sur les actions et, plus généralement, sur les pratiques : pratiques sociales et culturelles, pratiques techniques et sportives10, et plus largement les techniques du corps11. Csordas12 formule des propositions fortes dans cette perspective puisque la signification ne s’arrête pas au fonctionnement sémantique des signes, mais s’étend « à l’incorporation et l’être-dans-le-monde, en complémentarité de la textualité et de la représentation13 ». Prendre en considération ses propres « modes d’attentions somatiques14 », mais aussi s’exposer à ceux qu’il rencontre sur le terrain, offre à l’enquêteur la possibilité de s’approprier – par incorporation (embodiment) – les dynamiques du temps, de l’espace et de l’action, les dimensions somatiques de l’expérience que l’on fait du monde en général, d’un monde en particulier, en usant de tous nos sens : la vue et l’ouïe, certes, mais aussi le goût et l’odorat, le toucher et les mouvements du corps dans l’espace (proprioception15), les dynamiques propres aux objets, aux choses qui nous entourent16.
Plus précisément, parce qu’elle nous immerge dans des réalités sociales complexes en nous donnant accès à leur déroulé, à leurs enchevêtrements via les interactions qui nous y engagent, l’observation participante nourrit notre capacité plus proprement cognitive, d’identifier dans le fil de l’enquête – et au-delà – la pertinence d’une information, d’un phénomène, d’une sensation, au regard du contexte qui permet d’en comprendre le sens et la portée. On ne peut apprendre au moyen d’un enseignement formalisé cette capacité qui s’applique dans toute situation d’interaction au sein d’une situation donnée (interlocution comprise) et qui nous permet d’en comprendre l’organisation et les dynamiques. Elle ne peut être développée qu’au fil de la pratique, c’est-à-dire de l’expérience17. L’expérience, dans ses dimensions subjectives, mais aussi socialement et culturellement suscitées, développées, approfondies, est centrale dans nos interactions avec le monde. Elle est au cœur de toute démarche proprement « qualitative » en SHS, particulièrement en ethnologie/anthropologie.
La question que pose la légitimité de l’enquête ethnographique qualitative trouve donc deux types de réponses, souvent combinées, mais pas toujours explicites.
La première de ces réponses est celle de la « preuve »18 qu’il s’agit d’« administrer » dans une perspective résolument empirique : observer les phénomènes, les décrire et les contextualiser de telle sorte que la précision rend l’analyse incontestable. Comme le défend Steven Prigent, sélection, isolement et traitement des faits dans leur unicité permettent de saisir l’ordinaire des vies, le résultat des actions et, plus globalement, le sens, souvent pluriel, qui en émerge pour les personnes qui s’y trouvent engagées. Cependant, de telles preuves ne renvoient jamais à l’ordre intangible d’une réalité objective, comme prétendent le faire celles déployées dans le domaine des sciences de la vie, par exemple. En anthropologie, les preuves restent définies par la nature de la question posée (accessoirement, par la méthode employée) et leur degré de pertinence au regard de cette question (accès, sélection, présentation…). Bref, en anthropologie, les preuves ne valent que dans le régime de vérification propre à la discipline. Et ce régime implique très directement celui qui les produit : l’ethnologue et sa légitimité.
La seconde réponse aux questions de légitimité est celle de l’expérience que l’ethnologue acquière lors de l’enquête de terrain en pratiquant « l’observation participante ». Un paradoxe de l’anthropologie est que, si son principe méthodologique premier est la rupture de familiarité que suppose la création d’un objet d’étude par décentrement et mise à distance, un principe corollaire est l’acquisition d’une familiarité refondée. Pour la commodité du propos, je distinguerai différents registres de familiarité19.
Un premier registre de familiarité est celui des émotions, selon le degré de l’engagement affectif du chercheur20, la question se posant alors de savoir dans quelle mesure nous avons un accès direct aux dimensions sociales des émotions21 si tant est que les émotions d’autrui soient déchiffrables et partageables au-delà d’une empathie superficielle. Les objets de la familiarité peuvent ainsi varier. Selon Geertz, par exemple, la « description dense » caractérisant l’anthropologie doit reposer sur « une très grande familiarité avec des sujets extrêmement limités »22. Les investigations systématiques (relevés, collectes, entretiens…) génèrent ainsi des connaissances énonçables qui participent de l’appareil interprétatif permettant de rendre compte du sens que les différents acteurs donnent à ce qu’ils vivent23. Pour J-P. Olivier de Sardan, la familiarité ne concerne pas un (ou des) sujet(s) d’étude, mais les sujets de l’enquête24. Elle permet de collecter de l’information et nourrit l’analyse dans le cadre méthodologique de ce qui, procédant par recoupements, revient à une « triangulation »25.
« Familiarité », connaissances implicites et savoirs tacites
La familiarité consiste donc en un phénomène très général qui organise de façon plus ou moins consciente et maîtrisée la connaissance que nous construisons au sujet du monde. En contrepoint de l’étonnement et de l’effet d’altérité, elle se nourrit de notre expérience et enrichit cette dernière en retour. D’un point de vue épistémologique, différents registres, ou régimes de familiarité peuvent être identifiés : les uns s’attachent au fonctionnement même de notre esprit et à l’émergence de la signification, à commencer par ce qui concerne les pratiques langagières et les dimensions pragmatiques de la parole ; d’autres relèvent de savoirs tacites qui organisent notre action individuelle ; d’autres encore relèvent des règles et des principes de la vie sociale, des contextes d’action individuelle et collective : « allants de soi » partagés permettant la coordination des actions (en ethnométhodologie par exemple), cognition distribuée et organisation de l’action26, coopération des acteurs27. Un dernier registre qui sera développé ici concerne les réseaux relationnels où les rituels sont essentiels, mais aussi l’univers de significations que de tels réseaux constituent avec ses principes sémiotiques propres.
Pour ce qui concerne le fonctionnement des signes en général – celui des échanges langagiers en particulier – la « familiarité » (acquaintance) participe pleinement des processus de sémiose qui, selon Peirce, donnent sens à notre expérience : c’est l’appropriation progressive, via l’exposition répétée d’un interprétant à une connexion entre un sign et un object, qui conditionne le fonctionnement des processus de sémiose28.
La familiarité, donc les processus de familiarisation, permet d’établir des relations stabilisées entre un signe (mot, image, signe indexical) et un phénomène, un objet, qui vient ainsi s’articuler dans notre esprit (en position d’interprétant). On peut prendre en exemple la relation que nous sommes amenés à inférer, en écoutant parler quelqu’un, entre son accent et son origine ; entre une odeur et un plat en train de cuire ; entre un craquement et la chute d’un arbre, mais aussi entre le son ou la graphie d’un mot et un ensemble de significations dont le sens se précise en contexte. D’un point de vue méthodologique, ce registre est fondamental en ce qu’y correspondent tous les phénomènes indexicaux sur lesquels reposent, de façon plus ou moins consciente, les intuitions et les inférences générant les significations qui soutiennent et alimentent tout autant la perception que la description et l’analyse des faits tels que nous les constatons.
Dans un registre connexe de notre rapport au monde, la familiarisation permet l’accès à d’autres formes de connaissances pratiques non verbalisées que Mickaël Polanyi29 a appelé « savoirs tacites » (tacite knowing30). Ces derniers ne doivent pas être confondus avec les savoirs « intentionnels », acquis du fait de l’attention que l’on porte à un objet de connaissance. Nous ne sommes conscients des processus qui sous-tendent ces savoirs éminemment pratiques qu’en mobilisant ces derniers pour une performance, telle nager ou faire du vélo. Ils sont difficilement mis en discours et formalisables parce que, intégrés au déroulement même de l’action, ils ont été directement incorporés via la pratique. Comme pour les savoirs techniques, leur acquisition se déroule au long de la vie et l’expertise augmente au fil de la pratique. À ces savoirs tacites se superposent des modes spécifiques de réalisation. Mauss31 avait noté que la démarche des femmes, ou le « tour de main » dans le maniement des outils, permet d’inférer la nationalité des personnes observées (une exis sociale relevant des processus indexicaux tels que Peirce les a définis). Bourdieu32 a repris le concept d’habitus suggéré par Mauss pour désigner ce qui, dans nos actions, présente des dimensions culturelles acquises sans pour autant répondre à des règles ou à des demandes formulées : « un système de dispositions à la pratique, […] fondement objectif de pratiques régulières, donc de la régularité des pratiques […] » écrit-il33.
Lev Vygotski34 a bien noté que « la forme primaire de l’activité intellectuelle est la pensée active, pratique, dirigée vers la réalité et représentant l’une des formes fondamentales de l’adaptation aux conditions nouvelles, aux conditions changeantes du milieu extérieur. » La situation d’enquête et le décentrement qu’elle implique, avec les attentes, les théories plus ou moins implicites relatives au monde et à l’action, changent donc le type des savoir-faire auxquels il convient de s’exercer, mais aussi les conditions et le rythme de la familiarisation. Bourdieu est sceptique sur le niveau de familiarisation que permet l’observation participante : « [… On] a raison de mettre en doute la possibilité de participer vraiment à des pratiques étrangères, inscrites dans la tradition d’une autre société, et supposant, à ce titre, un autre apprentissage, différent de celui dont l’observateur et ses dispositions sont le produit, donc une tout autre manière d’être et de vivre les expériences auxquelles il entend participer » écrit-il35. La structure de l’action, fondamentalement sociale et culturelle, est difficilement transmissible hors d’un monde donné. Ingold défend un point de vue tout différent. Il insiste, après Merleau-Ponty et Schutz, sur le type d’attention qu’il est nécessaire de développer pour construire une connaissance sur les phénomènes du monde : une « intension de l’aperception ». Concernant les savoir-faire(skills), Ingold précise donc :
Il ne s’agit pas d’un savoir qui m’a été communiqué, mais d’un savoir que je me suis construit en suivant les mêmes chemins que mes prédécesseurs et sous leur direction. En bref, la croissance des connaissances dans l’histoire de vie d’une personne est le résultat non pas d’une transmission d’informations mais d’une redécouverte guidée36 [une éducation de l’attention].
Ces formes d’acquisition, indique-t-il, reposent sur des processus où l’imitation et la répétition sont centrales alors que les déterminismes culturels et sociaux y paraissent marginaux. Dans cette perspective, très radicale, un terrain ne vise pas tant la compréhension des phénomènes que, en premier lieu, le développement de connaissances acquises au moyen d’une expérience, toute personnelle, et dont la portée est pratique : ces connaissances permettent la réalisation de tâches, et faire une analyse anthropologique est l’une d’elles. Il s’agit alors de comprendre ce qui se passe et ce qui est attendu des participants d’une action commune, idéalement selon leurs propres méthodes et dans leurs propres termes.
Une troisième voie, que fonde solidement la tradition empirique de l’anthropologie, est celle de la possibilité de socialisations secondaires, si tant est que le chercheur et ses hôtes s’engagent dans une expérience concertée et partagée. La familiarisation qu’établit l’expérience permet alors d’acquérir une infinité de connaissances généralement implicites, mais aussi de comprendre les relations entre les faits de certains ordres et les règles qui éventuellement y président. De telles connaissances ne sont verbalisées qu’en de rares occasions, lors de questions sur le vif, de discours accompagnant certaines séquences de l’action, de rappels aux normes en cas de manquement, d’imputations de malheurs, etc.
Dans cette perspective, la familiarisation forme le ressort des apprentissages que favorise l’engagement du chercheur sur le terrain. La familiarité qui en résulte consiste à se repérer, en toutes circonstances, dans le temps, dans l’espace, dans les règles d’un univers singulier. Elle permet de comprendre l’agencement, les codes et les valeurs de ce dernier, de nourrir des intuitions et de formuler des hypothèses à vérifier. Cela suppose de comprendre les contextes de l’action et des discours, d’en saisir les enjeux, de maitriser certaines techniques, si possible, d’incorporer leurs dynamiques.
Tel est le cas des règles relatives aux échanges sociaux et l’importance des rites d’interaction37 auxquels nous devons nous adapter et nous plier selon les circonstances : salutations, formes d’adresse, tours de paroles… Plus important encore, Goffman38 a bien dégagé et souligné – après Bateson (1978) – l’importance des cadres sociaux et culturels implicites qui déterminent et structurent l’action, permettant la mise en place des processus d’inférence appropriés.
Dans un souci comparable pour la question des contextes et les phénomènes d’indexicalité qu’ils génèrent en fonction de considérations culturelles et sociales, Silverstein, enfin, a souligné (1979, entre autres) l’importance des idéologies linguistiques et de leur prise en considération dans toute analyse socio-anthropologique de la parole39.
Or, pour revenir sur la problématique du terrain ethnographique, Jean-Pierre Olivier de Sardan a clairement décrit l’importance extrême de la familiarisation pour ce qui relève de la méthode qualitative :
Le chercheur de terrain observe et interagit aussi sans y prêter autrement attention, sans avoir l’impression de travailler, et donc sans prendre de notes, ni pendant, ni après. […] Il mange, bavarde, papote, plaisante, drague, joue, regarde, écoute, aime, déteste. En vivant, il observe, malgré lui en quelque sorte, et ces observations-là sont “enregistrées” dans son inconscient, son subconscient, sa subjectivité, son “je”, ou ce que vous voudrez. Elles ne se transforment pas en corpus et ne s’inscrivent pas sur le carnet de terrain. Elles n’en jouent pas moins un rôle, indirect mais important, dans cette “familiarisation” de l’anthropologue avec la culture locale, dans sa capacité à décoder, sans à la fin y prêter même attention, les faits et gestes des autres, dans la façon dont il va quasi machinalement interpréter telle ou telle situation. […] c’est ainsi que l’on apprend à maîtriser les codes de la bienséance (et cela interviendra très indirectement et inconsciemment, mais très efficacement, dans la façon de mener des entretiens) ; c’est ainsi que l’on apprend à savoir de quoi la vie quotidienne est faite et de quoi l’on parle spontanément au village (et cela interviendra très indirectement et inconsciemment, mais très efficacement, dans la façon d’interpréter les données relatives à l’enquête)40.
Ici comme ailleurs, mais ici particulièrement, l’expérience de l’ethnologue est donc essentielle, car, si toute expérience participe de notre connaissance du monde, seule une expérience intense et prolongée (avec ou sans participation immédiate) fonde (découvre, crée) la relation entre des réalités d’ordres et de niveaux différents pour souligner ce qui apparaît comme des continuités, des cohérences, parfois même du sens.
Acquérir des compétences sociales pour étudier les relations sociales
Dans un ouvrage qui fit grand bruit au moment de sa parution, Paul Rabinow décrit son engagement sur le terrain comme une forme d’aliénation41 : il y développa, face aux attentes de ses hôtes, ce qu’il a appelé une persona, une construction artificielle dont il sentit la contrainte sur ses aspirations profondes, sa volonté, sa sensibilité. Ainsi Jeanne Favret42 explique-t-elle l’importance des journaux de terrain où les ethnologues « pouvaient enfin se laisser aller, se retrouver eux-mêmes en dehors des heures de travail, pendant lesquelles ils s’étaient contraints à faire figure devant les indigènes ». Cependant, poser le problème de la position du chercheur sur le terrain en ces termes ne permet pas de le résoudre et, de fait, Rabinow quitta le terrain choisi. L’enquête sur le terrain, en effet, ne nécessite pas de dédoublement de l’enquêteur via la construction d’une position d’extériorité et de surplomb, mais un engagement total venant nourrir les apprentissages et l’analyse qui en est faite au fil de l’action. Car, nul besoin d’une expérience ethnographique pour faire l’expérience des adaptations, voire des concessions nécessaires à l’intégration d’un milieu social, d’un contexte, d’une situation donnée. Il s’agit donc moins d’un dédoublement de la personne entre un « soi » profond et une « personne sociale » illusoire, que de la conscience – plus ou moins vive – de l’effort que nécessite, de part et d’autre, tout engagement dans des relations sociales, au plus proche comme au plus lointain. Olivier de Sardan (cf. supra) a montré l’intérêt méthodologique de cet engagement pour le chercheur et sa recherche. Encore faut-il qu’un intérêt soit éveillé de l’autre part et que l’enquête ne soit pas vécue comme intrusive ou dangereuse.
Toutefois, la participation étant inévitable du seul fait de la présence en situation sociale, le problème posé est celui de sa nature : dans quelle mesure participer, sous quelles conditions ? Il s’agit donc de définir les conditions, le niveau d’engagement du chercheur, son degré d’implication, avec le type des relations ainsi créées dans le cadre de la recherche. Cela revient à la question de savoir si, en anthropologie, l’on travaille sur un objet ou avec des personnes. Dans le second cas, l’immersion est réelle. L’engagement ne peut alors être que total et la relation créée, celle d’un partage fondé sur la confiance43. Cela demande du temps et de lourds investissements, de part et d’autre, car un processus de familiarisation, dans ce contexte, ne peut être que « guidé », accompagné et/ou dirigé, c’est-à-dire plus ou moins activement pris en charge, sur le terrain, par des membres de la communauté accueillante. Le chercheur doit négocier et toujours réajuster les conditions de son travail, la place qui lui est conférée et ce qui est attendu de lui en échange de sa présence. À chaque terrain ses modalités, ses conditions, ses moments de doute, de souffrance(s) et son « inconfort »44. Toute socialisation est coûteuse. Elle peut nécessiter des apprentissages plus ou moins longs et complexes allant jusqu’à ce qui devient une socialisation secondaire. Ces apprentissages sont de différents types. Ils sont au cœur de toute existence humaine et, en tant que méthode scientifique, au cœur du travail anthropologique.
Cela passe, classiquement, par de véritables processus de socialisation secondaire, voire d’une éducation (ou d’une initiation) visant l’intégration de l’ethnologue au sein des relations sociales locales. Dans ces cas, l’éducation via des apprentissages formels n’est pas exclue et comprend la transmission réglée de savoirs précis sous forme de normes de conduite et de corpus à apprendre. Le plus généralement, ils reposent cependant sur le principe de l’imitation45 et des « apprentissages situés » suivant le principe de la « participation périphérique légitime »46. L’expression désigne l’intégration progressive des apprenants au sein d’une communauté de pratique : c’est une fois les taches les plus simples et les plus périphériques maitrisées que l’accès à des tâches plus complexes et plus centrales est permis. De tels apprentissages fondent, avec l’inscription dans un réseau relationnel où la personne trouve une position, des savoirs situés et forment les conditions mêmes d’une observation participante initiant aux pratiques techniques et, plus généralement, à tout savoir social. Ce faisant, ils transmettent les structures de l’action47, étoffent les savoirs tacites48 et initient à la compréhension par l’expérience de tout ce qui n’est pas dit, de ce qui ne se dit pas. Ils intègrent progressivement la personne au cœur du monde social en lui conférant conjointement des savoir-faire, des connaissances, des responsabilités et un statut c’est-à-dire, pour le chercheur, une position d’où il pourra agir, interagir et apprendre ce qui est accessible dans cette limite, amenée à évoluer49. S’ouvre ainsi l’univers des relations sociales et des valeurs qui le fondent. En y trouvant place, en agissant conformément à cette place de façon répétée mais toujours contextualisée, on apprend par exposition et par la pratique plus ou moins guidée, par l’incorporation et l’appropriation des logiques et des normes de l’action, avec l’évaluation de ses résultats en contexte. La participation, le partage et l’échange d’expérience font que l’on apprend chemin faisant et une expertise se construit, pas tout à fait interne, plus tout à fait externe. C’est cette dernière qui permet une comparaison « maîtrisée » entre « ici » et « là-bas », la compréhension d’un monde de relations dans les termes de l’autre. Ce protocole est essentiel pour comprendre tout phénomène social, les rituels en particulier, dans leur structure, dans le système qu’ils forment ensemble50 et dans leur relation à la totalité partielle que constitue un groupe social ou une société.
Je rappellerai, avant de continuer sur la question des rites, que toute socialisation plus ou moins poussée implique un engagement total du chercheur, du tact51, du respect, et sa loyauté envers ses hôtes. Elle nécessite en contrepoint, une mise en perspective critique, de la « réflexivité » sur la situation d’enquête : ce qui l’a contrainte, ce qui l’organise et ce qui en résulte. « L’observation devient beaucoup plus “participante” dès le moment où l’anthropologue opère un retour sur ce qu’il a perçu et fait remonter à la surface les éléments enfouis qui témoignent de la dimension participative de son observation », explique Yves Winkin52. L’engagement personnel et subjectif est donc inévitable, comme dans toute interaction sociale. Cependant, rendues explicites, les dimensions personnelles et expérientielles, avec la perspective particulière qu’elles induisent, peuvent être maitrisées, ou du moins intégrées à l’analyse et rendues sensibles au lecteur.
On voit, en suivant le fil de ces développements que la question de l’expérience et celle de l’observation participante ne se superposent pas exactement. En effet, si l’expérience que l’on retire d’un terrain repose en grande partie sur une participation active, elle ne s’y cantonne pas : mobilisations corporelles, sensorielles, émotionnelles peuvent, après tout, être intenses et augmenter l’acuité de notre perception et de notre compréhension d’un phénomène sans que nous y participions de façon active – ou sans implication directe. On peut évidemment construire une connaissance détaillée de faits auxquels on ne prend pas nécessairement part.
Les rituels offrent toutefois un objet particulier pour les SHS en ce que, phénomènes complexes par excellence, ils ne se laissent saisir sous aucune description synthétique, ils ne se laissent décrire par aucune narration linéaire, ils ne se laissent réduire sous aucune des innombrables théories qui tentent de les classer et les expliquer. Tel est le cas de l’« art », très certainement, mais la question du rituel touche à la définition même de ce qui constitue un monde – ou une communauté – et les définitions comme les caractéristiques varient selon le monde – ou la communauté – que l’on est amené à considérer. Les rituels, y compris ceux enclavés dans nos pratiques les plus quotidiennes, restent des réalités globalement opaques que les approches en termes de rationalité, de symbolisme ou communication n’éclairent pas, et contribuent parfois à obscurcir53.
Accéder à l’idéologie sémiotique pour étudier le rituel
Webb Keane a proposé d’appeler « idéologie sémiotique » les « présuppositions sous-jacentes qu’ont les gens à propos de ce que sont les signes, les fonctions qu’ils remplissent ou ne remplissent pas, et les conséquences qu’ils peuvent engendrer ou non »54. Accéder à l’idéologie sémiotique d’un groupe social suppose de saisir, d’identifier et d’expliciter des principes généralement sous-jacents et très souvent inconscients qui, en fonction du contexte, associent signe, objet et signification. Bateson55 a bien identifié ce problème lorsqu’il a discuté la controverse entre catholiques et protestants concernant l’Eucharistie : ce qui est pour les uns un sacrement, un acte efficace réitérant le sacrifice de Jésus au profit de la communauté des fidèles est, tout au plus pour les autres, un dispositif métaphorique de commémoration. Webb Keane (2007) montre bien que, dans les deux cas, la définition de l’action menée et la signification qu’il convient d’y déceler ne peuvent être déterminées qu’au regard de la théologie considérée (catholique ou protestante) et de sa théorie des signes particulière. Ainsi, sommes-nous héritiers, au-delà de nos us et coutumes, de théories relatives au fonctionnement des signes plus ou moins partagées, imbriquées, conscientes, que cette économie sémiotique couvre le champ de l’ordinaire (superstitions, diagnostiques divers reposant sur des processus d’induction et d’abductions courants…) ou de pratiques plus savantes : religieuses, philosophiques, artistiques, scientifiques, parmi lesquelles les sciences humaines et sociales.
Le travail que j’ai eu la chance de pouvoir réaliser à Wallis puis dans la communauté wallisienne expatriée m’a permis de comprendre – très progressivement – certains principes réglant les pratiques rituelles de cette société insulaire et, plus généralement, de la plupart des pratiques : les principes fondant les rites wallisiens ne peuvent être compris que dans la mesure où l’on se trouve mobilisé dans ces derniers à un degré ou à un autre. Ils doivent être vécus et il faut en ressentir personnellement les effets : le niveau d’engagement, les attentes, les résultats à court, moyen et long terme. Il faut noter que ces pratiques s’inscrivent dans le cadre général que l’évangélisation et le catholicisme romain ont imposé à la société locale au milieu du XIXe siècle : cycle liturgique, sacrements et pratiques dévotionnelles intenses. Elles s’articulent toutefois à des pratiques plus proprement locales pour ce qui concerne les nombreux rites de passage : naissance, baptême, communion(s), puberté, mariage, investitures, funérailles. Les cérémonies plus ou moins complexes incluant une retraite religieuse, une messe, une distribution de kava et de vivres, un repas et des danses s’étendaient autrefois sur plusieurs jours. Au fil des ans, il m’est ainsi apparu que l’étude des pratiques rituelles et des incessantes circulations cérémonielles devait être replacée dans le cadre général d’une étude des relations au monde socio-cosmique et de ce qui, à ce niveau, fonde toute action et toute parole efficace. Seule l’étude au long cours via une enquête sans cesse nourrie par la pratique (en position de fille, puis de mère et de tante, enfin de grand-mère) avec les négociations et les discussions que cela a généré, m’a permis de saisir les significations que prennent actions et paroles. Tel est le cas dans le contexte relationnel très précis des situations particulières, mais aussi, dans le contexte plus large de l’organisation du monde local et des logiques, ou des principes, qui l’organisent du point de vue des personnes engagées dans ces transactions.
En l’occurrence, considérer que toute action efficace suppose un investissement des ancêtres et de Dieu aux côtés de la personne qui la réalise implique de s’écarter de nos idées communes sur ce qui rend une action efficace. De même, il me fallut comprendre que mes actions impliquent l’ensemble du réseau relationnel où je me trouve engagée. À ce titre, mon autonomie personnelle s’est trouvée réduite : j’ai des comptes à rendre aux anciens du réseau où l’on m’a fait place et je ne peux m’affranchir de leur tutelle sans leur causer de tort. J’ai des responsabilités et des devoirs, par ailleurs, envers mes pairs et les jeunes membres de cet ensemble. Un réseau d’interdépendance particulier m’a ainsi été donné à découvrir, où des actes nous paraissant bénins sont graves et où rien n’aboutit à une issue favorable sans avoir au préalable reçu le soutien de Dieu et des ancêtres. Autrement dit, la distinction entre action rituelle (socialement efficace) et non rituelle (non importante car simplement mécanique ou réalisée par une personne jugée comme socialement immature) est contextuelle, soumise au statut des personnes – et des autres entités – en présence et aux enjeux de l’interaction. L’évaluation de la performance, son caractère exceptionnel ou impressionnant sont, en retour, essentiels pour confirmer le niveau du soutien que reçoit un acteur social et donc, sa position et son statut.
La conviction qu’est venue nourrir mon expérience de terrain, est donc que tout ce qui nous apparaît comme étant un « rituel » – et ceci bien que les définitions s’accordent peu à ce sujet – ne peut être compris qu’au sein d’un univers de pratiques et de représentations qu’il faut étudier dans son économie interne si on souhaite le comprendre : un rituel peut être analysé de façon située, mais ne peut être compris seul. Il ne peut être compris que dans la totalité des pratiques sociales qui le rendent nécessaire et lui donnent sens56. L’analyse doit donc, certes, porter sur la forme et le contexte immédiat de la performance, sur le cadre élargi des représentations et des valeurs, mais aussi et surtout, des relations qu’il établit, relance ou modifie selon les théories de l’action et les principes sémiotiques qui sont propres au groupe considéré. Cela rend les choses infiniment complexes à saisir et à documenter.
Conclusion
Si le terrain ethnographique contribue à l’élaboration de savoirs académiques, il favorise en premier lieu, sur la base d’une méthodologie empiriste et immersive, une expérience – certes située et partielle – mais prolongée et profonde des phénomènes auxquels l’enquêteur se trouve exposé du fait de la position qu’il trouve parmi les personnes qui l’accueillent, au sein de leur(s) réseau(x) relationnel(s). Il développe ainsi conjointement des compétences et des savoir-faire pratiques de différents ordres, des perceptions et les savoirs situés que cela implique, mais aussi une compréhension progressive des idées, individuelles et collectives, conscientes et inconscientes, que les acteurs nourrissent au sujet de ce qu’ils font et de ce qu’ils ressentent, de ce qu’ils comprennent du monde et de son ordre. Ce faisant le chercheur accède progressivement à une connaissance de l’organisation du social, des institutions et des relations entre les différentes entités qui le constituent. Cette méthode nourrit une connaissance approfondie des règles et de leurs variations, des enjeux et des attentes avec les réponses que l’on y apporte selon les contextes, c’est-à-dire le développement au long cours d’une perception holiste des situations concrètes et de ce qui en résulte. Seule, elle permet, d’aborder les phénomènes rituels tels qu’ils sont localement perçus et vécus dans toute leur complexité, et de saisir tant leurs principes, leurs dynamiques, que les relations en jeu. Arrivé à ce point de la recherche on ne peut que constater le caractère central de l’étude des pratiques – tant ordinaires, techniques, rituelles – pour saisir, au-delà des phénomènes qui les caractérisent, les principes organisant tout autant le fait humain dans sa généralité (le fonctionnement du langage et des signes, par exemple) que, pour chacun des mondes humains et de ses membres, l’agencement relationnel et l’idéologie sémiotique qui fondent leur particularité.
Notes
- Prigent Steven, L’anthropologie comme conversation, Anacharsis, 2021.
- Olivier de Sardan Jean-Pierre, « La politique du terrain », Enquête, 1, 1995. URL : http://journals.openedition.org/enquete/263.
- L’auteur ajoute (note 6, p. 3) : on pourrait considérer que l’enquête de terrain relève de « l’analyse naturelle » (Schatzman, cité par A. Strauss, op. cit., p. 3), dans un sens analogue à celui où l’on parle de « langage naturel », ou encore à la façon dont on a pu dire que les sciences sociales opéraient dans le registre du « raisonnement naturel » (J.‑C. Passeron, op. cit., 1991). La différence avec les analyses pragmatiques de tout un chacun placé dans des conditions analogues n’est pas de nature, mais d’expérience, de savoir-faire, de réflexivité et de vigilance.
- Dewey John, Logique : la théorie de l’enquête, Paris, PUF, 2006 [1938]. Voir entre autres, la lecture qu’en fait Ingold (2018) pour élaborer ses propositions sur la transformation (l’apprentissage et la maturation) par l’expérience.
- Voir https://www.cnrtl.fr/definition/induction : « Type de raisonnement consistant à remonter, par une suite d’opérations cognitives, de données particulières (faits, expériences, énoncés) à des propositions plus générales, de cas particuliers à la loi qui les régit, des effets à la cause, des conséquences au principe, de l’expérience à la théorie. » Les processus inductifs, considérés comme essentiels dans l’analyse anthropologique, ne le sont pas moins dans notre rapport commun au monde et donc dans les inférences que suscite, à un autre niveau du travail anthropologique, toute description ethnographique chez les personnes qui en prennent connaissance.
- Keane Webb “Sur l’idéologie sémiotique”, Cygne noir, 12, 2024, p. 77-106. URL : https://www.erudit.org/fr/revues/cygnenoir/2024-n12-cygnenoir09466/1112622ar/.
- Voir par exemple Monnerie Denis, « Symboles et figures, deux modes sociaux de signification. L’exemple de la Grande Maison d’Arama (Nouvelle-Calédonie) », Journal de la Société des Océanistes, 130 (1), 2010, p. 191-208.
- Bourdieu Pierre, « L’objectivation participante », Actes de la recherche en sciences sociales, 150(5), 2003, p. 43-58.
- Favret Jeanne, « Être affecté », Gradhiva : Revue d’Histoire et d’Archives de l’Anthropologie, 8 (1), 1990, p. 3-9.
- Wacquant Loïc, « Corps et âme », Actes de la recherche en sciences sociales, 80(1), 1989, p. 33-67.
- Mauss Marcel, « Les techniques du corps », Sociologie et anthropologie, Paris, Puf, 1950.
- Csordas Thomas, « Somatic modes of attention », Cultural anthropology, 8 (2), 1993, p. 135-156.
- « embodiment and being in the world alongside textuality and representation », ibid. p. 137. [Traduction personnelle].
- « Somatic modes of attention are culturally elaborated ways of attending to and with one’s body in the surroundings that include the embodied presence of others », ibidem, p. 138).
- Berthoz Alain, Le sens du mouvement, Odile Jacob, Paris, 2013.
- Warnier Jean-Pierre, Construire la culture matérielle. L’homme qui pensait avec ses doigts, Paris, PUF, coll. « Sciences sociales et société », 1999.
- Bazin Jean, « Questions de sens », Enquête. Archives de la revue Enquête, 6, 1998, p. 13-34.
- Prigent Steven, L’anthropologie comme conversation, op. cit.
- La question de la familiarité est posée par Husserl au regard de ce qu’il considère comme des « degrés d’objectivation ». Schutz propose le concept de « degré de familiarité » pour rendre compte de la gradation entre connaissance préconsciente et connaissance consciente. Voir sur ces questions le travail de Laurent Thévenot (1998) dont la discussion sur les « pragmatiques de la connaissance » apporte un complément théorique important au présent propos.
- Voir Favret Jeanne, « Être affecté », art. cit. et Houseman Mickael, Le rouge est le noir. Essais sur le rituel,Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2012.
- Mauss Marcel, « L’expression obligatoire des sentiments », Essais de sociologie, Paris, Éditions de Minuit, 1968-1969.
- Geertz Clifford, « La description dense. Vers une théorie interprétative de la culture », Enquête. Archives de la revue Enquête, 6, 1998, p. 15.
- Selon la définition de Vincent Descombes qui discute la proposition de Geertz : « la description doit être ‘épaisse’, c’est-à-dire identifier le type de conduite du point de vue du sens qu’il possède dans le contexte où cette conduite intervient. » Cela revient, pour Bazin, à « une description impure parce que fortement chargée en interprétation, […] une pseudo description ». Les deux auteurs établissent la distance du concept de « description épaisse » entre les propositions de Geertz et celles de Ryle, qui a forgé le concept. In : Descombes Vincent, « La confusion des langues », Enquête. Archives de la revue Enquête, 6, 1998, p. 35-36.
- Olivier de Sardan Jean-Pierre, « La rigueur du qualitatif. L’anthropologie comme science empirique », Espace-Temps, 84 (1), 2004, p. 44. Voir aussi Olivier de Sardan Jean-Pierre, « La politique du terrain », Enquête, 1, 1995, p. 13. URL : http://journals.openedition.org/enquete/263 « Certaines de ces données sont recueillies pour une part préalablement à l’enquête de terrain (cf. littérature savante sur l’aire considérée – anthropologie, histoire, etc. – et littérature « grise » – rapports, évaluations, maîtrises, etc.) et permettent alors une « familiarisation » ou, mieux, l’élaboration d’hypothèses exploratoires et de questionnements particuliers ».
- Olivier de Sardan Jean-Pierre, « La politique du terrain », art. cit.
- Hutchins Edwin, Cognition in the Wild. Cambridge, MA, MIT Press, 1995.
- Goodwin Charles, Co-operative action, Cambridge, University Press, 2018.
- Peirce CP 2.329, in : Hilpinen Risto, « Peirce on language and reference ». Peirce and Contemporary Thought: Philosophical Inquiries, 1995, p. 272-303. URL : https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=noKZ4unz9M4C&oi=fnd&pg=PA272&dq=peirce+acquaintance&ots=XH8-AjfV98&sig=6kM0P2gjTQJGkhy5TpoeVB61kHA#v=onepage&q=acquaintance&f=false.
- Polanyi Michael, « Tacit knowing », Philosophy Today, 6 (4), 1962, p. 239-262.
- Selon Bateson, la distinction que fait la langue française entre connaissance (notion/connaître/percevoir) et savoir (concept/savoir/classer), pourtant peu nette dans les usages communs comme savants, est utile au regard de la pauvreté lexicale de l’anglais. Bateson Gregory, Vers une écologie de l’esprit, Tome 1, Paris, Le Seuil, « Essais », 1978. Toutefois, la distinction qu’a proposé Ryle (1949) entre knowing-how (savoir procédural) et knowing-that (savoir descriptif ou déclaratif) est très directement utile. Ryle Gilbert, La Notion d’esprit, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2005 [1949].
- Mauss Marcel, « Les techniques du corps », art. cit.
- Voir Bourdieu Pierre, Esquisse d’une théorie de la pratique, Précédé de trois études d’ethnologie kabyle, Paris, Les Éditions de Minuit, 1972 ; Bourdieu Pierre, « Le sens pratique », Actes de la recherche en sciences sociales, 2(1), 1976, p. 43-86.
- Bourdieu Pierre, « Habitus, code et codification », Actes de la recherche en sciences sociales, 64 (1), 1986, (p. 40-44) p. 40.
- 1997, p. 84.
- Bourdieu Pierre, « L’objectivation participante », Actes de la recherche en sciences sociales, 150 (5), 2003, p. 43.
- Ingold Tim, “From the transmission of representations to the education of attention”, in : The debated mind. Routledge, 2020, p. 16. URL : https://webzone.ee/bateson/Ingold/From%20the%20Transmission%20of%20Representations%20to%20the%20Education%20of%20Attention.doc.
- Goffman Erwin, Les rites d’interaction, Paris, Édition de minuit, 1974 ; Mauss Marcel, « Sur la salutation par les rires et les larmes », in : Mauss Marcel, Œuvres, tome 3, Cohésion sociale et division de la sociologie, Paris, Éditions de minuit, 1969 a, p. 278-279 ; Mauss Marcel, « Allocution à la société de psychologie (1923) », in : Mauss Marcel, Œuvres, tome 3, « Cohésion sociale et division de la sociologie », Paris, Éditions de minuit, 1969 b, p. 280-282.
- Goffman Erwin, Les cadres de l’expérience, Paris, Éditions de minuit, 1991.
- Silverstein Michael, “Language Structure and Linguistic Ideology”, in : R. Clyne Paul, F. Hanks William, F. Hofbauer Carol (éd.), The Elements: A Parasession on Linguistic Units and Levels, Chicago Linguistic Society, 1979, p. 193-247.
- Olivier de Sardan Jean-Pierre, « La politique du terrain », art. cit., p. 6-7.
- Rabinow Paul, Un ethnologue au Maroc, Paris, Hachette, 1988.
- Favret Jeanne, « Être affecté », art. cit., p. 5.
- S’appuyant sur Harney et Moten, Ingold (2018, p. 52) propose l’idée d’undercomons (une « mise en commun ») à établir dans tout processus d’apprentissage : cet « espace social [qui] est toujours là » « est l’antithèse absolue de l’understanding, la « compréhension », souvent considérée comme une condition préalable à la civilité et le but ultime de l’éducation. » Celle-ci « établit un socle de connaissances certaine, […] un substrat sur lequel reposer. « Cette mise en commun, poursuit-il, implique plutôt une tension attentive par laquelle tous les participants projettent leur expérience d’une façon qui puisse correspondre à l’expérience des autres […] ». Pour souligner l’importance de ces phénomènes, Ingold laisse de côté les formes sociales et culturelles de régulation auxquels ils peuvent obéir. Du fait de son inexpérience culturelle et sociale ou de son souhait de distanciation face aux règles sociales, ces phénomènes sont souvent essentiels dans la relation d’un ethnologue avec ses interlocuteurs.
- La Soudière Martin de, « L’inconfort du terrain : “Faire” la Creuse, le Maroc, la Lozère… (À propos des ouvrages Éthnologue au Maroc, réflexion sur une enquête de terrain de Paul Rabinow, et Vivre dans la Creuse de Jacques Maho) », Terrain, 11, 1988, p. 94-105.
- Ingold 2018 ; Ingold Tim, “From the transmission of representations to the education of attention”, art. cit. ; Mauss Marcel, « Les techniques du corps », art. cit.
- Lave Jean, Wenger Étienne, Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge, University of Cambridge Press, 1991; Lave Jean, Wenger Étienne, “Legitimate peripheral participation in communities of practice”, in : Harrison Roger, Reeve Fiona, Hanson Ann, Clarke Julia (éd.), Supporting lifelong learning. New York, Routledge, 2001, p. 121-136.
- Chave-Dartoen Sophie, « Vers une colonisation des esprits ? Les enjeux sociaux, cognitifs et politiques de la politique des langues à Wallis », Ethnographiques.org, « Apprentissages sous tensions. Ruptures, conflits, débats dans la globalisation des savoirs », 45 / automne, 2023. URL : https://www.ethnographiques.org/2023/Chave-Dartoen.
- Polanyi Michael, « Tacit knowing », Philosophy Today, 6 (4), 1962, p. 239-262.
- Rémy Catherine, « Accepter de se perdre. Les leçons ethnographiques de Jeanne Favret-Saada », SociologieS, Dossiers, 2014. URL : http://journals.openedition.org/sociologies/4776.
- Coppet Daniel de, Understanding Rituals, London, Routledge/European Association of Social Anthropologists, 1992, URL : http://vedicilluminations.com/downloads/Academic%20General/de_Coppet_Daniel_(editor)_-_Understanding_Rituals.pdf.
- Rémy Catherine, « Accepter de se perdre. Les leçons ethnographiques de Jeanne Favret-Saada », art. cit.
- Winkin Yves, « L’observation participante est-elle un leurre ? », Communication et organisation, 12 | 1997, p.4. URL : https://journals.openedition.org/communicationorganisation/1983#:~:text=L’observation%20participante%20n’est,est%20pas%20de%20tout%20repos.
- Lara Philippe de, Le rite et la raison. Wittgenstein anthropologue, Paris, Ellipses, coll. « Philo », 2005.
- Cf. supra, Keane Webb “Sur l’idéologie sémiotique”, Cygne noir, 12, 2024, p. 78. URL : https://www.erudit.org/fr/revues/cygnenoir/2024-n12-cygnenoir09466/1112622ar/.
- Bateson Gregory, Vers une écologie de l’esprit, Tome 1, Paris, Le Seuil, coll. « Essais », 1978, p. 66-67.
- Fortes Meyer, « Les prémisses religieuses et la technique logique des rites divinatoires », in : Huxley Julian (dir.), Le comportement rituel chez l’homme et chez l’animal, Paris, Gallimard, 1971, p. 249-268 ; Coppet Daniel de, Understanding Rituals, op. cit.