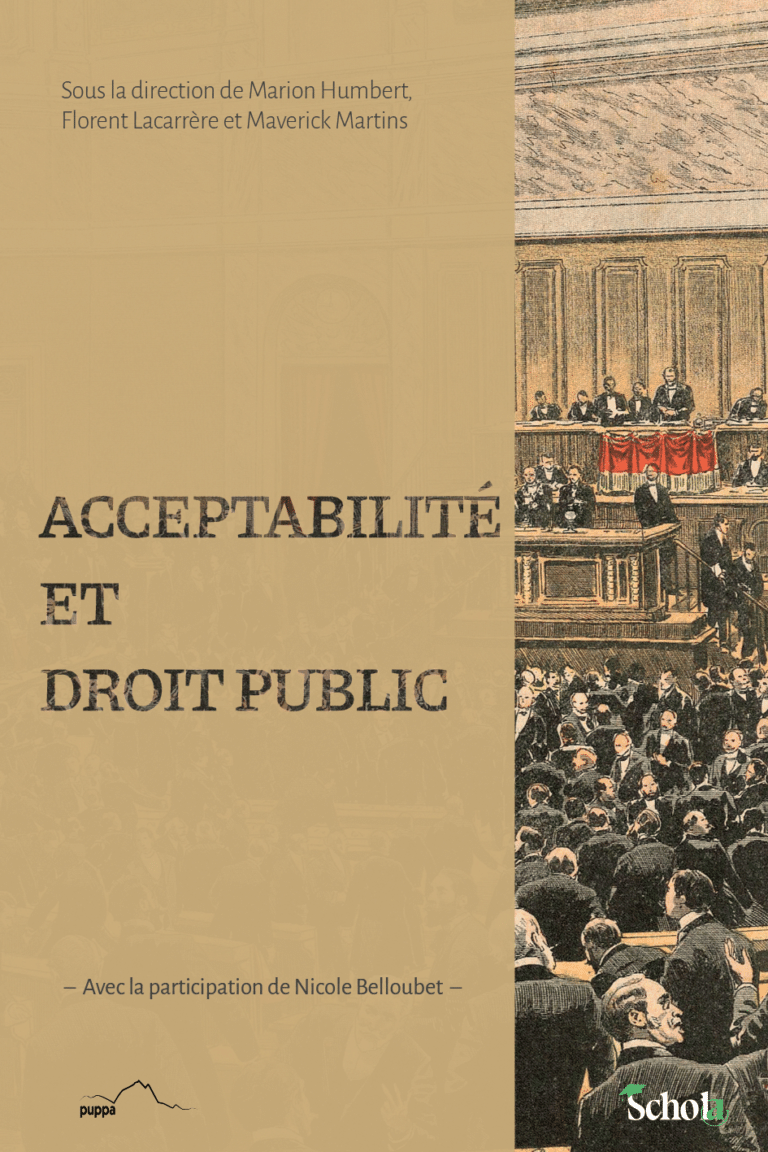« Si on sait ce que l’on fait, on le fait mieux :
c’est le passage d’une pratique
à une méthode »
BOURDIEU (P.), Sur l’État. Cours au Collège de France 1989-1992,
Raisons d’agir, Seuil, 2012, p. 162.
« L’acceptabilité sociale des décisions de justice comme des textes légaux est un facteur primordial de leur effectivité ». Ces quelques mots, empruntés à Jean-Emmanuel Ray1, témoignent d’emblée de l’intérêt et des enjeux de cette VIe journée paloise de la jeune recherche en droit public. VIe journée – déjà – qui rend compte de la pérennité de la formule et du dynamisme de nos jeunes chercheurs. VIe journée qui a fait surgir, j’y reviendrai, une foule de préoccupations autour du thème « L’acceptabilité et le droit public ». Grâce aux réflexions menées par nos contributeurs, des éclaircissements, mais aussi des questions ont émergé, signe de la richesse de la thématique retenue par les organisateurs de cette journée d’étude. Réjouissons-nous de tout cela.
Sur le plan de l’ontologie du droit2, pourtant, les chances n’étaient a priori pas tout à fait de leur côté. À l’instar de la légitimité, on concèdera en effet que l’acceptabilité, définie ici « comme intervalle d’accord entre celui qui propose et celui qui reçoit »3, ne fait de prime abord pas grand sens chez le juriste pour peu qu’il s’inscrive dans une analyse positiviste du droit. Le fondement du positivisme juridique, entendu dans son acception kelsenienne de science du droit pure4, repose sur l’idée selon laquelle la validité d’une norme juridique et, par là même, son caractère obligatoire se posent exclusivement en termes d’habilitation par une autre norme (supérieure) du système juridique étatique. Peu importe, dès lors, que la règle de droit dont on se voit imposer le respect soit frappée du sceau de l’acceptabilité. Pour qu’une norme soit considérée comme telle il faut qu’une autre norme lui donne cette qualité, ni plus ni moins. Dit autrement, « la norme posée ne peut recevoir la signification objective de norme juridique que si son auteur a lui-même été habilité par une autre norme supérieure. De manière générale, Kelsen soutient que “la validité d’une norme ne peut avoir d’autre fondement que la validité d’une autre norme” »5. Il ne s’agit donc pas d’élucider un phénomène social tel que peut le suggérer l’idée d’acceptabilité6, mais de trouver une logique interne au monde des normes construite, non pas dans l’ordre de la causalité et de l’être (si A est, B est ou sera), mais de l’imputation, du devoir être (si A est, B doit être). D’un point de vue juridique, une norme peut, en conséquence, être parfaitement valable sans pour autant recueillir l’assentiment de ses destinataires. Elle n’en demeure pas moins une norme. Autrement dit, l’acceptabilité ne constitue pas a priori un critère de validité et, par conséquent, de définition de la norme juridique. Pourra exclusivement être qualifiée de juridique la « norme dont il est possible de fonder le caractère obligatoire dans une norme édictée elle-même par un organe de l’État »7.
Cela dit, on ne sache pas pour autant que le caractère obligatoire de la norme juridique exclut nécessairement son acceptabilité. Certes, l’État, parce qu’il est détenteur en propre de la souveraineté, c’est-à-dire du monopole de la violence physique légitime8, dispose de la faculté de contraindre au moyen de règles de droit exprimant un devoir-être impératif. Du reste, et nous rejoignons sur ce point Michel Troper, « les règles du droit positif, quel que soit leur contenu, sont justes et doivent être obéies […] non parce qu’elles sont justes, mais parce qu’elles sont le droit »9. Elles doivent être respectées car elles sont édictées par l’État, ou par habilitation de celui-ci, conformément au système de production du droit qu’il a lui-même prévu10.
Mais rien de tout cela ne s’oppose à ce que le droit aménage, dans ses modalités d’élaboration notamment, une forme d’adhésion à ce qu’il prescrit. Denys de Béchillon le rappelle très justement.
Primo, car « impératif ne signifie par unilatéral. La notion d’impératif ne renvoie à aucun mode particulier d’élaboration du droit. Ou plutôt, elle les autorise tous ; du plus autoritaire au plus consensuel. Le Droit le plus impératif, le plus obligatoire qui soit peut parfaitement gésir dans une convention »11. Or, le contrat précisément, parce qu’il repose sur un échange de consentement libre et éclairé, suppose un degré élevé d’acceptabilité. Il n’en reste pas moins une norme contraignante12 dont le non-respect est constitutif d’une illégalité.
Secundo, et pour poursuivre avec Denys de Béchillon, « l’impératif ne procède en aucune manière de quelconque monologue susceptible de venir s’écraser sur les sujets de la norme. […] Le discours normatif le plus unilatéral et le plus vertical qui soit s’adresse néanmoins à l’autre, et non pas à soi-même. Il répond donc forcément à la configuration d’un dialogue, asymétrique et inégalitaire sans aucun doute, mais authentiquement “dialogique” quand même ». Par conséquent, « rien n’enlève à son “récepteur” la part irréductible de liberté au travers de laquelle il peut ou non, à ses risques et périls, se laisser saisir par la signification du message normatif qui lui est adressé »13. Par exemple, et pour rester sur le sujet qui nous occupe, parce qu’il en accepte ou non la teneur.
En somme, l’acceptabilité, si elle ne constitue pas a priori un élément de définition pertinent de la norme juridique, n’est pas nécessairement étrangère au mode d’élaboration du droit.
Mais ce n’est pas tout. Notre droit « postmoderne » – et ce constat renforce la pertinence de cette journée d’étude – semble de plus en plus enclin à s’affranchir de sa dimension autoritaire pour rechercher l’adhésion à la règle de droit de ses destinataires. Et le droit public n’échappe pas à ce mouvement. Droit de la puissance publique et de l’unilatéralité, le droit public – et singulièrement le droit administratif – s’embarrasserait assez peu, selon une croyance établie, de quelconques agréments à ce qu’il prescrit. Ses évolutions contemporaines bouleversent toutefois cette vision des choses. Nicole Belloubet l’a rappelé, l’acceptabilité de la règle de droit est devenue un enjeu majeur face à diverses manifestations de défiance à l’égard des décisions publiques. Maverick Martins a également insisté en ce sens : en proie à une crise dont on peine à trouver l’origine, nos systèmes de gouvernance démocratiques semblent devoir s’imprégner de cette logique d’acceptabilité. Elle constituerait un marqueur, un label de la qualité de la norme juridique14. Plus encore, mais c’est lié, elle en conditionnerait, parfois, leur effectivité, voire leur efficacité15. On suppose en effet que plus une norme jouit d’un niveau élevé d’acceptabilité, plus elle a de chances d’être effective et, inversement, plus son degré d’acceptabilité est faible, plus son effectivité risque d’être compromise.
Ce postulat trouve, au demeurant, à se vérifier d’un point de vue empirique. Le droit aux garanties juridictionnelles permet d’en rendre compte à deux égards au moins.
D’une part, du point de vue de la liberté d’accès à un tribunal. À cet endroit, la sociologie du droit enseigne que cette liberté, bien que consacrée parmi les normes de valeur supérieure, est loin d’être toujours effective dans la mesure où des désaccords se nouent au sujet de ses modalités d’exercice. On assiste ainsi à des situations de non-recours au juge – choisies ou subies – par « non-demande » en raison d’un désaccord sur les modalités d’accès (coût et technicité des procédures contentieuses) ou sur le contenu de l’offre proposée (lenteur de la procédure, charge émotionnelle et psychologique du procès, méfiance à l’égard de l’impartialité des tribunaux, circonstances jurisprudentielles défavorables, etc.)16. De toute évidence, la question de l’acceptabilité est ici centrale : certains justiciables renoncent à jouer le jeu juridictionnel car ses conditions d’exercice ne recueillent pas leur adhésion.
D’autre part, s’agissant de l’obligation d’exécuter les décisions de justice. Ces dernières, on le sait, sont revêtues de l’autorité de la chose jugée. Elles constituent elles-mêmes des règles de droit qui ont force obligatoire et doivent, à ce titre, être respectées. Dans la pratique, pourtant, le juge rencontre, parfois, les plus grandes peines à convaincre du bien-fondé de ces décisions. Par exemple, et pour reprendre le mot d’André de Laubadère à propos de la juridiction administrative, en raison de « l’incommunicabilité » de la décision et de sa motivation. Mais encore, car ses modalités d’exécution, telle que la modulation dans le temps de ses effets, évoquée par Nicolas Aujard, n’emporte pas la conviction. La qualité de la chose acceptée peut alors faire défaut et l’exécution de la décision de justice s’en trouver compromise17.
Nul besoin d’insister davantage. L’acceptabilité du droit est susceptible d’avoir une influence sur son effectivité et c’est précisément la raison pour laquelle ce processus compte au nombre des préoccupations contemporaines du droit public. Plus encore, l’acceptabilité semble depuis quelques années être « matériellement » saisie par le droit positif. On assiste en effet à une multiplication des dispositifs juridiques dont on suppose qu’ils sont de nature à encourager l’acceptabilité des décisions publiques.
Les concepts de responsabilité sociale des entreprises et de démocratie environnementale exposés par Clément Lacombe s’inscrivent dans cette perspective. Ils font d’ailleurs plus largement écho à l’ensemble des mécanismes de démocratie participative et délibérative destinés à associer le citoyen au processus d’élaboration de la décision publique (consultation et concertation publique préalable, référendum, etc.). On songera également aux procédés de soft law mis en lumière par Romain Routier et dont la finalité consiste à suggérer une ligne de conduite à suivre sans l’imposer. En tant que mode de direction non autoritaire des conduites, la soft law postule un mode de production du droit selon un processus élevé d’acceptabilité dans la mesure où la concrétisation de l’acte de droit souple est conditionnée par le consentement de son destinataire à s’y conformer. La matière contentieuse elle-même n’échappe pas à ce mouvement. Une illustration en est donnée par certains modes alternatifs de résolution des conflits, dont Franck Lamas nous a proposé l’analyse. L’acceptabilité est ici supposée garantie par le fait que les parties élaborent elles-mêmes et consentent librement aux termes de la décision qui met fin au différend qui les oppose. De même, l’oralité dans le procès administratif, Baptiste Pardeilhan l’a souligné, encouragerait l’acceptabilité de la justice administrative en ce qu’elle donne au justiciable le sentiment d’être acteur de la procédure juridictionnelle.
On le voit, l’ensemble de ces dispositifs ont en commun de rompre avec l’unilatéralité de la prise de décision publique. L’idée sous-jacente est qu’en associant les destinataires de la décision à son élaboration, celle-ci jouira d’une acceptabilité forte. L’adhésion à la norme juridique et, par là même, son effectivité et sa pérennité s’en trouveraient ainsi renforcées. S’assurer l’assentiment des destinataires de la règle de droit au moment de son élaboration peut toutefois ne pas suffire. Florent Lacarrère a insisté sur ce point, encore faut-il parvenir à maintenir l’acceptabilité dans la durée. Or, il s’agit là d’une entreprise complexe qui pose la question du nécessaire développement des outils d’évaluation ex post du droit.
Ajoutons encore à cela que l’acceptabilité semble se poser avec une acuité singulière lorsque les organes de production du droit se saisissent de questions politiquement « sensibles ». De façon symptomatique lorsque la souveraineté des États est en jeu, ainsi que l’ont mis en avant Marion Humbert, au sujet de l’harmonisation des règles européennes relatives à la politique d’immigration et d’asile, et Noémie Véron, s’agissant du contrôle juridictionnel des activités des services de renseignements.
Ce constat établi, reste à savoir dans quelles conditions les juristes sont susceptibles de développer un discours scientifique au sujet de l’acceptabilité en droit. La question mérite d’être posée dans la mesure où toute démarche scientifique « présuppose nécessairement d’avoir un minimum de connaissances sur ce qu’il s’agit d’observer et la manière dont il convient de le faire »18. Les résultats de la recherche, bien sûr, sont importants. Mais il faut également « décrire, parler de la démarche scientifique, ce qui est beaucoup plus difficile mais plus fécond »19. Faisant écho aux considérations ontologiques sur lesquelles j’ai ouvert ces propos conclusifs, c’est par quelques réflexions épistémologiques que je souhaiterais donc les refermer.
De deux choses l’une ici. Soit l’acceptabilité est saisie par le droit, auquel cas elle devient un objet qui relève du droit et le juriste est naturellement habilité à produire un discours à son sujet. En l’occurrence un discours consistant à fournir les explications et les évaluations juridiques de nature à justifier ou à critiquer celles produites par les organes de création ou d’application du droit sur cet objet. Par exemple, cette journée, je le disais, a permis de constater que notre droit positif tend à multiplier les dispositifs de nature à encourager – on le suppose du moins – l’acceptabilité des décisions publiques. À cet endroit, les compétences du juriste lui permettront, sans faire intervenir aucune autre norme qui serait étrangère au système juridique en cause, de développer un raisonnement descriptif et critique sur ces dispositifs afin d’en livrer une meilleure connaissance. Diverses questions pourront en ce sens être soulevées : Quels arguments juridiques justifient leur mise en place ? Quelle catégorie de norme juridique les consacre ? Selon quelle procédure ils trouvent à s’exercer ? Quelle forme prennent-ils ? Quel sens leur est donné par les organes d’interprétation du droit ? etc.
Les choses se compliquent, en revanche, lorsqu’il s’agit de porter le regard sur l’acceptabilité en tant que non-objet du droit mais non dépourvu de tout lien avec celui-ci. À titre d’exemple, interroger l’acceptabilité en tant que processus social d’adhésion au droit, éprouver la causalité supposée entre acceptabilité et effectivité du droit, mesurer l’acceptabilité de telle ou telle règle de droit ou, que sais-je encore, apprécier l’acceptabilité de son contenu. Ainsi entendue, l’acceptabilité relève des faits sociaux ou du système des valeurs. Son rapport au droit est sans aucun doute indéniable. Pour autant, il ne s’agit plus ici d’un objet du droit en tant que tel puisque l’acceptabilité, on le répète, ne constitue pas, a priori, un critère de validité et/ou de définition du droit.
Cela posé, les juristes ont-ils, ès qualités, une légitimité singulière à dire un certain nombre de choses sur l’acceptabilité en droit ainsi entendue ? Sur le plan du positivisme juridique, on y a suffisamment insisté, la réponse est clairement négative. La logique positiviste appréhende en effet le droit comme un système clos et autonome, dont la signification ne peut être révélée que selon sa dynamique interne. Tous les phénomènes qui débordent le cadre de celui-ci et qui requièrent des considérations d’ordres sociologiques, économiques, historiques, philosophiques sont refoulés comme non pertinents pour la science du droit20. Prenant toutefois le contre-pied ou, du moins, quelques distances avec cette approche monodisciplinaire du droit, une analyse juridique orientée vers l’interdisciplinarité nous semble envisageable et, à la vérité, souhaitable. Dans le sillage de Michel Van de Kerchove et François Ost21, notamment, nous soutenons l’idée que l’autonomie du droit par rapport aux phénomènes sociaux est réelle, mais relative22. Relative en ce qu’il existe une influence réciproque entre droit et société. Le premier, en même temps qu’il structure la seconde est en partie le produit de celle-ci. Par conséquent, « s’il est vrai que le juriste ne doit surtout pas confondre les explications juridiques et les explications sociologiques, il ne peut pas pour autant se couper des faits politiques et sociaux »23. Or, en admettant que le droit peut ne pas s’expliquer exclusivement par lui-même, le juriste admet dans le même temps que l’élaboration d’une théorie critique du droit exclue l’autarcie disciplinaire. Elle requiert au contraire une articulation des explications juridiques et des explications extra-juridiques fournies par les sciences sociales dans une perspective heuristique de meilleure connaissance du droit.
Dans ces conditions, et pour en revenir au sujet qui nous occupe, l’acceptabilité, quand bien même elle ne constitue pas un objet du droit, ne saurait être d’office exclue du cadre de réflexion du juriste. En première analyse son examen relève certes des autres sciences sociales. Mais dès lors qu’elle entretient des liens avec le droit, le juriste peut avoir intérêt à mobiliser les sciences avoisinantes du droit afin d’enrichir, par une forme de retour réflexif, la connaissance de son propre objet d’étude. Par exemple, et ainsi que je le soulignais précédemment, observer, grâce à la sociologie du procès, qu’il existe une distorsion entre la liberté d’accès au juge telle que juridiquement consacrée et son effectivité parce que l’acceptabilité des conditions d’exercice du droit au recours juridictionnel fait parfois défaut. Le recours à la sociologie est ici riche d’enseignements. Par une entreprise de dévoilement des ressorts cachés du droit au recours juridictionnel, elle conduit le juriste à relativiser, non sans douleur il est vrai, la toute-puissance du pouvoir normatif en tant que vecteur de protection des droits fondamentaux.
Mobiliser les sciences sociales donc. Cela ne doit et ne peut cependant se faire de n’importe quelle façon. De bons moyens de méthode s’imposent. Dès lors que la dynamique interne du droit n’est plus suffisante, comment, en tant que juriste, organiser mon savoir autour d’un phénomène social tel que l’acceptabilité en droit ?
Un premier écueil, à éviter il me semble, serait, sous couvert d’invoquer les sciences sociales – à mauvais escient –, de se laisser aller à ses propres convictions idéologiques afin de faire œuvre de prescriptions sur ce que devrait être ou ne pas être le droit en termes d’acceptabilité. Le droit étant empreint de valeurs, la tentation peut en effet se faire jour de céder à une forme de subjectivité axiologique. Or, en formulant des jugements de valeur au sujet de l’acceptabilité des énoncés juridiques et, incidemment, sur leur pertinence, le discours perdrait inexorablement en scientificité. Il faut donc se départir des convictions personnelles, ce qui ne signifie pas pour autant s’interdire de porter tout jugement critique sur l’acceptabilité des énoncés juridiques. Mais cela doit toujours se faire sur un plan objectif et empirique. Autrement dit, en suivant les enseignements des sciences sociales. Envisageons la proposition suivante : « la pertinence d’adopter telle règle de droit se pose car, bien que juridiquement valable, son acceptabilité est susceptible de faire défaut ». Cette proposition sera scientifiquement recevable si et seulement si sa véracité a été empiriquement vérifiée, c’est-à-dire que le déficit d’acceptabilité supposé repose sur des faits réels objectivement observables et établis. Si l’inacceptabilité supposée de la règle de droit n’a, en revanche, pour seul fondement qu’un jugement de valeur – par exemple ce qu’elle prescrit heurte mes convictions personnelles – alors la proposition n’a aucune valeur scientifique. Aussi est-il absolument impératif, et nous rejoignons sur ce point Bachelard24, de se départir – autant que faire se peut – des opinions25.
Reste que l’élaboration par le juriste d’un discours empirique sur le processus social d’acceptabilité en droit demeure empreinte de difficultés26. Au moins deux raisons à cela.
En premier lieu, le risque d’être mû par le tropisme de son champ juridique d’appartenance. De façon plus ou moins consciente, le juriste incorpore en effet une forme de dogmatique juridique au contact de son champ disciplinaire. Certaines vérités qu’il tient pour acquises sont autant de déterminismes susceptibles de parasiter une entreprise d’analyse interdisciplinaire du droit. Pour le dire autrement, la connivence du juriste avec son propre objet d’étude ne facilite pas la mise à distance, pourtant nécessaire, de celui-ci afin de parvenir à une approche objectivement critique. Il ne jouit pas du point de vue externe au droit des sciences sociales et, pour cette raison, est susceptible de porter un regard déformant sur les phénomènes sociaux en lien avec le droit27.
En second lieu, l’absence de savoir-faire pour mobiliser les méthodes d’analyses des sciences de type empirique. On s’accordera en effet sur le fait que le juriste est assez mal outillé pour élaborer des questionnaires, mener des enquêtes de terrains, analyser et interpréter les données factuelles recueillies. A fortiori en France où – c’est peu de le dire – l’autonomisation du droit s’est construite contre les sciences sociales, de sorte que ces dernières sont, pour ainsi dire, absentes du cursus universitaire des facultés de droit28. De fait, les juristes ne sont donc pas préparés à mobiliser les méthodes empiriques des sciences avoisinantes du droit.
Pour l’ensemble de ces raisons, on plaidera que si le juriste n’est pas illégitime à recourir aux sciences sociales, encore faut-il, lorsqu’il y recourt, qu’il admette les limites de cette démarche. Son ambition en la matière ne peut être que mesurée. Il ne peut, d’après moi, le faire que « d’un point de vue externe modéré »29 ou, de façon peut être plus réaliste, « d’un point de vue interne modérément ouvert »30. Il ne s’agit donc pas de faire œuvre de sociologue, d’anthropologue ou de politiste pour produire un savoir scientifique dans ces disciplines, mais de recourir aux travaux des sciences sociales – en l’occurrence ceux relatifs aux rapports entre acceptabilité et droit – afin de dégager des éléments éclairants pour la connaissance du droit31. Étant entendu que, même ainsi circonscrite, « une telle démarche, pour être scientifiquement pertinente, ne saurait être conduite sans disposer d’un minimum de connaissances sur la ou les disciplines auxiliaires auxquelles l’on a recours, ne serait-ce que pour apprécier de manière critique les travaux utilisés, les situer dans le contexte de la discipline, dans les différents courants, les différentes écoles et les évaluer dans un contexte d’ensemble »32.
Ce n’est qu’en admettant et en énonçant ces limites, je crois, que le juriste peut raisonnablement envisager un pas de côté en faveur d’une ouverture – limitée – vers les sciences avoisinantes du droit : ainsi que l’écrivait Pierre Bourdieu, « la science consiste à faire ce qu’on fait en sachant et en disant que c’est tout ce qu’on peut faire, en énonçant les limites de la validité de ce que l’on fait »33. Le cadre d’analyse ainsi envisagé, nul doute que la thématique retenue par les organisateurs de cette journée d’étude révèle toute sa pertinence. Les diverses contributions n’ont d’ailleurs eu de cesse de le démontrer. En analysant une notion – l’acceptabilité – qui ne compte pas nécessairement parmi les objets du droit mais qui n’est pas dépourvue de tout lien avec celui-ci, elles nous permettent de ressortir de cette journée, un peu plus savants quant à notre propre objet d’étude qu’est le droit.
Ouvrages
ARNAUD (A.-J.) (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, LGDJ, 2e éd., 1993, 758 p.
BACHELARD (G.), La formation de l’esprit scientifique, Bibliothèque des textes philosophiques, 2011, 304 p.
BOURDIEU (P.), Questions de sociologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 2002, 288 p.
COMMAILLE (J.), À quoi nous sert le droit ?, Folio, 2015, 528 p.
DE BECHILLON (D.), Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Odile Jacob, 1997, 302 p.
DOUTEAUD (S.), ESTANGUET (P.), VÉRON (N.), Le juge et le moment, actes de la journée d’études organisée le 28 juin 2019, PUPPA, 2020, 217 p.
KELSEN (H.), Théorie pure du droit, Dalloz, 2e éd., 1962, 496 p.
OST (F.), VAN DE KERCHOVE (M.), Jalons pour une théorie critique du droit, Bruxelles, Publications des facultés universitaires Saint-Louis, 1987, 602 p.
VAN DE KERCHOVE (M.), OST (F.), Le système juridique entre ordre et désordre, PUF, 1988, 254 p.
VILLANI (C.), UZAN (J.-Ph.), MONCORGE (V.), La maison des mathématiques, Cherche-Midi, 2014, 144 p.
WEBER (M.), Le savant et le politique, 1919.
Articles de revues
BONNOTTE (Ch.), « L’acceptabilité sociale est-elle un indice de la qualité de la justice administrative ? », RFAP, n° 3, 2016, p. 689-700.
COPPENS (Ph.), « Introduction à l’article de H. Kelsen », Droit et société, n° 22, 1992, p. 553-550.
DE BECHILLON (D.), « Le contrat comme norme dans le droit public positif », RFDA, n° 1, 1992, p 15.
DE BECHILLON (D.), « À propos de la réception de la sociologie de Jean Carbonnier dans les facultés de droit françaises », L’année sociologique, n° 2, 2007, p. 547-553.
DUMONT (H.), BAILLEUX (A.), « Esquisse d’une théorie des ouvertures interdisciplinaires accessibles aux juristes », Droit et société, n° 2, 2010, p. 275-293.
FRISON-ROCHE (M.-A.), « L’utilisation de l’outil sociologique dans l’élaboration de la jurisprudence », RRJ, Droit prospectif, 1993, p. 1271-1277.
ISRAËL (L.), « Question(s) de méthodes. Se saisir du droit en sociologue », Droit et Société, n° 2-3, 2008, p. 381-395.
MAGNON (X.), « Pour un moment épistémologique du droit – constitutionnel – », AIJC, 2015, p. 13-25.
RAY (J.-E.), « Droit public et droit social en matière de conflits collectifs », Droit social, 1991, p. 220.
PEANO (D.), « Qualité et accessibilité des décisions des juridictions administratives », AJDA, 2011, p. 612.
Notes
- RAY, 1991, p. 220.
- Le droit étant ici entendu de manière restrictive comme le droit à l’intérieur de l’État occidental moderne et tel que celui-ci en définit les contours officiels.
- Nous reprenons ici la définition suggérée par les organisateurs de la journée d’étude dans l’appel à contribution.
- KELSEN, 1962.
- COPPENS, 1992, p. 537.
- Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le concept d’acceptabilité a été forgé par les sciences sociales et se révèle globalement absent de la littérature juridique. Pour quelques études entreprises par des juristes sur le sujet, v. : BONNOTTE, 2016, p. 689 ; FRISON-ROCHE, 1993, p. 1271-1277.
- DE BECHILLON, 1997, p. 255.
- WEBER, 1919.
- TROPER, V° Positivisme, in ARNAUD (dir.)., 1993, p. 461.
- Ce qui n’empêche pas que l’État pose volontairement des limites à sa souveraineté afin d’imposer, par la voie constitutionnelle notamment, le respect de valeurs aux autorités normatives qui agissent en son nom et pour son compte. Ce qui n’empêche pas, non plus, un positivisme critique à l’égard du Droit. Car, « prétendre à une science du Droit, c’est forcément savoir. Savoir que le Droit, la juridicité, puisent leur source dans un fait d’autorité, dans un processus étatique d’autoaffirmation susceptible de recouvrir n’importe quel contenu. C’est savoir que l’État, la forme État, reste “axiologiquement neutre”, selon l’expression consacrée ; qu’elle est spongieuse, perméable à toutes valeurs possibles y compris les plus odieuses. Prétendre à une science du droit, c’est savoir la froideur et la dangerosité du Droit » (DE BECHILLON, 1997, op. cit., p. 258).
- DE BECHILLON, 1997, op. cit., p. 208.
- Sur la normativité juridique du contrat, voir DE BECHILLON, 1992, p 15.
- DE BECHILLON, 1997, Ibid., p. 214-215.
- En ce sens, et à propos de la justice administrative, voir BONNOTTE, 2016, op. cit., p. 689.
- « Pour simplifier les choses à l’extrême et adopter une définition très juridique de ces notions, on pourrait présenter l’effectivité comme la propriété qu’aurait une règle de produire des effets dans la réalité empirique, et l’efficacité comme la propriété qu’elle aurait de produire les effets que l’on attendait d’elle » (DE BECHILLON, 1997, op. cit., p. 87).
- Nous renvoyons ici à nos propres travaux, par ex. : La fonction d’aide à l’accès au juge du Défenseur des droits, Revue française de droit constitutionnel, 2020, n° 1, p. 189 ; Le non-recours au juge et le moment, in DOUTEAUD, ESTANGUET, VERON (dir.), 2021, p. 31.
- Sur cette question, v. par ex. : FRISON-ROCHE, 1993, op. cit. p. 1272-1274 ; PEANO, 2011, p. 612.
- MAGNON, 2015, p. 17.
- VILLANI, 2014, p. 50.
- DUMONT, BAILLEUX, 2010, n° 2, p. 284-285.
- V. par ex. leur ouvrage Jalons pour une théorie critique du droit, Publications des facultés universitaires Saint-Louis, 1987.
- VAN DE KERCHOVE, OST, 1988, p. 149 et s. Dans un sens similaire, voir COMMAILLE, 2015.
- DUMONT, BAILLEUX, 2010, op. cit., p. 285.
- « La science, dans son besoin d’achèvement comme dans son principe, s’oppose absolument à l’opinion. S’il lui arrive, sur un point particulier, de légitimer l’opinion, c’est pour d’autres raisons que celles qui fondent l’opinion ; de sorte que l’opinion a, en droit, toujours tort. L’opinion pense mal ; elle ne pense pas : elle traduit des besoins en connaissances. En désignant les objets par leur utilité, elle s’interdit de les connaître. On ne peut rien fonder sur l’opinion : il faut d’abord la détruire. Elle est le premier obstacle à surmonter » (BACHELARD, 2011, p. 16).
- Une démarche préalable en ce sens est, peut-être, d’ailleurs d’avoir l’honnêteté intellectuelle d’assumer et d’énoncer ses convictions afin, sinon de s’en départir complètement, d’entretenir la méfiance et le doute à leur égard.
- Nous mettons ici de côté le « théoricien du droit professionnel capable de jongler aussi bien avec la doctrine juridique qu’avec au moins certains des paradigmes de la sociologie, de la science politique et de la philosophie » (DUMONT, BAILLEUX, 2010, op. cit., p. 286).
- Sur cette problématique du bon positionnement épistémologique dans l’approche du phénomène juridique, v. ISRAËL, 2008, n° 2-3, p. 381.
- Sur ce point, v. DE BECHILLON, 2007, p. 548.
- OST, VAN DE KERCHOVE, 1987.
- DUMONT, BAILLEUX, 2010, op. cit., p. 287.
- En ce sens, v. MAGNON, 2015, op. cit., p. 24.
- Ibid.
- BOURDIEU, 2002, p. 54.