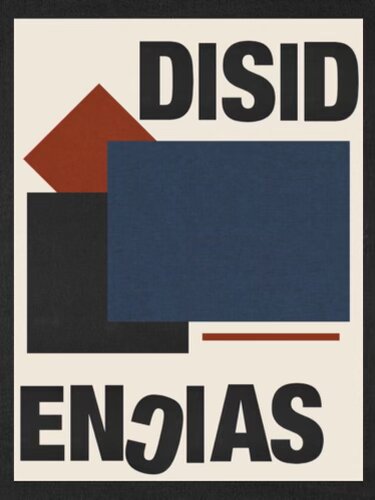À Lola, notre petite Pasionaria.
Alors même que la crise actuelle du capitalisme post-fordiste ou néolibéral semble ne jamais avoir autant donné raison à la politique antagoniste, qui en dénonce – depuis longtemps déjà – les excès et autres travers, force est cependant de constater que cette dernière accuse un manque flagrant de soutien populaire. Plus encore : loin de faire l’objet d’une effectuation révolutionnaire, il nous faut prendre acte de la cristallisation conservatrice, voire réactionnaire, du mécontentement social causé par l’augmentation des inégalités et de l’injustice globales – comme l’atteste, par ailleurs, la montée des extrêmes droites un peu partout dans le monde, et notamment en Europe. Si un tel constat doit nous conduire à penser à nouveaux frais cette question spinoziste que Deleuze et Guattari identifiaient, dans L’Anti-Œdipe, au problème fondamental de la philosophie politique : “Pourquoi les hommes combattent-ils pour leur servitude comme s’il s’agissait de leur salut ?”1, c’est bien parce que pareille cristallisation pointe du doigt l’incapacité avérée des modèles courants de politique antagoniste à neutraliser les dispositifs institutionnels (sociaux, culturels, politiques, techniques, économiques, mais aussi médiatiques) en vertu desquels “le désir [est déterminé] à désirer sa propre répression”2 ; ou, pour dire la chose plus prosaïquement, les pauvres le sont à voter à droite3
La situation présente appelle donc une nouvelle manière de faire de la politique : plus horizontale, davantage participative et radicalement démocratique – en rupture, notamment, avec la forme-parti. Et si une telle réorientation s’impose, c’est bien parce que la politique antagoniste, dans la configuration qui est la sienne depuis au moins quatre décennies, n’a cessé de s’abîmer dans le jeu truqué de la démocratie parlementaire (ou bourgeoise), finissant par accuser un manque cruel d’efficacité pour rassembler, coordonner et empuissantiser la multiplicité des luttes et des revendications qui se sont faites jour ici et là… quand bien même les conditions objectives constituaient à elles seules – et c’est d’autant plus vrai à ce jour – un plaidoyer pour une telle convergence des luttes. Un manque d’efficacité, disions-nous, qui tient, entre autres, selon Juan Manuel Aragüés, à l’“appareil conceptuel hérité de la tradition idéaliste”4 que le stalinisme a insidieusement réintroduit dans la critique marxiste, et qui, perdant progressivement tout lien avec le matérialisme, a fini par détourner la politique antagoniste de son projet originel : la transformation sociale. Le “marxisme soviétique” qui, sous le règne de Staline, a accouché du concept de “marxisme-léninisme”, s’est en effet donné pour mission d’“oublier Marx”5, c’est-à-dire de vider son œuvre de la complexité qui est la sienne, en la ramenant à un vulgaire “économisme mécaniste” (dont Boukharine est, sans nul doute, le premier artisan), et en la convertissant en un nouveau dogme stérile et réticent à intégrer une quelconque nouveauté théorique – quand il ne s’est pas directement soldé par l’avènement d’une théologie “communiste” dont le premier principe aurait pu se formuler comme suit : il n’y a qu’un Dieu, le Parti, et le prolétariat éclairé est son prophète.
Pour remédier à l’absence d’une alternative (ou résistance) progressiste crédible face à une bourgeoisie (entendue ici comme métonymie du capitalisme) dont le désir d’accumulation monétaire semble ne connaître aujourd’hui aucune limite, et ce malgré ses répercutions avérées en termes, non seulement d’exploitation humaine, mais aussi de destruction climatique, écologique et pandémique de la planète, il est impératif de repenser la politique antagoniste, aussi bien dans ses effets théoriques que pratiques. Car on ne mettra pas fin au “capitalocène”6, auquel nous condamne une formation sociale acquise à “la production de valeurs d’usage monstrueusement colonisée par la valeur d’échange devenue folle”7, sans sortir de la simple “alternance” entre un néolibéralisme “réactionnaire” (propre à la droite extrême) et un néolibéralisme “progressiste” (caractéristique de la gauche dite “de gouvernement”)8, dont on sait maintenant combien tous deux ont concouru et concourent encore à la perpétuation du capitalisme et de sa pulsion de mort. Il est donc urgent de repenser la politique antagoniste, et Aragüés entend le faire sous le prisme d’une hybridation du marxisme critique et de la philosophie française de la différence : il s’agit, dit-il, de “récupérer un certain Marx, le Marx matérialiste que le stalinisme a relégué aux oubliettes de l’histoire”9, et d’en combiner les apports théoriques avec la “boîte à outils” poststructuraliste, deleuzienne notamment, afin de neutraliser par avance le risque d’un retour essentialisant à toute identité close, surplombante et excluante – enjeu d’autant plus crucial que l’efficacité même de la politique antagoniste dépendra de sa capacité à produire un sujet collectif suffisamment transversal pour accueillir en son sein la multiplicité des luttes.
Aussi ne saurait-il y avoir, selon Aragüés, de politique antagoniste efficace qui, avant toute chose, ne prenne appui sur ce “courant souterrain”10, cette ligne mineure et hétérodoxe – car immanentiste – qui se déploie depuis Démocrite, Épicure et Lucrèce, se poursuit au travers des œuvres de Spinoza, Feuerbach, Marx et Nietzsche, et à laquelle Althusser a donné le nom de “matérialisme de la rencontre”11. Si ce dernier consiste, selon Aragüés, en “une position véritablement matérialiste”12, c’est bien parce qu’il nous conduit – logique de la rencontre oblige – à reconnaître en la différence le “point de départ” ontologiquement indépassable : “la différence, disait déjà Deleuze, est derrière toute chose, mais derrière la différence il n’y a rien”13. Ainsi le monde social-humain, tout comme les sujets (individuels et collectifs) qui y déploient leur existence et y effectuent leurs actes, sont-ils toujours déjà parcourus – et il en va de même pour le monde naturel – par une “différence première” ou un “système premier de différences”, au regard desquels le principe d’identité ne peut être compris qu’en l’espèce d’un principe advenu, secondaire, dérivé.
Faire le pari d’une politique antagoniste, dont le fondement matérialiste pose qu’il n’y a de rencontre – rigoureusement parlant – que des différences, revient par conséquent à se mettre en quête de celles susceptibles de nous unir. Et s’il est vrai qu’à défaut d’une identité extérieure et transcendante, qui déterminerait par avance l’ordre fixe des similitudes et dissemblances, et puisqu’il en est fini de cette “lecture du monde” selon laquelle “seul ce qui se ressemble diffère” (“piège de l’identité”14), reste néanmoins qu’il nous faut œuvrer de sorte à éviter que ces mêmes différences, dorénavant renvoyées à elles-mêmes, et par lesquelles nous nous singularisons, ne se convertissent en un nouveau motif de séparation (“piège de la diversité”15). Ayant pour mission de coordonner les singularités, de fédérer les “anarchies couronnées”, la politique matérialiste se doit donc de nourrir une volonté de rencontre et d’élaboration d’un programme théorique et politique commun – seul remède, à vrai dire, aux deux écueils, parfaitement asymétriques mais également stériles, de l’universalisme tronqué et du particularisme forcené, dont on sait combien chacun, à sa manière, fait obstacle au processus de constitution du sujet collectif antagoniste – quel que soit, par ailleurs, le nom que l’on veuille bien donner à ce dernier : multitude, peuple, classe, etc.
Ainsi est-il besoin, pour restituer à la différence son primat ontologique, d’en finir avec les discours qui s’emploient à élever l’identité au rang de principe premier et ordonnateur du réel, à commencer par le platonisme et ce dont il est l’expression sublimée : le mythe. De fait, si Aragüés consacre de nombreuses pages à la question du mythos, c’est bien parce qu’il voit en ce dernier l’une des premières stratégies visant à “faire taire la différence”. Le discours mythique, dans la mesure où il légitime – en la racontant – l’histoire fondatrice de la société, ne fait rien d’autre qu’asseoir les “raisons” de la conduite sociale établie, qui sont autant de réponses fournies par avance et barrant la route à toute forme de questionnement. Puisque le mythe, comme l’a souligné Lévy-Bruhl, contient à la fois la question et la réponse, le problème et la solution, il ne saurait alors aucunement se présenter sous forme d’un dialogue ; au contraire, il est foncièrement monologue. Or, c’est bien là que se fait jour le pouvoir socio-politique de la parole mythique, et des poèmes homériques en particulier : ces derniers, loin d’opérer comme un simple instrument de divertissement, consistent surtout en une “efficace stratégie d’endoctrinement idéologique”16, comme le souligne Aragüés, qui relaie ici les analyses de Vernant. En effet, le discours mythique, notamment à travers sa mise en scène homérique, a-t-il pour vocation de rappeler constamment au dèmos – dont Thersite est la figure métonymique – quelle est la place à laquelle il doit se tenir – silencieusement – au sein de la société aristocratique. Les aristoï, dont Ulysse est l’emblème, sont, quant à eux, présentés à la fois comme les “vicaires” et les “légitimes descendants” des dieux ici-bas, de sorte que la manière par laquelle ils s’approprient privativement le pouvoir politique se trouve justifiée par leur ascendance divine. Si “en grec, qui dit mythologie, dit théologie”17, alors on comprend avec Aragüés pourquoi le mythe, qui en établit la généalogie divine, se trouve ainsi mis “au service des intérêts politiques de l’aristocratie” : c’est bien parce que le mythos leur prête le pouvoir démiurgique d’ordonner le chaos social que les aristocrates, et eux seuls, “possèdent le privilège d’intervenir dans le champ politique et d’exercer le droit à la parole”18.
Cependant, nous savons combien l’avènement conjoint de la démocratie et du logos (compris comme discours de la différence et de l’immanence) a mis à mal l’ordre aristocratique et le discours mythologique de l’identité et de la transcendance, qui en était le principal codificateur idéologique – avant que la philosophie platonicienne n’entreprenne, plus tard, et à sa manière, d’en reconduire la stratégie de légitimation. “Le logos, œil des différences, naît originairement comme dia-logos, […] débat entre opinions non convergentes”19. Adossé à l’ordre démocratique de la cité, au sein duquel il puise ses conditions de possibilité, le dialogue met donc en lumière l’existence de différences – celles-là mêmes que le monologue mythologique avait passées sous silence –, ouvrant ainsi la voie au(x) désaccord(s), à commencer par celui qu’éprouve le dèmos à l’égard de l’ethos individualiste d’une “aristocratie […] parcourue par l’hubris, et dont le seul but est de satisfaire ses intérêts”20, via l’accaparation du pouvoir politique. Aussi le passage du mythos aulogos va-t-il de pair avec la démocratisation de la parole et l’implication accrue du dèmos dans les processus de prise de décisions politiques. Passage de la transcendance monarchique à l’immanence démocratique, de l’individuel (en proie à la démesure) au collectif (adossé à la sôphrosunè) : telle est, par ailleurs, la dimension sociale et politique de la “voie de l’Être” sur laquelle s’engage alors la polis (selon l’interprétation déroutante qu’en propose Capizzi21).
Cependant, en dépit des soubresauts démocratiques qui, au cours de l’histoire, ont permis au peuple de retrouver progressivement voix au chapitre, force est de constater que “le silence du subalterne, comme le rappelle Aragüés, demeure la stratégie fondamentale à laquelle s’adosse le pouvoir tout au long de l’histoire”22. Silence auquel se trouve de nouveau acculée la subjectivité contemporaine, et ce au moment même où l’on assiste à une profusion inégalée de discours (médias de masse, réseaux sociaux, etc.). Si la subjectivité est ainsi devenue le lieu par excellence de l’intervention politique – chose qu’a très bien comprise le néolibéralisme –, c’est bien parce que la promesse moderne, celle d’un affranchissement de l’individu d’avec un ordre social fortement stratifié, devait – du point de vue du pouvoir – faire l’objet de nouveaux dispositifs de capture à même d’en désamorcer la charge – la puissance – révolutionnaire23. Et sur ce terrain-là, force est également de constater que le néolibéralisme – nous le disions déjà – a parfaitement compris que la meilleure façon d’obtenir l’adhésion des individus à son utopie marchande de la société consiste à refaçonner leur subjectivité pour en faire des “entrepreneurs de soi”. Car “aligner le désir des enrôlés [ou des subalternes] sur le désir-maître [du capital]”24 est aussi un moyen efficace – plus que ne l’est, d’ailleurs, la contrainte – de “faire taire la différence”25.
Au regard de ce travail d’enrôlement réalisé par la société capitaliste – travail qui s’avère d’autant plus efficace qu’il présente aux enrôlés leur obéissance joyeuse à l’“utopie libérale” sous forme d’un libre consentement –, Aragüés considère alors qu’il ne saurait y avoir d’élaboration d’une politique antagoniste qui ne passe d’abord par une reconceptualisation du sujet – un sujet aux antipodes du subjectum dont a accouché la métaphysique subjectiviste et qu’a reconduit l’humanisme théorique en vogue dans certains secteurs des sciences sociales. Loin du sujet souverain, doué de libre arbitre, capable d’auto-détermination et responsable à tout instant de ses décisions et de ses actes ; loin, donc, de ce “sujet substantiel achevé [et] bien constitué”26 – que la théorie contractualiste, aussi bien moderne que contemporaine, a pris soin de mobiliser –, la politique antagoniste, pour paraphraser Spinoza27, doit, quant à elle, et conformément à son réalisme critique, prendre le sujet tel qu’il est (subditum) et non tel qu’elle voudrait qu’il fût (subjectum28). Et si le sujet est subditum, c’est bien parce qu’il est irrémédiablement aliéné au double sens de l’aliénation, qui dit – étymologiquement – la “présence d’autre chose que soi (alien, alius) dans la direction de soi” et – imaginairement – le “lien” qui unit le soi à l’autre de soi29. C’est donc sur la base d’un “sujet relationnel” que doit s’articuler la politique antagoniste, d’un sujet qui n’est plus point de départ mais point d’arrivée, soit le résultat d’un processus de subjectivation inféodé, par ailleurs, à un ordre double de médiations. D’une part, à celui des déterminations internes : l’homme est homo passionalis car irrémédiablement enchaîné à ses désirs30 ; et de l’autre, à celui des déterminations externes : il est homo socialis car foncièrement constitué par “l’ensemble des rapports sociaux”31 – au sein desquels se déploient ses forces de désir et ses puissances d’agir.
Or, parmi les rapports sociaux qui tendent à modeler et orienter les mouvements conatifs du sujet relationnel, il en est un en particulier qui, à l’heure du “techno-capitalisme”, jouit d’une importance non négligeable, à savoir : le rapport de l’homme à la “machine”. La subjectivité contemporaine, souligne Aragüés, se fait cyborg, en ce sens qu’elle entre dans des rapports de composition inédits avec un monde social hautement technicisé. Cependant, s’il est vrai, comme l’a montré Sloterdijk, que le cyborg, soit le sujet accouplé à la machine (entendue ici comme métonymie de la technologie), accroît notoirement ses capacités communicationnelles et informationnelles, reste néanmoins que la pléthore d’information et de communication à laquelle il se trouve exposé contribue paradoxalement – tel que l’a souligné Virilio pour sa part – à intensifier la situation d’isolement généralisé dont l’ascension du “marché” et de son atomistique sociale avait déjà posé les premiers jalons. Et Aragüés de conclure : “la technologie est en train de se transformer en instrument de mise à distance des subjectivités entre elles, ce qui rend d’autant plus difficile l’intervention politique”32, qui “est affaire de coprésence de corps parlants”33. Ainsi la technologie, loin d’empuissantiser politiquement les sujets, tend plutôt à se présenter comme une nouvelle forme de domination, comme un nouveau dispositif de capture des puissances d’agir individuelles et collectives, en cela qu’elle concourt à une “virtualisation” du réel (au sens, non pas deleuzien, mais baudrillardien du terme), c’est-à-dire à une “déréalisation” du monde (social) en vertu de laquelle le sujet, qui croît fermement exercer un pouvoir souverain sur le réel, s’en trouve en réalité foncièrement dépossédé. Tel est le “crime parfait” accompli par la “technologie-conduite-par-le-capital” : faire disparaître le réel et effacer les traces d’une telle disparition34.
Pareil mouvement, par le biais duquel la technologie, nous dit Aragüés, “[soumet] le sujet au diktat de la machine-capital”35, est symptomatique en dernière instance du mode de fonctionnement actuel du capitalisme. Un mode de fonctionnement dont Marx, dans Le Capital, nous avait déjà livré la formule : “la subsomption réelle du travail dans le capital”. Par là, rappelons-le, il nous faut entendre “le processus d’extraction de la survaleur […] en vertu duquel sont mobilisés, afin d’augmenter la productivité du travail et, par suite, le surtravail (dont le capital soutire la plus-value), non seulement le travail réalisé au sein de l’entreprise, mais plus généralement, l’ensemble des sphères sociales et des activités correspondantes”36. Et c’est bien parce que le philosophe allemand décrivait déjà le mode de fonctionnement capitaliste “comme relevant d’un régime de mobilisation et de subordination totales (de la science, de la technologie, de la culture, de la politique, de la vie sociale, y compris de la subjectivité) au cycle du capital”37 qu’Aragüés entend “[porter] l’analyse de Marx au-delà de Marx lui-même”38, en montrant combien la subsomption réelle, dans le cadre du capitalisme néolibéral, s’est approfondie et étendue à la personne même du producteur, de sorte qu’il est désormais possible de parler d’une “subsomption réelle de la subjectivité du travailleur dans le capital”39. Pareille opération requiert, pour ce dernier, de s’immiscer dans la sphère des “pratiques de construction de soi” et d’y déployer un travail de remodelage des subjectivités afin de produire – nous le disions déjà – “l’entrepreneur de soi-même”. Ainsi le capitalisme néolibéral, en même temps qu’il en promeut ouvertement l’individualisation, reconduit-il insidieusement les trajectoires socio-biographiques vers un horizon commun, celui de l’entrepreneuriat de soi généralisé, dont Deleuze, pour sa part, avait déjà entrevu tous les dangers : “On nous apprend que les entreprises ont une âme, ce qui est bien la nouvelle la plus terrifiante du monde”40. À travers cette production de subjectivités ajustées aux besoins (re)productifs du capitalisme post-fordiste, c’est finalement toute une “ontologie ingénue”41, celle-là même qui sous-tend la conception néolibérale de l’individu et de la société, qui en ressort fortifiée : “[la société] n’existe pas ! Il n’y a que des individus, hommes et femmes” pris dans des rapports de concurrence généralisée, soit des “unités de production” individuelles et égocentrées qui, tentant frénétiquement de mettre en valeur leur “capital humain”, contribuent de façon irrémédiable à leur propre aliénation (comprise ici au sens fischbachien42 du terme), c’est-à-dire à leur propre “séparation” d’avec le monde (social) et les autres – état de “séparation” et donc de “réduction à l’impuissance”43 dont on peut se figurer combien il fait obstacle à la constitution de ce sujet collectif antagoniste qu’Aragüés appelle de ses vœux.
Aussi est-il nécessaire, avant de pouvoir intervenir politiquement sur le réel, d’en produire la connaissance adéquate, et ce, notamment, afin d’éviter les représentations tronquées (ces “conséquences sans prémisses”, comme disait Spinoza) dont nous abreuve l’imagination spontanée, et dont les subjectivités néolibérales, pour leur part, restent tributaires dès lors, par exemple, qu’elles relaient pareille vision a-sociologique de l’individu et de la société. Or, pour ce faire, comme le souligne Aragüés, il nous faut d’abord nous déprendre ou, du moins, resignifier les outils conceptuels que nous a légués la tradition idéaliste hégémonique, à commencer par ceux de “sujet” et d’“objet”. En effet, de même que le sujet n’est plus à comprendre comme un subjectum, mais comme un subditum : il est le pli singulier – et jamais complètement clos – de multiples médiations qui, tout en le constituant, l’assujettissent à un certain point de vue sur le réel ; il se trouve que l’objet ne peut plus être conçu, pour sa part, comme une entité stable et identique à soi qui s’offrirait à la simple récognition. En tant qu’il est le résultat – au même titre que le sujet – d’une genèse processuelle sans terminus assigné, l’objet perd irrémédiablement la substantialité que la tradition idéaliste lui avait prêtée pour se faire “simulacre” ou “signe” (comme dirait Deleuze), emporté comme il l’est par ce “devenir-fou” dont on sait combien Platon avait tenté de lui imposer des limites – voire, pour sa part la plus rebelle, de “l’enfermer dans une caverne au fond de l’Océan”44. Cependant, une fois admis que le sujet et l’objet ne cessent de se faire, se défaire et se refaire mutuellement dans le temps, c’est alors le réel lui-même qui, comme le note Aragüés, tend à être affecté d’une “perte de densité ontologique”45, laquelle semble nous condamner derechef au silence – chose d’autant plus inacceptable que la parole est au centre de la (pratique) politique.
Si l’approche matérialiste du sujet et de l’objet nous permet donc de dissoudre l’essentialisme dont la tradition idéaliste – rationaliste – les avait lestés, alors on pourrait penser qu’il serait judicieux de partir, à la manière empiriste, du “réel concret”. Sauf que pour Marx, le réel concret, loin d’être un simple point de départ dans l’ordre des choses, n’est en fait qu’un point d’arrivée – “une synthèse, un résultat, un effet”46, nous dit Aragüés. Et s’il ne peut en être autrement, c’est en raison du fait que, ce que le sujet comprend comme le réel concret, n’est en réalité que la perspective “première” – c’est-à-dire socialement (et affectivement) médiatisée – à partir de laquelle il se saisit du réel. En d’autres termes, le réel concret est, non seulement origine, mais aussi résultat, en ce sens qu’il désigne à la fois ce à partir de quoi s’exerce la conscience et le produit de cette conscience s’exerçant, elle-même produit de la vie sociale (et affective). C’est pourquoi il est nécessaire, nous dit Aragüés, de comprendre “la réalité […] comme un exercice matérialiste de production subjective”47. Or, c’est précisément en ce sens-là – soutient l’auteur – que se fait jour un lien possible entre le matérialisme marxien et l’“empirisme transcendantal” deleuzien : désormais, il n’y a plus de sujet et d’objet déjà constitués, placés d’emblée l’un en face de l’autre ; au contraire, ce à quoi nous avons affaire originairement, c’est à un champ pré-subjectif et pré-objectif – la vie – se présentant sous la forme d’un plan d’immanence qui, loin d’en reconduire la transcendance, préside au contraire à la “genèse conjointe et variable du sujet et de l’objet”48, de sorte que “l’individuation d’un nouvel objet ne se sépare pas d’une nouvelle individuation du sujet”49, et vice versa. Mais une fois établi que les subjectivités, produites comme elles le sont par de multiples médiations, produisent à leur tour le réel, il s’en suit alors un perspectivisme, un “panorama archipélagique” (comme le dit Aragüés) qu’il nous faut impérativement dépasser, si notre projet est bel et bien celui d’œuvrer à la “construction d’un horizon commun de sens”50.
Toutefois, il s’agit là d’une construction dont on ne saurait malheureusement trouver d’indication dans l’œuvre deleuzienne, réputée pour ses dures invectives à l’encontre de la communication. C’est pourquoi Aragüés décide de se tourner simultanément vers Spinoza et Negri : vers Spinoza, parce que ce dernier, loin de s’en tenir au simple constat du caractère singulier de toute perspective sur le monde, propose d’élaborer une connaissance et un regard partagés sur le réel (les “notions communes”) – élaboration “rendue possible, souligne Aragüés, par la proximité vitale des corps”51 chère au philosophe hollandais ; et vers Negri, dans la mesure où celui-ci s’emploie à la production d’outils linguistiques (les “noms communs”) capables d’attribuer au “réel-emporté-par-le-temps”, au kairos, à l’événement, un sens commun – production qui, précisément parce qu’elle trouve dans la praxis sa condition de possibilité, requiert également “l’être-avec et le faire-avec”52. Or si ce dont il est question, c’est bien de produire et de donner un sens commun au kairos, alors nous ne saurions, en dernière instance, faire l’économie de cette faculté pourtant si dépréciée par la tradition idéaliste sous le qualificatif de “folle du logis” : l’imagination. En effet, elle – et elle seule – nous confère la capacité de nous forger une idée (partiellement) adéquate – et, ce faisant, d’anticiper autant que faire se peut – ce qui, à court ou moyen terme, pourra bien advenir ; ou, pour dire les choses de manière kantienne, “ce qu’il nous est permis d’espérer” – notamment en ce qui concerne le devenir-actif des individus, sans quoi point de politique antagoniste. Car prendre les hommes tels qu’ils sont – à un moment donné de l’histoire et en un point particulier de la géographie – et non tels que l’on voudrait qu’ils fussent – en tout lieu et en tout temps –, n’empêche nullement d’imaginer comment ils pourraient être à l’avenir. Critique et clinique, comme dirait Deleuze53.
Ceci dit, nous ne saurions ignorer l’impasse politique à laquelle nous conduisent potentiellement l’ontologie et l’épistémologie matérialistes de “la différence pure et sans concept” : celle d’une micro-politique du quotidien, cantonnée aux marges et rétive à tout projet globalisant – soit celle d’une “miniaturisation de la politique”54, dont la dissémination en tout lieu de la vie sociale va de pair, comme le rappelle I. Garo à propos de Deleuze, avec le rejet de toute perspective collective de conquête et de transformation. Or, pour éviter une telle impasse, il nous faut trouver la façon – insiste Aragüés – de construire un horizon de sens commun, faute de quoi nous nous verrons renvoyés à l’incommensurabilité de nos points de vue singuliers. Car “la conclusion la plus évidente et extrême d’une approche matérialiste de l’épistémologie est l’impossibilité même d’une épistémologie matérialiste. Ou, à tout le moins, d’une épistémologie pleinement et radicalement matérialiste, c’est-à-dire, soumise au flux extrême du réel et du pli de subjectivation”55. Pour doter la différence pure et sans concept de consistance ; en d’autres termes, pour construire un horizon de sens commun à partir duquel engendrer une entente mutuelle et coordonner une action commune, l’accès égal à la parole – et donc l’entrée en jeu d’un minimum de communication – s’avère en ce sens une condition absolument nécessaire. Nécessaire, à n’en pas douter, mais aussi et malheureusement insuffisante – car pouvoir parler n’est pas tout. Encore faut-il joindre à la parole l’“écoute” et la “traduction”, comme ne cesse de le rappeler Aragüés (au grand dam d’une certaine orthodoxie ou vulgate deleuzienne) : la première, afin d’esquiver l’écueil de l’absolutisation du relatif et du particulier (dont on retrouve les traces dans la “lutte des luttes”, qu’elle opère par “négation” ou par “réduction”56) ; et la deuxième, pour échapper au caractère idiolectique de la langue (étant donné qu’“il n’y a pas d’espéranto de la révolte”57).
Tournée vers l’avenir, l’épistémologie matérialiste n’a pas tant pour mission de décrire le monde que d’en produire un. Et comme le soutient Aragüés, “cette construction du commun est, parallèlement, ontologique et épistémologique. Et, sans l’ombre d’un doute, politique”58. Or – nous le disions déjà – il ne saurait y avoir de construction du commun qui n’aille de pair avec la production d’une subjectivité, non seulement individuelle, mais aussi collective. Comme le rappelle en effet Aragüés, “la politique consiste fondamentalement en une stratégie visant la construction de subjectivité”59 – chose dont on a souligné combien le néolibéralisme en a compris l’enjeu, lui qui s’emploie à promouvoir chez les sujets un autogouvernement entrepreneurial qui court-circuite d’emblée toute action antagoniste. Si, pour combattre le néolibéralisme, il est impératif de “déconstruire” la métaphysique subjectiviste que ce dernier reconduit sous la forme du self made man, reste néanmoins que pareille déconstruction doit s’opérer par et dans un double mouvement : d’une part, via le structuralisme marxien des rapports, qui dénonce l’illusion du sujet monadique et ses “robinsonades” – l’homme est un “individu social”, comme dit Marx dans les Grundrisse ; d’autre part, moyennant l’onto-anthropologie spinoziste de la subjectivité désirante, qui défait le mythe de l’homo omni rationalis (tel que reconduit, notamment par la théorie néoclassique, sous la forme du “sujet rationnel et calculateur”) et qui, ce faisant, restaure en l’homme la primauté des désirs et des affects – dimension que la tradition ou l’orthodoxie marxiste néglige également pour sa part, dès lors qu’elle fait le pari de la “prise de conscience” comme unique moyen de constitution d’une conscience antagoniste. Or, faire un tel pari, c’est oublier que le rôle premier de la critique est de “sentir autrement”, d’accoucher d’“une autre sensibilité”60.
S’il est donc nécessaire eu égard au mépris que témoigne généralement la tradition antagoniste envers les forces du désir, de reconnaître au capitalisme post-fordiste le mérite d’avoir su “comprendre à la perfection, comme le rappelle Aragüés, le rôle central que jouent les dynamiques désirantes chez les sujets, ce qui l’a conduit très tôt à faire de la séduction […] l’une de ses stratégies de domination les plus efficaces”61, c’est d’abord et avant tout pour montrer en quoi la conception de Badiou du sujet révolutionnaire comme “virtuose du désintéressement et de la raison”62 est proprement intenable. De fait, le constat de l’hégémonie néolibérale, en même temps qu’il nous contraint à discréditer par avance toute politique antagoniste qui aurait l’ambition de s’adosser – platoniquement – à la seule raison et au seul désintéressement, ne rend que plus pertinente la thèse de Deleuze et Guattari, d’inspiration spinozisto-nietzschéenne, selon laquelle le désir, loin de se réduire à la seule réalité mentale ou psychique, est toujours déjà en train d’investir le champ social et politique ; production désirante du social qui s’accompagne en retour d’une production sociale du désir, car “il est […] d’une importance vitale pour une société de réprimer le désir, et même de trouver mieux que la répression, pour que la répression, la hiérarchie, l’exploitation, l’asservissement soient eux-mêmes désirés”63 – la séduction. En résumé, le capital a compris qu’il ne suffit pas de s’adresser à la “subjectivité rationnelle” – de la convaincre – pour obtenir d’elle l’obsequium, l’acceptation de l’ordre établi ; il est d’abord et avant tout besoin de remodeler, notamment par le biais de cette “méta-machine affectante”64 qu’est le pouvoir médiatique, son régime de désirs (de choses matérielles, symboliques, mais aussi vocationnelles) et, ce faisant, l’imaginaire social (ouvertement consumériste et entrepreneurial) auquel elle est déterminée à adhérer, quand bien même pareille adhésion est vécue comme relevant d’un libre décret de la volonté.
Forts de cet enseignement, il nous faut alors comprendre qu’il ne saurait y avoir de politique efficace qui ne soit aussi une “politique du désir”, c’est-à-dire une politique qui tienne compte de la “complexion affective” des sujets (individuels et collectifs), ainsi que de la possibilité d’en remodeler le paysage passionnel. Ars imaginandi, la politique antagoniste doit aussi se faire ars affectandi, comme le rappelle Aragüés dans le sillage de Lordon. Car il s’avère impossible de porter à l’hégémonie une rationalité et un horizon de sens commun alternatifs sans les empuissantiser par le biais d’une politique des affects. Face à l’“illusion scolastique”, dénoncée par Bourdieu, selon laquelle les idées vraies suffiraient à faire se mouvoir le monde, il nous faut rappeler avec Spinoza qu’“il n’y a pas de force intrinsèque de l’idée vraie”. En somme, la vérité d’une idée ne garantit en rien son efficace, encore faut-il qu’elle soit une “idée affectante”65. Or, étant donné que les idées s’adressent forcément à des sujets qui, bien que soumis au poids des structures sociales, ne s’en trouvent pas moins singularisés par leur trajectoire socio-biographique, il est nécessaire, afin de les empuissantiser d’un affect commun, de savoir comment traiter la différence (à décliner au pluriel) qui distingue ces mêmes individus les uns des autres. Pas de politique sans ontologie, nous dit Aragüés. Ainsi, face à l’“ontologie en archipel” d’un Lyotard, qui part de l’identité pour retrouver la différence et ne débouche, en dernière analyse, que sur des “micro-identités”, toutes susceptibles d’être à leur tour morcelées, notre auteur se fait deleuzien et conçoit la différence comme la “donnée” initiale à partir de laquelle il faut imaginer et fabriquer des identités ouvertes au devenir – travail de reconstitution de totalités donc, mais de “totalités à côté”, “transversales” et nécessairement sujettes à de nouvelles redistributions66, que certains lecteurs pressés de Deleuze ont trop souvent tendance à congédier. En d’autres termes, c’est du constat de la primauté de la différence dont découle la nécessité de construire un sujet politique transversal, celui-là même auquel Aragüés, dans la droite ligne de Spinoza, prête le nom de “multitude”, et qui ne saurait par conséquent être donné d’emblée. Contrairement à ce que soutient Virno, pour qui le sujet collectif serait constitué par les travailleurs post-fordistes et existerait déjà comme une sorte d’entité préformée ; ou, contrairement à ce qu’affirment parfois Hardt et Negri, tant ils paraissent hésiter entre deux conceptions contradictoires du sujet politique67, Aragüés considère pour sa part que “[la multitude] est un sujet politique qui demande à être construit”68 – position qui le conduit, par conséquent, à rompre avec ce qui, chez ses camarades de tranchée, relève encore à son sens d’un certain “idéalisme déshistoricisant”.
Pour ce faire, Aragüés s’en remet directement au texte spinozien : la multitude (multitudo) n’est autre que le résultat de la politisation de la foule (plebs, vulgus), initialement morcelée par ses passions individualisantes. Or, si Spinoza confère en ce point une place de choix à la raison, c’est bien parce qu’il voit en elle un instrument promouvant l’accord entre des sujets qui, du fait de leur entière “servitude passionnelle” et du rapport spontané qu’ils nourrissent au monde (social), aux autres et à eux-mêmes, sont originairement rivés à un point de vue “idiot” sur le réel (de idion, “particulier”, “propre”). “L’équation spinozienne, dit Aragüés, est empreinte d’une logique implacable, en ce sens que la raison […] permet aux êtres humains d’entrer dans des rapports de composition au travers de pratiques communes, ce qui débouche sur l’augmentation de leur puissance et leur confère, par conséquent, une plus grande capacité, non seulement de connaissance de la réalité, mais aussi d’action sur elle”69. Voilà pourquoi la constitution de la multitude, loin de lui faire obstacle, empuissantise-t-elle la liberté individuelle : en ce sens qu’elle remédie à l’état de séparation, d’aliénation (au sens fischbachien du terme) auquel sont acculées les subjectivités qui pensent pouvoir se valoir de leurs seules et uniques ressources. Par le truchement de la multitude, c’est donc la liberté individuelle qui s’intensifie d’autant plus qu’elle se compose politiquement avec celle des autres ; liberté politiquement composée qui tient en dernière instance à la “production de réalités nouvelles”, et qui n’est donc pas à entendre comme liberté élective, mais bien en l’espèce d’une “liberté productive” – liberté de créer des alternatives et non liberté de choisir entre des alternatives préexistantes70.
Si la multitude demande donc à être produite, alors – nous l’aurons compris – elle doit l’être à partir des singularités et de leurs rapports de composition, soit sur la base d’une “fusion ontologique” (comme dirait Sartre) qui, sans en supprimer les projets individuels, doit permettre à ces mêmes singularités de “trouver des points de convergence à partir desquels élaborer une pratique commune” et de “[s’engager] en même temps sur la voie d’une production du commun”71. Or, c’est là une construction, comme s’empresse de le souligner Aragüés à juste titre, qui ne pourra prospérer qu’à la condition de ne pas sombrer dans l’un de ces deux maux qui, constamment, la guettent : d’un côté, la dissolution chaotisante (à laquelle – ne nous en déplaise – cette “sorte d’éthique vitaliste de la joie insurrectionnelle”72, que promeut le Comité invisible, risque fort bien de nous condamner), et de l’autre, la sédimentation ankylosante (dont la forme-parti traditionnelle constitue, sans nul doute, l’expression la plus achevée). Pour le dire en termes sartriens, le défi majeur auquel est confrontée la multitude – en son processus même de constitution et de persévérance dans l’être – tient donc à cela : se frayer un chemin entre le “groupe en fusion” et l’“institution”. C’est pourquoi Aragüés insiste sur la nécessité d’“articuler une pratique politique de type “liquide””, et ce, précisément, dans le but de s’en tenir, nous dit-il, à “ce juste milieu entre le caractère éthéré des groupes en fusion et les textures solides du groupe institutionnalisé”73. Voilà notamment pourquoi la multitude ne saurait être conçue sous la forme d’un corps sociologiquement prédéfini, en attente de son activation politique : la classe sociale, souligne Aragüés, n’est rien d’autre que le résultat du processus de lutte lui-même. Ne pas voir cela revient à entreprendre une démarche encore tributaire d’un essentialisme qui ne dit pas son nom, car pareille conception de la multitude tend à nier la diversité – et, par suite, la possibilité même de sa constitution comme sujet collectif antagoniste à spectre large – au profit d’une identité sous-jacente : “la multitude, ce sont les ouvriers” (comme dirait le partisan boukharinien du réductionnisme économiciste). Or, outre le fait que la condition ouvrière ne saurait prédisposer en soi à l’action révolutionnaire, il se trouve que l’identification de la multitude à la position de classe reconduit une logique d’exclusion et de division qui en amenuise l’efficacité politique. Aussi la participation au sujet collectif antagoniste, loin de l’être par la seule position de classe, est-elle plus largement définie par les pratiques, les processus de lutte et la prolifération des liens qui en découle.
Finalement, si la constitution de la multitude rend possible celle du commun (dont il faut signaler la rupture que celui-ci implique notamment avec la conception libérale de la propriété : pour cette dernière, il ne saurait y avoir en effet d’autre propriété que privée, et d’autre fondement de la propriété que le travail), alors il s’avère qu’en retour c’est l’extension même du commun qui dépend foncièrement du degré de puissance de la multitude, de l’intensité de son conatus – tantum juris quantum potentiae (“autant de droit que de puissance”), comme dit Spinoza. Degré de puissance ou intensité du conatusde la multitude dont les affects de joie nous donnent, en dernière instance, la mesure, et dans lesquels Aragüés voit le meilleur antidote pour contrer “l’esprit de sérieux, la pesanteur et la rigidité qui ont accompagné jusqu’à présent le militantisme”74. En somme, de tels affects de joie sont nécessaires pour contrebalancer les “passions tristes” dont – soulignons-le – la stratégie de l’identification globale préalable (autour de la position de classe), tout comme celle visant à exacerber les différences locales et autres particularismes (avec ce que cela implique en termes de “guerres culturelles” morcelées), constituent de puissants instigateurs, si opposées soient-elles. Rappelons d’ailleurs avec Aragüés que, ni le prolétariat ni les femmes, ni les étudiants ni les immigrés, ni les précarisés ni les marginalisés ne sauraient constituer à eux seuls le sujet collectif antagoniste ; bien au contraire, la multitude c’est tout cela, plus les liens qui découlent de leur mise en rapport machinique – soit la coordination de tous ces collectifs et de leurs “luttes minoritaires”.
Au vu de ce qui précède, on aura compris que le sujet collectif antagoniste, dont Aragüés fait le pari, ne saurait être confondu avec ce que Negri dénomme le “pouvoir constitué”. La multitude désigne au contraire un “pouvoir constituant” ou, pour reprendre la terminologie spinoziste, une “puissance” (potentia), mais une puissance qui, en reconstituant de manière endogène un pouvoir institutionnel (potestas), court constamment le risque de sombrer dans ce que la Critique de la raison dialectique avait identifié (sous le terme d’“institutionnalisation”) comme ce moment d’essoufflement où les groupes et les mouvements sociaux perdent de vue le projet de transformation qui était initialement le leur, et finissent par se durcir (“se reterritorialiser” rigidement, dirait Deleuze), ouvrant ainsi la voie à la restauration de dispositifs de capture qui tendent à les “séparer” de leur puissance (de comprendre et d’agir). Tel est donc, aux côtés de la dissolution chaotisante, l’autre risque majeur auquel s’expose (le pouvoir ou) la puissance constituante qui sous-tend tout processus révolutionnaire : celui de s’ankyloser et de se dénaturer sous la forme d’un “pouvoir constitué” (au sens négrien du terme). À cet égard, comme l’a bien souligné Sartre, la révolution russe et l’avènement postérieur du stalinisme expriment à la perfection ce mouvement par lequel la puissance constituante de la multitude, après avoir renversé l’ordre établi (le tsarisme), finit par faire l’objet d’une capture institutionnelle autoritaire (le Parti unique) qui détourne le sujet collectif antagoniste de son projet originel (la révolution), et dont la configuration dictatoriale conduit finalement “le révolutionnaire le plus radical” à devenir – dixit Bakounine – “pire que le Tsar lui-même”.
Parmi les dispositifs de capture ou les institutions qu’Aragüés juge obsolètes, il y a bien évidemment la forme-parti traditionnelle, dont l’extrême verticalité (ou transcendance) s’avère incompatible, selon l’auteur, avec l’affirmation matérialiste d’un sujet pluriel, protéiforme et ouvert au devenir – car toujours déjà traversé par la différence. Aussi “le défi qui nous attend [tient-il] à la production d’une forme organisationnelle qui soit capable de prendre en ligne de compte la pluralité, la diversité et la différence qui parcourent le sujet politique antagoniste”75. Il s’en suit alors la nécessité, selon Aragüés, de s’orienter vers des formes organisationnelles plus horizontales et flexibles… sans que, pour autant, il ne nous soit permis de faire l’économie de certaines modalités de représentation et de délégation : d’abord, pour des raisons pratiques relatives à la taille et à la complexité des sociétés humaines existantes ; ensuite, parce que l’assembléarisme à l’état pur, comme l’a bien souligné Rancière, conduit fâcheusement à la lassitude. Pour sa part, Aragüés propose donc d’hybrider l’assembléarisme avec des formes de représentation et de délégation strictement soumises au “contrôle citoyen” et trouvant notamment dans la révocabilité, le contrôle et la rotation des mandats l’une de leurs pierres angulaires. On aura donc compris que, pour Aragüés, renoncer à la forme-parti ne signifie nullement renoncer à tout mode d’organisation ; bien au contraire, c’est l’inefficacité politique avérée de l’individu isolé qui appelle l’organisation comme moyen de remédier à pareille “impuissance”. Sauf que, toutes les organisations ne se valant pas, il est nécessaire d’en promouvoir un certain type capable de produire et d’empuissantiser le sujet collectif antagoniste – un sujet dont on attendra légitimement en retour qu’il soit à même de conduire une politique axée sur les majorités sociales et le commun, soit une politique à la vue koinote76, si différente de ce regard idiot par lequel se caractérise, pour sa part, la forme-parti.
Enfin, pour s’assurer que la “multitude organisée” – que le lecteur nous pardonne pareille redondance – ne se dégrade en un “pouvoir constitué”, il faudra également veiller – comme le rappelle Aragüés, qui paraphrase ici Korsch – à “appliquer le pouvoir constituant aux organisations qui parlent de pouvoir constituant”77. Un pouvoir constituant dont le nom, par ailleurs, n’est autre que celui de “démocratie” et que l’on ne saurait confondre “avec le vain formalisme parlementaire qui caractérise nos sociétés néolibérales”78. De fait, si Aragüés décide de conserver ce concept ô combien galvaudé, c’est bien parce que – fort des enseignements de Sousa Santos – il considère qu’y renoncer n’est pas une option : en effet, le faire – comme le propose notamment Badiou – revient à l’abandonner à l’ennemi – qui n’hésite pas, lui, à s’en servir comme d’une arme pour discréditer par avance toute aspiration démocratique ne s’ajustant pas au cadre étroit de la “démocratie bourgeoise”. Pour Aragüés, la question n’est donc pas de faire un trait sur le concept de démocratie, mais bien plutôt de le resignifier : “il ne s’agit pas, dit-il, de chercher une alternative à la démocratie, mais de construire une démocratie alternative”79. Or, la construction d’une telle démocratie alternative devra être entreprise, comme nous le suggérions déjà, en marge de cette tentation lancinante qui a pour nom “démocratie directe”. En effet, de même qu’il s’avère impossible d’édifier une épistémologie pleinement matérialiste de la différence, de même il nous faut prendre acte – cette fois-ci sur le plan politique – de “l’impossibilité de trouver […] une démocratie pleinement démocratique, où chaque sujet jouirait d’une participation pleine et entière aux décisions politiques dans tous les domaines le concernant”80. Conserver cette mise en garde à l’esprit est une obligation à laquelle la politique antagoniste ne saurait déroger, elle qui entend s’ancrer à un diagnostic réaliste du réel : “ne pas se raconter d’histoire” (comme disait Althusser), telle est en effet la devise du réalisme critique. Or, ce que nous donne à voir pareil diagnostic matérialiste du réel ce sont, non seulement les forces centripètes des structures sociales, qui tendent à façonner de manière plus ou moins uniforme les manières de penser, de sentir et d’agir des hommes, mais aussi – et sous ces mêmes structures – le jeu des forces centrifuges des désirs et des affects par lesquelles ces mêmes hommes ont tendance à se différencier les uns des autres – soit l’hétérogène sous l’homogène, la différence derrière l’identité. Si la politique matérialiste, telle que la comprend Aragüés, a donc pour mission d’œuvrer à la constitution d’un sujet collectif antagoniste capable de renverser l’ordre établi, alors elle se doit avant tout de veiller à ce que la totalité politique – qu’elle contribue à ériger : la multitude – conserve ce caractère poreux et non clos, sans quoi elle perdrait en transversalité, donc en puissance et en droit. Rappelons en effet pour conclure que la différence est première ; que les hommes – singularisés comme ils le sont par leurs passions individualisantes – sont des différences ; et qu’il ne saurait y avoir de politique antagoniste efficace qui fasse l’impasse sur l’articulation des différences entre elles. Et Aragüés de conclure à propos de cet agencement crucial à tout point de vue : seuls “l’écoute, la traduction et le désir”81 seront en dernière instance à même d’y contribuer. L’écoute et la traduction, pour donner voix aux différences et leur permettre de se frayer une voie au milieu du même ; le désir du commun, pour fédérer ces différences autour de pratiques et de luttes partagées et leur éviter, ce faisant, de s’enliser dans des querelles de chapelle. “Dans cette époque, comme le rappelle très justement le Comité invisible, il faut considérer le tact comme la vertu révolutionnaire cardinale, et non la radicalité abstraite ; et par “tact” nous entendons ici l’art de ménager les devenirs-révolutionnaires”82.
Saragosse, juin 2021
Notes
- Deleuze, G., Guattari, F., op. cit., Paris, Minuit, 1972, pp. 36-37.
- Ibid., p. 125.
- Cf. Frank, T., Pourquoi les pauvres votent à droite, Marseille, Agone, 2013.
- Aragüés, J.-M., Désir de multitude. Différence, antagonisme et politique matérialiste, Introduction : “Repenser la politique”.
- Aragüés, J.-M., De idiotas a koinotas. Para una política de la multitud, Madrid, Arena Libros, 2020, p. 108. Nous traduisons.
- Cf. Malm, A., L’anthropocène contre l’histoire. Le réchauffement climatique à l’ère du capital, Paris, La Fabrique, 2017.
- Lordon, F., Figures du communisme, Paris, La Fabrique, 2021, p. 91.
- Cf. Dardot, P., Guéguen, H., Laval, C. et Sauvêtre, P., Le choix de la guerre civile, Montréal, Lux Éditeur, 2021, p. 14 : “On ne saurait […] imputer à la droite extrême le monopole de la stratégie néolibérale”.
- Aragüés, J.-M., Désir de multitude, op. cit., “Repenser la politique”.
- Cf. Althusser, L., “Le courant souterrain du matérialisme de la rencontre”, Paris, Éditions Stock, 1982.
- Ibidem.
- Aragüés, J.-M., Désir de multitude, op. cit., Chapitre I.
- Deleuze, G., Différence et répétition, Paris, Minuit, 1968, p. 80.
- Cf. Aragüés, J.-M., “La trampa de la identidad”, Diario El Salto – Edición General, 20 de noviembre de 2018.
- Cf. Bernabé, D., La trampa de la diversidad, Madrid, Akal, 2018.
- Aragüés, J.-M., Désir de multitude, op. cit., Chapitre I.
- Cf. Pardo, J.-L., La metafísica. Preguntas sin respuesta y problemas sin solución, Valencia, Pre-Textos, 2006, p. 42-45.
- Aragüés, J.-M., Désir de multitude, op. cit., Chapitre I.
- Pardo, J.-L., La metafísica, op. cit., p. 59. Nous traduisons.
- Aragüés, J.-M., Désir de multitude, op. cit., Chapitre I.
- Cf. Capizzi, A., Introduzione a Parmenide, Roma-Bari, Editori Laterza, 2000.
- Aragüés, J.-M., De idiotas a koinotas, op. cit., p. 31.
- En comprenant ici par pouvoir l’ensemble des dispositifs de capture permettant “la confiscation par les dirigeants de la puissance collective de leurs propres sujets”. Cf. Matheron, A., Individu et communauté chez Spinoza, Paris, Minuit, 1988, p. 20.
- Lordon, F., Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, Paris, La Fabrique, 2010, p. 54.
- Aragüés, J.-M., Désir de multitude, op. cit., Chapitre I.
- Deleuze, G., Différence et répétition, op. cit., p. 156.
- Cf. Spinoza, Traité politique, Paris, PUF, 2005, I, 1.
- Ce même sujet constituant dont Foucault annonçait la mort prochaine dans Les mots et les choses.
- Cf. Lordon, F., Capitalisme, désir et servitude, op. cit., p. 83.
- Cf. Spinoza, B., Éthique, Paris, Éditions de l’Éclat, 2005, Parties III et IV.
- Cf. Marx, K., “Thèses sur Feuerbach”, in Marx, K., Engels, F., L’idéologie allemande, Paris, Éditions sociales, 1968, pp. 31-34.
- Aragüés, J.-M., Désir de multitude, op. cit., p. Chapitre II.
- Lordon, F., Figures du communisme, op. cit., p. 79.
- Cf. Baudrillard, J., Le Crime parfait, Paris, Galilée, 1995, p. 18.
- Aragüés, J.-M., Désir de multitude, op. cit., Chapitre II.
- Canavera, J., Aragüés, J.-M., “Politique et affects chez Frédéric Lordon”, Implications philosophiques, 8 février 2021. Disponible en ligne : http://www.implications-philosophiques.org/politique-et-affects-chez-frederic-lordon/.
- Ibidem.
- León, J., “ARAGÜÉS, Juan Manuel (2019): Deseo de multitud. Diferencia, antagonismo y política materialista. Valencia: Pre-Textos”, Daimon. Revista Internacional de Filosofía, 2020, n.º 80, p. 223. Nous traduisons.
- Ibidem. Nous traduisons.
- Deleuze, G., Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, “Post-scriptum sur les sociétés de contrôle”, p. 245.
- Escalante, F., Historia mínima del neoliberalismo, Madrid, Turner Publicaciones, 2016, p. 88. Nous traduisons.
- Cf. Fischbach, F., La production des hommes. Marx avec Spinoza, Paris, Vrin, 2014.
- Ibid., p. 21.
- Deleuze, G., Logique du sens, op. cit., p. 298.
- Aragüés, J.-M., Désir de multitude, op. cit., p. Chapitre III.
- Ibidem.
- Ibidem.
- Zourabichvili, F., Deleuze. Une philosophie de l’événement, Paris, PUF, 1996, p. 36.
- Ibid., p. 35.
- Aragüés, J.-M., Désir de multitude, op. cit., Chapitre III.
- Ibidem.
- Ibidem.
- Deleuze, G., Critique et clinique, Paris, Minuit, 1993.
- Garo, I., “Les révolutions moléculaires : le paradoxe de la politique chez Gilles Deleuze”. Disponible en ligne : https://www.academia.edu/29778011/Les_révolutions_moléculaires_le_paradoxe_de_la_politique_chez_Gilles_Deleuze.
- Aragüés, J.-M., Désir de multitude, op. cit., p. Chapitre III.
- Cf. Lordon, F., Figures du communisme, op. cit., pp. 218-219.
- Comité Invisible, À nos amis, op. cit., p. 233.
- Aragüés, J.-M., Désir de multitude, op. cit., p. Chapitre III.
- Ibid., Chapitre IV.
- Deleuze, G., Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 1962, p. 108.
- Aragüés, J.-M., Désir de multitude, op. cit., Chapitre IV.
- Lordon, F., Imperium. Structure et affects des corps politiques, Paris, La Fabrique, 2015, p. 296.
- Deleuze, G., Guattari, F., L’Anti-Œdipe, op. cit., p. 138.
- Lordon, F., Les affects de la politique, Paris, Le Seuil, 2016, p. 168.
- Ibid., p. 57.
- Deleuze, G., Guattari, F., L’Anti-Œdipe, op. cit., pp. 50-51.
- Contradiction qui, précise l’auteur, peut être comprise comme la persistance en eux du schéma marxiste entre “classe en soi” et “classe pour soi”.
- Aragüés, J.-M., Désir de multitude, op. cit., Chapitre IV.
- Ibid., Chapitre V.
- Ibidem.
- Ibid., Chapitre IV.
- Lordon, F., Imperium, op. cit., p. 296.
- Aragüés, J.-M., Désir de multitude, op. cit., Chapitre IV.
- Ibidem.
- Ibid., Chapitre V.
- Néologisme forgé par l’auteur à partir du grec koinon (“commun”), par opposition au terme “idiot” provenant du grec idion (“particulier”, “propre à”).
- Aragüés, J.-M., Désir de multitude, op. cit., Chapitre V.
- Ibidem.
- Ibidem. Nous soulignons.
- Ibidem.
- Ibidem.
- Comité invisible, À nos amis, op. cit., p. 148.