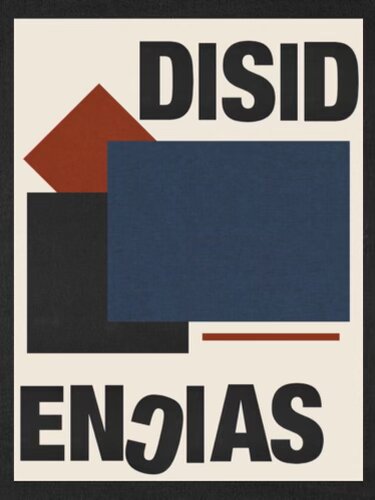Introduction
L’histoire de la philosophie occidentale, celle que l’on raconte dans les manuels scolaires, et qui fait l’objet d’exposés dans divers milieux académiques, porte en son cœur la marque profonde d’un héritage platonicien qui a fait de l’identité une vieille rengaine que l’on répète à satiété. On comprend mieux alors le dégoût justifié de Nietzsche face à l’extraordinaire pesanteur de siècles chargés de nihilisme et de transcendance ; ou la proposition de Deleuze visant à renverser le platonisme. De Platon à Hegel, ou, si l’on souhaite en prolonger le geste jusqu’à Habermas ou Rorty, Badiou ou Rawls, la philosophie dominante n’a eu de cesse de célébrer, de manière diverse, discrète et silencieuse, son triomphe originaire sur la différence. Un triomphe qui est à la fois célébré et tu, car la plus grande victoire est bien celle qui consiste à effacer les traces du combat pour naturaliser ce qui ne relève en fait que d’un coup de force politique. Car la transcendance est, en effet, l’allié naturel du pouvoir et de la pensée constituée. Soit des formes mêmes de l’identité.
La stratégie de “présocratisation” appliquée à la pensée grecque naissante, dont l’origine remonte aux milésiens et se déploie jusqu’au post-socratique Démocrite, répond, comme l’a bien souligné Onfray1, à la prétention de fixer l’origine véritable de la philosophie à partir de Socrate, et par conséquent, de Platon. Ce qui revient à dire qu’il n’existerait, avant eux, qu’un anecdotique “bric-à-brac” sur lequel il ne vaudrait même pas la peine de s’attarder. Et c’est ainsi que fut établi pour la postérité ce qu’il conviendrait d’appeler l’état-civil de la philosophie, une identité que la tradition s’est employée à conserver et renforcer au fil du temps. Les formes de la transcendance, ses hypostases fondatrices, ont bien pu évoluer au cours des siècles, elles n’en conservent pas moins intact le geste transcendant qui se tient en amont de la pensée philosophante. Un geste dans lequel la pensée religieuse célébrera d’ailleurs une manière philosophique de défendre et promouvoir une conception partagée du monde. Il est pourtant nécessaire de remettre en cause ce récit. En effet, le geste transcendant de Socrate et de Platon doit être entendu comme une réaction face à l’immanence radicale depuis laquelle la philosophie avait, quelques siècles auparavant, fait son apparition à l’horizon du discours. Car c’est bien en arrachant le cosmos aux griffes des dieux que la philosophie, apparue dans les poleis de l’Ionie, signe son acte de naissance.
Mythologie, transcendance, aristocratie
Avant la naissance de la philosophie, la mythologie constituait le discours prototypique de sociétés aristocratiques qui faisaient de la généalogie divine de la noblesse le fondement de leur pouvoir. Le mythe, qui était tissé par les actions conjointes des dieux et des héros, recherchait, dans la transcendance d’un discours religieux, des stratégies lui permettant de rendre raison de l’ordre naturel et social. Tout ce qui arrivait pouvait alors être expliqué par l’intervention des dieux, qui avaient été chargés de modeler le cosmos à partir du chaos originaire.
En ce qui concerne sa fonction explicative des événements naturels, le mythe occupait alors la place que l’on réserve dans l’actualité au discours scientifique. C’est ainsi que des questions comme celles relatives à l’origine de l’univers ou aux phénomènes météorologiques, qui, pour nous autres, relèvent de l’immanence de l’explication scientifique, étaient, selon le discours mythique, l’objet d’une explication en termes d’intervention divine, transcendante, surnaturelle. C’est Hésiode qui, dans sa Théogonie, ouvrage rédigé à la charnière du VIIIe siècle et du VIIe siècle av. J.-C., rassemblera la conception cosmologique des grecs :
Au commencement donc fut le Chaos, puis Géa au vaste sein, éternel et inébranlable soutien de toutes choses, puis dans le fond des abîmes de la terre spacieuse, le ténébreux Tartare, puis enfin l’Amour, le plus beau des immortels, qui pénètre de sa douce langueur et les dieux et les hommes, qui dompte tous les cœurs, et triomphe des plus sages conseils. Du Chaos et de l’Érèbe naquit la nuit noire…2
Au commencement du cosmos (ordre) était donc le chaos (désordre), qui sera ensuite dompté par le travail des divinités ou, comme l’écrit Platon, par le patient modelage que saura lui imposer le Démiurge3. Il ne fait aucun doute que les Grecs, dont le contact avec d’autres cultures vient de loin, s’approprièrent des mythes venus d’ailleurs, lesquels avaient pour fonction originelle de répondre aux inquiétudes propres de ces cultures. Il n’est en effet pas d’autre manière de comprendre la présence, dans le cadre grec, de la thématique mythique – ou “mythème” – du déluge, si commune à différentes cultures, mais dont le caractère explicatif des inondations périodiques propres aux sociétés mésopotamiennes, s’avérait dénué de sens s’agissant du climat sec de la péninsule balkanique. Pourtant, Deucalion, qu’on peut considérer comme une copie de l’Uta-Napishtim sumérien ou du Noé hébreu, semble bien avoir trouvé sa place dans la mythologie hellénique, par simple effet de contamination culturelle. Quoiqu’il en soit, il importe de souligner que le mythe, et c’est là l’une de ses prétentions les plus marquées, aspire à replacer les phénomènes naturels dans le cadre d’une logique de l’intervention divine qui garantit l’ordre cyclique du monde, et peut aussi expliquer des événements inattendus. Ainsi, le fait que la végétation réapparaisse annuellement suivant son cycle d’aoûtement et d’éclosion, ou le fait qu’une tempête inattendue vienne briser la douceur de la navigation en mer, donnera chaque fois lieu à une explication où les dieux – Déméter et Hadès, dans le premier cas, ou Zeus, dans le deuxième – auront laissé leur marque.
L’ordre naturel demeure donc soumis au dessein des dieux. Et il en va de même pour ce qui est du monde humain, où les diverses hiérarchisations qui en constituent l’ordre idéologique, sont également sanctionnées par les dieux. C’est ainsi que le rapport de domination de l’homme sur la femme, comme il sied à toute société patriarcale, est justifié par l’idée selon laquelle celle-ci serait à l’origine du mal qui dévaste la société. C’est d’ailleurs ce que met en évidence le mythe de Prométhée et de Pandore, dont les parallélismes avec le mythe d’Adam et Ève ont été amplement soulignés. Dans les deux cas, c’est bien la femme – Pandore, Ève – qui est chargée de convaincre l’homme – Adam, Épiméthée – d’accomplir une action dont la conséquence sera la fin de l’âge d’or et la soumission future des êtres humains aux rigueurs du travail, à la maladie et à la mort. Une sanction divine qui consacre donc la domination de l’homme sur la femme en raison de sa conduite manifestement répréhensible, mais qui envoie également aux hommes un message d’une grande fermeté: l’être humain ne doit pas même songer à se comparer avec les dieux, car la sagesse, présente dans l’arbre du bien et du mal, ainsi que le savoir technique, représenté par le feu, sont des privilèges divins.
Mais arrêtons-nous, ne serait-ce qu’un instant, sur le rapport social qui nous importe le plus : la question du pouvoir. Dans ce domaine, le mythe remplit sa fonction politique d’une manière extrêmement précise. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si c’est à la généalogie, soit à la référence aux ancêtres, que revient le rôle de justifier la domination de ceux qui détiennent le pouvoir. En effet, si la géographie du pouvoir s’inscrit dans l’aristocratie des héros, c’est précisément parce que ces derniers sont à l’origine des descendants des dieux. Le pouvoir se transmettant directement par la divinité aux descendants, il s’ensuit alors une neutralisation immédiate de la question relative à la convenance de la forme politique, puisque ce ne sont pas les hommes mais les dieux qui l’ont instaurée. Le début du texte homérique, dans son Iliade, nous livre à cet égard la formule synthétique de la pragmatique sociale. Ulysse, sur indication d’Athéna, parcourt l’assemblée de l’armée achéenne pour y mettre de l’ordre :
Quand il rencontre un roi ou un héros de marque, il s’approche et, avec des mots apaisants, il cherche à le retenir […]. Qu’il voie en revanche un homme du peuple et qu’il le surprenne à crier, il le frappe alors de son sceptre et il le gourmande en ces termes : “Grand fou ! demeure en place et tiens-toi tranquille ; puis écoute l’avis des autres, de ceux qui valent mieux que toi : tu n’es, toi, qu’un pleutre, un couard ; tu ne comptes pas plus au Conseil qu’au combat. Chacun ne va pas devenir roi ici, parmi nous, les Achéens. Avoir trop de chefs ne vaut rien : qu’un seul soit chef, qu’un seul soit roi — celui à qui le fils de Cronos le Fourbe aura octroyé de l’être.4
Dans ce passage, Homère souligne l’autorité du roi comme effet d’un don divin, et assoit les bases du principe monarchique face au manque de courage et à l’incompétence du dèmos, c’est-à-dire du peuple. Et, de surcroît, la machine homérique est loin d’être à court d’arguments :
Les autres donc s’assoient et consentent enfin à demeurer en place. Thersite, seul, persiste à piailler sans mesure. Son cœur connaît des mots malséants, à foison, et, pour s’en prendre aux rois, à tort et à travers, tout lui est bon, pourvu qu’il pense faire rire les Argiens. C’est l’homme le plus laid qui soit venu sous Ilion. Bancroche et boiteux d’un pied, il a de plus les épaules voûtées, ramassées en dedans. Sur son crâne pointu s’étale un poil rare. Il fait horreur surtout à Achille et Ulysse, qu’il querelle sans répit. Cette fois, c’est le tour du divin Agamemnon. Avec des cris aigus, il s’en va débitant contre lui force injures. Il est vrai que les Achéens gardent contre le roi, dans le fond de leur cœur, une rancune, un dépit furieux. Mais lui, c’est à grands cris qu’il cherche querelle à Agamemnon, disant :
“Allons ! fils d’Atrée, de quoi te plains-tu ? De quoi as-tu besoin encore ? Tes baraques sont pleines de bronze, tes baraques regorgent de femmes, butin de choix, que nous, les Achéens, nous t’accordons, à toi, avant tout autre, chaque fois qu’une ville est prise. Ou, encore un coup, as-tu besoin d’or ? — d’un or venu d’Ilion, que t’apportera un Troyen dompteur de cavales, pour racheter son fils, pris et lié par moi ou quelque autre Achéen. Ou bien encore d’une jeune captive, pour goûter l’amour dans ses bras et la garder pour toi seul, loin de tous ? Non, il ne sied pas à un chef de mener au malheur les fils des Achéens. Ah ! Poltrons ! Lâches infâmes ! Achéennes ! — je ne peux plus dire Achéens — retournons donc chez nous avec nos nefs, et laissons-le là, en Troade, à cuver ses privilèges. Il verra si nous sommes, ou non, disposés à lui prêter aide — lui qui vient encore de faire affront à Achille, un guerrier bien meilleur que lui. Il lui a pris, il lui retient sa part d’honneur ; de son chef, il l’a dépouillé. Achille n’a vraiment pas de rancune au cœur : il est longanime ! Sans quoi, fils d’Atrée, tu eusses ce jour-là lancé ton dernier outrage.”
Ainsi parle Thersite. Il cherche querelle à Agamemnon, pasteur d’hommes. Mais le divin Ulysse, vite, est près de lui ; sur lui il lève un œil sombre, il le tance avec des mots durs :
“Thersite, tu peux être un orateur sonore ; mais tu parles sans fin. Assez ! ne prétends pas tout seul prendre à parti les rois. Je te dis ceci, moi, il n’y a pas pire lâche que toi parmi tous ceux qui sont venus sous Ilion avec les fils d’Atrée […].”
Il dit, et, de son sceptre, il le frappe au dos, aux épaules. L’autre ploie l’échine, et de grosses larmes coulent de ses yeux : une bosse sanguinolente a sailli sur son dos au choc du sceptre d’or. Il s’assied, pris de peur, et, sous la souffrance, le regard éperdu, il essuie ses larmes. Et, malgré tout leur déplaisir, les autres à le voir ont un rire content ; et chacun alors de dire en regardant son voisin
“Ah ! Ulysse nous a souvent rendu d’utiles services, en ouvrant de bons avis, ou en menant le combat. Mais voilà bien, cette fois, ce qu’il a jamais fait de mieux en présence des Argiens : il a clos la bouche à cet insulteur, toujours à déblatérer. Son noble cœur ne le poussera plus, je pense, à prendre les rois à partie avec des mots injurieux.”5
Dans ce long passage, les dispositifs auxquels a recours Homère pour transmettre à l’auditoire quelques-unes des lignes générales du discours politique monarchique, sont au nombre de quatre :
- En premier lieu, et comme nous l’avons déjà souligné, la généalogie, c’est-à-dire la référence à l’origine divine des héros comme stratégie visant à justifier le fait que ces derniers détiennent le pouvoir.
- Deuxièmement, le discrédit jeté sur le procédé discursif mis en œuvre par le plébéien Thersite. Bien que celui-ci fasse montre d’une certaine habileté dans le maniement de la parole, celle-ci apparaît comme une parole décousue, désordonnée (acosma), et son discours manque d’ordre (atar ou kata cosmon), contrairement au discours bien construit et harmonieux des rois. Il convient de rappeler que la transformation du chaos en cosmos est, comme nous l’avons montré dans le cadre de notre description de la cosmogonie grecque, un privilège de la divinité. Comme on le voit, dans l’ordre du discours, seuls les fils des dieux sont capables de conférer de l’ordre (cosmos), c’est-à-dire aussi de la beauté, au langage. On comprend mieux dès lors l’importance de la lutte qu’entamera le dèmos, quelques siècles plus tard, notamment sous l’impulsion des Sophistes, pour triompher de l’ordre et du sens des mots, et réclamer en son propre nom la capacité d’organisation du chaos, de la parole et, par conséquent, de la réalité sociale.
- Troisièmement, ce passage fait entrer en jeu la théorie de la kalokagathia héroïque, opposée à la figure de Thersite et du peuple en général. Les héros d’Homère sont en effet des kaloï kai agathoï, soit – pour reprendre l’expression en sa forme contractée – des kaloskagathoï : ils sont beaux et bons. Pareille caractérisation du héros ne saurait d’ailleurs faire l’objet d’une remise en question : elle le définit comme tel, en son essence. À cette figure, Homère oppose celle de Thersite et du dèmos. Et c’est ainsi qu’Ulysse, dès lors qu’il s’adresse au peuple, le fait sans ménagement et le traite de “pleutre”, de “couard”, ce qui est une manière de sous-entendre que le peuple se trouve dépourvu de bonté, au sens où il n’est pas apte à accomplir certaines tâches. À l’image de Thersite qui, pour sa part, est l’expression personnifiée de la laideur, ainsi que le décrit le texte d’Homère : “Bancroche et boiteux d’un pied, il a de plus les épaules voûtées, ramassées en dedans. Sur son crâne pointu s’étale un poil rare”. La condition de kalos kagathos n’est donc qu’un trait caractéristique supplémentaire par le biais duquel le héros réaffirme une fois de plus sa parenté avec la divinité, contrairement à ce qui se passe dans le cas de Thersite.
- Enfin, en quatrième et dernier lieu, Homère met en œuvre un procédé de transfert grâce auquel il fait entendre au peuple ce qu’il doit penser à l’écoute de ce fragment. Rappelons que les poèmes homériques furent récités par les aèdes, durant des décennies, aux quatre coins de la Grèce, et que leur déclamation sur la place publique, loin d’opérer comme un simple instrument de divertissement, constituait aussi, et par suite, une efficace stratégie d’endoctrinement idéologique. C’est d’ailleurs pourquoi Homère, désireux d’éviter que ne naisse un sentiment de solidarité envers le plébéien malmené (après tout, Thersite appartient à la même classe sociale que ceux qui écoutent le poème sur la place publique), établit très clairement la réaction du dèmos dans le cœur du poème, escomptant qu’elle opère comme un modèle dans lequel le public se reconnaisse obligatoirement. Le fait qu’Homère invite le dèmos à saluer l’action d’Ulysse, à se féliciter de la répression de Thersite, constitue sans nul doute une stratégie idéologique de grande portée.
Dans tous les cas, il s’avère que la dimension politique et idéologique du mythe s’en trouve attestée, puisque c’est bien à travers lui qu’est clairement transmis le message d’après lequel seuls les aristoï, qui sont les meilleurs en ce sens qu’ils descendent de la divinité, possèdent le privilège d’intervenir dans la sphère politique, et d’exercer le droit à la parole. Le dèmos, quant à lui, doit demeurer muet et s’éloigner du logos politique. À l’inverse, le trait caractéristique du héros, dans la mesure où il est présenté comme le fils de la divinité, tiendra à l’absence de toute restriction portant sur son action, dont le seul et unique horizon sera d’atteindre son but. C’est pourquoi le héros développera une praxis individualiste dont l’hubris (c’est-à-dire la démesure et l’excès) constituera le trait le plus significatif. Et cet individualisme, comme nous allons le voir ci-après, est présent et déterminant dans différentes sphères de la société.
Deux traits distinctifs permettent ainsi de caractériser l’arété, la manière d’être du héros homérique : être à la fois “ faiseur de discours et faiseur d’actions”. C’est ce que souligne Rodríguez Adrados :
L’action guerrière et l’action politique apparaissent déjà ici comme étant indissolublement unies sous le concept d’excellence ou de vertu (arété) ; elles font toutes deux, nous dit-on, la renommée de l’homme, et c’est bien là la fin visée.6
En ce qui concerne la fonction guerrière, elle est marquée du sceau de l’individualisme, dans sa pratique comme dans ses objectifs. Ainsi le combat possède-t-il un caractère foncièrement individualiste puisque le héros homérique affronte son adversaire en faisant fi de toute stratégie collective, et ce dans le seul but de vaincre son ennemi choisi. C’est d’ailleurs cela qui a conduit J.-P. Vernant à définir la bataille de l’époque homérique comme une “mosaïque de duels singuliers”7. L’armement, le char, la lance, l’épée et le bouclier suspendu au cou du héros (et que ce dernier peut à tout moment porter sur ses épaules afin de mieux pourchasser l’ennemi en fuite) évoque clairement, face à la stratégie future de la phalange hoplitique, une action à caractère individuel. Le dénouement du combat, au terme duquel le vainqueur traîne le cadavre du vaincu loin du cœur de la bataille pour le dépouiller de son armure, attestant matériellement par là sa victoire, évoque également l’individualité de la lutte. Un combat dont la finalité n’est autre, pour le héros, que de parvenir à une victoire individuelle lui permettant d’accroître sa réputation et sa gloire. Loin de tout objectif à caractère collectif, le héros homérique ne vise donc rien d’autre que l’accroissement de sa légende personnelle. La recherche de la gloire demeure étrangère aux restrictions tactiques et aux objectifs collectifs, de sorte que sera considéré comme juste et opportun tout ce qui la mettra à la portée du héros.
Et même si le combat en vient à se solder par la mort du héros, ses funérailles constitueront l’occasion ultime d’agrandir encore son prestige personnel. Aussi pouvons-nous dire des funérailles venant couronner la mort au combat qu’elles constituent l’acte guerrier par excellence, celui au travers duquel l’exaltation de l’individualité atteint son paroxysme. La mort au combat parvient en effet à satisfaire simultanément deux objectifs : en premier lieu, elle vient couronner une vie de guerrier de la manière la plus paradigmatique qui soit, puisque le héros meurt en accomplissant son arété, en réalisant ce pour quoi il était né ; en deuxième et dernière instance, elle constitue le moyen grâce auquel la vie et la mort du sujet deviennent, pour l’aède (le poète), l’objet d’un chant en vertu duquel le héros vaincra, dans sa mort, la mort même ; car, comme le rappelle Nicole Loraux8, il ne saurait y avoir de mort plus grande que l’oubli. La mort (au combat) du guerrier donne lieu à tout un rituel autour de sa personne, devenue le centre de l’attention pour l’armée. Le héros ne fera pas seulement l’objet de chants et de lamentations lors du thrếnos déclamé par l’aède ; il sera, de surcroît, embelli avant d’être envoyé au bûcher funéraire. Voilà ce que Nicole Loraux dénomme le “Beau Mort”9, lorsqu’elle fait allusion au héros qui, dans sa mort, parvient au zénith de son être, aussi bien en vertu de la beauté de son corps exposé, qu’en raison de la gloire que lui confèrent ses exploits passés.
Le moment politique s’avère lui aussi imprégné d’individualité. Rappelons qu’Ulysse, dans le fragment de l’Iliade mentionné plus haut, souligne combien “avoir trop de chefs ne vaut rien”. Et c’est ainsi que revient au roi, au héros, au sein de son oikos10, la détention privilégiée et exclusive du pouvoir. Seul le roi, dépositaire de la loi et détenteur du sceptre, jouit du droit à la parole, instrument politique par excellence. Toute décision émanant de sa personne ne pourra qu’être juste, puisqu’il est lui-même source de justice, une justice (diké) qui se confond avec ses propres intérêts.
Récapitulons. Le mythe, comme nous avons pu l’observer au travers de ses multiples manifestations, constitue un discours de la transcendance. Un discours selon lequel l’instauration de l’ordre social et naturel est à mettre au compte d’une extériorité, qui n’est autre que la transcendance de la divinité. Les dieux sont les instances chargées d’instaurer l’ordre (cosmos), aussi bien dans le cadre naturel, que dans le cadre social. Et pour mener à bien cet objectif, ils bénéficient, notamment dans ce dernier cas, de la complicité de ceux qui, ici-bas, sont appelés à être leurs vicaires et leurs légitimes descendants : les aristoï. Une aristocratie sans frein, individualiste, parcourue par l’hubris, et dont le seul but est de satisfaire ses intérêts individuels. Les agissements des dieux grecs ont très souvent, en raison de leur caractère “humain, trop humain”, été l’objet d’un certain étonnement. Mais seuls peuvent être surpris ceux qui ignorent ce que Xénophane, pour sa part, savait déjà : ce sont les dieux qui sont le fruit d’une production humaine, et non l’inverse ; raison pour laquelle ils arborent les caractères sublimés de ceux-là mêmes qui en sont les producteurs. Du point de vue des hommes, les héros sont toujours considérés comme des demi-dieux, et du point de vue des dieux, il ne sont guère que des demi-hommes. Telle est donc l’étroitesse du lien qui unit la divinité aux rois, ce qui nous permet d’ailleurs de comprendre pourquoi le discours ayant servi de fondement à l’ordre social et naturel, c’est-à-dire le mythe, en est venu à s’éroder au moment même où la domination de l’aristocratie commençait à péricliter.
“Les aèdes disent bien des mensonges”.
La destitution du mythe dans la société de la polis
“Les aèdes disent bien des mensonges”, écrit Solon11, l’un des principaux responsables du processus de démocratisation qui commence en Grèce au VIe siècle av. J.-C. Comme l’a bien montré Marcel Detienne12, il n’est en effet pas étonnant que la poésie, cette machine à produire des discours fictionnels à forte teneur surnaturelle, se distingue des mécanismes par le biais desquels on a coutume d’accéder à la vérité, à l’alètheia. Une séparation, ou un déplacement, à l’œuvre dans les textes canoniques de la tradition, qui s’avère en Grèce d’une plus grande simplicité et efficacité que dans d’autres cultures ; ce n’est en effet pas un hasard si l’on parle ici de textes poétiques et de poètes, plutôt que de textes sacrés et de prêtres.
Entre le VIIe et le Ve siècles av. J.-C., va avoir lieu en Grèce un processus progressif d’érosion du pouvoir aristocratique, allant de pair avec la présence chaque fois plus marquée du dèmos dans la prise de décision politique. La transition de la société aristocratique à la polis, dont on retrouve la description dans les poèmes homériques, va requérir une mise en adéquation des caractéristiques du discours avec les nouvelles exigences sociales ; en un mot, un changement au sein de l’idéologie sociale. Le mythe qui, comme nous avons tâché de le montrer, était au service des intérêts politiques de l’aristocratie, se voit donc contraint de laisser place à de nouvelles formes discursives, davantage en phase avec la société émergente. Cela ne signifie pas que le mythe disparaisse, mais qu’il est déchu de son privilège d’expliquer le réel ; un pouvoir d’expliquer, dont il n’a plus le monopole, et qui est ainsi transféré, au terme d’un processus laborieux, à d’autres formes discursives, que l’on regroupera sous la dénomination commune de logos. Or, étant donné que l’un des traits distinctifs du mythe a toujours tenu à son caractère de discours englobant, où se logent toutes sortes de considérations relatives à la cosmogonie, à la cosmologie, à l’anthropologie, à l’éthique ou à la politique, il faudra donc à son remplaçant prendre en charge et assumer toutes ces dimensions. Une différence se fait alors jour et tient à ceci : alors qu’initialement toutes ces fonctions étaient assumées de façon monopolistique par le mythe, il s’avère désormais que ce dernier est voué à se dissoudre en une multiplicité de discours régionaux, tels que la philosophie, l’histoire ou la tragédie.
Mais intéressons-nous, pour l’instant, au champ social. Entre le VIIe et le Ve siècles, c’est au sein de nombreuses cités grecques, disions-nous, que s’est amorcé, bien que de manière inégale, un processus conjoint d’érosion du pouvoir aristocratique, et de développement des mécanismes donnant libre cours aux exigences du dèmos. L’apparition de codes recueillant les lois va ainsi impliquer de prendre en compte l’une des exigences fondamentales émanant des secteurs étrangers à l’aristocratie : le caractère public de la loi. C’est ainsi que, dans certains cas, comme celui d’Athènes, des législations vont faire l’objet de modifications visant à aménager un espace juridique apte à accueillir des propositions chaque fois plus en accord avec les intérêts dudèmos. Entre la première moitié du VIe siècle et la seconde moitié du Ve siècle, c’est bien Athènes qui sera appelée à devenir l’artisan d’une série de réformes législatives, qui, de Solon à Périclès, en passant par Clisthène et Éphialtès, aboutiront à l’érection d’un système démocratique envisageant la participation universelle des citoyens de la polis. Il nous faut également noter que ce processus politique va de pair avec un processus militaire, dans lequel se produit un accroissement progressif du corps de la milice. Il s’agit de la réforme hoplitique, qui instaure et promeut la phalange d’infanterie légère au rang de corps militaire fondamental, et ouvre ainsi les portes de l’armée à une partie non négligeable du dèmos, qui peut alors acquérir un équipement militaire dont le coût, minime, est désormais à la portée de la plupart des économies populaires. De plus, cet engagement militaire s’accompagnera d’une exigence de participer à la vie politique; en effet, celui qui, à ses risques et périls, s’engage à défendre la polis, souhaitera, du même coup, faire valoir son droit à se prononcer sur les prises de décisions concernant la cité. Tel est donc le lien existant entre la fonction militaire et politique, dont les rameurs nous donnent, par ailleurs, l’illustration parfaite : issus des strates les plus défavorisées de la population, ceux-ci seront, en raison de leur contribution vitale aux batailles maritimes, parmi les premiers à achever le processus d’expansion du corps citoyen à Athènes.
Ce changement politique s’accompagne d’une transformation au sein de l’idéologie sociale qui se traduit par l’effacement progressif des critères individualistes, dont nous avons brossé le tableau dans le cadre de la société homérique, au profit d’une revendication grandissante à l’endroit du commun et du collectif. Comme nous l’avons vu, l’activité militaire et politique homérique est marquée du sceau de l’individualisme (dans sa pratique comme dans ses fins), et face à cela, la polis s’emploiera à instaurer des pratiques collectives qui finiront par gagner les domaines politique et militaire.
À plus d’un égard décisive dans la transformation sociale en cours, la nouvelle forme de combat définie par la réforme hoplitique, donne lieu à deux phénomènes incontournables : d’un côté, elle engendre une praxis solidaire parmi les membres de la phalange ; de l’autre, elle contribue à l’expansion du corps militaire, et par suite, à celle du corps politique. Dans ce dernier cas, nous avons déjà souligné combien l’apparition de l’infanterie légère, représentée par la figure de l’hoplite, facilite l’accès aux fonctions militaires à un plus grand nombre de citoyens qui, en retour, vont exiger leur droit de participer aux prises de décisions politiques. L’hoplite conjugue en lui les deux facettes, militaire et politique, du citoyen. Mais, qui plus est, il s’avère que la phalange modifie profondément les modalités du combat, en faisant de ce dernier une action collective, voire solidaire. Et ce pour de nombreuses raisons. En premier lieu, raison pratique oblige, il se trouve que le succès de la phalange et la sécurité de l’hoplite dépendent directement de la coordination de ses membres. Le bon hoplite est celui qui sait progresser au même rythme que ses compagnons, et qui se soumet à la discipline collective. Entre autres, parce que la sécurité de l’hoplite est directement liée à la protection que lui garantit le bouclier de son compagnon d’armes. D’autre part, l’hoplite ne doit à aucun moment succomber à l’hubris, au désir personnel de gloire ou de vengeance, faute de quoi il compromettrait le sécurité et l’intégrité du groupe. Le but ultime de son action n’est autre que la victoire de la phalange, et non le succès individuel, contrairement à ce qui se passait avec le héros. L’hubris laisse ici place à la sôphrosunè, c’est-à-dire à la tempérance qui se doit d’accompagner toute action, et qui s’avère bénéfique pour le groupe, la polis. Vernant résume magistralement toutes ces questions :
L’apparition de l’hoplite, lourdement armé, combattant en ligne, son emploi en formation serrée suivant le principe de la phalange, portent un coup décisif aux prérogatives militaires des hippeis. Tous ceux qui peuvent faire les frais de leur équipement d’hoplites, – c’est-à-dire les petits propriétaires libres formant le dèmos, comme sont à Athènes les Zeugites –, se trouvent placés sur le même plan que les possesseurs de chevaux. Mais, là encore, la démocratisation de la fonction militaire – ancien privilège aristocratique – entraîne une refonte complète de l’éthique du guerrier. Le héros homérique, le bon meneur de chars, pouvait encore se survivre dans la personne du hippeus ; il n’a plus grand-chose de commun avec l’hoplite, ce soldat-citoyen. Ce qui comptait pour le premier, c’était l’exploit individuel, le haut fait accompli en combat singulier. Dans la bataille, mosaïque de duels, où s’affrontent les promachoi, la valeur militaire s’affirmait sous forme d’une aristeia, d’une supériorité toute personnelle. L’audace qui permettait au guerrier d’accomplir ces actions d’éclat, il la trouvait dans une sorte d’exaltation, de fureur belliqueuse, la lussa, où le jetait, comme hors de lui-même, le menos, l’ardeur inspirée par un dieu. Mais l’hoplite ne connaît plus le combat singulier ; il doit refuser, si elle s’offre, la tentation d’une prouesse purement individuelle. Il est l’homme de la bataille au coude à coude, de la lutte épaule contre épaule. On l’a entraîné à tenir le rang, à marcher en ordre, à s’élancer d’un même pas contre l’ennemi, à veiller, au cœur de la mêlée, à ne pas quitter sa place. La vertu guerrière n’est plus alors de l’ordre du thumos ; elle est faite de sôphrosunè.13
Le combat et la victoire deviennent alors des enjeux collectifs. Lorsque Cimon, en qualité de général de l’armée athénienne, s’adresse au peuple et lui demande à être récompensé pour la victoire que ses troupes ont remportée face aux perses sur le Strymon, Athènes accepte bien d’ériger trois Hermès en pierre sur le Portique d’Hermès, mais elle se refuse à y inscrire le nom de Cimon, afin de ne pas donner l’impression que c’est au général, et non à la cité, que revient la gloire.14
Les funérailles connaissent à Athènes le même sort que celui qui a été réservé au combat. Nous voilà désormais face à un événement également collectif, et survenant pour la plus grande gloire de la polis. Désormais, les morts au combat feront l’objet d’un hommage collectif, sous forme de funérailles d’État présidées par un archonte. Durant les funérailles, les corps sont présentés à la cité de manière anonyme, sans éléments distinctifs permettant de les identifier afin que soit mise en relief leur commune condition de soldats de la cité ayant donné leur vie pour elle. Le Beau Mort laisse place à la Belle Mort, c’est-à-dire à celle qui survient durant la défense de la cité. C’est pourquoi l’oraison funèbre, prononcée par le magistrat, fera l’éloge de la cité dans son ensemble, et non du soldat en particulier. Dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse, Thucydide recueille quelques-unes des oraisons funèbres prononcées par Périclès, où c’est bien à la cité que revient le premier rôle. Les funérailles constituent, d’ailleurs, une magnifique occasion d’exalter les valeurs propres à l’Athènes démocratique :
Notre constitution politique n’a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins ; loin d’imiter les autres, nous donnons l’exemple à suivre. Du fait que l’État, chez nous, est administré dans l’intérêt de la masse et non d’une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui concerne les différends particuliers, l’égalité est assurée à tous par les lois ; mais en ce qui concerne la participation à la vie publique, chacun obtient la considération en raison de son mérite, et la classe à laquelle il appartient importe moins que sa valeur personnelle.15
Citoyens de la meilleure des cités qui soient, vous donnerez votre vie pour elle :
Telle est la cité dont, avec raison, ces hommes n’ont pas voulu se laisser dépouiller et pour laquelle ils ont péri courageusement dans le combat ; pour sa défense nos descendants consentiront à tout souffrir.16
Il ne saurait y avoir de plus grande gloire que de mourir en défendant la cité :
Faisant en commun le sacrifice de leur vie, ils ont acquis chacun pour sa part une gloire immortelle et obtenu la plus honorable sépulture. C’est moins celle où ils reposent maintenant que le souvenir immortel sans cesse renouvelé par les discours et les commémorations. […] Aussi ne m’apitoierai-je pas sur le sort des pères ici présents, je me contenterai de les réconforter. Ils savent qu’ils ont grandi au milieu des vicissitudes de la vie et que le bonheur est pour ceux qui obtiennent comme ces guerriers la fin la plus glorieuse ou comme vous le deuil le plus glorieux et qui voient coïncider l’heure de leur mort avec la mesure de leur félicité.17
Le combat et les funérailles sont donc l’expression de cette nouvelle idéologie de la polis où le collectif prime sur l’individuel. La polis elle-même incarne, à sa manière, ce sens de la collectivité, en cela qu’elle s’approprie les valeurs et pratiques permettant d’endiguer l’individualisme homérique. Concernant ces valeurs, rappelons que l’hubris héroïque laisse place à la sôphrosunè, soit à une modération dans les comportements qui sera toujours conditionnée à l’intérêt commun. Aussi ne serait-il pas abusif de soutenir que la sôphrosunè constitue la valeur rectrice de l’univers de la polis, celle qui résume le mieux les aspirations de la cité. Une cité qui, à travers ses pratiques politiques, démonte le modèle aristocratique afin d’accueillir progressivement en son sein la participation du dèmos. Si Homère fait dire à Ulysse combien est inopportun le gouvernement du plus grand nombre, c’est bien la cité qui constituera l’horizon à partir duquel cette grande majorité pourra accéder aux fonctions politiques, à l’usage de la parole. L’iségorie, l’égal accès à la parole, s’oppose alors au silence auquel était condamné le dèmos dans les poèmes homériques. De même, l’idéal d’égalité devant la loi, ou isonomia, jouira d’une présence constante au sein de la réalité citoyenne et du discours politique.
Il ne fait donc aucun doute que l’apparition de la polis entraîne un changement de paradigme idéologique, une rupture avec les valeurs, principes et pratiques qui avaient prévalus jusqu’alors au sein de la société homérique, et dont le mythe était devenu l’instrument théorique. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le changement social va nécessairement de pair avec une transformation du discours, le mythe ayant cessé, dans la société nouvelle, d’assumer les fonctions régulatrices qui étaient les siennes. Et c’est notamment le cas pour la politique, au regard de laquelle il est évident qu’un discours légitimant le pouvoir de l’aristocratie et condamnant le dèmos au silence constitue une attaque directe à l’encontre de l’idéologie de la polis. C’est donc dans ce contexte-là que surgira le logos, cette forme nouvelle de discours dont l’ambition consistera à porter un regard neuf sur le réel, dans sa dimension sociale aussi bien que naturelle. Un regard neuf chargé d’immanence et en opposition directe avec la transcendance de la pensée aristocratique. Ce logos est par nature multiple, en ce sens qu’il résulte de l’éclatement du mythe en une multitude de formes nouvelles de savoir-pouvoir. D’où le fait que le discours se spécialise en “régionalisant” la réalité, et en apportant une réponse théorique à chacune de ses parcelles. Le logos, c’est la philosophie, mais c’est également l’histoire ou la tragédie. Aussi, face à la conception traditionnelle qui voit dans le passage du mythe au logos la naissance de la philosophie, et qui, par suite, attribue à cette dernière l’exclusivité du logos, nous considérons, pour notre part, qu’est tributaire du logostout discours visant à appréhender le réel, social ou naturel, sous le prisme de l’immanence la plus radicale.
La philosophie : le discours de l’immanence
Mais intéressons-nous pour l’instant à la philosophie. Cette dernière, disions-nous, arrache le cosmos des griffes du divin. Il ne fait d’ailleurs aucun doute qu’elle est, en ce sens, le domaine où l’on assiste au dépassement du mythe le plus rapide et vigoureux qui soit ; rappelons en effet que la première école de philosophie, l’École de Milet, et ce dès la fin du VIIe siècle av. J.-C., énonce les conditions de possibilité du dépassement du discours mythique. Et la condition fondamentale de ce dépassement est, comme nous l’avons déjà dit, l’immanence. Immanence dans l’explication de l’origine du cosmos, immanence dans la réflexion sur la nature. Lorsqu’elle est interrogée sur l’origine de l’univers, la mythologie – les mythologies – fait immanquablement entrer en jeu des références surnaturelles : ce sont les dieux qui ont mission de créer et d’ordonner correctement le cosmos, mais aussi d’en assurer le bon fonctionnement. Ici, la transcendance imprègne le discours. Mais lorsque la philosophie aborde la question pour la première fois, elle le fait depuis la plus radicale des immanences. Élevée au rang de trait distinctif de l’École de Milet, la question portant sur l’origine du cosmos fera ainsi l’objet d’une réponse formulée depuis l’intérieur même du cosmos. Thalès, Anaximandre et Anaximène vont en ce sens se référer aux éléments constitutifs du cosmos pour tenter d’y apporter une réponse. L’Eau et l’Air sont les éléments respectivement choisis par Thalès et Anaximène en guise d’archè, d’origine ou cause de l’univers. Ici, le cosmos explique le cosmos, aussi bien en ce qui a trait à son origine qu’en ce qui concerne son fonctionnement. C’est ainsi que les physiciens milésiens s’emploient à mettre en lumière la mécanique du cosmos en proposant une explication physique de la phusis (la nature). Ce n’est donc pas un hasard si l’on trouve chez Thalès un regard scientifique sur la nature qui, pour ne citer qu’un exemple, lui permettra de prédire une éclipse. Hérodote, parmi bien d’autres, nous en propose le récit :
Pendant cinq années qu’elle dura, les Mèdes et les Lydiens eurent alternativement de fréquents avantages, et la sixième il y eut une espèce de combat nocturne car, après une fortune égale de part et d’autre, s’étant livré bataille, le jour se changea tout à coup en nuit, pendant que les deux armées en étaient aux mains. Thalès de Milet avait prédit aux Ioniens ce changement, et il en avait fixé le temps en l’année où il s’opéra.18
Le surnaturel, quand il n’en est pas tout bonnement évincé, n’occupe qu’une place marginale dans l’explication du réel, et ce à tel point que l’affirmation d’après laquelle “tout est pétri de dieux”19 peut être comprise comme une manière de dissoudre les divinités dans le réel, tel que le soutient Gustavo Bueno :
“Tout est pétri de dieux” : voilà donc le véritable coup de grâce qu’assène Thalès de Milet à la religion. Car on ne détruit pas les dieux en les niant mais en affirmant partout leur présence. Si tout est pétri de dieux, c’est parce qu’il n’y a plus de lieu particulier qui leur soit réservé, plus d’Olympe sacré : les astres sont divins, mais d’une divinité qui n’est pas moindre que celle de la roche la plus humble. La nature est inépuisable – l’eau est toujours plus que de l’eau – mais il n’y a rien en elle qui soit source d’étonnement ou motif d’animosité, car tout ce qui existe dans les cieux existe également en nous-mêmes.20
Si nous avons laissé Anaximandre pour la fin, c’est parce que nous pensons qu’il est possible de trouver dans ses textes un grand nombre d’éléments se rattachant à l’univers idéologique de la polis. Plus encore, nous allons tenter de montrer que chez Anaximandre le langage de la philosophie emprunte son vocabulaire au champ du social, celui de la politique et de la polis. Commençons par sa référence à l’archè du cosmos.
Sur cette question, il ne fait aucun doute que la proposition d’Anaximandre s’avère plus confuse et obscure que ne l’est celle de Thalès et d’Anaximène : sa référence à l’apeiron, à l’indéterminé ou à l’illimité, semble en effet s’éloigner de cette immédiateté physique par laquelle se caractérise la proposition de ses condisciples. Or, s’il est clair que l’apeiron a fait l’objet de diverses interprétations, l’une d’entre elles nous paraît s’inscrire plus particulièrement dans le contexte philosophique de son temps. Il s’agit de celle selon laquelle l’apeiron est compris comme le résultat d’un équilibre entre les quatre éléments de la nature : l’eau, l’air, la terre et le feu. Et l’on ne peut faire ici l’économie du texte aristotélicien qui sous-tend cette interprétation. Dans sa Physique, Aristote écrit ainsi :
Il n’est pas possible non plus que le corps infini soit un et simple, ni, comme le prétendent certains, qu’il soit ce qui est en dehors des éléments et à partir de quoi ils sont advenus, ni qu’il existe absolument. Certains, en effet, font de cela l’infini, et non l’air ou l’eau, pour que les autres éléments ne soient pas détruits par celui d’entre eux qui est infini – car ils ont entre eux une contrariété […], et si l’un d’entre eux était infini, il détruirait dès lors les autres – mais en réalité, disent-ils, il existe une autre chose d’où viennent ces éléments.21
D’après la lecture aristotélicienne, l’apeiron désigne quelque chose qui ne saurait en aucun cas être assimilé à l’un de ces quatre éléments. De fait, si assimilation y il avait, il s’ensuivrait alors que l’excès de l’apeiron, par nature illimité, en viendrait à se superposer au reste des éléments et, par suite, à y mettre un terme. C’est pourquoi on peut considérer que ce n’est pas forcer outre mesure le sens ultime du texte que d’envisager l’apeiron en l’espèce d’une stratégie visant à dépasser (ou à neutraliser) l’hubris potentielle de l’un de ces éléments. L’apeiron devient une garantie d’équilibre entre les éléments. Le passage suivant de Vernant abonde d’ailleurs en ce sens :
La primauté accordée par Anaximandre à l’apeiron vise à garantir la permanence d’un ordre égalitaire où les puissances opposées s’équilibrent réciproquement de telle sorte que si l’une domine un moment, elle sera à son tour dominée, si l’une avance et s’étend au-delà de ses limites, elle reculera autant qu’elle s’était avancée pour céder la place à son contraire. L’apeiron ne représente pas, comme le ferait tout autre élément, une réalité particulière, un idion, mais le fond commun à toutes les réalités, le koinon, ce qui est aussi bien air, feu, terre et eau sans être aucun d’entre eux, ce qui les comprend tous et les unit les uns aux autres, sans s’identifier à aucun.22
Cette lecture politique de l’apeiron, au sens où il est ici fait référence à la polis, est avalisée par la cosmologie d’Anaximandre, au sein de laquelle le langage politique occupe une place de choix.
C’est à Diogène Laërce, à Hippolyte et à Aristote que l’on doit de nous avoir transmis l’essentiel de la cosmologie d’Anaximandre, ou, du moins, les aspects de cette dernière qui, selon nous, importent le plus. Nous prenons la liberté de reproduire ci-après les trois fragments suivants :
- 154 (12 A1) Diogène Laërce, II 1 :
La terre, selon lui [Anaximandre], est située au milieu de l’univers ; elle en est le centre ; sa forme est sphérique.23 - 155 (12 A11) Hippolyte, I 6, 3 :
La terre est librement suspendue, sans être soumise à la domination de quoi que ce soit ; elle est en repos par sa distance égale vis-à-vis de toute chose.24 - 156 (12 A26) Aristote, Du Ciel, II 13, 295b :
[…] Il y a d’autres philosophes, qui prétendent que la terre reste en repos par son propre équilibre. Telle est, parmi les anciens, l’opinion d’Anaximandre ; selon lui, il n’y a pas de raison pour qu’un corps qui est placé au centre et est à une distance égale des extrémités, soit porté en haut plutôt qu’en bas, ou dans une direction oblique ; et comme il est impossible que le mouvement se fasse en même temps en des sens contraires, ce corps doit nécessairement demeurer immobile et en repos.25
Les trois textes que nous citons ici sont imprégnés d’une terminologie dont les résonances politiques ne font aucun doute : la situation de la Terre, “au milieu de l’univers” dont “elle est […] le centre”, tel que le soutient Diogène Laërce ; sa condition de “[n’] être soumise à la domination de quoi que ce soit”,hipo medenos kratoumene, en raison de sa “distance égale”, homoian, comme le souligne Hippolyte, ou, de son “équilibre”, homoiotes, selon l’expression d’Aristote. En Grèce, le centre est le lieu politique par excellence, le lieu depuis lequel le sujet politique s’adresse à l’assemblée, et ce aussi bien durant l’époque homérique qu’au temps de la cité. La conception de la Terre comme centre de l’univers confère donc à la cosmologie d’Anaximandre des résonances incontestablement politiques. Toutefois, le centre politique opère différemment selon qu’il désigne l’assemblée des héros, fils des dieux, ou la cité. Au sein de l’assemblée homérique, le centre est le lieu privilégié du pouvoir, lieu interdit à qui en est dépourvu, et depuis lequel le pouvoir se diffuse à travers le corps social. Toute personne n’étant pas investie de ce pouvoir doit impérativement se garder d’approcher le centre, lequel constitue, par conséquent, la plus grande distance politique. Inversement, dans la cité, le centre devient le lieu commun où les citoyens peuvent exprimer, sans contrainte, leurs opinions. Le centre citoyen égalise et rend les citoyens maîtres de la parole ; il fait d’eux les porteurs solidaires du pouvoir de la polis. Aussi pourrait-on dire de celui parvenant à s’approprier la parole qu’il se trouve, comme la terre d’Anaximandre, hipo medenos kratoumene, soustrait à toute forme de domination. Mû par un désir d’“équité”, le citoyen qui, depuis le centre de l’assemblée, s’adresse à ses pairs, devient dès lors la voix de la polis et de ses intérêts collectifs. En observant ces ressemblances entre le langage cosmologique et le langage politique, il est permis de souligner combien Anaximandre transforme sa conception du cosmos en un reflet de l’organisation idéale de la polis naissante. C’est également en ce sens que l’entend Vernant, lorsqu’il soutient que “la nouvelle image sphérique du monde a été rendue possible par l’élaboration d’une nouvelle image de la société humaine dans le cadre des institutions de la polis”.26
Aussi n’est-il peut-être pas malvenu, afin de mieux comprendre et mettre en relief la contamination politique à laquelle est sujet le discours philosophique, de s’arrêter, ne serait-ce qu’un instant, sur l’engagement social des auteurs appartenant à l’École de Milet. Car il n’y a, à vrai dire, rien de plus injuste que de dresser le portrait d’un Thalès en sage éloigné du réel ; portrait que la tradition nous a transmis et qui a contribué à forger une image erronée du philosophe astronome. Un geste qui n’a certainement rien d’innocent, si l’on considère que le Théétète (le dialogue platonicien qui évoque la figure de Thalès) s’appuie sur une version simplifiée et dénaturée de l’une des fables d’Esope27. Or, c’est précisément une telle volonté d’éloigner le philosophique du réel, du pratique et du social, qui a, tout au long des siècles, forgé la ligne de pensée dominante. À cette image d’un Thalès éloigné des préoccupations de son temps, il convient d’ opposer la réalité : celle d’un Thalès acteur politique de premier rang, comme le rapportent notamment Hérodote et Diogène Laërce. Ce dernier s’empresse de souligner l’habileté politique d’un Thalès, qui “a toujours su conseiller de la meilleure des manières”, et qui, ce faisant, “sauva l’État”28. Quant à Hérodote, il nous livre une information à tous égards cruciale :
Avant que l’Ionie ne fût détruite, le milésien Thalès, d’ascendance phénicienne, eut une idée brillante : il exhorta les ioniens à établir un unique siège pour le Conseil à Téos (car Téos se situe au milieu de l’Ionie), et à faire en sorte que les autres États, sans ne rien perdre de leur population, fussent considérés comme des districts.29
Aussi retrouvons-nous à nouveau cette conception du centre comme lieu privilégié de l’action politique, mais cette fois-ci chez Thalès. Quant à Anaximandre, il a lui aussi sa place dans la politique ionienne, puisque, nous dit-on, “il fut responsable de la colonie de Milet à Apollonie”30. Ainsi, les auteurs chargés de produire un nouveau discours, en rupture avec la tradition mythique, ont-ils également mission d’organiser la nouvelle société de la polis, laquelle aspire à étouffer les formes aristocratiques dont le mythe avait été jusqu’alors le porte-parole.
Or, ce rôle n’incombe pas aux seuls milésiens. Des auteurs traditionnellement associés, dans la lecture péripatéticienne, à la chose métaphysique, tels que Parménide ou Héraclite, peuvent également faire l’objet, comme le montre Antonio Capizzi, d’une lecture soucieuse de la force politique qui les traverse. Dans le cas de Parménide, Capizzi interprète et traduit ses fragments d’une manière radicalement nouvelle et en rupture avec les lectures traditionnelles, l’enrichissant de références politiques destinées à le soustraire au “Pays de la Conceptualité Pure”31 où la tradition dominante l’avait reclus. C’est ainsi que le préambule à son Poème se voit dépouillé de ses composantes mystiques et mythiques, pour faire place à la trajectoire réelle d’un Parménide voué à accomplir une action politique cruciale : celle consistant à œuvrer en qualité d’ambassadeur au sein d’une cité, Élée, plongée dans un profond conflit social. Pour ce faire, Capizzi recourt, d’une manière extrêmement efficace, à l’archéologie et à la numismatique32. De la sorte, lePoème parvient à déborder la clé de lecture logico-ontologique et à acquérir une dimension éthico-politique : seule la cité unie, la voie de l’Être, peut faire face aux dangers qui la menacent, et qui sont, pour la cité d’Élée, les desseins expansionnistes des phéniciens et des syracusains.
C’est donc dans le cadre d’une société démocratique naissante que l’immanence vient présider au geste philosophique originaire. Une immanence qui n’est pas uniquement le fait du discours philosophique, mais que l’on retrouve aussi bien à l’œuvre dans la conception de l’histoire léguée par Thucydide (qui recherche dans l’action humaine les causes de l’évolution sociale), qu’au sein de la tragédie attique du Ve siècle, qui, d’Eschyle à Euripide, s’attelle à une critique croissante des valeurs aristocratiques33. Une immanence qui, par ailleurs, ne s’érige jamais en rempart contre un autre concept qui commence alors à prendre forme et place dans la philosophie qui s’élabore avant Socrate et Platon : celui de la différence. Le tournant anthropologique imposé par les Sophistes à la pensée philosophique se produit également dans le cadre d’une stricte immanence, qui va soumettre la subjectivité à une double médiation : celle de l’espace et celle du temps. L’homme, comme nous le rappelle Protagoras, est la mesure de toute chose et devient une médiation incontournable en matière d’interprétation et d’évaluation du réel. Mais, de surcroît, il s’avère que la subjectivité est soumise au kairos, à l’occasion, au moment, de sorte que ses postures peuvent évoluer au cours du temps. Dès sa naissance, la sophistique prend donc acte de la différence constitutive des subjectivités, qu’elle érige au rang de donnée difficilement contestable.
Mais face à tout cela, et à tout ce qui précède, les voix de Socrate et de Platon s’élèvent, et s’ensuit alors une formidable opération dans laquelle les éléments théoriques et politiques avancent une nouvelle fois de concert. Le dispositif socratico-platonicien s’attelle alors à une tâche de re-transcendantalisation qui a pour conséquence principale de faire retour à l’univers mythique. Si Dodds a pu parler d’une réaction platonicienne34, c’est bien parce que, ontologiquement et politiquement parlant, Platon récupère, tout en l’actualisant, l’horizon homérique dans le but de produire un discours teinté de transcendance et d’aristocratisme. Tout le contenu matérialiste, qui avait imprégné la réflexion philosophique initiale dans le champ de l’ontologie, est contesté via un étonnant récit où la matière est dévalorisée au profit d’une prétendue réalité transcendante : le monde des Idées. Tel est donc le premier tour de force de l’idéalisme : un exercice délirant consistant à remettre en cause le domaine du tangible et, parallèlement, à doter l’ineffable d’une existence réelle, suivant une démarche qui relève davantage de la foi religieuse que de la raison philosophique. Mais telle sera désormais, et malgré tout, l’orientation discursive de la philosophie dominante.
Cette opération de re-transcendantalisation ontologique, au sein de laquelle l’explication du monde est à rechercher en dehors de ce dernier, va aboutir à la normalisation de l’identité face à la différence. Le réel dans sa totalité reste soumis à une identité primordiale, dont le modèle eidétique nous fournit la forme. Par rapport à ce modèle, la différence n’est que divergence, dégradation, anomalie. Or, si la prétention de toute copie n’est ni plus ni moins que d’être identique à son modèle, il s’ensuit alors que la différence, dont toute copie est inévitablement porteuse, exprime en elle l’existence d’une défaillance à la fois condamnable et répréhensible, qui constitue, en dernière instance, le propre de l’imperfection caractéristique du monde sensible.
La machine de guerre théorique socratico-platonique apparaît dans un contexte politique bien précis, celui d’une lutte féroce entre la démocratie et l’aristocratie, dans laquelle nos deux philosophes prennent parti pour les positions les plus élitistes. Pour ces derniers, en effet, la démocratie est la pire forme de gouvernement possible, et c’est pourquoi tout l’effort théorique de Platon vise à fonder une polis à caractère éminemment aristocratique, où la participation populaire aux prises de décisions politiques, qui avait constitué l’un des grands acquis des luttes sociales du VIe et du Ve siècles av. J.-C., n’a désormais plus sa place. Pour ce faire, Platon met en jeu une hiérarchisation anthropologique, adossée au dualisme ontologique que nous avons évoqué, en vertu de laquelle la politique devient le privilège des sages. À cet égard, il convient de noter la frappante proximité qui se fait jour entre le portrait du nouveau riche que brosse Platon dans le livre VI de la République, ce “forgeron chauve et de petite taille”,35 et la description de Thersite que fait Homère dans l’Iliade. Aussi bien Socrate que Platon orchestrent une subtile opération théorique au moyen de laquelle ils inversent les effets que la sôphrosunè avait favorisés au sein de la société athénienne classique. Nombreux sont les auteurs ayant souligné l’efficacité du rôle qu’a joué le concept de sôphrosunè dans la construction de la polis démocratique. En effet, alors que la société aristocratique de l’époque homérique avait promu l’hubris, la démesure et l’absence de toute restriction ou obligation collective au rang de vertu caractéristique du héros, la polis naissante s’emploiera, pour sa part, à articuler une idéologie nouvelle où le collectif sera voué à occuper une place de choix. Dans cette dynamique-là, la sôphrosunè joue un rôle d’autant plus central qu’elle se transforme en un dispositif permettant de régler efficacement le comportement du citoyen sur les besoins de la polis. Le succès de la tragédie dans l’Athènes du Ve siècle tient d’ailleurs, selon Vernant et Vidal-Naquet, à la nouvelle vision qu’elle offre du monde, où l’hubris héroïque apparaît, aux yeux de la cité, comme un véritable problème. Le citoyen ne devient citoyen qu’en exerçant comme hoplite, c’est-à-dire comme soldat d’infanterie, dont l’action se fait au rythme collectif de la phalange, suivant la cadence marquée par le joueur de flûte, et dont la finalité n’est pas, contrairement au héros, le succès personnel, mais bel et bien celui de l’armée à laquelle il appartient. Socrate et Platon inversent donc l’idéal desôphrosunè en faisant de la maxime delphique du “connais-toi toi-même” un mécanisme d’auto-régulation subjective imposant à l’individu de se connaître lui-même (soit de reconnaître quel est le type d’âme qui prédomine en lui) afin de remplir au mieux la fonction sociale qui lui correspond. De cette façon, si la sôphrosunè avait auparavant servi à contenir l’hubris aristocratique, elle devient, avec Socrate et Platon, un instrument permettant d’éradiquer la participation politique du dèmos : étant donné que prédomine dans ce dernier l’élément irrationnel de l’âme concupiscente, il s’ensuit alors que sa fonction sociale devra impérativement se limiter au seul travail manuel, toute participation à la prise de décision politique étant dorénavant exclue.
Conclusion
En résumé, le premier épisode de la philosophie, caractérisé par un fort matérialisme immanentiste et par une première ébauche de la question de la différence, est balayé par la réaction socratico-platonicienne dans le cadre d’une lutte féroce entre démocratie et aristocratie. Et c’est à partir de ce moment-là que la tradition philosophique dominante s’est employée, soit à effacer les traces de tout discours matérialiste (à l’instar de celui de Démocrite, dont pratiquement aucun des très nombreux écrits n’est parvenu jusqu’à nous), soit à en reformuler les termes en vue de les ajuster au lit de Procuste d’une histoire de la philosophie construite pour la plus grande gloire de l’idéalisme.
Pour toutes ces raisons, effacer les traces de vingt siècles de domination idéaliste n’est pas une mince affaire, mais indiscutablement une vaste entreprise dont les principaux jalons ont déjà été posés au cours du XIXe et du XXe siècles, de Marx à Deleuze, en passant, assurément, par Nietzsche. Les pages qui suivent sont une modeste tentative de récupérer le geste inaugural de la philosophie, celui qui fit la part belle à l’immanence et à la différence, mais qui fut rapidement supplanté par un discours qui alla jusqu’à usurper le concept de philosophie lui-même, pour le transformer en rien de moins qu’une théologie légèrement sécularisée. Penser à partir d’une position véritablement matérialiste, afin de construire une politique digne de ce nom: telle est donc la tâche que nous proposons ici d’entreprendre. Althusser avait coutume de dire que nous, les matérialistes, sommes capables d’expliquer aux idéalistes pourquoi ils pensent ce qu’ils pensent. Reste maintenant à voir si nous serons vraiment capables de penser de manière différente.
Notes
- Onfray, M., Les sagesses antiques, Paris, Grasset, 2006, p. 53.
- Hésiode, Théogonie, Paris, Typographie Georges Chamerot, 1872, pp. 8-9. Traduction nouvelle de M. Patin [NdT].
- Il ne semble pas anecdotique que Platon, le grand récupérateur de la transcendance, ramène l’origine du monde des Idées à l’intervention démiurgique, telle qu’elle s’exerce à même le chaos originaire.
- Homère, Iliade, Paris, Gallimard, 1975, II, pp. 58-59.
- Ibid., II, pp. 59-61.
- Rodríguez Adrados, F., La democracia ateniense, Madrid, Alianza, 1983, p. 37. Nous traduisons.
- Vernant, J.-P., Les origines de la pensée grecque, in Vernant, J.-P., Œuvres. Religions, Rationalités, Politique, Paris, Seuil, 2007, p. 196.
- Loraux, N., “La Belle mort et le cadavre outragé”, in Vernant, J.-P., La mort, les morts dans les sociétés anciennes, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1982, p. 55.
- “Mourir devant Troie, tomber pour Athènes : de la gloire du héros à l’idée de la cité”, ibid., p. 28.
- Finley, M., Le Monde d’Ulysse, Paris, Seuil, 2002.
- García Gual, C., Los siete sabios (y tres más), Madrid, Alianza, 1989, p. 32.
- Detienne, M., Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Paris, Le Livre de Poche, 2006.
- Vernant, J.-P., Les origines…, op. cit., pp. 195-196.
- Detienne, M., “La phalange : problèmes et controverses”, in Vernant, J.-P., Problèmes de la guerre en Grèce ancienne, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études, 1985, p. 128.
- Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, Paris, Librairie Garnier Frères, 1966, Livre II, p. 120.
- Ibid., p. 123.
- Ibid., pp. 124-125.
- Hérodote, Histoire d’Hérodote, Paris, Charpentier Librairie-Éditeur, 1850, Livre I, 74, p. 60.
- AA. VV., Los filósofos presocráticos, Madrid, Gredos, 1986, vol. I, p. 70.
- Bueno, G., La metafísica presocrática, Oviedo, Pentalfa, 1974, p. 82. Nous traduisons.
- Aristote, La Physique, Paris, Vrin, 1999, Livre III, 204b23, p. 139.
- Vernant, J.-P., Mythe et pensée chez les Grecs, Paris, Éditions La Découverte, 1988, p. 234.
- Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes de l’Antiquité, Paris, Charpentier, 1847, Livre II, Chap. I, p. 62.
- Apud. AA. VV., Los filósofos presocráticos, op. cit., p. 119.
- Aristote, Traité du ciel, Paris, Librairie Philosophique de Ladrange, 1866, Livre II, Chap. XIII, pp. 202-203.
- Vernant, J.-P., Mythe et pensée chez les Grecs, op. cit., p. 213.
- Dans le Théétète, Platon, par l’intermédiaire de Socrate, fait de Thalès le personnage d’une fable ésopique, laquelle ne parlait dans un premier temps que d’ “un astronome”. Sur ce point, voir Blumenberg, H., La risa de la muchacha tracia, Valencia, Pre-Textos, 2000, pp. 21-22. [Trad. fr. Le Rire de la servante de Thrace, Paris, L’Arche, 2000. NdT.]
- AA. VV., Los filósofos presocráticos, op. cit., p. 63.
- Ibidem.
- Ibid., p. 83.
- Capizzi, A., La Repubblica cosmica, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1997, p. 10.
- Capizzi, A., Introducción a Parménides, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2016.
- Vernant, J.-P., Vidal Naquet, P., Mythe et tragédie en Grèce antique, Paris, Maspero, 1972.
- Dodds, E., Les Grecs et l’irrationnel, Paris, Flammarion, 1977.
- Platon, La République, in Platon, Œuvres complètes, Paris, Libraire Garnier Frères, 1950, 495b, p. 224.