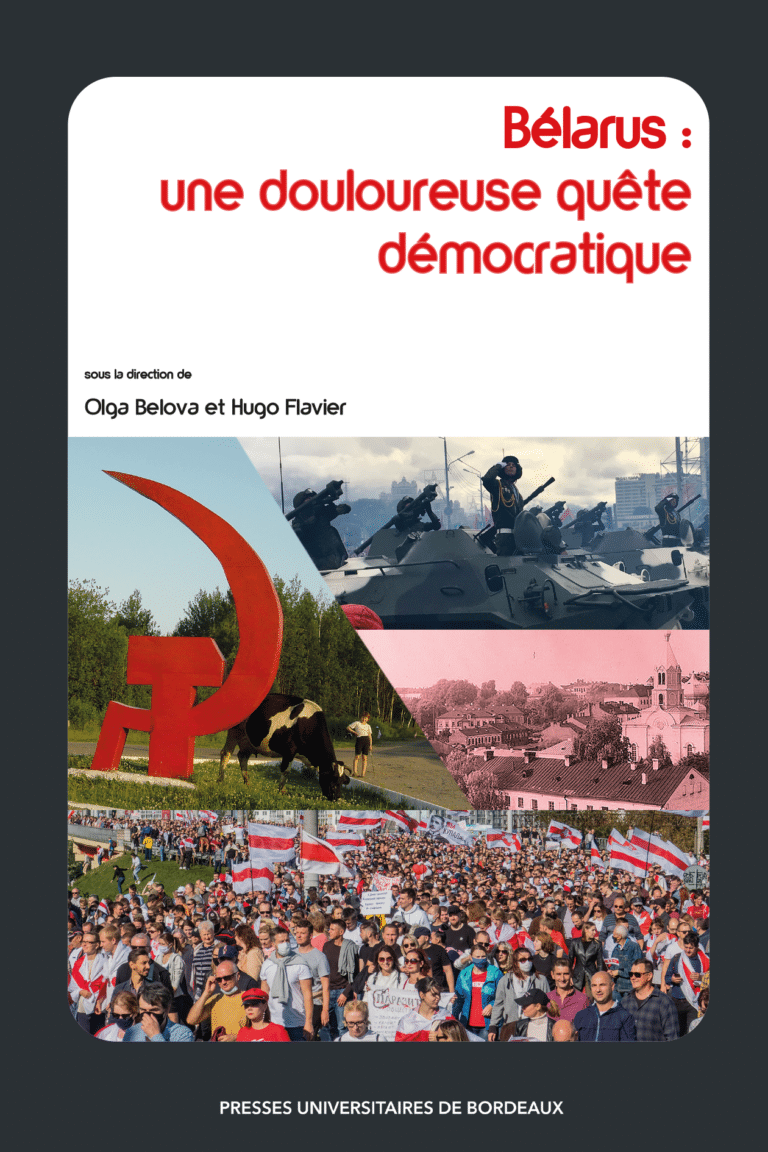S’interroger, comme nous y invitent les organisateurs de cette rencontre, sur les usages et significations données au droit international, à ses règles, lorsqu’il est question de révolutions ou, plus généralement, de protestations populaires, est une démarche ambitieuse, sinon vertigineuse. La « révolution » constitue assurément une grande et belle question de droit international. Chacun saura se souvenir que celui-ci protège et trouve même ses fondements dans la souveraineté, et s’abstient, par principe, d’intervenir dans les affaires intérieures des États. On dira toutefois tout autant du droit international qu’il consacre d’autres droits, éventuellement contradictoires avec ce que laisserait supposer cette neutralité de principe, tel le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Voici, brossé grossièrement, le dilemme posé en et par le droit international : celui de valeurs et intérêts, souvent antagonistes, qu’il lui faut hiérarchiser, ou à tout le moins s’efforcer d’ordonner.
Si grande et belle soit-elle, cette question ne pose pas moins, d’emblée, un épineux problème de définition. Identifier la révolution au sens du droit international n’est pas chose évidente. Rares sont les textes, ou auteurs, qui ont accompli cet effort de qualification des phénomènes que le droit international désignerait comme révolutionnaires, par opposition à ceux qui, tout en s’approchant de cette catégorie juridique, ne l’intègreraient pas. Un exemple saisissant de cette difficulté a été donné par la Commission du droit international dans le projet d’articles relatifs à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. L’article 10 dudit projet envisage l’hypothèse du « rebelle triomphant » et le problème de l’attribution des comportements d’un « mouvement insurrectionnel » qui devient le nouveau gouvernement de l’État. Mais il échoue à définir ce qu’il s’agirait d’entendre par cette dernière expression1. Une pratique internationale plus ancienne s’était déjà fait l’écho de ce problème de définition, dès les années 1930. Dans l’affaire Georges Pinson, la Commission franco-mexicaine des réclamations avait ainsi relevé l’indétermination de la notion de révolution2, aussi bien en doctrine que dans la jurisprudence internationale :
« [s]i les auteurs et les tribunaux internationaux tâchent de classer un peu les différents mouvements qui peuvent mettre en péril l›ordre public dans un État, tels que : émeutes, troubles, désordres, soulèvements, séditions, insurrections, révoltes, rébellions, révolutions, guerres civiles, guerres intestines, etc., et leurs équivalents également nombreux en d’autres langues, ou bien ils ne mentionnent pas du tout spécialement les révolutions, ou bien ils ne font pas de distinction nette entre celles-ci et les autres troubles, ni entre ces derniers entre eux, pour se borner à la remarque générale que tous ces mouvements forment, pour ainsi dire, une échelle de désordres, ascendante selon leur caractère plus ou moins grave pour l’ordre public »3.
Des travaux doctrinaux de l’époque, on retiendra toutefois déjà l’amorce d’une approche conséquentialiste, au sens où serait susceptible d’être qualifiée de révolutionnaire, le trouble ou l’émeute qui provoque un changement de régime. Cette réflexion se prolongera au fil des époques, et l’on trouve, bien des années plus tard, un éclairage particulièrement précieux dans les travaux de la Société française pour le droit international consacrés, l’année de la célébration du Bicentenaire de la Révolution française, à « [r]évolution et droit international ». Dans les propos d’ouverture du colloque qui s’était alors tenu à Dijon, les professeurs Burdeau et Leben relevaient encore la relative discrétion des études doctrinales, aussi bien françaises qu’étrangères, dédiées au phénomène révolutionnaire et à son appréhension par les règles et principes du droit international4. Cette histoire dijonnaise ne manquait d’ailleurs pas d’ironie puisque ces journées d’étude se déroulaient au moment des évènements de la place Tienanmen, et peu de temps avant ceux de la Roumanie et des nombreux autres soubresauts d’Europe de l’est, qui allaient jouer « la grande scène de la révolution des peuples »5. Si la coïncidence temporelle devait, en cette fin de décennie 1980, ainsi confirmer l’actualité brûlante de ces débats académiques, nul doute que les quelques trente années qui nous séparent de cette époque n’auront nullement entamé l’intérêt de poursuivre ces recherches, qu’il s’agit ici, et aujourd’hui, d’associer au cas biélorusse et aux protestations populaires survenues au cours de l’été 2020.
Du reste, la littérature consacrée à ces questions se sera, depuis la fin de la guerre froide, considérablement renouvelée, alimentée il est vrai par de multiples insurrections et « rébellions »6 à l’autorité étatique, mais également par les problèmes hautement théoriques que drainent ces situations. Quelle qu’ait été leur issue, victorieuse ou non, ces situations posent d’abord un problème de principe, vis-à-vis du droit, se caractérisant essentiellement par l’idée que le protestataire « n’emploie pas [en de tels contextes] les voies légales pour contester l’autorité »7. Devant la contestation de l’autorité de ses règles, le système juridique se trouve ainsi tenu de réagir, soit en résistant à l’affront et en organisant la sanction de ceux à qui il impute le trouble, soit éventuellement en tolérant ce dernier. Là toutefois se présente l’aporie, identifiée en ces termes par la doctrine : « le droit semble (…) avoir pour vocation à réprimer la rébellion, et à traiter de ses conséquences, mais il ne peut prétendre domestiquer, ou même réglementer les modalités de la rébellion dans son essence même. En d’autres termes, on semble confronté ici à un dilemme (…) : “comment le droit peut-il en même temps poser la règle et énoncer les circonstances légitimes de sa violation ?”. Car l’ouverture de nouvelles possibilités légales pour remettre en cause une loi, un règlement ou une décision ne fait que déplacer le problème. Si l’on y réfléchit, en effet, lorsque les opposants utilisent ces nouvelles possibilités, ils perdent alors leur qualité de “rebelles”, la rébellion étant par essence toujours insatisfaite du système juridique existant »8.
Des rapports entre droit international et révolution, la réflexion doctrinale internationaliste a su, malgré ces difficultés conceptuelles, identifier les principaux ressorts, et notamment relever que les termes du couple droit international / révolution sont réversibles puisque donnant également à s’interroger sur les révolutions du droit international. L’on sait toutefois que le peuple n’y a, ici, pas toujours, et même plutôt rarement, sa place, nombre de révolutions juridiques ayant eu lieu, non sous la pression populaire ou sous l’effet d’un changement de titulaires du pouvoir politique, mais du seul fait de l’intervention d’un juge ! L’on retient également des travaux juridiques consacrés à ces questions l’influence de certaines révolutions nationales sur le contenu même du droit international, avec, comme exemple choisi, les répercussions qu’auront entrainées, de façon durable, les révolutions française et bolchévique. Dans un papier resté célèbre, et consacré à la Révolution française et à son influence sur le droit international, René-Jean Dupuy suggérait que la force qui a porté les révolutions n’était pas celle qui cherchait à modifier l’ordonnancement international, mais bien plutôt celle qui libère le peuple du régime intérieur auquel il était assujetti9. Dans le même temps, les expériences révolutionnaires russe et française auront, paradoxalement, contribué à augmenter la puissance de l’État. La chose est connue ; les soviétiques convoqueront à l’envi le concept de souveraineté étatique pour favoriser leurs thèses et intérêts nationaux10. Quant à l’Histoire française, elle aura montré que la Révolution a, certes, mis fin à l’État dynastique, mais y a substitué l’État-nation. Au plan international, il n’était donc nullement question d’une perte ou d’un effritement du pouvoir politique. On en voudrait pour preuve les discours juridiques, d’essence volontariste, ayant accompagné ces transformations et justifiant que les États n’aient nulle autre obligation à assumer que celles qu’ils auront eux-mêmes décidé d’accepter. Le droit international demeure, du reste, encore profondément traversé par ce type de discours et de représentations qui, comme l’avait encore montré le professeur Dupuy, font de la souveraineté de l’État-nation le pendant de la liberté pour l’individu. De cette souveraineté dérive tout autant l’égalité entre les Nations. L’égalité souveraine.
L’Histoire des révolutions ne va toutefois pas moins fortement influencer la validité juridique accordée aux actes des gouvernants, selon qu’ils sont despotes ou démocrates. Dans son texte, Dupuy rappelle, pour l’illustrer, d’autres épisodes historiques qui se sont inscrits dans le prolongement des thèses révolutionnaires victorieuses. Les évènements de 1789 et leur suite auront eu pour effet de vider de toute validité les anciens « accords conclus entre tyrans », notamment ceux passés par la Monarchie française avec la Royauté espagnole11. De façon plus remarquable encore, les révolutionnaires français affirmeront, les premiers, certains grands principes, tel le libre exercice du droit des peuples, ou encore la faculté de porter la liberté aux autres en intervenant, au besoin, dans les affaires intérieures des autres États. Plus qu’une simple faculté, il s’agissait, dans l’esprit révolutionnaire français, d’un véritable devoir que celui d’agir au soutien du combat libérateur d’un peuple. L’article 16 de la Déclaration de 1789 qui prévoit que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution » pouvait ainsi être compris, dans sa dimension internationaliste, comme ouvrant ce droit d’intervention12. À l’époque contemporaine, cet héritage révolutionnaire aura trouvé l’un de ses principaux prolongements dans la célèbre résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, dite Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre États, laquelle reconnaît aux États tiers la faculté d’assister un peuple opprimé dans son droit à la libre disposition. Comme il a pu toutefois être justement rappelé, l’on peut douter que de telles situations mettent à proprement parler en cause la problématique de la révolution, puisqu’il s’agit plutôt ici « pour le peuple de revendiquer l’indépendance par la voie de la sécession, conduisant ainsi à la création d’un nouvel État »13.
Des traces, donc, les révolutionnaires en auront manifestement laissé en nombre, même si l’analyse de la situation biélorusse doit essentiellement nous conduire à confirmer que le droit international se trouve, encore aujourd’hui, replié sur des principes qui se seront maintenu à travers les âges, essentiellement ceux protégeant la souveraineté, bannissant l’ingérence, et connaissant pour seules exceptions quelques situations strictement définies qui mettent en cause le droit à l’autodétermination – mais que le cas biélorusse, comme nous le redirons, ne concerne pas. Pour ces mêmes raisons, et guidé par des principes ou notions, tels celui de non-ingérence dans les affaires intérieures, de « domaine réservé » de l’État, ou encore de « compétence nationale », l’intuition du juriste pourrait être de considérer que le phénomène révolutionnaire ne relève pas du périmètre couvert par les règles internationales, tant il entretient un rapport intime avec la souveraineté ; qu’il devrait, de surcroît, être mis en relation avec le seul droit national, et plus particulièrement avec le droit constitutionnel. Et pour cause, la révolution, telle qu’on peut chercher à la définir, semble se caractériser par la rupture qu’elle induit dans le pouvoir de l’État, rupture qui se réalise dans des conditions non conformes aux règles de fonctionnement de l’État, principalement à sa constitution14. La révolution est ainsi le plus souvent abordée au titre de l’une de ses conséquences les plus immédiates : celle du changement de régime politique qu’elle provoque15. L’on peut, de la même façon, définir les protestations comme une démarche avortée de changement, c’est-à-dire un mouvement qui échoue à mettre un terme à l’action politique contestée et aux mandats de ceux qui la conduisent. Ces définitions, qui seront retenues pour les analyses à suivre, s’avèrent sans doute extrêmement larges, réservant finalement un statut identique aux tentatives de révolutions populaires et de coups d’État. Or, si ces deux situations ont en commun l’idée d’un changement du titulaire du pouvoir en rupture avec l’ordre constitutionnel, le coup d’État se singularise en ce que le changement est, cette fois, imposé par le haut et aux dépens du peuple. Dans les deux cas, on retrouve bien l’idée d’une « méconnaissance des procédures existantes relatives à la désignation des détenteurs effectifs du pouvoir »16 ; dans l’hypothèse d’un coup d’État, c’est également et surtout sa possible issue, celle du renversement d’un gouvernement démocratique, qui conduirait – au moins pour un majorité d’États incluant naturellement toutes les autres démocraties – à y voir un fait international illicite17, la démocratie étant présentée comme un « processus irréversible » et toute entorse à ce mouvement général apparaissant comme une anomalie que la communauté internationale se doit de désapprouver18. L’analyse juridique fondée sur la définition que l’on retient connaît donc, en un sens, ses limites. En s’en tenant à ce seul substrat, celui du changement inconstitutionnel de gouvernement, elle méconnaît tout une gamme variée de situations placées sous l’investigation des autres disciplines, au premier rang desquelles la science politique.
Pour le propos qui nous concerne, il faut surtout relever, de façon peut-être contre-intuitive, que ces différents phénomènes apparaissent désormais, dans une certaine mesure, justiciables du droit international et de ses préceptes. Sous l’effet notamment de la reformulation des rapports entre droit international et constitutionnel, l’idée d’une frontière naturelle et immuable entre ces sphères semble aujourd’hui datée. Pour en résumer l’essentiel, car cette question déborde de loin la seule appréhension de la question révolutionnaire, l’internationaliste aura, tout au long du XXe siècle, assisté au dépassement de l’indifférence de principe du droit international à l’égard de l’organisation politique des États, et à des phénomènes d’infiltration de normes, d’origine internationale, cherchant à contraindre le pouvoir national jusque dans sa forme même19. Le développement du droit constitutionnel et du droit international auront progressivement conduit à l’exercice d’influences réciproques, – telles l’internationalisation des constitutions nationales, mais encore, l’importation en droit international de logiques constitutionnelles et l’idée d’une hiérarchisation de ses normes20 – de sorte qu’il n’apparaît plus incongru d’inclure le second (le droit international) dans la grille d’analysede la crise politique biélorusse et de faits relevant, de prime abord, du seul premier (le droit constitutionnel).
La question qu’il s’agit d’affronter est toutefois loin d’être évidente. Comment et jusqu’à quel point le droit international est-il prêt à influencer le phénomène révolutionnaire et à travers lui, la question démocratique – c’est-à-dire l’obligation qui serait faite à l’État d’organiser son pouvoir, de le faire exercer par des représentants élus par le peuple et dans le respect de certains principes et valeurs, notamment le respect des droits fondamentaux ? C’est en tout cas l’interrogation qu’inspire légitimement l’observation de la situation politique biélorusse, à l’été 2020. Remarquons d’ailleurs à ce même sujet que « l’argument » du droit international a été, jusqu’à lors, mobilisé avec parcimonie dans l’analyse de la crise biélorusse, y compris par ceux qui cherchent à défendre et légitimer l’opposition au pouvoir. Le tout donnerait à comprendre que le contenu même du droit international n’est pas, même encore aujourd’hui, sans comporter une part d’indétermination, voire même une réelle ambiguïté. L’incertitude trouve plusieurs explications, essentiellement deux. La première tient à ce que la situation de révolution demeure encore relativement peu déterminée ou influencée par la sphère internationale, au sens où rares sont les règles issues de cette sphère qui s’y trouvent spécifiquement consacrées. Du reste, si tant est que l’on parvienne à isoler un « droit international de la révolution », avec des normes et principes en nombre suffisant, il resterait encore à découvrir leur juste signification, et l’apport qu’ils seraient susceptibles de représenter pour des peuples en lutte contre un pouvoir non démocratique. Le deuxième facteur qui brouille sans doute la juste compréhension des choses tient à ce que la révolution, telle qu’on l’a précédemment définie, est une situation factuelle susceptible de déclencher l’application d’une série de régimes juridiques ne portant pas spécifiquement sur la question révolutionnaire, mais qui seraient malgré tout susceptibles d’y attacher des conséquences juridiques de différentes natures, et d’intensité variable.
Au sujet d’un « droit international de la révolution »
Le droit international a été bâti sur l’idée d’une neutralité, au sens d’une indifférence de principe à l’égard des questions agitant la vie politique des États et des formes de gouvernement dont ces derniers décident de se doter. Si cet héritage a été, pour sa part la plus essentielle, conservé à travers les âges, les vicissitudes la vie internationale contemporaine ont pu toutefois lui donner de nouvelles aspérités.
Le positionnement initial : la neutralité de principe du droit international
Cette neutralité, ou indifférence, signifie qu’aucune conséquence juridique n’est censée être attachée par l’ordre juridique international au renversement d’un régime et plus généralement aux « mutations organiques du pouvoir »21, y compris lorsque le changement apparaît illégitime et aboutit à une usurpation du pouvoir22. Pour dire simplement les choses, si l’on adopte le point de vue du droit international, il importerait moins de savoir les États dirigés par des démocrates que par des gouvernants en capacité de se faire obéir de la population et ainsi d’imposer le respect des normes internationales. Disposer d’une telle mécanique, et être assuré de sa fiabilité, c’est là la condition même d’un droit inter-national, partagé par les différents peuples. Longtemps, l’ordre international aura ainsi ignoré la structure constitutionnelle des États et les procédures par lesquelles leurs organes sont conduits à exercer leur pouvoir sur leurs sujets. On rappellera les mots de l’arbitre William H. Taft dans la célèbre sentence Tinoco de 1923, qui jugeait au sujet de la reconnaissance d’État que « si l’examen auquel procèdent les États étrangers porte non sur l’effectivité du pouvoir, mais sur l’illégitimité ou l’irrégularité de ses origines, le refus de reconnaissance perd quelque chose de sa force probante au regard des seules questions dont doivent s’occuper ceux qui ont pour mission d’appliquer le droit international »23. En cela, on conçoit que le système international est par essence réactionnaire, puisqu’il vise d’abord l’effectivité et la stabilité du pouvoir. Ces deux qualités apparaissent comme les conditions nécessaires à l’épanouissement des normes internationales et à leur réalisation. Si la stabilité est troublée, le système international s’accommodera toutefois de l’autorité nouvelle, pourvu qu’elle se trouve en capacité d’imposer son autorité.
Cette neutralité de principe se concrétise essentiellement dans l’attitude des États tiers qui, assistant à une révolution, ne disposeraient d’aucun droit d’intervention, de réaction, ni même de jugement critique de la situation, sous peine de faire ingérence. Plus fondamentalement, la neutralité traduit l’absence de norme internationale générale d’interdiction d’un changement inconstitutionnel de gouvernement. L’on devrait, pour certains, y déceler une lacune du droit international24, mais qui traduit surtout l’absence de volonté des États de réglementer des situations purement internes. Là ne s’arrête toutefois pas le « calcul » du droit international : contre son indifférence, ce dernier troque en quelque sorte un statu quo au plan juridique. L’État dont le régime politique est l’objet du trouble ne peut l’invoquer en vue de se défaire de ses engagements internationaux, et notamment ceux contractés avant les évènements. Ce principe, ancien, avait notamment été consacré dans la jurisprudence arbitrale du début du XXe siècle, à l’égard des dettes publiques25. L’ordre juridique international postule, en d’autres termes, la continuité de l’identité de l’État, et de ses devoirs internationaux, même dans les cas où ses structures politiques se trouvent profondément bouleversées. Plus tard, ces principes se heurteront à de fortes résistances, à l’image de celles de l’ordre nouveau socialiste refusant d’être solidaire des obligations acceptées par l’ancien État bourgeois. La chose est bien connue, ne serait-ce qu’à travers le cas des « emprunts russes », qui en avait livré témoignage.
Au moment où cette « doctrine de l’indifférence » émerge, c’est-à-dire au XVIIe et XVIIIe siècle, elle est naturellement portée par les États et la retenue qu’ils observent en de telles situations. Dans les lignes qu’il consacre à cette question, Charles Leben rassemble plusieurs exemples historiques, citant notamment Vattel au sujet d’Henri IV se refusant à être « le juge [comme] le tuteur de la nation suédoise pour refuser, contre le bien de son royaume de reconnaître le roi qu’elle s’était choisi sous prétexte qu’un compétiteur traitait [ce dernier, Charles de Sudermanie] d’usurpateur : fut-ce même avec raison, les étrangers ne sont pas appelés à en juger »26. Leben cite encore, au titre de la pratique diplomatique française, l’accueil par Mazarin de l’ambassadeur anglais envoyé par Cromwell et l’absence à son égard de toute forme de résistance, malgré la réprobation que le régime britannique alimente, à cette même époque, en France. En d’autres termes, il s’agit uniquement, pour les dirigeants, de prendre acte des insurrections et mutations politiques enregistrées à l’étranger, sans jamais y voir des facteurs susceptibles d’affecter les relations interétatiques. À s’en tenir à ces doctrines, la révolution, ou ses tentatives, ne sauraient fonder un quelconque jugement de valeur, ni son analyse être ramenée à un plan éthique ou politique. Au XXe siècle, et plus précisément durant les années 1930, certains États théoriseront même cette attitude de retenue, faisant de l’effectivité du pouvoir, plutôt que de sa légitimité, la condition de sa reconnaissance. En ce sens, et à cette époque, la doctrine dite Estrada, du nom du Ministre des affaires étrangères du Mexique, jugeait offensante la pratique de reconnaissance des gouvernements étrangers, parce que contraire à l’obligation de non-ingérence, faisant ainsi écho à l’interventionnisme de certaines puissances subi par les États d’Amérique latine27.
La neutralité comme composante de l’ordre juridique international et des relations qui s’y nouent, ne saurait trop surprendre. Elle reflète finalement l’un des principaux caractères de l’ordre international : celui de sa « primitivité », au sens de l’absence d’un pouvoir institutionnalisé susceptible de s’imposer à la volonté souveraine des États. Cet état de fait explique l’importance donnée à la dimension relationnelle de la vie internationale, laquelle laisse libre cours au jeu de la réciprocité entre les États. Si ces derniers ne réagissent ainsi pas aux évènements politiques survenant chez leurs voisins, c’est naturellement parce qu’ils y trouvent un intérêt : celui de ne pas voir leur propre activité politique soumise au jugement d’autrui. L’indifférence communément manifestée, à cette même époque, à l’égard des changements de régime ne serait en définitive qu’une illustration parmi d’autres de la fonction quasi « constitutionnelle » du principe de réciprocité dans les relations interétatiques, c’est-à-dire celle qui conduit à introduire « une mesure d’ordre, spontanée et évidente, à laquelle tout sujet tend à se plier par intérêt. Chacun ne s’engage que dans la mesure où l’autre s’engage ; chacun peut moduler ses obligations par rapport à celles assumées par l’autre ; chacun ne respecte son engagement que si l’autre le respecte également ; chacun reste libre de refuser d’exécuter si l’autre n’exécute pas ; etc… »28. Tout serait ainsi affaire de « calcul », d’anticipation et d’attentes légitimes d’un traitement identique à celui qu’on réserve pour autrui. En ce sens, il faut remarquer que les mouvements révolutionnaires victorieux auront eux-mêmes eu tendance, une fois aux responsabilités, à veiller jalousement au strict respect de leur souveraineté, On retient le plus souvent cette analyse de l’expérience de 1789, alors qu’elle ouvrait des perspectives moins étatistes qu’humanistes. Mais encore faut-il comprendre de cette discipline introduite par la réciprocité qu’elle demeure fondamentalement précaire29. C’est aussi ce que révèle, en creux, l’évolution des conceptions internationales de la révolution qui trouve ses origines dans les soubresauts et contingences de la vie politique internationale, mais également dans sa lente et progressive institutionnalisation.
L’avènement d’une légalité internationale des révolutions ?
L’intérêt que le droit international voue aux questions de politique interne est classiquement perçu comme un phénomène récent, que l’on associerait pour l’essentiel à la rhétorique onusienne, plus précisément celle qui, depuis plus d’une trentaine d’années et la fin de la guerre froide, tend à privilégier et même imposer la démocratie vis-à-vis de tout autre mode d’exercice du pouvoir étatique. Rappelons tout de même, pour équilibrer cette présentation, que certains États avaient pu, bien avant cette dynamique engagée durant la seconde moitié du XXe siècle, prétendre régir, par voie d’accords, la révolution survenant au sein de l’un d’entre eux. Dans le cours que Boris Mirkine-Guetzévitch consacre en 1931, à l’Académie de La Haye, aux rapports entre droit international et droit constitutionnel, il relève ainsi des exemples de « garanties internationales du fonctionnement normal des régimes constitutionnels »30. Est évoqué le traité que les représentants de cinq États de l’Amérique centrale avaient signé le 7 février 1923, à Washington. Assez largement influencé par la doctrine Tobar, l’instrument consacrait la nécessité d’une non-reconnaissance mutuelle des révolutions susceptibles d’affecter les régimes constitutionnels aux fins d’œuvrer à leur stabilité, dans un contexte américain de succession des coups d’État. Au surplus, et là résidait également toute son originalité, le traité de 1923 réservait le refus de reconnaissance aux seules révolutions n’ayant pas accouché d’un régime démocratique. Pour reprendre ses termes exacts, l’obligation de non-reconnaissance devait s’imposer aux États parties « tant qu’une représentation du peuple librement élue n’aura[it] pas réorganisé le pays dans sa forme constitutionnelle »31. Il est encore possible de mentionner d’autres épisodes historiques à l’occasion desquelles auront pu être émises des prétentions d’encadrer juridiquement les révolutions. Dès le début du XIXe siècle, la Sainte Alliance avait ainsi mis hors la loi les révolutions anti-monarchiques. En1815, autrichiens, prussiens et russes décidaient, par la Constitution de la Sainte Alliance, des’accorder un droit d’intervenir, de façon pacifique ou militaire, contre un État faisant l’expérience d’une révolution. Était ainsi instituée une police européenne contre les insurrections, mais qui ne s’inscrira pas dans la durée, faute d’une volonté interventionniste suffisante.
Si la question n’est pas foncièrement nouvelle, c’est l’inspiration onusienne de la fin du XXe siècle qui aura véritablement amorcé la réflexion autour d’une obligation de comportement ou gouvernance démocratique, d’origine internationale. Et celle-ci n’est pas sans emporter certaines conséquences vis-à-vis de l’hypothèse révolutionnaire. Rappelons d’abord à ce propos la rhétorique de l’Organisation universelle utilisée dans le but de favoriser, par effet d’entraînement, l’État de droit et les libertés individuelles au plan national, d’une part, et la coexistence pacifique au plan mondial, d’autre part32.Aussi a-t-on assisté, pour reprendre la formule de René-Jean Dupuy, au moins au plan des idées, au « passage de l’équivalence des régimes politiques à la légitimité exclusive de la démocratie libérale »33, avec pour points culminants la présentation par Boutros Boutros Ghali de l’Agenda pour la démocratisation fin 199634, puis l’adoption trois ans plus tard de la résolution de la Commission des droits de l’homme sur le « droit à la démocratie » répertoriant les différentes composantes du mode de gouvernement démocratique35. Cette promotion de la « bonne gouvernance », ancrée dans le respect des principes de légitimité démocratique et de prééminence du droit, a progressivement conduit à mettre la norme constitutionnelle au cœur des préoccupations onusiennes.L’assistance constitutionnelle pourvue par l’Organisation est, à cet égard, révélatrice des différentes modalités d’interventions du droit international dans la sphère constitutionnelle interne. Il s’agira en effet, suivant le contexte et l’objectif recherché, de recommander le respect de certaines valeurs ou règles, tel que le pluralisme politique ou l’indépendance de l’appareil judiciaire, d’imposer certains standards dont le respect conditionnerait l’aide au développement ou la participation à certaines organisations internationales, ou même encore de réécrire la norme constitutionnelle dans le cas extrême où la Communauté internationale prend le relai des autorités étatiques défaillantes pour administrer le territoire national36. À ces différents niveaux, l’internationalisation rend ainsi compte de « l’emprise concrète des relations internationales et des normes internationales sur les normes constitutionnelles »37 et se présente comme un facteur d’homogénéisation des droits constitutionnels, ou même de confiscation du pouvoir constituant suivant le point de vue que l’on adopte. C’est bien effectivement d’un certain modèle d’État, « démocratique et respectueux des droits de l’homme »38, dont il est question, et dont les contours se reflètent dans les normes constitutionnelles façonnées par l’organisation internationale. Il n’est naturellement pas surprenant de retrouver des applications de ce mouvement d’ensemble à l’hypothèse des révolutions, dont rien ne garantit qu’elles apportent ou maintiennent ce modèle politique. Les concrétisations les plus remarquables sont d’ailleurs issues du droit régional : le droit issu de la Convention européenne des droits de l’homme, auquel la Biélorussie n’a toutefois pas souscrit, ainsi que l’ensemble juridique africain dont les textes envisagent spécifiquement le changement inconstitutionnel de gouvernement39. L’Acte constitutif de l’Union africaine réprouve ainsi l’accession au pouvoir par des « moyens anticonstitutionnels » comme le recours à la force, et exclut les gouvernements qui en seraient issus de toutes les activités de l’Union40. La pratique des organes africains a pu aboutir à condamner des coups d’État militaire dirigés contre des gouvernements issus d’élections démocratiques. Tel a récemment été le cas du « changement inconstitutionnel de régime » survenu au Mali le 18 août 2020, l’Union africaine appelant, par la voix de son Président, à la « libération immédiate » du président Ibrahim Boubacar Keïta, alors détenu par l’armée41. Juridiquement, la figure demeure originale : il s’agit de confronter les comportements des autorités nationales à l’ordre constitutionnel auquel elles sont assujetties. L’originalité tient surtout à ce qu’il revient ici au droit international et à ses agents de qualifier l’atteinte au droit national constitutionnel42. C’est par le truchement des textes de droit interne que l’autorité internationale viendra ainsi caractériser, et le cas échéant condamner, le changement anticonstitutionnel. Si le modèle africain est certainement le plus sophistiqué, d’autres organisations régionales veillent au respect, par ses membres, de la démocratie et de l’ordre constitutionnel national, et parfois même au-delà du seul cercle des États parties. La politique extérieure de l’Union européenne a pu ainsi se saisir de la situation biélorusse. Il faut dire que celle-ci rompt manifestement avec l’exigence démocratique. L’Union a ainsi caractérisé l’incompatibilité de l’élection présidentielle du 9 août 2020, et des conditions de sa tenue, avec les standards internationaux applicables au processus électoral, notamment ceux d’équité et de transparence, ainsi que le recours à des arrestations arbitraires de membre de l’opposition, jugement que les autorités biélorusses auront immédiatement rejeté et même qualifié d’acte d’ingérence dans les affaires nationales43. Le caractère frauduleux des élections aura, dans le même sillage, conduit à l’édiction de sanctions visant les autorités gouvernementales, les institutions européennes ayant ciblé une quarantaine d’agents étatiques, dont le président biélorusse et son fils Victor, réputés « responsables de la violence, des arrestations injustifiées et de la falsification des résultats de l’élection »44, en gelant leur avoirs et ressources économiques, ainsi qu’en leur interdisant l’accès au territoire européen.
Ce type de séquences n’a naturellement rien de propre au cas biélorusse. Il est fréquent, voire quasi-systématique, que l’atteinte portée à l’ordre démocratique et à ses mécanismes conduisent à sanctionner les autorités à qui on l’impute45. Et ces réactions ne sont pas davantage étrangères au cadre universel. L’un de cas les plus emblématiques ayant mobilisé le Conseil de sécurité des Nations unies est celui d’Haïti et du Président Aristide, investi à l’issue d’une élection au suffrage universel mais qu’un coup d’État avait contraint à l’exil. Le Conseil de sécurité lui apportera un solide soutien, exigeant à différentes reprises son retour au pouvoir, ainsi que le rétablissement de l’ordre démocratique haïtien46. Ce précédent n’est pas nécessairement isolé. La pratique onusienne ultérieure se sera progressivement alignée sur celle des organisations régionales47. Le tout laisse toutefois l’impression de réactions éparses des États et des institutions internationales. La réaction aux troubles politiques demeure, en somme, l’exception, malgré l’idée, un temps avancé, de créer un mécanisme de « protection des gouvernants démocratiquement élus contre les renversements institutionnels »48, au point qu’il semble encore aujourd’hui difficile d’affirmer avec une certitude absolue qu’un coup d’État constitue une violation, à proprement parler, du droit international49 et qu’il serait toujours traité comme tel. Comme le relève, en ce sens, Caroline Chaux, « dans la majorité des cas de changements anticonstitutionnels, le Conseil de sécurité adopte uniquement une déclaration contraignante condamnant les actes survenus. L’absence d’une pratique uniforme de réaction aux coups d’État, tel que souhaité par le Secrétaire général, s’explique par les dissensions existantes entre les membres du Conseil de sécurité. La position adoptée par le Conseil dépend des intérêts des membres permanents au sein de l’État dont le gouvernement a été renversé. Ainsi, la proximité entre la France et le Mali a motivé l’adoption d’une résolution à l’égard du coup d’État survenu le 18 août 2020. À l’inverse, les intérêts de la Chine en Birmanie expliquent le défaut de résolution contraignante à la suite du coup d’État du 1er février 2021, la proposition des membres occidentaux du Conseil s’étant heurtée aux veto russes et chinois »50. Ces schémas trouveraient ainsi une simple confirmation avec le cas de la Biélorussie de 2020. Ils donnent l’explication du silence coupable de l’Organisation universelle, certains États comme la Chine ayant considéré que la crise biélorusse était « une affaire intérieure(…)ne posant aucune menace pour la paix et la sécurité régionales ou internationales », échappant du même fait à la compétence du Conseil de sécurité. L’exemple biélorusse démontre surtout qu’il serait illusoire de considérer qu’un principe de légitimité ou de représentativité de l’autorité nationale à l’égard de son peuple aurait acquis force obligatoire, et surtout valeur universelle. Le maître mot demeure encore celui de relativisme, en l’absence d’un système politique capable de s’imposer à tous les gouvernants du monde51[51].
Au sujet d’autres règles internationales applicables au processus révolutionnaire
La recherche des règles et principes intéressant le phénomène révolutionnaire a, jusque-là, conduit à n’aborder que celles et ceux qui s’y trouvent spécifiquement consacrés. De façon logique, cette recherche n’épuise pas celle des autres règles juridiques internationales susceptibles de s’appliquer à des faits survenus à l’occasion d’une révolution. Pour ainsi dire, la révolution, et son rapport au droit international, peuvent tout aussi bien s’envisager à travers des régimes juridiques qui n’ont pas pour objet exclusif de la règlementer, mais qui sont dans le même temps susceptibles d’attacher des conséquences à ses modalités de réalisation. Envisagée comme un processus, plutôt qu’un point d’aboutissement, la révolution se présente comme une somme de situations factuelles susceptibles de déclencher l’application d’un grand nombre de règles internationales, d’application plus générale. D’aucuns seraient tentés d’y voir une illustration du développement tentaculaire de la sphère internationale, à laquelle aucun objet n’est désormais censé échapper. À l’analyse du cas biélorusse, on serait toutefois précisément tenté de valider l’idée inverse, c’est-à-dire l’existence de lacunes persistantes d’un droit international qui ne couvre pas, ou très imparfaitement, la situation à l’étude. Plusieurs segments du droit international doivent ici être interrogés, même si les résultats de notre enquête s’avèrent, disons-le d’emblée, relativement frugaux pour le cas biélorusse.
Révolution et droit des conflits armés
Premier ensemble normatif qui trouve à s’illustrer : le droit des conflits armés et les règles encadrant le recours à la force. Le rapport que ces règles entretiennent avec la révolution est pluriel. Il n’est évidemment pas exclu que le déclenchement d’une révolution puisse être qualifiée de menace à la paix internationale et conduise à l’adoption de mesures au titre du chapitre VII de la Charte des Nations unie. Il serait, plus généralement, susceptible d’impliquer les Nations unies et éventuellement d’autres organisations internationales, en vue d’un règlement politique, et éventuellement militaire, de la crise. Dans le cas qui nous concerne, la question a surtout été posée de savoir si le contexte biélorusse permettait de fonder juridiquement une intervention tierce, celle notamment d’un État étranger, au soutien des populations opprimées ou du pouvoir contesté. Bien connu du droit international, le problème de droit peut se formuler ainsi : existe-t-il un droit à l’assistance au gouvernement légal, ou aux insurgés, ou aux deux, ou encore à aucun d’entre eux ? En y songeant, l’on pense naturellement à la visite officielle du président biélorusse, Alexandre Loukachenko, le 14 septembre 2020, à Sotchi en Fédération de Russie. On relèvera d’ailleurs que le chef d’État avait, à cette occasion, été accueilli sur le tarmac par un simple gouverneur régional, et qu’il remerciera publiquement, à six reprises, son hôte russe. Plus fondamentalement, le droit international est, comme abordé précédemment, traversé par des principes en tension. Si l’on a pu précédemment indiquer la continuité historique de principes bénéficiant à la population d’un État, il faut aussi observer que les normes du droit international, et notamment la résolution 2625 déjà mentionnée, maintiennent avec fermeté l’interdiction faite à « tous les États (…) d’organiser, de fomenter, de financer, d’encourager ou de tolérer des activités armées subversives destinées à changer par la violence le régime d’un autre État ainsi que d’intervenir dans les luttes intestines d’un autre État ». La célèbre affaire du Nicaragua, tranchée par la Cour mondiale en 1986, et mettant en cause la révolution sandiniste intervenue au début des années 1960, avait permis de confirmer que « le droit international contemporain ne prévoit aucun droit général d’intervention en faveur de l’opposition existant dans un autre État »52. Ce type d’initiatives ne trouveraient en d’autres termes leur justification que sur le terrain de la politique, de l’idéologie et de la morale, en considération de la dignité du combat mené contre un pouvoir oppresseur. Elles ne seraient en revanche pas juridiquement fondées. Dans l’affaire du Nicaragua, la Cour conclura, avec fermeté, que « les actes constituant une violation du principe coutumier de non-intervention qui impliquent, sous une forme directe ou indirecte, l’emploi de la force dans les relations internationales, constitueront aussi une violation du principe interdisant celui-ci »53. Dans le même arrêt, il aura également été rappelé que « les orientations politiques internes d’un État relèvent de la compétence exclusive de celui-ci pour autant, bien entendu, qu’elles ne violent aucune obligation de droit international. Chaque État possède le droit fondamental de choisir et de mettre en œuvre comme il l’entend son système politique, économique et social »54. Chose remarquable, ces mêmes questions se reposeront peu de temps après, au sujet de la Roumanie de 1989, et le débat convoquera cette fois le droit international des droits de l’homme et son importance désormais acquise.
L’idée d’un droit d’intervention armée fondée sur la répression d’un peuple demeure, encore aujourd’hui très discutée, ne serait-ce au vu des initiatives prises par plusieurs États au soutien de la rébellion syrienne. Le concept de « sécession-remède », qui se situe, certes, à un autre niveau, celui du droit à l’autodétermination et qui vise l’hypothèse d’une révolution dont l’objectif ou le résultat serait de créer un nouvel État, mais dont on sait qu’il n’est pas sans influence sur les droits reconnus aux tiers, constitue l’une des propositions doctrinales les plus remarquables. Il vise les cas dans lesquels « l’État réprime une de ces minorités de manière tellement flagrante qu’il ne pourrait plus prétendre la représenter, et donc invoquer à son encontre son intégrité territoriale »55. Dès lors, le remède proposé par le droit international consisterait à protéger à la « minorité-victime », en lui reconnaissant un droit à la sécession. L’hypothèse demeure naturellement éloignée du cas biélorusse : il n’est pas question ici de minorité et n’est pas davantage en cause la faculté pour les opposants politiques de créer un nouvel État. Toutefois, ces percées démontrent la légitimité des droits fondamentaux, et de leur nécessaire garantie internationale, à questionner la toute-puissance souveraine. Par ailleurs, pour en rester à la seule question de l’intervention armée d’un État tiers dans le cas de la répression d’une population, les aspirations humanitaires, qui justifieraient ce type d’initiatives, sont assez largement neutralisées par le risque – avéré, au demeurant, en considération par exemple du cas libyen – d’abus ou de détournement de « l’argument droits de l’homme ». C’est ici tout l’objet du débat actuel sur la responsabilité de protéger et sa juste articulation avec la non-intervention dans les affaires intérieures de l’État ; et c’était déjà le débat d’hier sur le droit ou devoir d’ingérence humanitaire.
En revanche, et les démocrates seront encore déçus, le droit international admet sans aucun doute le principe de l’intervention d’un État tiers en faveur d’un gouvernement en place, et dont l’autorité serait contestée. L’affaire du Nicaragua l’avait, là encore, clairement rappelé. La condition posée par les règles internationales est toutefois celle d’une demande d’assistance expressément formulée par les autorités gouvernementales en prise avec l’insurrection. C’est précisément pour ne pas priver de tout objet le principe de non-intervention dans les affaires intérieures de l’État que seul lui est admis à solliciter une intervention, et non son opposition politique. Dans l’hypothèse inverse, pour reprendre les mots de la Cour, « on voit mal en effet ce qui resterait du principe de non-intervention en droit international si l’intervention, qui peut déjà être justifiée par la demande d’un gouvernement, devait aussi être admise à la demande de l’opposition à celui-ci. Tout État serait ainsi en mesure d’intervenir à tout coup dans les affaires intérieures d’un autre État, à la requête, tantôt de son gouvernement, tantôt de son opposition »56. Des exemples récents ont pu confirmer l’actualité de ces principes, telle l’intervention de l’Arabie Saoudite au soutien du Bahreïn, au moment des printemps arabes, mais aussi naturellement le soutien russe accordé à Minsk, que l’on évoquait en introduisant notre réflexion même s’il aura plutôt ici été question de rhétorique – celle de l’aide promise par Moscou – que de la mise en œuvre proprement opérationnelle d’une assistance militaire.
À ce stade, le droit international se montre proprement réactionnaire, œuvrant essentiellement à la stabilité des régimes et neutralisant l’argument politique ou idéologique qui viendrait au soutien d’une rébellion. Il faut toutefois remarquer que le système international n’est pas tout à fait indifférent aux formes que peut prendre le processus révolutionnaire. C’est d’ailleurs essentiellement au titre de ses excès que la révolution trouve à être encadrée par le droit international, afin de protéger ceux qui subissent la violence (le droit international humanitaire) et sanctionner ceux qui la mettent en œuvre (le droit international pénal).
Pertinence du droit international humanitaire et du droit international pénal
On sait du droit international humanitaire qu’il n’a plus uniquement vocation à s’appliquer aux affrontements armés entre États, et qu’il trouve tout aussi bien à régir des conflits armés non internationaux, et ce quelles que soient les raisons, légitimes ou non, ayant conduit une partie de la population à entrer en lutte contre ses autorités. On sait également de ces règles internationales qu’elles sont plus protectrices des populations civiles et des catégories protégées lorsqu’est menée une guerre de libération nationale, fondée sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ce qui n’est, encore une fois, pas en cause dans le cas biélorusse. Rappelons que l’invocabilité du droit à l’autodétermination demeure, depuis sa consécration même par le droit onusien57, limité à quelques hypothèses restreintes, telle la lutte d’un peuple contre une domination coloniale, un régime raciste ou une occupation étrangère. De toute évidence, aucun de ces scénarios ne caractérise la position du peuple biélorusse. Mais même dénuées de tout lien avec la problématique de l’autodétermination, et la volonté d’une fraction du peuple de créer un nouvel État, les normes du droit international humanitaire, de nature coutumière, et d’élaboration ancienne, disposent d’une pertinence en ce type de contextes. À ce propos, l’on sait notamment de ces normes qu’elles demeurent indépendantes des instruments conventionnels acceptés – ou non – par l’État en matière de protection internationale des droits de l’homme, registre dans lequel l’État biélorusse ne compte pas parmi les plus vertueux. S’agissant des évènements de l’été 2020, toute la difficulté réside toutefois ailleurs : leur gravité ne franchit vraisemblablement pas le seuil de violence identifié par le droit humanitaire comme fait-condition de l’application de ses normes protectrices. La tentative de révolution biélorusse s’inscrit plutôt dans le registre des troubles intérieurs ou tensions internes, que le droit humanitaire distingue classiquement des conflits armés à proprement parler, c’est-à-dire de situations qui supposent un certain degré d’organisation des forces en présence ainsi qu’un niveau d’hostilité collective supérieur à de simple attentats, émeutes et autres actes sporadiques de violence58. Or, même à valider la thèse des autorités biélorusses, qui ont pu notamment recenser les différents actes de violence des protestataires – par exemple le cas d’Alexandre Taraïkovski, première victime civile des évènements, décédé le 10 août 2020 à Minsk, près de la station de métro Pouchkinskaïa, après avoir tenté, toujours selon les autorités, de lancer un engin explosif contre les forces de police biélorusse –, ce seuil ne semble pas franchi. La somme des dérives et violences policières survenues en réaction, pour lesquelles le gouvernement présentera des excuses et ordonnera la constitution d’un comité d’enquête, ne suffiraient pas davantage. Outre Alexandre Taraïkovski, ajoutons les noms d’Alexandre Vikhor, 25 ans, qui décède à Gomel sans doute d’une insuffisance cardiaque mais aussi de sa rétention plusieurs heures durant dans une camionnette des forces de sécurité, alors que les températures sont élevées, de Guennadi Choutov, touché d’une balle dans la tête lors des manifestations du 11 août à Minsk, ou encore de Roman Bondarenko, battu à mort pour avoir essayé de protéger des rubans rouges et blancs, symbole de la contestation.
De tout cela, il semble raisonnable de conclure que les manifestants ont été les victimes d’une répression policière qui n’a pas conduit à un « affrontement armé ». Faute d’une violence suffisante, le droit humanitaire n’a pas, en d’autres termes, son mot à dire. En revanche, les instruments du droit international des droits de l’homme, que l’on aura longtemps – et abusivement – réduits au droit applicable « en temps de paix », demeurent, de ce point de vue parfaitement applicables. La Biélorussie n’a toutefois pris que quelques engagements de cette nature, essentiellement les deux Pactes onusiens de 1966, et par ailleurs accepté, au moins un temps59, la compétence contentieuse du Comité des droits de l’homme, chargé de veiller à la pleine application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le droit international peut et pourra ainsi dire que l’État biélorusse s’est rendu responsable de multiples violations du droit international dans sa répression des manifestations, à l’occasion d’arrestations et de détentions arbitraires, d’atteintes répétées aux libertés d’expression et de réunion, mais aussi d’actes de torture. Ces violations ne datent, du reste, pas de l’été 2020. Ils sont documentés par les travaux du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, et l’étaient également par la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Bélarus, Anaïs Marin qui, dès mai 2019, faisait déjà état de violations des droits de l’homme généralisées et systématiques, d’un musèlement de la presse, d’un manque d’indépendance des juges et avocats, et d’atteintes à la liberté de réunion pacifique et à l’action syndicale. Dans sa déclaration au Conseil de sécurité prononcée le 4 septembre 2020, la Rapporteuse évoquait par ailleurs 450 cas documentés d’actes de torture commis par des agents de l’État. Il est par ailleurs notoire qu’une disposition en particulier, celle de l’article 23.34 du Code des infractions administratives biélorusse sur la participation à des rassemblements non autorisés, aura été massivement utilisée pour punir les manifestants à des peines de prison – d’une durée de quinze jours, en moyenne.
C’est précisément ce référentiel des droits de l’homme qui est le plus souvent invoqué par les États tiers et les institutions internationales, afin de fonder les sanctions internationales. On trouve ici le reflet d’une pratique bien ancrée, qui vient réagir à un usage excessif de la force60. Dans le sillage des sanctions européennes, adoptées par l’Union européenne, les États-Unis annonçaient, le 2 octobre 2020, des sanctions économiques contre huit hauts responsables biélorusses, dont le ministre de l’intérieur, pour leur rôle dans la répression du mouvement de contestation. Il ne faut par ailleurs pas exclure l’hypothèse d’une condamnation judiciaire de l’État biélorusse par la Cour internationale de Justice. Celle-ci demeure, du moins, techniquement possible. Une voie praticable est celle ouverte par la Convention contre la torture de 1984, dont la Biélorussie est État partie. Politiquement, la chose demeure toutefois délicate puisqu’elle nécessiterait qu’un État tiers se décide à porter une réclamation contre les autorités de Minsk, sur le terrain de la Convention de 1987, afin d’engager leur responsabilité internationale au titre des évènements de l’été 2020. La Convention protégeant un intérêt collectif, celui en l’occurrence d’interdire le recours à la torture en toutes circonstances, et instituant une actio popularis pour sa défense, la qualité à agir de l’État qui se déciderait à saisir la Cour serait présumée, comme l’enseigne sa jurisprudence61. C’est que, dans le système international, la défense de l’intérêt général est encore très largement l’affaire des États eux-mêmes, à qui il revient de réagir individuellement à sa mise en cause.
L’on ne saurait par ailleurs, en évoquant les règles internationales à vocation humanitaire, écarter la question du droit international de réfugiés et de la protection dont doivent pouvoir bénéficier tous ceux qui craignent des persécutions en raison de leurs opinions politiques. L’« asile politique » est bien souvent abordé au titre des conséquences humanitaires des conflits et crises, internes ou internationaux, et les évènements d’août 2020 pourraient, une nouvelle fois, être pris à témoin. On sait, par ailleurs, que la Biélorussie aura, en fin d’année 2021, été le théâtre d’une sinistre instrumentalisation des demandeurs d’asile et migrants, essentiellement irakiens et syriens, opération qui n’était pas sans lien avec la tentative avortée de révolution. Comme l’a relevé Hugo Flavier, « [t]out le monde en était conscient et l’issue était prévisible : le régime de Minsk avait décidé de générer artificiellement une pression migratoire sur le sol européen en réponse aux quatre paquets de sanctions62 adoptés par l’Union européenne »63. Pour n’évoquer toutefois que le sort des protestataires biélorusses, ces derniers sont, aux termes de l’article 1er de la Convention de Genève relative au statut de réfugié de 1951, éligibles à une protection internationale lorsqu’ils craignent d’être persécutés du fait de leurs opinions politiques, réelles ou imputées. Le guide du HCR qui vient éclairer la signification des dispositions de la Convention, précise que l’obtention de la qualité de réfugié présuppose des opinions qui ne seraient pas « tolérées par le pouvoir, parce qu’elles sont critiques de la politique ou des méthodes du pouvoir. Cela présuppose également que les autorités ont connaissance de ces opinions politiques ou qu’elles les imputent au demandeur »64. Nul doute que ces conditions se trouveraient parfaitement remplies pour bon nombre de participants aux manifestations de 2020, qui pourraient ainsi utilement se prévaloir de ces dispositions. Pour l’heure, la Pologne et la Lituanie ont pris la plus large part dans l’accueil de ces personnes, confirmant en cela des traditions nationales de promotion des valeurs démocratiques65, et de protection des « combattants de la liberté »66.
Le faisceau de violations qui semblent devoir être imputées au régime de Minsk conduit, enfin, à interroger un dernier ensemble juridique : celui des instruments de répression pénale. Ces derniers avaient d’ailleurs été assez rapidement évoqués, dans le débat public, en réaction aux évènements de Biélorussie. Et pour cause, des violences électorales, comme celles survenues au Kenya durant les années 2007-2008, ont déjà pu mobiliser les juridictions pénales internationales. Une pétition relayée par Eurojournalist, un collectif de ressortissants biélorusses en France qui en appelait aux « Nations unies et à la CPI », faisait ainsi état, en septembre 2020, de la commission de crimes contre l’humanité, dans le contexte des élections présidentielles de 2020, notamment de tirs à balles réelles, de coups violemment portés aux manifestants, de traitements inhumains et dégradants, de conditions de détention attentatoires aux standards internationaux, et de plusieurs victimes et personnes portées disparues67. Devaient également être ajoutés à cette liste, les éléments recensés dans le Livre des crimes, la plateforme mise en place par Svetlana Tikhanovskaïa et les membres de l’opposition, afin de documenter les comportements illicites des autorités biélorusses : harcèlement judiciaire, arrestations arbitraires et détention sans fondement ou d’une durée disproportionnée au regard des faits reprochés, condamnation de personnalités publiques ou encore de journalistes (à de la prison ferme) pour avoir simplement couvert les faits, étudiants radiés des universités… D’autres plateformes, essentiellement des ONG, ont pu par la suite prendre le relai, et même transmettre des informations au Procureur de la Cour. L’International Partnership for Human Rights (IPHR), le Norwegian Helsinki Committee, ou encore Global Diligence LPP auront ainsi fondé pareille initiative68 sur les dispositions de l’Article 15 du Statut de Rome, qui autorise le Procureur de la Cour pénale internationale à « ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour ». Les documents soumis faisaient état, depuis mai 2020, d’un bilan dramatique : six civils tués, 33 000 personnes arrêtées, des centaines torturées, et près de 14 000 personnes expulsées du territoire national.
L’exercice par la Cour pénale internationale de sa compétence est toutefois subordonné à plusieurs conditions cumulatives, notamment à un lien de rattachement à la situation criminelle qui supposerait que la Biélorussie ait ratifié le Statut de Rome et reconnu les pouvoirs de la Cour, ce qui n’est pas le cas. Par ailleurs, du point de vue de l’objet des poursuites, la question de la gravité des faits trouverait encore nécessairement à se poser, puisqu’il s’agirait ratione materiae de fonder la compétence du juge pénal au titre, on l’a dit, de la commission de crimes contre l’humanité, l’hypothèse d’un génocide ou encore d’un crime de guerre étant ici totalement étrangère aux faits litigieux. Tout dépendrait donc encore ici du degré de violence exercé par le despote, ou éventuellement, au plan théorique, du degré de violence utilisé par ceux qui le contestent et cherchent à le renverser. Par ailleurs, aussi dramatique soient les chiffres avancés, ce que l’on sait de la situation biélorusse demeure peut-être encore éloigné des standards appliqués par la Cour pour ouvrir des enquêtes et engager des poursuites face à ce qui doit se présenter comme des attaques généralisées contre une population civile.
Pour recentrer l’analyse sur les cas de violences électorales qui avaient conduit à des poursuites devant la Cour, et en reprenant l’exemple du Kenya entre la fin d’année 2007 et le début d’année 2008, l’on déplorait alors près de 1 500 victimes et 300 000 déplacés internes, avec des éléments caractéristiques d’un nettoyage ethnique. Pour se situer dans une échelle plus proche de notre cas, du moins en termes de décès, pensons également au raid israélien sur la flottille humanitaire à Gaza en 2010, qui avait été à l’origine de dix décès, mais qui avait été écarté par la Cour de ses investigations pour défaut de gravité. À ce jour, la situation biélorusse n’a pas donné lieu à l’ouverture d’une enquête, ni même à un examen préliminaire par le Bureau du Procureur. À l’image de ce qui a déjà été dit du droit humanitaire et de son seuil d’applicabilité, tout laisse penser que la crise biélorusse, plutôt que d’illustrer la complétudedu droit international, met la lumière sur l’une de ses « zones grises », pour reprendre l’expression saisissante de Théodore Méron, expression désignant ces contextes de violence interne que l’on aurait quelque mal à situer entre paix et guerre, et qui peinent à franchir les seuils posés par le droit international tout en provoquant leur lot de victimes, et de souffrance69.
Notes
- Article 10 du projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État, et son commentaire, in J. Crawford, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’État, Paris, Pedone, 2003, p. 137-143.
- Commission des réclamations France/Mexique, Georges Pinson (France) c. United Mexican States, sentence arbitrale du 17 octobre 1928, prés. M. Verzijl, Recueil des sentences arbitrales, vol. V, p. 327-466, spéc. p. 426 et ss.
- Ibid., p. 426.
- G. Burdeau, Ch. Leben, « Avant-propos », in Société française pour le droit international, Révolution et droit international, colloque de Dijon, Paris, Pedone, 1990.
- Ibid.
- O. Corten, « La rébellion et le droit international : le principe de neutralité en tension », RCADI, vol. 374, 2014, p. 53-312.
- Ibid, p. 71.
- Ibid., p. 72.
- R.-J. Dupuy, « La Révolution française et le droit international actuel », Conférence prononcée le 25 juillet 1989, RCADI, 1989, Volume 214, p. 9-30.
- Voir, à ce sujet, nos observations in « La conception de la souveraineté dans les opinions séparées des juges russes au sein des Cours internationales », Revue générale de droit international public, 2019-1 (« La Russie et le droit international »), p. 7-23.
- R.-J. Dupuy, « La Révolution française et le droit international actuel », op. cit.
- Ibid.
- F. Poirat, « Révolution » in D. Alland, S. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003,p. 1359-1366, spéc. p. 1365.
- Ch. Leben, « Les révolutions en droit international : essai de classification et de problématique générale », in Société française pour le droit international, Révolution et droit international, colloque de Dijon, Paris, Pedone, 1990, p. 3-48, spéc. p. 6. Voir la contribution de C. Cerda-Guzman dans cet ouvrage.
- Ibid.
- J. d’Aspremont, « La licéité des coups d’État en droit international », in Société française pour le droit international, colloque de Bruxelles, L’État de droit en droit international, p. 121-142, spéc. p. 121.
- Voir pour une approche compréhensive de la question, L.-A. Sicilianos, L’ONU et la démocratisation de l’État, Systèmes régionaux et ordre juridique universel, Paris, Pedone, 2000.
- J. d’Aspremont, « La licéité des coups d’État en droit international, op. cit., p. 126.
- Voir, à ce sujet la remarquable thèse de Caroline Chaux, Les contraintes internationales sur le pouvoir constituant national, thèse Paris II-Panthéon Assas, décembre 2021.
- Sur ces mouvements réciproques, voir P.F. Laval, R. Prouvèze, Constitutions et droit international. L’ONU, entre internationalisation et constitutionnalisation, éd. Pedone, 2015
- Ch. Leben, « Les révolutions en droit international : essai de classification et de problématique générale », op. cit., p. 8.
- Sur la genèse et les développements contemporains du principe de neutralité, voir O. Corten, « La rébellion et le droit international : le principe de neutralité en tension », op. cit., p. 87 et ss.
- Tinoco, Grande Bretagne/Costa Rica, sentence arbitrale du 18 octobre 1923, Recueil des sentences arbitrales, vol. I, p. 369.
- Voir en ce sens, J. Salmon, « Vers l’adoption d’un principe de légitimité démocratique ? », in O. Corten et al. (dir.), À la recherche du nouvel ordre mondial, tome I, Le droit international à l’épreuve, Bruxelles, Complexe, 1993, p. 63.
- Voir la sentence Tinoco précitée.
- E. de Vattel, Droit des gens, Amsterdam, 1775, t. 1, Livre IC, ch. V, n° 68, et le commentaire de Ch. Leben, « Les révolutions en droit international : essai de classification et de problématique générale », op. cit., p. 9.
- R. Bierzaneck, « La non-reconnaissance et le droit international contemporain », AFDI, 1962, p. 117-137, spéc. p. 125.
- R. Kolb, Théories du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 691.
- Ibid., p. 697.
- B. Mirkine-Guetzévitch, « Droit international et droit constitutionnel », RCADI, 1931, vol. 38, p. 307-465, spéc. p. 328 et ss.
- Texte cité par Ch. Rousseau, Droit international public, t. 3, Paris, Srey, 1977, p. 559 et ss.
- À ce sujet, voir, à titre principal, la résolution 66/102, Assemblée générale des Nations Unies, 13 janvier 2012, L’État de droit aux niveaux national et international, A/RES/66/102.
- R.-J. Dupuy, « Concept de démocratie et action des Nations Unies. Rapport introductif », Colloque de l’AFNU (23 octobre 1993), Bulletin de Centre d’information des Nations Unies, Paris, 1993, n° 7-8, p. 59-62. Voir également, au sujet d’un tel glissement, L.-A. Sicilianos, L’ONU et la démocratisation de l’État, op. cit., p. 27 et ss.
- Doc. A/51/761, 17 janvier 1997.
- Résolution 1999/57, 24 avril 1999, Promotion du droit à la démocratie. S’y trouvent énoncées les composantes d’un mode de gouvernement démocratique, tels « les droits à la liberté d’opinion et d’expression, de pensée, de conscience et de religion, et d’association », « la suprématie du droit », « le droit au suffrage universel et égal et à des procédures assurant la liberté de vote, ainsi qu’à des élections périodiques et libres », « le droit à la participation politique », l’existence d’« institutions gouvernementales transparentes et rendant des comptes », ou encore « le choix des citoyens de choisir leur système de gouvernement par des moyens constitutionnels ou d’autres moyens démocratiques ».
- C. Chaux, Les contraintes internationales sur le pouvoir constituant national, op. cit., passim
- H. Tourard, L’internationalisation des Constitutions nationales, op. cit., p. 7-8.
- H. Ruiz Fabri, C. Grewe, « La constitutionnalisation à l’épreuve du droit international et du droit européen », in Les dynamiques du droit européen en début de siècle. Études en l’honneur de Jean-Claude Gautron, Paris, Pedone, 2004, p. 197.
- Voir, au sujet notamment de cette question, C. Chaux, Les contraintes internationales sur le pouvoir constituant national, op.cit., p. 431 et ss.
- Article 30 de l’Acte constitutif de l’Union africaine du 11 juillet 2000. Voir également l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.
- Communiqué de Presse adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), en sa 941ème réunion tenue le 19 août 2020 sur la situation au Mali, PSC/PR/COMM.(CMXLI)
- C. Chaux, Les contraintes internationales sur le pouvoir constituant national, op. cit., p. 431 et ss.
- Décision d’exécution (PESC) 2020/1388 du Conseil du 2 octobre 2020 mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.
- Décision d’exécution (PESC) précitée.
- J. d’Aspremont, « La licéité des coups d’État en droit international, op.cit., p. 127.
- Voir les résolutions 841 du 16 juin 1993 et 940 du 2 août 1994 adoptées par le Conseil de sécurité.
- C. Chaux, Les contraintes internationales sur le pouvoir constituant national, op. cit., p. 442-443.
- Rapport du groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et les changements, 2 décembre 2004, A/59/565, § 94.
- Voir en ce sens, J. d’Aspremont, « La licéité des coups d’État en droit international », op. cit., p. 134-142.
- C. Chaux, Les contraintes internationales sur le pouvoir constituant national, op. cit., p. 443-444.
- Voir notamment, à ce sujet, J. d’Aspremont, « Émergence et déclin de la gouvernance démocratique en droit international », Revue québécoise de droit international, 2009, p. 57-80.
- CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Nicaragua c. États-Unis, arrêt du 27 juin 1986, Rec.1986, p. 109, § 209.
- Ibid, p. 109-110.
- Ibid, p. 131.
- O. Corten, « Les visions des internationalistes du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes : une approche critique », Civitas Europa, IRENEE, 2014, p. 93-111, spéc. p. 104.
- Arrêt précité, Rec., p. 126, § 246.
- Voir les articles 1 § 2 et 55 de la Charte des Nations unies, ainsi que les résolutions 1514 (XV) du 14 décembre 1960 (« Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ») et 1541 (XV) du 15 décembre 1960 (« Principes qui doivent guider les États membres pour déterminer si l’obligation de communiquer des renseignements prévus à l’alinéa e) de l’article 73 de la Charte des Nations Unies, leur est applicable ou non »).
- Voir notamment à ce sujet, CPI, Procureur contre Katanga, 30 septembre 2008, Chambre préliminaire I, § 238 et ss.
- La Biélorussie a très récemment dénoncé, fin novembre 2022, le Protocole facultatif, par lequel il avait investi le Comité des droits de l’homme de sa compétence de contrôle de l’application du Pacte de 1966 : voir, à ce sujet, [en ligne] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/belarus-withdrawal-individual-complaints-procedure-serious-setback-human [consulté le 05/02/2024].
- D’autres crises politiques récentes ont pu justifier les mêmes discours étatiques, sans d’ailleurs nécessairement conduire à l’adoption de sanctions contre le régime en place, à l’image de la crise syrienne
- Voir notamment CIJ, Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader, Belgique c. Sénégal, arrêt du 20 juillet 2012, CIJ Rec. 2012 (II), p. 471 ; Chasse à la baleine dans l’Antarctique, Australie c Japon, arrêt du 31 mars 2014, CIJ Rec. 2014, p. 226.
- [en ligne] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02012D0642-20210625&qid=1636968256233 [consulté le 05/02/2024].
- H. Flavier, « Crise migratoire entre la Biélorussie et l’UE : tragique géopolitique », The Conversation, 15 novembre 2021, [en ligne] https://theconversation.com/crise-migratoire-entre-la-bielorussie-et-lue-tragique-geopolitique-171885 [consulté le 05/02/2024].
- Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés HCR/1P/4/FRE/REV.1, réédité, Genève, février 2019.
- Voir O. Gille-Belova, « De Vilnius à Varsovie : l’exil des opposants biélorusses », France Culture, émission du 15 juin 2021.
- L’expression est celle du droit constitutionnel français, qui offre protection à toute personne en raison de son action en faveur de la liberté (alinéa 4 du Préambule de la Constitution de 1946).
- [en ligne] http://eurojournalist.eu/belarus-appel-aux-nations-unies-et-a-la-cour-penale-internationale/ [consulté le 05/02/2024].
- The Situation in Belarus/Lithuania/Poland/ Latvia and Ukraine: Crimes Against Humanity of Deportation and Persecution, [en ligne] https://www.iphronline.org/belarus-crimes-against-humanity-of-deportation-and-persecution.html [consulté le 05/02/2024].
- A. Eide, T. Meron, A. Rosas, « Combatting Lawlessness in Gray Zones Through Minimum Humanitarian Standards », American Journal of International Law, 1995, p. 215-223.