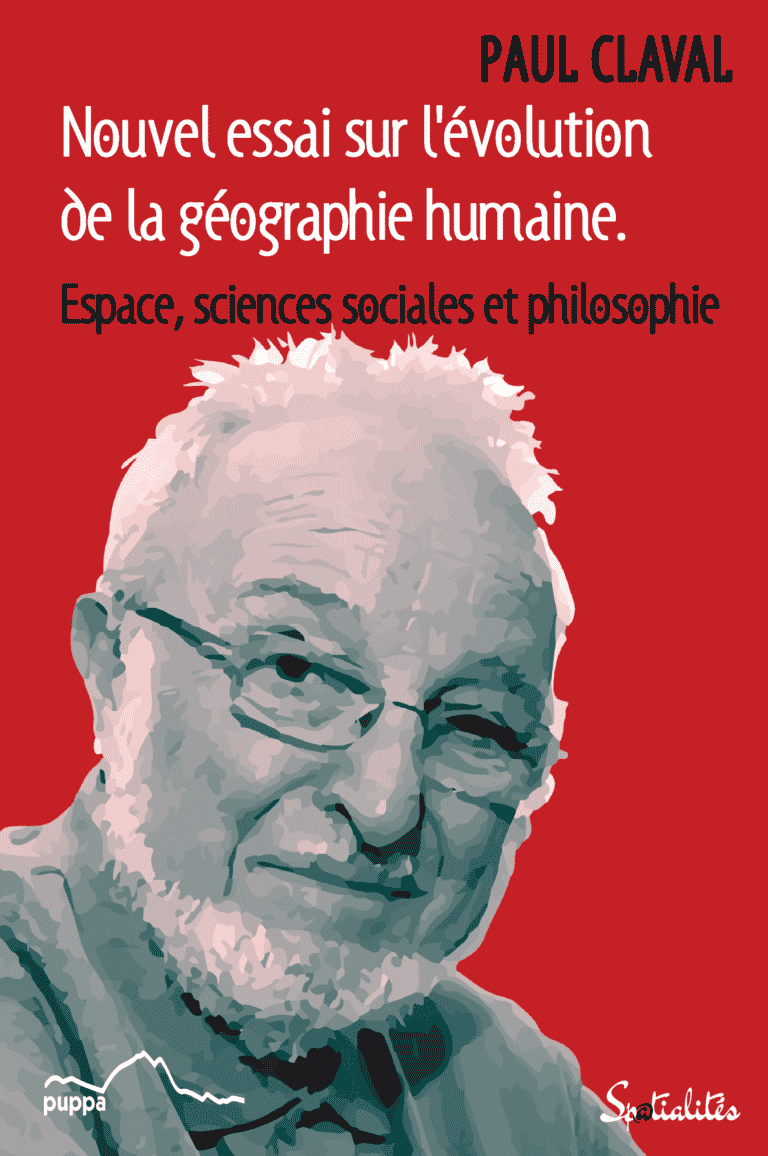Mutations et permanences
L’Essai sur l’évolution de la géographie humaine mettait l’accent sur la prééminence exercée, un temps, en France, par la géographie classique née de préoccupations évolutionnistes et de l’héritage rittérien et humboldtien, et sur l’émergence, au milieu des années 1950, de la Nouvelle Géographie, que l’on interpréta à l’époque comme un paradigme issu d’une révolution scientifique, mais qui me parût davantage traiter d’un thème jugé important par les initiateurs de la discipline mais longtemps négligé.
Je n’ai pas cessé depuis de suivre l’évolution de la géographie humaine et d’analyser les principes épistémologiques de ceux qui la pratiquent. Cela m’a conduit à replacer la discipline dans le concert des sciences de l’homme et de la société, et à mesurer ce que celles-ci avaient de parallèle et ce qui les différenciait (Claval, 2020a). Pour comprendre les tempêtes qu’elles traversent toutes entre 1960 et 1990, je me penche sur les courants phénoménologiques (Claval, 2020a, p. 169-194) et radicaux (Claval, 2020a, p. 195-254) qui les traversent et sur les techniques de déconstruction (cf. supra, chapitres 3 et 6) que mettent alors en œuvre les philosophes. Deux conceptions de la géographie naissent de ces évolutions. Elles ont en commun de rompre avec les attitudes positivistes, avec le refus de prendre en compte la subjectivité humaine et avec le parti-pris fonctionnaliste des explications. L’approche poststructuraliste insiste sur les ruptures avec la modernité et avec le structuralisme qui la motivent, élargit considérablement le champ de la discipline, se montre subversive, mais n’explore qu’en partie les mécanismes culturels et retombe dans le déterminisme sociologique qui marquait, d’une autre façon, le radicalisme sous sa forme marxiste. L’approche culturelle va plus loin dans l’exploration des mécanismes culturels et dans l’interprétation des dynamismes du monde actuel.
Un bilan de l’approche culturelle
L’approche culturelle élargit considérablement ce qu’apportaient les interprétations fonctionnalistes de la réalité géographique. À la quête de richesse et de pouvoir dont traitaient ces dernières, elle ajoute la compétition pour le statut : celle-ci met en œuvre une constellation de motivations plus riche que celle, simplifiée, de l’utilitarisme. L’homme se socialise grâce à la culture que lui transmet son entourage et aux institutions spécialisées d’apprentissage et d’éducation. Les transferts dont il bénéficie ainsi le rattachent au passé, déterminent souvent ses opinions, ses valeurs et sa conduite, mais lui donnent des armes pour faire face aux défis du présent et pour se projeter dans l’avenir. La culture conditionne les gens et les soumet souvent docilement à ceux qui la modèlent et la diffusent, mais leur ouvre des moyens (différents et inégalement efficaces selon les lieux et les époques) pour réagir de manière autonome et pour innover. L’approche culturelle refuse ainsi de cautionner le pessimisme du poststructuralisme.
L’approche culturelle prend en compte la multiplicité des formes que revêtent les processus de transmission en fonction des techniques qui élargissent les espaces où sont diffusées les pratiques, les savoir-faire, les connaissances et les croyances. Elle souligne qu’à côté des mécanismes d’endoctrinement, il y a place pour la confrontation des idées et la formation d’opinions publiques, dont le rôle est essentiel dans la vie politique.
Pour l’approche culturelle, les processus de distinction mènent à la fois à la construction de l’altérité et à l’exclusion, et à la compétition pour l’excellence, à la quête de statut et à des dynamiques sociales qui sont celles de l’influence, du prestige, de l’entraide et de la solidarité. Dans les sociétés modernes, ils introduisent une dynamique qui fonde la distinction sur la recherche de l’excellence artistique ou intellectuelle. À l’âge postmoderne, la visibilité médiatique remplace celle que régulait la nécessité d’exceller pour être retenu. Cela conduit ainsi à une lecture renouvelée de la dynamique socio-spatiale des sociétés du passé proche et d’aujourd’hui.
En soulignant la dualité des imaginaires que nourrit la culture, l’approche culturelle fait enfin comprendre que l’espace social a une double nature : empirique d’une part et instituée de l’autre. C’est à travers les imaginaires traitant d’autres mondes que les sociétés se dotent de valeurs qui orientent l’action de leurs membres et font de l’espace social une réalité qu’il convient d’appréhender à deux niveaux.
À l’analyse de l’espace divers, mais dont la nature est toute entière empirique du monde physique, elle ajoute celle des différences ontologiques qui naissent des représentations culturelles, opposent les lieux où la vie n’a pas de mystère et ceux où l’on accède à d’autres réalités. C’est ainsi la seule interprétation à prendre en compte la différenciation spatiale et les formes de sacralité qu’impliquent les quatre modes de religiosité (ceux de l’immémorial et du mythe, ceux de la Révélation, ceux de la métaphysique et ceux de l’idéologie) que les hommes ont inventé pour donner un sens à leur vie.
Ce que montre aussi l’approche culturelle, c’est que les interprétations de l’existence dont se dotent les hommes sont inséparables des conceptions qu’ils se font de l’espace ; elle rappelle du même coup que les concepts-clés de toute métaphysique, ceux de transcendance ou d’immanence, sont d’essence spatiale. La géographie éclaire ainsi sous un jour nouveau la réflexion philosophique.
Les trois conceptions des sciences sociales
et leurs implications
1. J’ai consacré beaucoup de temps à explorer les fondements épistémologiques des sciences sociales et à les comparer à ceux de la géographie que j’étudiais plus en détail. J’en ai tiré l’idée que les disciplines de l’homme à base empirique tiennent leur diversité de la multiplicité des documents sur lesquels repose leur travail, mais qu’elles contribuent toutes à l’établissement d’une métathéorie de l’individu socialisé et de la vie collective. C’est à cette tâche que participe la géographie humaine.
Ces sciences sociales sont modestes : elles s’appuient sur l’analyse systématique de données, sont attentives aux structures qu’elles y détectent, essaient de démêler les forces qui en sont responsables et celles qui les font évoluer et les inscrivent dans l’histoire.
2. Une seconde façon de bâtir l’étude de la société s’est également développée, et cela, plus spécialement en France. La sociologie y est née, au début du XIXe siècle, de la volonté de bâtir une philosophie des sociétés humaines qui revêtirait l’habit des savoirs alors émergents. Cette discipline serait à elle seule capable de couvrir la totalité du champ de la vie collective, ou aurait, à tout le moins, la mission de le régenter.
La grande question qu’elle se pose est héritée de l’humanisme renaissant : c’est celle de la conciliation de la liberté inscrite dans la nature de l’homme et des rapports de sujétion, toujours présents dans les relations collectives et qui peuvent concerner la quasi-totalité de certaines sociétés. Scandale, clame Étienne La Boétie, qui s’insurge à la vue de la servitude consentie de peuples entiers tremblant devant un tyran qu’ils pourraient facilement renverser !
Pour les sciences sociales naissantes, aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’ordre nécessaire à la vie collective impose une limitation de la liberté de chacun. La nécessité s’en fait à tel point sentir que les hommes acceptent au moins partiellement cette amputation dans le contrat qu’ils signent pour sortir de l’état de nature.
Dans la sociologie de tradition française, de Comte à Durkheim, c’est une religion civique partagée qui fait comprendre la solidarité nécessaire à la bonne marche de la société et conduit les gens à accepter le sacrifice d’une partie de leur libre-arbitre. Dans la forme plus laïque que prend cette sociologie à la fin du XXe siècle avec Pierre Bourdieu, c’est le conditionnement de tous par l’habitus qui leur fait accepter comme normale la servitude à laquelle ils sont réduits ; la formation du sociologue le met à part et le conduit à remettre en cause de ce qui paraît aller de soi et est attribué aux forces de la nature ; c’est à lui qu’il revient de dénoncer l’entorse que les sociétés modernes font aux principes qu’elles affichent.
Sauf dans leur formulation bourdieusienne, cette famille de sociologies se distingue par l’attention qu’elle porte aux représentations religieuses – mais ne prend pas en compte la forme que revêtent celles-ci dans le monde moderne où elles sont complétées ou remplacées par les systèmes de croyances que constituent les idéologies.
3. Une troisième façon de concevoir les sciences sociales repose sur un constat : l’analyse de ce qui y est observable n’explique qu’une partie de la réalité ; nombre des processus qui modèlent la vie des individus et des groupes passent inaperçus au commun des mortels comme au chercheur dont les yeux n’ont pas été dessillés par une rupture épistémologique.
Les seules vraies sciences sociales sont celles qui arrivent à décrypter la face inconsciente du réel. Pour Marx, celle-ci concerne les réalités économiques ; pour Freud, les motivations réelles de l’être, la sexualité en particulier ; pour Ferdinand de Saussure, ce qui transite par le langage.
La rupture épistémologique dont bénéficie le chercheur en sciences sociales conduit celui-ci à considérer comme fallacieux les systèmes d’idées qui circulent dans les sociétés qu’il analyse et à les considérer comme des discours mensongers, des idéologies – Marx donne l’exemple.
C’est cette conception dont Foucault fait tardivement la théorie en inversant la métaphysique de Kant et de l’idéalisme allemand : il reprend pour cela à Nietzsche l’idée que ce sont les forces profondes de l’homme, et non pas sa raison, qui font sa grandeur. Cela le conduit à condamner la totalité des sciences sociales empiriques.
La séduction qu’exercent les recherches fondées sur l’inconscient tient à la radicalité des thèses qu’elles proposent : elles mettent en évidence les contradictions et les vices des systèmes qu’elles analysent, ce qui leur confère un élan révolutionnaire (Claval, 1977b ; Springer, 2017a et 2017b). Leur faiblesse vient de l’interprétation souvent arbitraire de ce qui est voilé, si bien que la « science » critique qu’elles prétendent élaborer n’est en réalité qu’une construction mal étayée, une « idéologie » au mauvais sens du terme.
Le refus de l’anthropologie culturelle américaine de prendre en compte les valeurs morales des groupes qu’elle étudie a eu des effets analogues : il privait les groupes étudiés de ce qui faisait leur cohérence et leur donnait de l’authenticité.
L’évolution de la géographie saisie dans son contexte
Depuis le début des années 1960, j’ai la conviction que les transformations de la géographie humaine et les possibilités qu’elle ouvre ne peuvent être convenablement comprises que si elles sont saisies dans leur contexte. Cela me conduit à embrasser à la fois les dynamiques de cette discipline, celles de l’ensemble des sciences sociales et celles de la société contemporaine (Claval, 2019). À l’analyse des forces socio-économiques en œuvre dans le monde d’aujourd’hui, aux diverses mutations techniques qui se succèdent depuis la première révolution industrielle, à la globalisation accélérée des échanges, à l’élargissement des responsabilités de l’État, il convient d’ajouter l’évolution des modes de religiosité en œuvre dans les sociétés occidentales et dans les autres. Aux processus socio-économiques mis en évidence par les approches fonctionnalistes de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe s’additionne le poids des cultures et des dispositifs spatiaux qu’elles mobilisent. Les problèmes que connaît le monde actuel s’éclairent ainsi ; on y observe une tendance à la fragmentation de l’espace après une longue phase où s’affirmait sa standardisation ; cela va de pair avec la remise en cause de la civilisation occidentale.
Le progrès technique a permis de triompher de nombre des contraintes qu’imposaient localement les milieux, mais au prix d’une mobilité et d’une consommation d’énergie qui mettent en danger les équilibres globaux : il est devenu indispensable de les sauvegarder et de les restaurer. Cela pose à la géographie des questions nouvelles et fondamentales. Comment réorganiser les rapports des groupes humains à leurs environnements locaux pour sauver la planète ? Dans quelle mesure ces nouvelles contraintes imposent-elles une réorganisation ou une limitation à l’exercice des libertés humaines ?
L’espace et les processus sociaux
Quelle que soit la manière dont on les conçoit, les sciences sociales étudient des processus sociaux qui se situent dans l’espace. Dans la mesure où elles prennent en compte systématiquement ce que Foucault qualifie de dispositifs spatiaux, toutes contribuent à aiguiser le regard que porte le géographe en ce domaine.
Étendue et réseaux, obstacle, transparence et visibilité
Les géographes qui créent la géographie humaine promènent un regard émerveillé et inquisiteur sur la surface de la terre. Leur tâche est celle de défricheurs : ils sont les premiers à mettre systématiquement l’accent sur les traces et les marques qu’y ont inscrites les hommes ; comme tous les pionniers, ils doivent d’abord se familiariser avec la distribution des faits qui les intéressent. L’espace est pour eux une étendue dont ils observent les nuances et les contrastes et où apparaissent des ensembles plus ou moins homogènes séparés par des lignes de contact et des frontières : les chercheurs y découvrent ainsi des structures. Ils les associent aux données naturelles d’une part, et aux genres de vie que leur fait connaître leur analyse, de l’autre.
Dans la mesure où la Nouvelle Géographie est plus sensible aux formes que prennent la vie et la distribution des hommes dans un monde qui s’urbanise et s’industrialise rapidement, la recherche prête davantage attention aux routes, aux autoroutes, aux voies ferrées, aux fleuves et aux canaux, aux ports et aux aéroports, à tout ce qui touche à la circulation, d’une part, et aux points où ces lignes se croisent, et où poussent villages, bourgs, villes ou grandes métropoles. Ce qui structure désormais l’espace, ce sont les réseaux qui canalisent les flux de circulation et les lieux centraux vers lesquels convergent les voies.
Parmi les sciences sociales, l’économie porte un intérêt tout aussi grand à la circulation que ne le fait la géographie, mais elle attire l’attention sur des flux jusque-là négligés : ceux d’information. Elle montre le rôle essentiel qu’ils jouent dans la préparation des décisions que prennent les acteurs géographiques et dans leur régulation. De leur côté, les anthropologues mettent l’accent sur la manière dont la culture se transmet : l’espace les intéresse par les communications qui y prennent place, et par la forme qu’elles revêtent, orales ici, écrites ailleurs, véhiculées par les médias modernes dans d’autres circonstances.
L’anthropologie et la sociologie sont enfin sensibles à un autre aspect de l’espace humain : sa structuration par les réseaux de relations institutionnalisées qui établissent des connexions privilégiées entre certains acteurs.
Les géographes ont ainsi intérêt à appréhender l’espace de plusieurs manières : (i) comme étendue divisée en plages plus ou moins larges et constituant des mosaïques, (ii) comme structuré par des réseaux de voies de circulation des hommes, des biens et des moyens de paiement, mais aussi des nouvelles, des connaissances ou des croyances. Aux réseaux physiques se superposent les (iii) relations sociales institutionnalisées, qui empruntent les infrastructures matérielles disponibles, mais réduisent les distances en s’appuyant sur la confiance, ou les allongent lorsque s’installent la défiance et l’hostilité.
Étendue et espace doivent donc être appréhendés par les géographes comme des réalités physiques, mais en tenant compte des variables sociales qui les qualifient : localités et régions sont désirables, sinistres ou repoussantes ; les relations sont plus faciles avec des groupes amis, et lorsqu’elles empruntent des chenaux sociaux bien structurés et où règne la confiance.
Les qualités qui font apprécier l’espace varient en fonction des perspectives retenues par les géographes : pour les géographes humains de la première génération, l’attention va aux qualités qui rendent l’étendue exploitable par la pêche, la chasse, la foresterie, l’élevage, l’agriculture ou les mines ; la terre est appréciée en fonction de sa fertilité et des ressources qu’elle recèle. Pour la Nouvelle Géographie, l’accessibilité devient la variable essentielle.
L’attitude des hommes à l’égard de l’espace n’est pas uniquement commandée par l’utilitarisme qui est au cœur de l’économie. À côté des choix rationnels qu’elle analyse, il y a ceux qui naissent des sentiments, du charme des lieux ou de la répugnance qu’ils suscitent, de leur sécurité ou de leur insécurité. L’approche culturelle introduit ainsi des dimensions nouvelles dans l’évaluation géographique de l’espace : la valeur paysagère des lieux et leur visibilité en particulier. Progrès des techniques de communication et augmentation des niveaux de vie leur donnent une signification nouvelle en déplaçant la consommation vers les activités culturelles ou de loisir.
L’espace qu’étudie la géographie humaine est une construction humaine. Il est différencié à la fois par son relief, son climat et ses formes de vie, et par les agencements qui y ont apportés les hommes. Ceux-ci font partie de dispositifs qui isolent les gens ou les intègrent dans des groupes, en font la cible du regard d’autrui ou les y soustraient, les cachent ou les mettent sur le devant de la scène. La géographie qu’analyse la discipline parle d’un espace structuré par le jeu des regards, des formes de surveillance qu’ils permettent, mais aussi des connaissances qu’ils apportent et des plaisirs qu’ils font naître. Le monde qu’elle restitue est mis en scène – une mise en scène conçue par de nombreux réalisateurs, mais où les masses ne tiennent souvent que des rôles de figurants.
Telle qu’il concevait son métier à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe, le géographe cherchait à dresser un tableau aussi informé et précis que possible de la surface de la Terre. Pour y parvenir, il devait porter sur le monde un regard dépassionné et objectif. Comme on disait volontiers à l’époque, il lui fallait acquérir « l’œil du géographe », c’est-à-dire un regard rompu aux changements de focale et d’échelle (Claval, 2012). Il pouvait ainsi saisir à la fois le réel à la dimension de ce que vivaient les gens et avec du recul ; il prenait conscience de l’existence d’ensembles homogènes ou de zones de polarisation à la surface de la terre. La démarche régionale qu’il adoptait permettait de distinguer des ensembles qui appelaient, de la part des gouvernants, les mêmes actions politiques.
Le tournant culturel a profondément modifié le métier du géographe. Ce que l’on attend de lui, ce n’est plus la construction à lui tout seul d’une image qui mette en évidence les structures objectives de la surface de la terre et permette d’imaginer les aménagements qu’elles appellent. Le chercheur s’attache désormais à analyser le regard que portent sur le monde les populations qu’il étudie (Claval, 2012). Ce qu’il analyse, c’est un théâtre, avec une scène où se déroule l’action et des coulisses qui lui sont cachées ; il y a des acteurs d’un côté et des spectateurs de l’autre. Certains acteurs aspirent à échapper à la curiosité collective, à vivre en coulisses dans l’anonymat et à se trouver isolés. D’autres aiment s’exposer et fréquentent de préférence les avenues, les places, les parcs ou les terrasses où se pressent les gens. C’est pour cela qu’aux qualités de fertilité ou accessibilité sur laquelle la géographie d’hier attirait l’attention s’ajoute celle qu’assure la visibilité.
L’appréhension de l’espace par la géographie humaine s’est donc considérablement affinée en un siècle et demi. Elle le doit en partie aux ouvertures apportées par d’autres sciences sociales.
La double nature de l’espace social
Les recherches menées dans les disciplines de l’homme soulignent la nature complexe de l’espace social. L’interprétation proposée par Claude Lévi-Strauss (Lévi-Strauss, 1936) du plan des villages Bororo du Matto Grosso brésilien est célèbre ; les habitations y sont disposées en cercle autour de la maison des hommes : l’espace qui revient à ceux-ci, au centre, s’oppose à celui, périphérique, des femmes. Mais ce cercle est coupé par deux axes, l’un en gros est-ouest par rapport auquel s’organisaient les phratries, et l’autre perpendiculaire au rio Vermelho, tout proche, et qui sert de limite aux clans d’aval et d’amont. Trois groupes de classes (qui regroupent les individus supérieurs, moyens et inférieurs) soulignent enfin la division de chaque clan en trois ensembles dont les supérieurs d’une moitié épousent les supérieurs de l’autre, les moyens en font autant des moyens de l’autre et les inférieurs, des inférieurs.
Trois dimensions de l’espace social bororo sont ainsi inscrites sur le sol : derrière la simplicité du cercle des maisons se traduisent ainsi les multiples dimensions de l’espace social de ce peuple telles que les résume Lévi-Strauss :
« Récapitulons les traits principaux de la société bororo. Nous en avons dégagé trois qui consistent : 1° dans plusieurs formes de dualisme de type diamétral […] ; 2° dans plusieurs formes de dualisme de type concentrique […] ; 3° dans une structure triadique qui opère une redistribution de tous les clans en trois classes endogames (chacune divisée en deux classes exogamiques…) » (Lévi-Strauss, 1958, p. 162).
Cette complexité, on la trouve évoquée sous la plume de nombre d’auteurs. Elle exprime dans l’espace géographique les oppositions binaires ou les structures triangulaires de ces groupes dans l’espace social.
Les structures spatiales peuvent aussi avoir une autre origine et une autre fonction. Foucault prend conscience de l’hétérogénéité très générale des espaces sociaux : des hétérotopies y sont partout présentes, alors même qu’elles contredisent les principes de l’organisation du reste de la société. À côté ou au sein de l’espace socialisé en commun qui est celui du groupe, il existe des enclaves qui en diffèrent qualitativement et qui en constituent, à bien des titres, l’envers.
Foucault retrouve là, mais dans un contexte laïque, ce qui est depuis longtemps une évidence pour les spécialistes des religions : à l’espace profane de la vie de tous les jours s’opposent les espaces sacrés où se célèbrent les cultes et où se commémorent les fêtes du calendrier religieux. À certains moments, des célébrations interrompent le train de la vie quotidienne ; l’espace est décoré pour signifier sa renaissance ; des processions le parcourent qui lui restituent sa sacralité d’origine. Toute portion d’espace peut être ainsi sanctifiée et purifiée pour que la vie s’y développe avec plus de force et plus de succès.
Si l’espace social n’est pas partout de la même nature, la géographie humaine se doit de consacrer un de ses chapitres à l’ontologie spatiale. Le problème, c’est que certaines convictions scientifiques s’y opposent dans la mesure où elles se refusent à faire intervenir les valeurs éthiques dans leurs interprétations. On le voit aux hésitations de Michel Foucault, qui attend dix-sept ans pour rendre public un des résultats les plus originaux de ses recherches : l’existence universelle d’hétérotopies.
Comment surmonter ce refus ?
L’espace social comme donnée empirique
et comme réalité instituée
Une constatation banale met sur la voie de la solution : le monde social est toujours institué ; nous le percevons d’abord comme une réalité empirique, mais la société le fait accéder à une réalité supérieure en lui donnant un autre statut. L’opération n’est pas une création ex nihilo ; c’est fondamentalement un baptême, l’admission de quelque chose qui existe déjà de manière empirique au sein du monde de valeurs sans lequel il n’y aurait pas de vie de groupe. L’espace est donc deux fois né : le cosmos ordonné de l’Antiquité et le monde des philosophes contemporains se substituent au chaos originel. L’individu ne commence socialement à exister que lorsqu’il a officiellement reçu un nom ; il cesse alors de n’être qu’une chose vivante pour devenir un être humain. La société ne naît pas fortuitement de la rencontre des hommes. Les colons grecs qui partaient fonder de nouvelles cités emportaient avec eux les statues des dieux qui veilleraient sur le nouvel établissement. Comme Gottmann (1952) le rappelle, les Serbes qui allaient défricher un coin de forêt pour y créer un village, étaient menés par des popes porteurs des icônes nécessaires à l’intégration de la terre mise en valeur et de ceux qui l’habitaient dans le monde chrétien. Au sein même de chaque société, les relations qui sont essentielles à la vie du groupe sont institutionnalisées, c’est-à-dire socialement reconnues. Cela les dote d’une force dont elles ne jouiraient pas sans cela. En intégrant des jours fériés et des fêtes, le calendrier institutionnalise le temps.
À la suite d’Arnold van Gennep, l’étude des rites de passage (van Gennep, 1909), éléments essentiels des procédures d’institution du social, n’a cessé de progresser. Ils jouaient un rôle essentiel dans le monde traditionnel où on les a d’abord analysés. Malgré tous les efforts pour les faire disparaître, ils subsistent dans nos sociétés. Ils paraissent même renaître de rien dans les groupes de jeunes désocialisés, auxquels ils donnent une structure.
Un des grands problèmes des sciences humaines d’aujourd’hui est de rendre compte de l’institution du social : une société vraie, une société instituée, c’est une société pourvue de valeurs – et de valeurs partagées.
Que le problème soit important, rien ne le montre mieux que la place que lui réserve la sociologie française d’inspiration philosophique : pour elle, le ciment sans lequel un groupe ne peut vivre ne peut lui être fourni que par une religion. Les formes traditionnelles de celle-ci, qu’elles se fondent sur l’immémorial et sur le mythe, sur la Révélation ou sur un Être suprême ayant perdu leur crédibilité, c’est à la sociologie qu’incombe de fonder une religion civile de l’humanité. Dans l’interprétation laïque qu’en imagine Bourdieu, l’imprégnation de tous par des valeurs partagées n’est plus expliquée en termes religieux. C’est par l’inculcation progressive d’attitudes, de pratiques et de valeurs que constitue l’habitus que les couches de la société qui contrôlent la production d’idéologies façonnent l’ensemble du groupe et le préparent à la soumission. Le côté le plus novateur de cette interprétation est qu’elle est valable dans toutes les sociétés, celles qui se réclament d’une même pratique ou d’une même foi religieuse, et celles qui s’articulent autour d’idéologies.
Michel Foucault admet que la prise en compte des hétérotopies implique que l’espace puisse être qualitativement différent d’un point à un autre, mais il est incapable d’en fournir une explication satisfaisante : son rationalisme méthodologique lui interdit en effet de prendre au sérieux les mécanismes de la religiosité. Ce sont pourtant eux qui expliquent que le monde social ne soit pas celui de l’empirie, mais celui, deux fois né, d’un monde recréé dans un univers de valeurs ainsi institutionnalisé.
Ce qui a manqué à Foucault, c’est de pousser jusqu’au bout la logique de son analyse du rôle des dispositifs spatiaux dans la genèse du pouvoir. Ce n’est pas seulement la genèse des micro-pouvoirs du quotidien qu’explique ce type de mécanique ; c’est la nécessité inhérente à toute vie sociale de donner un sens à la vie en l’encadrant de valeurs et en l’ancrant dans une forme ou une autre de vérité, d’absolu ou de sagesse. Cela oblige à relativiser l’opposition des sociétés à religions ou à métaphysiques, d’une part, et de celles à idéologies d’autre part – les unes et les autres étant structurées par leur religiosité, même si celle-ci ne revêt pas les mêmes formes. Cela implique de prendre au sérieux les aux-delàs que fabriquent les imaginaires du second genre. Cela conduit à tirer parti de l’immense réflexion menée depuis longtemps sur la spiritualité.
Les approches philosophiques
et les approches culturelles de la vie sociale
L’enquête que nous menons depuis un demi-siècle sur les interprétations de la vie sociale proposées par les sciences sociales nous a ainsi conduit à opposer trois grandes familles d’approches : celles qui partent de ses manifestations observables, des traces de l’activité humaine en particulier ; celles qui se construisent sur la mise en lumière des mécanismes cachés et inconscients qui la structurent, et celles qui la posent en termes philosophiques de liberté et de rapports de l’individu au groupe.
Le courant de pensée d’où sort la modernité est à la rencontre de la réflexion médiévale sur le transcendantal, telle que la résument les études du philosophe néerlandais Jan Aertsen (Aertsen, 2002), et de la redécouverte des philosophies antiques de l’homme (stoïcisme, épicurisme, scepticisme) qui inspirent l’humanisme. Ce mouvement met l’être humain et ses capacités au cœur des nouvelles problématiques. L’individu n’a que son intelligence pour penser le monde, s’y faire une place et le gérer, mais il est libre, c’est-à-dire que son esprit lui permet d’aller au-delà du sensible.
Le cours de la réflexion philosophique en est profondément modifié : le problème sur lequel elle est désormais centrée est fondamentalement celui de l’exercice de la liberté, qui fonde la dignité de l’homme, dans un environnement politique qui la contraint. C’est la question que pose le Contr’Un de La Boétie et qui inspire Montaigne. C’est celle qui se trouve au cœur des théories du contrat social, où s’enracinent à la fois les sciences sociales et les idéologies du progrès. Cette conception est reformulée par Kant qui conçoit l’homme comme un être limité par ses sens, mais dont l’esprit, doté de capacités transcendantales, est capable de choix libres.
Ce sont ces conceptions qui motivent, au début du XIXe siècle, la naissance de la sociologie telle que la conçoit Auguste Comte. De la tradition humaniste et contractualiste, elle hérite l’idée que la société doit être saisie comme un tout régi par des règles communes – c’est en ce sens que Durkheim parle du fait social total. De sa composante humaniste, la sociologie conserve l’idée que l’enjeu central de l’organisation sociale, c’est celui de la liberté et de la nécessité de concilier celle de chacun avec celle des autres. À ce problème social, il convient d’apporter une réponse globale : dans des sociétés où la vie d’échange est encore peu développée, celle-ci ne peut venir que d’un contrôle général des comportements, celui que permet un corps partagé de principes, une religion. Dans le monde moderne, où les complémentarités réelles se multiplient mais où les croyances traditionnelles sont remises en cause, il convient de bâtir une religion civique de l’humanité pour maintenir l’équilibre social.
Pierre Bourdieu est marqué par cette tradition. Les sciences de la société constituent pour lui une continuation de la philosophie par d’autres moyens. Les problèmes auxquels elles sont confrontées sont fondamentalement globaux. Ils naissent toujours de la tension entre le droit qu’ont les hommes à s’accomplir en faisant pleinement usage de leur liberté et les contraintes qu’impose la vie sociale. La solution proposée par Durkheim d’une conciliation assurée par une religion civique n’a aucun sens dans un monde devenu post-religieux.
Bourdieu approfondit l’analyse jusque-là menée du social en prenant en compte ses composantes culturelles. L’expérience de la recherche anthropologique qu’il acquiert en Algérie lui apprend comment analyser une société en la déconstruisant d’abord.
C’est à son expérience d’ethnologue, mais aussi à son intérêt pour l’esthétique et pour les travaux d’Erwin Panofsky, que Bourdieu doit l’analyse qu’il propose de la diffusion des modèles culturels de comportement. Il ne la situe pas, comme Foucault, à l’étage moyen de la culture, celui des formations discursives. Il l’identifie aux moyens qui inculquent à l’individu, et sans que celui-ci en soit conscient, l’ensemble de ce qu’il éprouve, qu’il sait et qui en fait un être social. C’est parce que l’individu est une illusion, que l’habitus qui le meut lui est imposé par le milieu encadrant et par ceux qui le façonnent et le manipulent, que la société fonctionne, alors même que sa marche est aux antipodes des valeurs dont elle se réclame, que la liberté n’est que de façade et que la plus grande partie de la population est dominée et exploitée.
La démarche de Foucault a d’autres ancrages. Elle part de Kant et de Nietzsche. Dans un premier temps, elle s’attache à l’étage moyen de la culture et aux moyens qu’il offre de saisir la société ; ce niveau se situe entre l’encodage direct des données dans les catégories du langage et celui de la connaissance élaborée et rationnellement construite qu’est la science. Cet étage moyen, celui des épistémès et des formations discursives « sérieuses », voit se mêler objectifs intellectuels et jeux de pouvoir. C’est là que s’élaborent les « énoncés » qui confèrent aux « discours sérieux » leur propriété fondamentale : celle de figer les représentations et de permettre leur diffusion à l’identique. C’est par ces processus que s’opère, pour Foucault, le passage de l’échelon global (celui de la société entière) à ses expressions locales.
Les conceptions officielles du monde exaltent la liberté et la responsabilité de l’homme. L’analyse de l’étage intermédiaire de la culture montre une réalité différente : un contrôle social de plus en plus tatillon des comportements y limite la liberté. C’est d’autant plus grave, professe alors Foucault, que l’homme n’est pas fait du mélange de corporéité et de pouvoirs transcendantaux mis en avant par Kant – les pouvoirs transcendantaux étant à l’origine de son dynamisme. C’est bien un être de tensions, mais celles qui le traversent ne naissent pas, comme on le pensait à l’époque de Kant, de l’étendue de son vouloir et des limites de sa constitution biologique ; elles résultent des forces de vie qui l’animent et sont au cœur de lui-même, et du contrôle qu’impose la société et qui conduit au refoulement de ce qui est pourtant fondamental.
Pour Foucault, le problème qui domine toute la vie sociale, c’est toujours celui de la conciliation entre l’accomplissement de l’individu – sa liberté – et l’ordre. Mais l’accomplissement n’est plus, pour lui, celui de l’intelligence, mais celui des forces profondes et souvent obscures de l’être ; l’oppression s’y fait au nom d’une raison sociale appuyée sur la science.
Selon Foucault, si cette situation s’est développée, c’est que sous leurs formes aujourd’hui dominantes, les sciences sociales, qui devraient guider l’action sociale, sont des caricatures de ce qu’elles devraient être dans la mesure où elles en restent à la surface des choses. Le modèle que préconise Foucault est ainsi inséparable des emprunts qu’il fait à la troisième conception des sciences sociales que nous avons analysée, celle qui les fondent sur l’exploration de l’inconscient.
C’est donc de leur réinterprétation de la métaphysique kantienne ou du paradigme de la sociologie philosophique que Foucault et Bourdieu tirent, par des voies différentes, leur condamnation des sociétés actuelles comme des sociétés de mensonge dont les objectifs de liberté et d’égalité sont toujours piétinés. Ils y arrivent par la critique de toute science sociale qui n’est pas arrimée sur l’inconscient pour Foucault, et par la déconstruction de la société grâce à la mise entre parenthèse de ses valeurs que Bourdieu emprunte à l’anthropologie (l’individu libre n’existe pas ; les êtres humains n’ont d’autre consistance que celle, sociale, que leur confère l’habitus).
Les approches poststructuralistes que mobilise la géographie se fondent sur les travaux de Foucault et de Bourdieu pour postuler l’existence de matrices de domination. C’est de là que provient leur fragilité.
Après 1975, les positions de Michel Foucault changent, nous l’avons vu. Son interprétation de la société devient plus nuancée : il ne la juge plus coupable d’effets massifs de domination. Attaché aux jeux de pouvoir qui naissent au niveau le plus humble de la vie collective, il ne pose plus le problème de la liberté humaine et de ses limites de la même façon et à la même échelle. Fini l’époque où il déduisait de l’analyse de textes anciens des vues globales sur tel ou tel type de société. Ce qu’il décortique dorénavant, c’est ce qui se passe dans l’existence quotidienne et se reproduit mille et mille fois. Il appréhende les relations sociales dans leur aspect le plus matériel et le plus concret. Elles doivent à la fois leurs caractères (i) à ce qu’elles sont instituées et formatées du même coup à l’échelle sociale, et (ii) aux dispositifs spatiaux où elles prennent concrètement place. Les processus sociaux et culturels sont ainsi appréhendés dans une perspective nouvelle : ils doivent leurs traits les plus importants aux configurations de l’espace où ils s’inscrivent. La surveillance atteint son efficacité maximale lorsqu’elle est effectuée dans les conditions mises en œuvre par le Panoptique de Jeremy Bentham : les gens savent qu’ils sont épiés, mais comme ils le sont à travers une paroi semi-transparente, ils ne peuvent détecter les moments où l’attention du garde se relâche, si bien qu’ils doivent se contrôler en permanence.
On passe de la contrainte extérieure que constitue la surveillance à l’autocontrôle à travers d’autres dispositifs : la confession, qui oblige à faire périodiquement retour sur soi en face d’un confesseur (ou publiquement, chez les protestants), ou l’examen de conscience, que favorise la tenue d’un journal.
La généralisation de tel ou tel dispositif transforme l’échelle de leurs effets – mais sans qu’ils aient le caractère systématique que l’on prête souvent à la domination. Ceux qui gouvernent les sociétés le savent bien, qui ménagent, dans le tissu spatial qu’ils aménagent, des hétérotopies, c’est-à-dire des zones où les dispositifs en vigueur ailleurs ne sont pas appliqués et sont remplacés par d’autres. L’espace change de nature parce que ce qui est officiellement condamné ici est toléré ailleurs grâce à des dispositifs spatiaux différents. Le problème de la liberté de l’individu n’a plus à être résolu d’un coup, par des mesures globales. Il l’est en partie par une sectorisation de la liberté. Ce qui est condamné dans certaines aires est toléré dans d’autres. À l’inverse, certaines enclaves sont conçues pour priver totalement ceux qui y sont confinés des libertés qui existent ailleurs.
La voie qu’ouvre ainsi Foucault, c’est celle du traitement fractionné du problème de la liberté qui caractérise certaines formes d’organisation de l’espace – certains types de dispositifs. Cette voie commence juste à être exploitée.
L’approche culturelle
et les problèmes du monde actuel
La géographie d’hier a contribué à modeler le monde contemporain en soulignant les bienfaits que l’humanité pouvait attendre d’une mobilité élargie : régularité des approvisionnements et augmentation des niveaux de vie. Il apparaît aujourd’hui que ces bienfaits se sont accompagnés d’un élargissement de la conflictualité – une conflictualité générée par les trois formes de compétition auxquelles se livrent les hommes : compétition pour la richesse, pour le pouvoir et pour le statut.
La géographie poststructuraliste permet d’analyser les transformations du monde dans une optique adaptée aux réalités actuelles : elle pose les problèmes à l’échelle globale et les analyse en mettant en œuvre une grille universelle d’évaluation.
Mais la géographie poststructuraliste souffre d’ignorer certaines des perspectives qu’ouvrent l’approche culturelle. Celle-ci montre en effet que l’on ne peut réduire l’analyse de l’organisation de l’espace par les hommes à ses dimensions palpables, matérielles. Toute société génère des ailleurs pour se donner un sens. Les aux-delàs de l’immémorial et de la Révélation ont depuis longtemps perdu de leur crédibilité. Ceux de la métaphysique – qui constitue l’assise de la philosophie occidentale –, menacés depuis le XVIIIe siècle, et sauvés par Kant, sont remis en question par Nietzsche et la déconstruction moderne. Celle-ci remet en cause la fabrique des idéologies.
La crise que connaît l’Occident ne résulte pas seulement de la fin des idéologies du progrès et des philosophies de l’histoire qui s’étaient dessinées à la Renaissance et affirmées à partir du XVIIe siècle. Une prise de conscience vient de s’effectuer : la structuration des sociétés humaines est inséparable de la mise en place de systèmes de valeurs, qui permettent de les instituer, elles et l’espace où elles vivent ; ceux-ci sont alors chargés de significations grâce à de grands récits dont l’autorité naît de ce qu’ils proviennent d’ailleurs lointains.
L’Occident croyait avoir réussi à sortir de la ronde des « aux-delàs » dont les hommes ont besoin pour se guider et se rencontrer : n’était-ce pas la seule civilisation qui ait proscrit comme fallacieux tous les « ailleurs » situés dans des espaces imaginaires ? Ceux sur lesquels étaient ancrés les idéologies n’étaient-ils pas terrestres ? La déconstruction à l’œuvre depuis Nietzsche et qui se systématise à partir des années 1950 montre que c’est inexact : le système des valeurs sur lequel s’est bâti le monde occidental est aussi fragile que les autres.
À partir de là, deux solutions : ou bien, on considère que toutes les civilisations se valent, ce qui conduit au relativisme et au communautarisme, ou bien on pense que reconnaître à toutes les civilisations la même valeur est un renoncement et une erreur. Le vrai défi, c’est d’apprendre à vivre dans un monde où l’on sait que tout système de valeur est relatif, transitoire et critiquable. Cette prise de conscience les affaiblit tous – les dévalorise, peut-on dire. La solution n’est certainement pas de les renvoyer dos-à-dos, mais de les dépasser – de mettre en place, au nom de l’intérêt supérieur de la planète et de l’environnement, des protocoles qui respectent la diversité des systèmes de valeurs, désormais considérés comme affaires privées, le seul critère commun étant qu’ils prennent en compte l »épanouissement de l’humanité ou la sauvegarde de la terre.
Pour les écologistes, il convient de passer d’un idéal de l’humanité à un idéal de la planète. Pour ceux qui refusent de rompre avec la tradition occidentale, il faut bâtir un ordre qui concilie à la fois les aspirations des hommes et les impératifs écologiques.