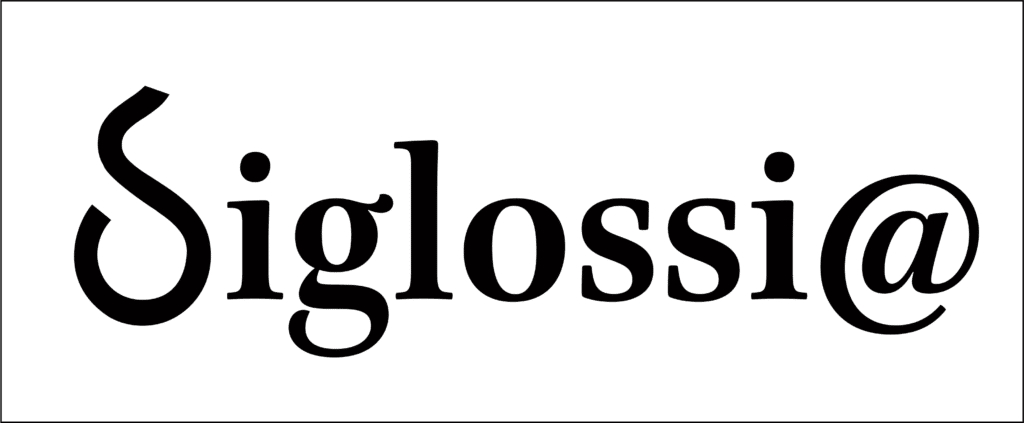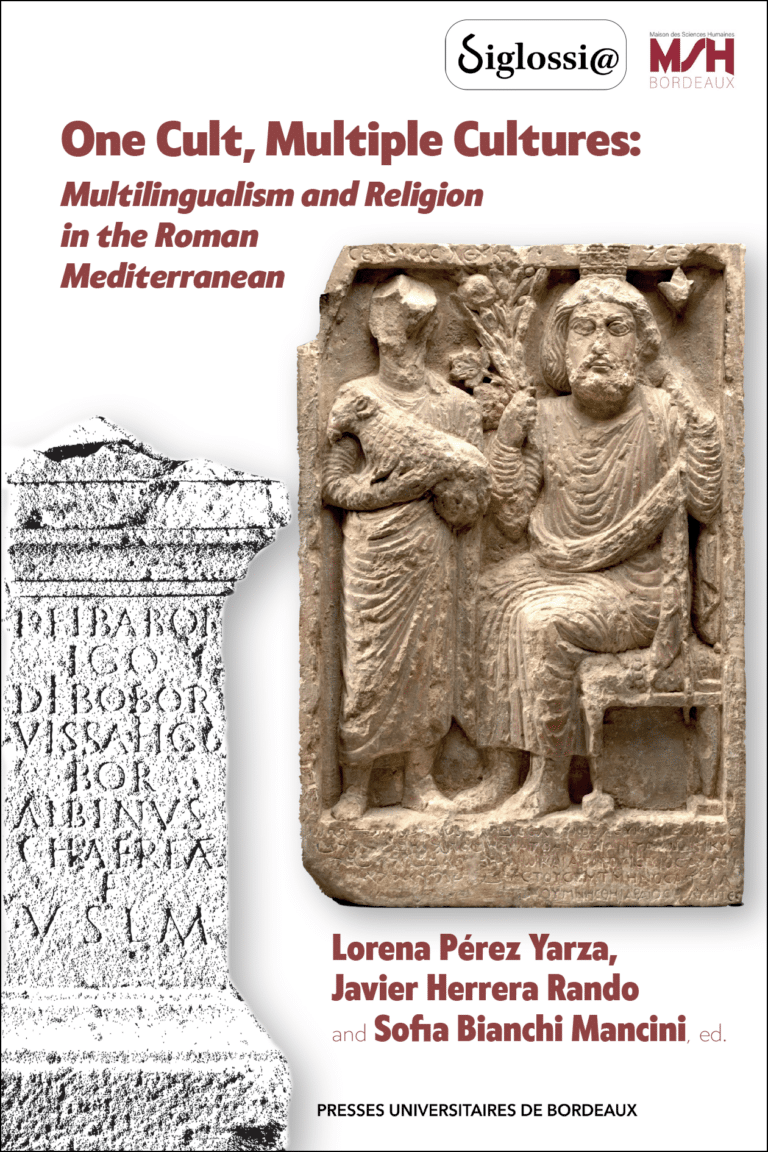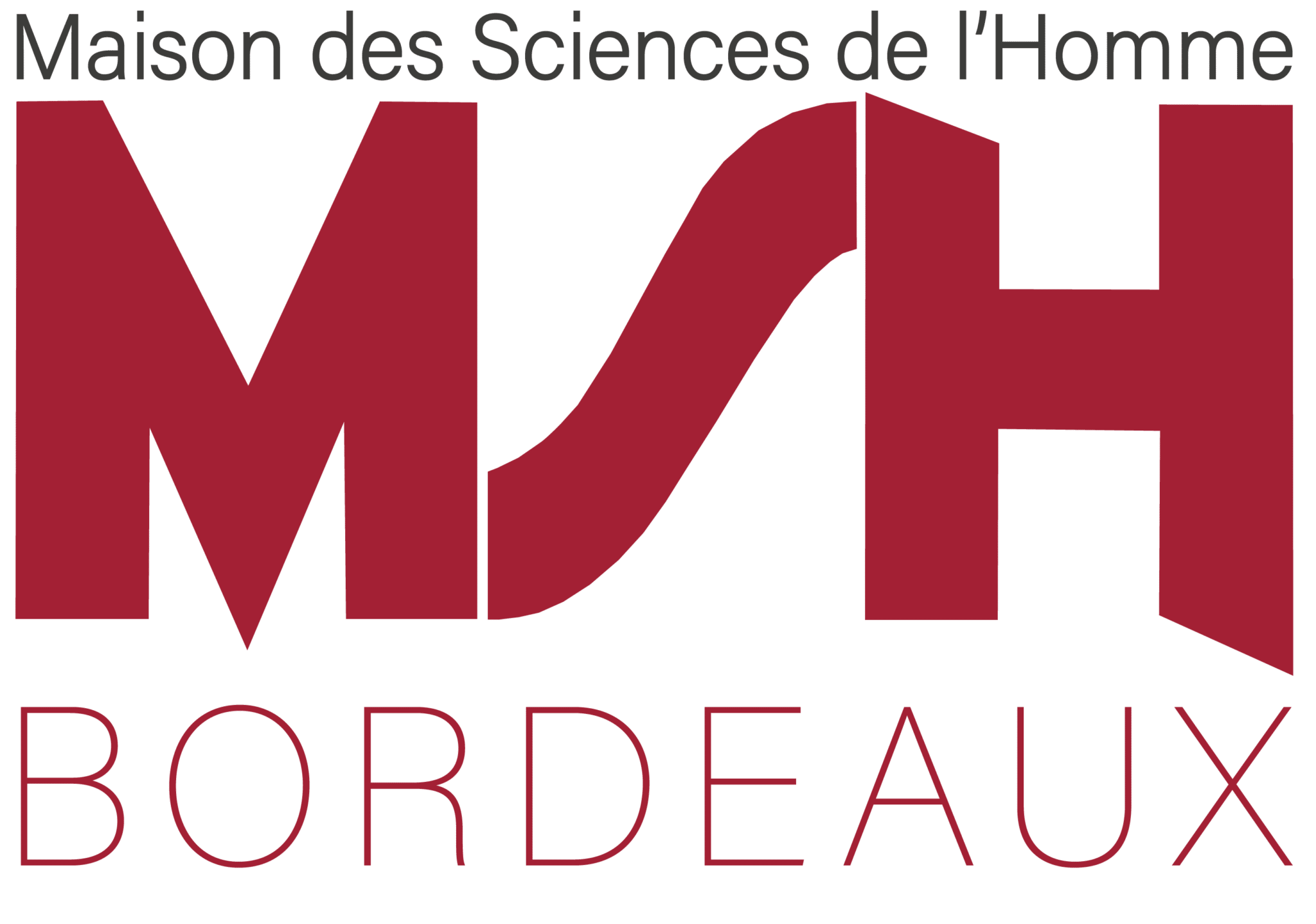Introduction
`ybšm–Ebusus est une ancienne colonie phénicienne et indigène, devenue civitas foederata romaine à une période mal déterminée du IIe au Ier s. av. J.-C. C’est à ce titre que la frappe de monnaies provinciales a probablement été initiée, sous l’empire de Tibère (14-37 apr. J.-C.)1. À l’époque, `ybšm-Ebusus est le seul atelier monétaire actif dans les territoires hispaniques, plus précisément dans ceux de la province dont il fait partie, la Citerior Tarraconensis, sans bénéficier d’un status privilégié. Il ne s’agit pas de la seule particularité de ce centre émetteur, dont l’insularité, l’évolution historique en tant que colonie phénico-punique, ainsi que la tradition de ville de frappe ont pu constituer trois facteurs déterminants de sa situation singulière.
En effet, les caractéristiques de ces monnaies sont si particulières qu’elles ont attiré l’attention de la plupart des personnes qui ont étudié l’histoire antique de l’île d’Ibiza, dont on peut citer des travaux de recherche spécifiques2 et d’ordre plus général3. Pour toutes ces raisons, et compte tenu des avancées scientifiques actuelles dans le domaine de l’étude de l’identité dans l’Antiquité4 et, plus précisément, en ce qui concerne le caractère hétérogène et adaptable qui caractérisait le panorama religieux à des époques telles que l’époque romaine5, nous avons décidé de nous inscrire dans la trajectoire prolifique des publications susmentionnées. Plus précisément, nous avons décidé d’approfondir l’analyse des éléments visuels adoptés sur les monnaies frappées par la ville d’`ybšm–Ebusus, en nous penchant sur les pièces qui ont suscité moins d’intérêt au sein de l’historiographie, à savoir celles qui ont été mises en circulation au cours de la période de frappe provinciale. L’objectif principal de notre contribution est de mener une réflexion sur les aspects sociaux qui pourraient avoir caractérisé ces objets monétaires, issus de la combinaison particulière de l’utilisation de l’écriture (avec ici la présence remarquable de deux alphabets distincts) et de l’iconologie sacrée. À ces fins, nous présenterons dans la première partie de cette étude une approche des aspects socioculturels caractéristiques de l’évolution historique de la ville et de la monnaie d’`ybšm–Ebusus, puis nous nous pencherons sur des éléments plus spécifiques, notamment ceux liés à la toponymie du centre, à l’idéologie religieuse et à la propagande politique diffusée par ses autorités.
`ybšm–Ebusus : une ville-atelier monétaire hispano-romaine appartenant à la tradition phénico-punique
Le lieu d’implantation de la ville qui deviendra plus tard la cité foederata d’`ybšm-Ebusus connaît plusieurs phases de peuplement préalables à la frappe de ses monnaies provinciales. Ces phases résultent de l’intégration progressive et dynamique de populations autochtones et étrangères (d’abord phéniciennes, puis puniques et plus tard romaines), en raison de divers facteurs, tels que la position particulière de la ville sur l’une des îles qui font office de lien entre le centre et le bassin occidental méditerranéen6.
On peut ainsi identifier une première phase d’occupation urbaine (ou peut-être initialement proto-urbaine), attestée quelques décennies plus tard par Diodore de Sicile (5.16-8) et corroborée par quelques vestiges archéologiques de sites funéraires7. Cette première phase se développe vers 650 av. J.-C. et est marquée par la colonisation de la baie d’Ibiza et de l’anse de Sa Caleta8 par des colons phéniciens, principalement originaires du sud de la péninsule ibérique9. Du fait de sa position stratégique, la présence sur ce territoire10 de colonies indigènes ayant potentiellement eu des contacts avec certains des nombreux navigateurs orientaux11, qui s’approchaient de ces régions depuis des décennies, n’est pas exclue12. Ainsi, les noyaux qui plus tard constitueront la ville d’`ybšm ne peuvent être considérés comme des centres urbains à part entière, mais plutôt comme deux des nombreuses enclaves portuaires13 établies par les marins phéniciens de façon permanente et, peut-être de façon, ultérieurement, dans tout le bassin méditerranéen14.
C’est à partir de la fin du Ve s. av. J.-C.15, ou du début du siècle suivant, que l’emporio phénico-indigène de la baie d’Ibiza devient une véritable ville16, fortifiée17 et dotée d’espaces aux fonctions diverses (résidentielles, politiques, économiques, funéraires, etc.)18. C’est probablement à cette période que sont introduits la plupart des aspects liés à son toponyme et à son éventuel mythe fondateur, qui ont vraisemblablement évolué et influencé directement les emblèmes et l’épigraphie monétaire propres à ce centre depuis l’Antiquité. Il n’est cependant pas exclu que certains de ces éléments aient été créés aux prémices de l’occupation phénicienne du territoire et aient servi de lien entre tous les habitants qui ont fini par former la ville d’`ybšm-Ebusus.
Il est tout à fait plausible que l’expansion urbaine et économique de cette enclave ait lieu, ou du moins s’accélère, suite à son incorporation dans la sphère commerciale et militaire punique19, qui entraîne également une série de transformations culturelles, comme en témoigne notamment le matériel funéraire20. Ces évolutions ne sont en revanche pas généralisées21, si bien que certains us et coutumes phénico-indigènes survivent et sont intégrés aux nouvelles pratiques punico-ébusitaines. C’est d’ailleurs à cette époque qu’`ybšm commence à frapper sa première série de monnaies dans laquelle22, curieusement, se dessine déjà un programme iconologique empreint d’un symbolisme purement emblématique. En effet, les caractéristiques des programmes typologiques diffusés par la ville indiquent que l’idéologie civique du centre avait déjà commencé à prendre forme au IVe s. av. J.-C. Les autorités ébusitaines décident de graver la même image au revers23 et, surtout, à l’avers24 de la quasi-totalité des pièces qu’elles font frapper. Sur les 73 émissions punico-ébusitaines connues, seule une ne présente pas ce type de monnayage25. On observe un phénomène similaire à l’époque impériale, où cette image26 est gravée sur quatre des cinq séries provinciales produites par `ybšm-Ebusus.
Bien que plusieurs historiens27 aient interprété que Rome décide de passer le traité foedus avec `ybšm dans le contexte de la deuxième guerre punique-romaine (218-201 av. J.-C.) ou au cours des décennies qui ont immédiatement suivi, E. García Riaza28 et M. L. Sánchez León29 soutiennent que le centre n’acquiert ce status, qui régira ensuite sa vie civile jusqu’à sa promotion municipale à l’époque de l’empereur Vespasien (74 apr. J.-.C.)30, que durant les années du conflit sertorien (82-72 av. J.-C.). La révision récente des lectures chronologiques des premières monnaies ébusitaines sur lesquelles ont été adoptées des légendes avec le toponyme du centre31, pourrait témoigner, selon les historiens susmentionnés, que c’est bien au cours de la première moitié du Ier s. av. J.-C. qu’Ebusus devient une civitas foederata, un changement juridique auquel est peut-être liée cette innovation de l’épigraphie monétaire32.
Quoi qu’il en soit, comme nous l’avons déjà souligné, les émissions produites par cette civitas foederata étaient tout à fait singulières, notamment celles qui ont été mises en circulation au cours de la période de frappe provinciale. En effet, l’observation des informations purement financières révèle une fabrication de ces monnaies de bronze bien différente de celle des autres centres de la Citerior et de la plupart des pôles émetteurs de l’ouest de l’Empire. Il est à noter que, contrairement à la période précédente33, l’époque julio-claudienne est marquée par la rareté de la production de monnaies ébusitaines34. M. Campo Díaz35 souligne même que la frappe de cette monnaie provinciale relève de raisons essentiellement politiques. En partant de ce postulat, qui nous semble relativement plausible, et d’autant plus sachant le nombre d’exemplaires punico-ébusitains encore potentiellement en circulation, il convient de reconnaître que ce n’est pas par nécessité financière que le centre d’`ybšm–Ebusus a repris la frappe de monnaie dès l’époque tibérienne. Au contraire, la tradition monétaire de la ville, et surtout – élément crucial pour notre travail de recherche –, le support de propagande que représentent les images et les mots gravés sur les monnaies sont sans doute les raisons pour lesquelles les autorités ébusitaines reprennent cette activité, du moins dans un premier temps.
Les données publiées documentent notamment que la ville d’`ybšm–Ebusus n’a frappé que quatre séries différentes de semis de bronze36 et une seule de quadrans37. Parmi les premières, seule une présente des variantes connues38. C’est précisément cette répartition par valeur, restreinte aux monnaies divisionnaires, qui constitue le second aspect distinctif de la production monétaire ébusitaine par rapport aux autres monnaies émises dans la Citerior, une caractéristique particulièrement intéressante car, contrairement au reste des territoires de la Tarraconensis, à `ybšm–Ebusus, les éléments de propagande liés à l’émission de monnaie sont diffusés au moyen de pièces de faible valeur et de petite taille.
Cette dynamique exceptionnelle perpétue la tradition établie au cours des siècles précédents, où la plupart des monnaies fabriquées par la ville avant les monnaies provinciales étaient frappées sur des disques de cuivre/bronze39. On sait plus précisément que seules sept40 des 73 émissions punico-ébusitaines connues correspondaient à des valeurs en argent41. Par ailleurs, `ybšm ne produit à cette période aucune émission en bronze de grande valeur, ce qui est pourtant le cas des autres ateliers monétaires occidentaux, à l’exception de certains pôles maritimes tels que Carteia42 et d’autres moins productifs43. Nous disposons de preuves que les monnaies d’`ybšm ne circulaient qu’en monnaie moitiés44, quarts45 et huitièmes46.
C. Alfaro Asins interprète cette production massive de pièces liées au commerce de détail comme un phénomène résultant des caractéristiques de l’activité commerciale de la ville47, basée, selon ce spécialiste, sur le paiement de dépenses importantes par d’autres moyens48, tels que des pièces frappées dans d’autres ateliers monétaires, d’autres formes de monnaie, le troc, etc. Il convient de souligner que c’est dans le cadre des paiements les plus courants – à savoir, ceux qui nécessitaient une monnaie d’échange – que sont utilisées les pièces ébusitaines, permettant la diffusion des images et des mots qui y sont inscrits, principalement fondée sur la relecture, la vie quotidienne et l’inclusion sociale.
Par ailleurs, il est à noter que la production de monnaies provinciales ébusitaines pourrait s’être étendue aux années de l’Empire claudien. Une hypothèse qui nous amène à considérer que cet atelier de frappe est le seul centre en Occident resté actif jusqu’au milieu du Ier s. apr. J.-C. Cette théorie chronologique s’appuie sur une interprétation généralement admise49, liée notamment à l’identification du portrait gravé sur les avers de deux des cinq séries produites par `ybšm-Ebusus50 (fig. 1). La particularité de ces avers anépigraphes rend toutefois difficile l’attribution chronologique de ces pièces, qui, selon diverses contributions publiées il y a quelque temps par J. B. Giard51 et C. H. V. Sutherland52, est sujette à caution.

Il a néanmoins été décidé de retenir l’hypothèse la plus largement défendue dans le cadre de cette étude, de sorte que notre travail de recherche repose sur l’idée qu’`ybšm-Ebusus frappe quelques pièces de monnaie après la mort de Caligula. Une perspective intéressante, dans la mesure où elle permet non seulement d’avancer que la diffusion des caractéristiques visuelles de ces pièces se poursuit au cours de ces années et des périodes qui les ont immédiatement suivies, mais aussi de disposer de preuves montrant que ces dernières sont toujours d’actualité sous l’ère claudienne. Cependant, ces pièces étant liées à des monnaies divisionnaires53, aucune d’entre elles n’a été contremarquée, ce qui nous empêche de confirmer leur éventuelle circulation au cours de périodes postérieures à leur frappe – contrairement à d’autres monnaies de la province Tarraconensis, une situation prévisible en dépit de l’absence de preuves documentaires.
En dehors de ces considérations purement financières et du contexte juridique particulier de la ville d’`ybšm–Ebusus, l’une des principales caractéristiques de ses monnaies provinciales réside dans les légendes que l’on a décidé d’y graver, qui reprennent à la fois des signes latins et des inscriptions en caractères traditionnels54. En effet, ces émissions sont les seules monnaies provinciales à épigraphie bilingue produites dans les vastes territoires qui constituent la Hispania Citerior Tarraconensis.
Comme le suggère J. N. Adams55 concernant les caractéristiques d’autres monnaies bilingues, il est fort probable que la décision prise par les magistrats qui contrôlent la production de bronzes d’`ybšm–Ebusus – consistant à se désolidariser de la politique épigraphique monétaire du reste des ateliers de frappe de Tarragone – n’est une stratégie ni anodine ni, bien entendu, inconsciente. En toute logique, ces particularités épigraphiques ont dû attirer l’attention des personnes qui utilisaient ces monnaies, qu’elles résident dans le centre émetteur ou dans d’autres régions. Il nous semble par conséquent nécessaire de fournir quelques brèves informations historiques et archéologiques en vue de définir les caractéristiques d’une ville dont l’idiosyncrasie reposait, même à l’époque claudienne, sur l’intégration des éléments culturels punico-ébusitains et hispano-romains.
Le dieu Bès et le toponyme phénico-indigène de la ville d’`ybšm-Ebusus
Comme cela a été proposé dans d’autres contributions de ce livre, nous estimons qu’il est important de prêter attention à des aspects tels que les caractéristiques toponymiques de la ville56. Le premier toponyme ébusitain connu est documenté par l’épigraphie punique et néopunique de ces monnaies57, de sorte que son nom exact n’est pas connu (éventuellement Aybošim58, Aybushim59 Ibshim60, Iboshim61 ou Ibusim62). Certains auteurs évoquent la possibilité que, comme les Grecs, les Phéniciens aient utilisé une toponymie faisant allusion à l’abondance de pins ou de balsamiers plantés sur le territoire63, mais la plupart des hypothèses suggèrent que le nom `ybšm-Ebusus serait lié à leur divinité principale64, peut-être adorée en tant que divinité patronymique. Ce phénomène d’association des noms de certains sites avec des concepts sacrés présente d’importants parallèles, puisqu’il a été documenté, comme le souligne A. Ibba65, dans de nombreuses autres régions influencées par la culture phénico-punique. Quoi qu’il en soit, notons que les Grecs appelaient parfois cette ville Πιτυοῦσσα 66(Pityoussa) et les îles d’Ibiza et de Formentera Πιτυοῦσσαι67 (Pityoussai). Nul doute que ces noms font allusion à l’abondance frappante de pins (Πιτυς) sur ces territoires68, et peut-être apparue des années avant la création du toponyme phénicien-ébusitain. On sait que les Hellènes ont également utilisé ces toponymes liés aux pins pour désigner nombre d’autres îles, telles que l’actuelle Spetses, en Grèce, ou Dana, en Turquie.
Cette récurrence malencontreuse pourrait être l’un des facteurs ayant conduit à la création, ou du moins à l’adoption, d’un autre toponyme qui détermine finalement le reste des toponymes d’Ibiza connus, dont certains mentionnés par des géographes classiques plus tardifs qui écrivaient en grec. Certains d’entre eux, comme Strabon (Géog. 3.5.1), ont continué à suivre la tradition hellénique en désignant les îles d’Ibiza et de Formentera sous le nom de Πιτυοῦσσαι. Toutefois, lorsqu’il parle de la ville d’`ybšm-Ebusus, il ne mentionne pas le toponyme Πιτυοῦσσα, mais celui d’´Εβουσος (Ebusos) (Strab. Géog. 3.3.4, 3.7.3 et 3.5.1), qui doit être interprété comme la translittération grecque du toponyme latin Ebusus, dérivé manifeste de la désignation phénico-indigène d’origine. On peut donc supposer que c’est précisément pour cette raison que le pluriel « les Pitiusas » est encore utilisé aujourd’hui en espagnol pour désigner ces îles, tandis que le mot `ybšm établirait la tradition toponymique postérieure de l’île d’Ibiza.
Se pose alors la question de l’identité de ce dieu, protagoniste probable de la légende fondatrice phénico-indigène de la ville, qui déterminerait l’ancien toponyme d’une île dont le nom actuel évoque encore l’héritage de cette dynamique religieuse. Suivant l’hypothèse la plus communément admise, nous sommes d’avis que la réponse à cette question réside dans l’icône présente sur la quasi-totalité des pièces frappées à `ybšm-Ebusus (fig. 2). La plupart des études affirment que cette image représentait le dieu oriental Bès, dont l’iconographie pourrait se référer à ce type de pièces, car on le sait presque toujours69 représenté de face, sous la forme d’un personnage masculin nain70 au visage disproportionné, barbu et aux traits grotesques (semblable à une bête aux sourcils froncés, au nez épaté et à la bouche ouverte). En outre, sa tête était presque toujours révélée rasée, son ventre exagérément bombé, ses jambes en position accroupie et ses pieds tournés vers l’intérieur71. Parmi ses attributs figurent, une couronne de plumes, une courte jupe (parfois avec une ceinture)72, des serpents (qu’il porte généralement à la main) et une masse73.

L’ensemble de ces traits physiques est particulièrement visible sur les monnaies ébusitaines, sur lesquelles il est toujours représenté en pied, son visage caractéristique détaillé à la manière d’un masque, à mi-chemin entre l’animal et l’homme. En outre, il apparaît sur les monnaies à épigraphie punique et néopunique74 dans un paysage monétaire légèrement plus varié que sur celles frappées à l’époque provinciale. Dans les premières séries, ce possible dieu apparaît toujours nu75, couronné d’un long panache et tenant dans chaque main un serpent76 ou une masse accompagnée d’un serpent77. À partir du IIIe s. av. J.-C.., de nouveaux éléments typologiques apparaissent et, bien que l’image diffusée au cours de la période précédente soit la plus représentée78, il existe également des preuves de la circulation de deux séries de huitièmes sur lesquelles la divinité a pour seul attribut sa couronne de plumes79. Sur une des frappes où le dieu est représenté tenant des objets, ont aussi été gravés une figure globulaire80, une fleur de lotus81 et un caduceus82. Compte tenu du contexte de frappe et d’utilisation de ces monnaies, il est tout à fait possible que ces détails constituent des marques d’émission figuratives. L’apparition séparée de ces figures pourrait en outre corroborer cette hypothèse.
Les séries datant de la première moitié du IIe s. av. J.-C.. présentent également des innovations iconographiques. Toutes représentent cette probable divinité coiffée d’une couronne de plumes et, à partir de cette période, toujours vêtue d’une courte jupe ouverte83, mais la masse et le serpent ne figurent que sur quelques-unes d’entre elles84. En effet, le type de monnaie qui circule le plus au cours de ces années est celui de la divinité dépourvue d’attributs85. Plutôt que le serpent et la masse, sur la plupart de ces bronzes sont gravés d’autres éléments86 également identifiés comme des marques d’émission (groupe de points87, rose à quatre pétales88, cercle avec point central89, caduceus90, croissant avec point central91, corne d’abondance92, symbole de la déesse tnt-Tanit93 (fig. 3), fleur de lotus94 et notamment une variété d’autres graphismes95). À la fin du IIe s. av. J.-C.. ou probablement dès le début du siècle suivant, l’image du dieu tenant une masse et un serpent est à nouveau généralisée, accompagnée seulement de différentes graphies96. Il s’agit de fait du seul type d’avers utilisé depuis lors, accompagné sur l’autre face de la monnaie, tel que mentionné précédemment, d’un type épigraphique reconnaissable comportant le toponyme néopunique de la ville97. Sous l’empire, la représentation monétaire de cette divinité reste la même que celle des derniers bronzes punico-ébusitains, mais les marques d’émission gravées sur ces derniers sont abandonnées. Par ailleurs, ce dieu ne figure qu’au revers de la plupart des exemplaires provinciaux réalisés par `ybšm-Ebusus, accompagné des portraits impériaux sur l’autre face.

Les aspects iconographiques particuliers de ces pièces, notamment les caractéristiques physiques du personnage qui y est représenté, expliquent pourquoi la plupart des recherches associent cette image au dieu Bès98. Mais, si cette hypothèse d’identification est effectivement la plus communément acceptée, il convient également de noter que certains auteurs ont identifié ce personnage à la divinité phénico-punique ´šmn-Eshmún99 ou à l’un des dieux grecs Cabires100.
En ce qui nous concerne, nous rejoignons la majorité quant au fait que le dieu représenté sur la monnaie frappée par `ybšm-Ebusus est bien Bès, une divinité dont on ignore encore le nom phénico-punique101. Aucune inscription connue ne fait référence à des anthroponymes religieux ni à d’autres types de mots liés à cette divinité, et plusieurs spécialistes, comme A. Hermany102, soutiennent que son nom diffère selon les régions. L’une de ses désignations cananéennes possibles peut toutefois être imaginée, puisque l’on connaît certains des noms égyptiens utilisés pour le désigner (parmi eux ḥr-bs103, bs104 ou bš105). Il est par ailleurs établi que ses appellations grecques et romaines ultérieures sont très proches des mots utilisés dans la culture nilotique. Ces éléments justifient l’adoption par la plupart des spécialistes d’un conventionnalisme historiographique106, qui consiste à employer dans la majorité des cas les termes génériques de « zwerghafte Götter »107, « Bes-image »108, « Bes-like god »109, « dio besoide »110, ou tout simplement « dieu Bès », selon la langue (« dio Bes », « dios Bes », « gott Bes » etc).
Étant donné que ces noms égyptiens, grecs et latins présentent de grandes similitudes avec le toponyme ébusitain, le nom `ybšm est traduit dans nombre d’études par « île de Bès » ou « île des fidèles de Bès »111. Une interprétation qui n’est pas nouvelle (puisqu’elle a déjà été proposée au milieu du XIXe siècle par A. Judas112) et est plus généralement fondée sur la racine phénicienne `y-, susceptible de renvoyer au mot « île » dans de nombreux autres territoires113, surtout lorsqu’elle apparaît avec la terminaison –m, présente dans le mot `ybšm.
Cette dernière particularité a été étudiée en détail par des auteurs tels que M. Sznycer114, dont l’analyse présente une description d’autres exemples comportant ces préfixes et suffixes. Mentionnons notamment les toponymes ´ynșm (San Pietro, Sulcis, Italia) (traduit par « île des faucons »), ´yrnm (Pantellaria, Trapani, Italia) (traduit par « île des autruches ») et ´yksm (Alger, Algerie) (traduit par « île des hiboux » 115). Quel que soit leur sens, ces trois exemples sont très éclairants, car si l’on extrait du toponyme phénico-ébusitain la racine et la terminaison commune à tous, on obtient un lexème, bš, qui reproduit précisément l’un des vocables égyptiens utilisés pour désigner le dieu Bès.
L’acceptation de ces propositions intéressantes nous conduit à émettre l’hypothèse selon laquelle l’image analysée sur les monnaies d’`ybšm-Ebusus serait un concept lié à certains des éléments idéologiques qui ont été associés à ceux connus dans la recherche numismatique sous le nom de « types parlants ». Ces icônes de frappe monétaire indiquent le nom de la ville d’émission de manière visuelle, sans nécessité de les accompagner d’une inscription y faisant allusion116. Il s’agit d’une caractéristique unique, car dans ces cas, l’identification est à la fois civique-emblématique et plus spécifiquement toponymique. Le fait qu’à la fin du IIe s. av. J.-C.., voire à partir du siècle suivant, `ybšm-Ebusus commence à frapper des monnaies avec des mentions de son toponyme pourrait remettre en question cette interprétation. Il convient toutefois de rappeler que d’autres ateliers monétaires majeurs, associés à des « types parlants », adoptent également des légendes permettant d’identifier leurs monnaies. C’est le cas des villes voisines de Ῥόδη (Rhode)117 (Rosas, Girona, Espagne) et Ἀκράγας (Akragas)118 (Agrigento, Italie), qui frappent sur certaines de leurs émissions une légende faisant allusion à leurs citoyens. Ces exemples sont très instructifs, car il a été mis en évidence que ces deux ateliers monétaires utilisaient la variété la plus classique de « types parlants », c’est-à-dire ceux qui comportent des images de plantes et/ou d’animaux, ainsi qu’une légende au génitif et/ou de gentilice, approche épigraphique la plus courante sur les monnaies grecques de l’époque. `ybšm-Ebusus pourrait avoir procédé de même, sachant que les monnaies puniques ont toujours adopté le nominatif se référant à la ville.
À cette comparaison s’ajoute le fait qu’`ybšm-Ebusus est pratiquement le seul atelier à frapper des monnaies à l’effigie de cette divinité, bien que le dieu Bès soit facilement identifiable en raison de son iconographie particulière et qu’il présente donc, comme on peut le déduire de ce qui précède, un avantage représentatif par rapport aux autres divinités méditerranéennes. Hormis sur l’île d’Ibiza, l’icône monétaire de Bès ne figure que sur de rares monnaies potentiellement produites quelques années avant l’utilisation des exemplaires ébusitains, c’est-à-dire les pièces frappées entre le Ve et le IVe s. av. J.-C.. par certains ateliers monétaires sémitiques, comme ceux de la confédération de Phillistia119 (côte syro-palestinienne)120 ou ceux des villes de Samarie (Samarie, Israël)121 ou de Gaza (Gaza, Palestine) 122et sur la plupart desquelles seule la tête reconnaissable du dieu est représentée123.
À la lumière de ces informations et compte tenu du fait que les inscriptions toponymiques gravées sur les monnaies d’`ybšm-Ebusus étaient rédigées dans une graphie traditionnelle, il semble très plausible que l’incorporation de ces légendes, et en particulier leur maintien à l’époque impériale romaine, témoignent de la volonté des autorités de la ville de continuer à diffuser son toponyme punico-indigène d’une part, et, d’autre part, d’affirmer à l’intérieur comme à l’extérieur du centre que le mot `ybšm (ainsi que, probablement, son allusion au dieu Bès) était un élément essentiel de l’identité ébusitaine. Cette éventualité revêt une grande importance, surtout si l’on tient compte de son contexte, puisqu’il correspond à l’introduction et à l’évolution de la langue et de l’écriture latine en Méditerranée occidentale. C’est pourquoi nous avons décidé de nous intéresser plus en détail à ces aspects dans la dernière partie de notre étude, non sans avoir au préalable examiné l’importance idéologique que le dieu Bès a pu avoir pour la population de la ville d’`ybšm-Ebusus.
Bès est un dieu masculin de moindre importance, de type tutélaire, protecteur et serviteur124 d’autres divinités125, vénéré à l’origine dans l’Égypte pharaonique126, où il est considéré comme l’un des nombreux génies/démons et, plus précisément, des dieux pataïques (Πάταικοι/Παταΐκοι) que ces populations appellent probablement dans les premiers temps Aha127 et qu’elles ne vénèrent qu’au sein de leurs foyers et dans leurs tombes128. Sans entrer dans le détail du phénomène d’expansion idéologique du culte de cette divinité vers les régions les plus orientales, pour lequel nous renvoyons aux ouvrages publiés par certains auteurs129, il convient de mentionner que le contact des navigateurs phéniciens avec les habitants de l’île de Chypre pourrait avoir été à l’origine de l’idolâtrie du dieu par ces navigateurs puis par leur famille130. Ces derniers peuvent ainsi assimiler cette divinité à un autre concept religieux déjà présent dans leur panthéon, comme c’est le cas d’autres divinités égyptiennes, notamment celles considérées comme « magiques »131. Les plus connus de ces dieux132 sont Osiris, Isis, Hathor, Bastet, Horus et Amon, ainsi que d’autres133, comme shéd y/ou ṣid, dont l’on sait que les noms ont été (ré)élaborés dans la culture phénico-punique134 ; comme le démontre en détail ce livre, ce qui a pu se passer pour d’autres dieux vénérés au cours des différentes étapes de l’Antiquité.
Ces circonstances ont permis au culte du dieu Bès de se répandre dans les différents territoires où se sont établis les Phéniciens : le centre et l’ouest de la Méditerranée135, y compris, en toute logique, la ville de Carthago136 et l’île d’Ibiza. Ce phénomène d’expansion semble être unique, dans la mesure où il est vraisemblablement attribuable à la diffusion d’un grand nombre d’amulettes, en particulier de type scarabée, sur lesquelles figure l’image reconnaissable du dieu137. Bien que la plupart de ces éléments nous proviennent de contextes funéraires, leur propagation est fondamentale sur le plan immatériel, car elle permet à cette divinité d’être associée à des pratiques cultuelles bien plus publiques que celles documentées précédemment en Égypte. Effectivement, malgré les limites inhérentes à la décontextualisation de nombreux vestiges actuellement exposés dans les musées, l’étude systématique de ceux conservés in situ a permis de vérifier que l’image de Bès commence à être exposée publiquement dans la vallée du Nil au moins à partir ’du IIIe av. J.-C.. En témoignent les objets liés à sa représentation exposés dans les temples138 et leurs mammisi139, dont l’analyse a récemment été comparée par G. Capriotti Vittozzies140. Parmi ceux détaillés par cette autrice, nous estimons pertinent de mentionner la grande statue trouvée dans le temple construit par Nectanebo II (359-343 av. J.-C..) dans le Serapeum de Memphis141 (Musée du Louvre, inv. n° N 437). Également à noter, l’existence, depuis l’époque romaine au moins, d’un temple dédié à cette divinité à Bawiti (Al Wahat Al Baharia, Égypte)142 et, à partir du IVe s. apr. J.-C., du culte des oracles, précédemment associé à Sérapis à Abydos (Suhag, Égypte), et consacré ensuite à Bès143.
Cette évolution revêt une importance manifeste, dans la mesure où elle pourrait également expliquer la raison pour laquelle les Ébusitains se lient d’une manière si particulière à une divinité de prime abord peu susceptible de jouer un rôle dans des processus institutionnels de nature patronymique, puisque, comme nous l’avons souligné, en de nombreux lieux et à de nombreuses époques, Bès fait l’objet d’une dévotion de nature essentiellement domestique. Cela expliquerait le peu d’exemples connus de matériel phénico-punique lié à cette divinité exposée dans la sphère publique. Parmi les exceptions, on peut citer les monnaies d’Ibiza, mais aussi quelques grandes sculptures trouvées dans des zones très spécifiques sur les îles de Chypre144 et de Sardaigne145.
Qui plus est, aujourd’hui encore, les pratiques cultuelles méditerranéennes liées à ce dieu sont extrêmement difficiles à identifier, car la confusion avec d’autres divinités plus connues n’est pas exclue (comme ´šmn-Eshmún, Ṣid ou Ptah146). Ces limites scientifiques sont évidentes et se traduisent par notre méconnaissance d’éléments aussi importants que, par exemple, le ou les mots exact(s) utilisé(s) par les Phéniciens pour nommer Bès.
En ce sens, soulignons que, bien que nous estimions très probable que le processus d’identification des Ébusitains à ce dieu ait pu être influencé par la religiosité antérieure des populations indigènes qui habitaient l’île, il est également tout à fait possible que ces pratiques aient été en harmonie avec le culte d’autres dieux phénico-puniques plus connus, et tout semble suggérer que l’appellation était Bès. Par conséquent, la question suivante que l’on peut se poser est celle du motif qui a conduit les habitants d’`ybšm-Ebusus à établir un lien entre le centre dans lequel ils résidaient et cette divinité particulière. Pour répondre à cette question, il faut tenir compte du fait qu’à cette époque, la plupart des caractéristiques matérielles et immatérielles liées au culte public/privé de Bès étaient déjà en place, de sorte que les colons phéniciens peuvent également avoir propagé l’image prototype de cette divinité147, considérée à partir de cette époque comme une divinité fondamentalement chtonienne (χθόνιος)148. Le statut de divinité tellurique (telluricus) de Bès renvoyant par ailleurs potentiellement à sa conception originelle, les manifestations de son culte sont nombreuses. Ainsi, la divinité peut avoir été vénérée comme dieu reproducteur149, sexuel150, prophylactique lors des accouchements151 et des enterrements152, protecteur des enfants, défenseur de la guerre153 et de la guérison154, divinatoire155, protecteur du sommeil156, bienfaiteur de la musique, de la danse, de la consommation de vin157 et du rire158, et défenseur contre certains animaux considérés comme dangereux, tels que les scorpions159, les lions160, les crocodiles161 et, surtout, les serpents162.
À cet égard, une hypothèse émise il y a quelque temps par J. H. Fernández Gómez163 mérite d’être mentionnée. Y est rappelé que certains auteurs classiques, tels que Pline (N.H. 3.78) et Pomponius Mela (Chor. 2.7), relèvent l’absence de serpents et autres animaux dangereux sur l’île d’Ibiza. Ces témoignages pourraient nous permettre de comprendre, selon ce spécialiste, pourquoi les habitants du noyau phénico-indigène ont associé l’acte de fondation de la ville d’`ybšm-Ebusus et, plus précisément, son toponyme, à l’action protectrice du dieu Bès, divinité directement liée au contrôle de ces reptiles164. Il nous semble également nécessaire de préciser que la plupart des monnaies ébusitaines illustrent cette idée, puisque la divinité est représentée tenant au moins un serpent, enroulé autour de son corps dans une attitude docile. La récurrence de la figure de la masse dans la plupart de ces exemplaires pourrait elle aussi renvoyer à ce même récit de la maîtrise, voire de la domestication, des animaux. Cette iconographie est également importante de manière plus générale, car le dessin gravé sur ces émissions diffère radicalement du modèle habituel en représentant Bès en pied. Ces particularités attirent potentiellement l’attention de la population qui utilise ces monnaies, contribuant ainsi à perpétuer le récit qui le présente en dieu dompteur de sauropsides. Ceci est peut-être vrai pour les bronzes provinciaux également, sur lesquels, malgré leur petite dimension et la présence d’épigraphes de différentes tailles sur la plupart, le type monétaire est toujours le protagoniste, la silhouette du dieu particulièrement détaillée, coiffé de sa couronne de plumes et portant masse et serpents.
On peut ajouter que la traduction du nom `ybšm par « île de Bès » ou « île des fidèles de Bès » est également cohérente avec cette éventuelle narration. Au vu de ce qui précède, et à condition que l’hypothèse formulée par J. H. Fernández Gómez soit recevable, la conclusion suivante s’impose : le symbolisme patronymique d’`ybšm-Ebusus associé à cette divinité pourrait également renvoyer à un récit d’exaltation territoriale qui, en se référant uniquement à l’absence singulière de serpents, s’avère tout à fait inédit. Cette narrative particulière ne peut d’ailleurs être analogue à l’exposition grecque précédente, basée sur la présence abondante de pins. Cependant, dans une perspective plus générale, cette symbiose hypothétique entre des éléments religieux de nature à la fois patronymique et territoriale serait tout à fait cohérente avec la période, puisqu’elle a aussi été documentée dans d’autres villes proches qui se sont identifiées à des divinités fondatrices aux allusions maritimes évidentes, comme le centre gréco-indigène d’Ἐμπόριον-Emporiae (Sant Martí d’Empúries, Girona, Espagne).
Que Bès soit ou non un symbole direct de l’exaltation territoriale de l’île d’Ibiza (ce que nous croyons possible), l’idiosyncrasie et le culte local de ce dieu en tant que divinité principale sont indéniablement flexibles dans la ville d’`ybšm-Ebusus, et évoluent au cours des siècles, en se syncrétisant avec d’autres idées très hétérogènes dérivées de la religiosité du substrat culturel de ses anciens habitants et des différentes populations avec lesquelles ils ont entretenu des contacts plus étroits au cours des siècles. De là naissent le culte local de ce dieu et sa représentation particulière qui, comme nous l’avons détaillé, évolue peu et est reprise aussi bien sur les monnaies décrites que sur d’autres vestiges, en l’occurrence des objets essentiellement domestique165. Ce culte se distingue également par l’absence de certains des éléments les plus récurrents dans l’iconographie plus ancienne et orientale des représentations de dieux besoïdes166, tels que les cornes, et, surtout, sa relation directe avec l’animal le plus associé à la monarchie, le lion. Sans oublier que dans cette expression punico-ébusitaine du dieu Bès, le nom phénico-indigène du centre, qui figure sur certaines de ses monnaies, et bilingue à partir de la période impériale romaine, est lui aussi fondamental.
Les mots latins et néopuniques sur les monnaies d’`ybšm-Ebusus
Sur les cinq types de monnaie provinciale mis en circulation par `ybšm–Ebusus, seules trois sont bilingues, avec une légende à la fois en latin et en graphies traditionnelles167. Les caractéristiques foncièrement linguistiques de toutes ces lettres ont attiré l’attention de la plupart des spécialistes qui ont étudié ces monnaies168. Il semble néanmoins pertinent, dans ce cas précis, de mettre en avant les réflexions de M. J. Estarán Tolosa169, dont l’étude sur l’épigraphie bilingue de l’Occident romain présente une approche très complète des inscriptions gravées sur les supports monétaires. Ces recherches, conjuguées à d’autres travaux postérieurs170, nous ont par ailleurs fourni des connaissances concernant les dynamiques épigraphiques relatives à d’autres monnaies sur lesquelles figuraient des légendes très similaires, parmi lesquelles certaines frappées à l’époque de Tibère : celles de l’atelier de ‘bdr’-Abdera171 (Adra, Almeria, Espagne) (fig. 4.a), dans la province romaine de Bétique et celles des centres monétaires africains de sbrt’n-Sabratha172 (Zauiya, Libye) (fig.4.b), wy’t-Oea173 (Tripoli, Libye) (fig. 4.c) ou encore lpqy-Lepcis Magna174 (Lebda, Libye).

Quant aux bronzes d’`ybšm–Ebusus, M. J. Estarán Tolosa soutient à juste titre que leurs légendes traditionnelles ne sont composées que de graphies néopuniques175, et non puniques. Ces dernières sont présentes sur certaines pièces numismatiques portant des inscriptions néopuniques frappées par la ville entre le IIe et le Ier s. av. J.-C..176. Ces données permettent de déduire que la diffusion de légendes issues de deux systèmes d’écriture est une pratique datant d’avant la période romaine impériale parmi les personnes chargées de décider des aspects formels propres à la monnaie produite ensuite par `ybšm-Ebusus. Par conséquent, cette pratique n’est vraisemblablement pas propre au monnayage que la ville a commencé à produire sous le règne de Tibère.
Or, s’il est évident que les autorités qui ont pris la décision d’adopter ces légendes ont pu être influencées par la stratégie antérieure de sélection épigraphique du centre, l’idée selon laquelle l’adoption de ces légendes serait passée inaperçue aux yeux de ceux qui ont eu l’occasion de les voir, même si, comme nous l’avons indiqué, elles figuraient sur des pièces de petite taille, certes manipulées très fréquemment, n’est selon nous pas complètement recevable. Les quatre raisons suivantes nous amènent à formuler cette hypothèse.
Tout d’abord, le fait que l’aspect des épigraphes latines gravées sur les monnaies provinciales ébusitaines est très différent de celui des monnaies frappées antérieurement par la ville. Par ailleurs, les inscriptions néopuniques de ces bronzes sont très différentes des légendes adoptées sur les monnaies produites à l’époque par la plupart des ateliers monétaires situés dans la partie occidentale de l’Empire, en particulier dans la province de Citerior Tarraconensis. Ensuite, dans la lignée des deux réflexions précédentes, il convient de souligner la possibilité indéniable que les graphies des monnaies ébusitaines pré-impériales soient assez semblables entre elles, tandis que les légendes des bronzes provinciaux sont, en revanche, visuellement très différentes.
À l’évidence, ces trois circonstances n’ont sans doute pas échappé aux utilisateurs de ces monnaies qui, compte tenu des arguments susmentionnés, les ont probablement eues très fréquemment entre les mains, de sorte qu’au quotidien, ils ont pu associer ces aspects épigraphiques, ainsi que l’image reconnaissable du dieu Bès, auquel ils avaient voué un culte privé des siècles durant, à l’identité communautaire d’`ybšm-Ebusus.
Une quatrième circonstance, peut-être plus intéressante encore, pourrait compléter les précédentes. Nous savons que des lettres provenant des deux alphabets étaient utilisées pour composer un même mot sur les monnaies pré-impériales, ce qui n’était pas le cas sur les monnaies provinciales, où elles étaient utilisées dans différents mots, voire différentes expressions.
L’ensemble de ces spécificités impose de rappeler que, selon les hypothèses de datation177, les trois monnaies provinciales à épigraphie bilingue d’`ybšm-Ebusus ont été frappées jusque sous l’empire de Tibère et de Caligula. Deux de ces séries adoptent comme avers le portrait de l’empereur (l’une celle de Tibère178 et l’autre celle de son jeune successeur179), accompagné de l’inscription de sa titulature en latin. `ybšm-Ebusus perpétue ainsi la stratégie de sélection typologique et épigraphique la plus répandue dans le bassin occidental méditerranéen. Si la ville a choisi de suivre une politique monétaire généralement populaire en matière d’avers, cette décision n’en est pas moins importante, puisque d’autres villes émettrices ont dérogé à cette pratique en n’adoptant aucun des éléments couramment utilisés pour représenter les membres de la famille impériale. C’est le cas de certains ateliers de frappe augustéens, comme ceux de Cartenna 180(Ténès, Algérie) et Cirta181 (Constantine, Algérie) en Afrique ou Halaesa182 (Messine, Italie) en Sicile, dont les monnaies témoignent de l’adoption tout à fait volontaire d’éléments de propagande impériale. Il doit en être de même pour `ybšm-Ebusus, car nous avons pu confirmer l’existence, durant les années d’activité de son atelier monétaire, d’un autre centre qui ne sélectionnait pas non plus ces éléments iconologico-épigraphiques : la cité tarraconaise d’Emporiae183 (Sant Martí d’Empúries, Girona, Espagne).
Au regard des idées proposées dans la section précédente de notre article, on peut conclure que la présence sur ces monnaies des portraits impériaux et de la titulature impériale a pu revêtir une importance toute particulière du fait de la présence sur l’autre face de l’image reconnaissable d’une divinité qui avait été adorée en de nombreux lieux et à de nombreuses époques en tant que déité fondamentalement domestique, et même de second plan184. En effet, ces monnaies sont les seules connues datées de l’époque impériale directement liées au dieu Bès et au princeps romain. On ne peut certes exclure l’hypothèse selon laquelle, dans d’autres régions, son image ait été exposée avec des éléments relevant de ce système politique, mais les éventuels cas connus, que nous examinerons dans de futurs travaux, se réfèrent à des phénomènes qui ne sont pas strictement contemporains, puisque les éléments liés à Bès sont vraisemblablement bien antérieurs au début du Principat d’Auguste.

Toujours est-il que le revers de ces monnaies bilingues, ainsi que l’avers de la série que nous n’avons pas encore décrite en détail185, comportent des légendes circulaires différentes, frappées sur les deux faces de la pièce, se faisant face et encadrant l’image du dieu Bès (fig. 5). L’une de ces légendes emploie la graphie `ybšm. Ce mot et les lettres qui le composent étaient déjà bien connus dans la ville, puisque, comme nous l’avons déjà expliqué, la plupart d’entre eux figuraient également sur les pièces de monnaie ébusitaines frappées au cours de la période précédente. Leur identification a donc dû être particulièrement aisée pour la population, même analphabète, et même sur les semis et les quadrantes, monnaies de petite taille où l’espace devait être occupé avant tout par le type monétaire. Cette dynamique combine différents éléments relevant à la fois de l’écriture et du langage visuel. En effet, bien qu’il s’agisse dans ce cas d’un code basé sur l’utilisation de caractères non pictographiques, cette inscription peut être lue de manière purement figurative. En complément, la présence de l’icône du dieu Bès et son lien direct potentiel avec le toponyme décrit dans cette inscription ont contribué à établir cette connexion entre le mot et l’image, connexion qui ne relève pas d’une nécessité purement informative, puisque, comme nous l’avons déjà suggéré, il se peut que la représentation de cette divinité soit une icône qui présente certains des traits distinctifs des « types parlants ».
Ce sont précisément tous ces éléments qui démontrent l’importance de cette inscription monétaire, car, à notre sens, l’explication de son rattachement à une identité ne tient pas seulement de l’information qui y figure. Dans ce cas précis, le mécanisme pourrait être plus complexe, car l’apparition d’une dynamique d’appartenance avec la représentation visuelle de ce toponyme est fort possible. Ce dernier a effectivement dû faire l’objet d’une attention particulière, puisque la légende de la plupart de ces monnaies est écrite dans la langue traditionnelle de la province de Citerior Tarraconensis à l’époque de l’Empire romain. Les caractéristiques de la légende latine gravée sur ces bronzes pourraient étayer cette hypothèse, dans la mesure où, comme nous le verrons, elle ne fait aucune allusion au toponyme romain du centre.

Avant d’aborder l’étude spécifique de cette inscription, il nous semble nécessaire de nous pencher sur d’autres données qui pourraient permettre d’étayer nos hypothèses. À cette fin, nous nous intéresserons aux deux émissions provinciales ébusitaines frappées à l’époque claudienne. L’une était anépigraphe186 et l’autre187 ne comportait que la graphie [`] au revers (fig. 6). La taille des lettres et les caractéristiques du contexte de fabrication de cette série laissent penser que cette graphie n’a pas fait partie des différentes marques d’émission présentes sur les monnaies ébusitaines produites à l’époque pré-impériale. Au contraire, nous pensons que le caractère [`] frappé au revers de ces monnaies était leur légende, car il s’agit d’une abréviation écrite dans l’alphabet ancien et faisant référence au nom non latinisé de la ville émettrice188. On peut donc considérer que l’adoption de cette lettre unique et du type monétaire besoïde fait allusion à la ville d’`ybšm-Ebusus et même à son toponyme. De ce fait, et à condition d’accepter la datation proposée pour ces spécimens, on peut supposer que, jusque sous l’empire de Claude, cette civitas foederata romaine a continué à être identifiée au moyen d’une graphie inscrite dans le système traditionnel, s’agissant donc d’un toponyme si bien connu qu’une seule lettre suffisait à l’identifier. En effet, si la graphie [`] renvoie au mot île et que le toponyme ébusitain signifie « île de Bès » ou « île des fidèles de Bès », le revers de ces monnaies revêt alors un sens particulièrement cohérent, fondé une fois de plus sur la conjonction visuelle entre un mot et une image qui renvoient à la fois à la ville et à son toponyme.

Si cette brève épigraphe néopunique est intéressante, l’inscription latine gravée sur les monnaies bilingues produites par `ybšm-Ebusus sous Tibère et Caligula l’est encore davantage. Elle figure dans la légende au revers de ces pièces, juste en face de l’inscription néopunique indiquant le toponyme de la ville, et indique ins aug189, ou ins augu190 (fig. 7). Une partie des spécialistes191 ne s’est pas attardée sur l’interprétation de cette légende, d’autres spécialistes ont tenté de l’approfondir, dont M. J. Estarán Tolosa192, déjà citée, ainsi que I. Macabich Llobet193 et A. Tóvar194, pour qui l’inscription doit se référer à l’ensemble de l’archipel des Baléares, soit la région dans laquelle se trouve la ville d’`ybšm-Ebusus. Ces historien(ne)s font remarquer que leur hypothèse repose sur des considérations déjà émises en son temps par E. Hübner195, qui ont également permis à d’autres196, comme E. García Riaza et M. L. Sánchez León, de considérer la possibilité que la légende analysée se réfère à l’éventuel contrôle politique exercé par la ville d’`ybšm-Ebusus sur toutes les îles voisines.
Sur la base des données actuellement disponibles, il n’est pas totalement exclu que nous ayons affaire à une mention de la région au sein de laquelle se trouvait `ybšm-Ebusus (dans ce cas, donc, les « insulae augustae »), mais il n’y a pas de certitude à ce sujet. D’autres études ont par conséquent formulé d’autres hypothèses. P. P. Ripollès197 est partisan de l’interprétation de l’expression ins aug comme un surnom pour la ville émettrice elle-même, et suggère qu’il s’agit peut-être d’une épigraphe d’héritage néopunique. Cependant, étant donné le caractère bilingue des deux légendes, cette seconde hypothèse nous semble peu plausible.
Ces doutes nous poussent à envisager une troisième hypothèse, en partie liée à celle défendue dans le paragraphe précédent, et fondée sur les considérations exposées dans un texte détaillé publié par B. Costa Ribas et J. H. Fernández Gómez198. Les deux historiens ont directement relié la légende monétaire ins aug au `ybšm néopunique, concluant que ce signe latin (ins[ula] aug[usta]) devait être interprété comme une traduction libre de la formule « île de Bès » ou « île des fidèles de Bès ». Compte tenu des hypothèses présentées dans ce document, ces idées pourraient être très intéressantes, mais au vu des données actuellement disponibles, nous émettons des doutes quant à leur validité. À cet égard, il convient de noter que la légende aug est une abréviation qui ne se réfère généralement qu’à l’empereur ou à des concepts qui lui sont directement liés (dont les divinités). Par conséquent, une telle interprétation de la part des utilisateurs de ces monnaies semble peu probable, si l’on tient compte des caractéristiques du culte rendu à un dieu qui, selon les informations connues, n’était lié nulle part ailleurs ni au pouvoir romain, ni a fortiori à la propagande politico-religieuse des empereurs Julio-Claudiens. Peut-être de futures recherches pourront-elles apporter des éléments de réponse à toutes ces interrogations.
Quoi qu’il en soit, même s’il est complexe selon nous de décrire la signification de la légende ins aug, nous avons jugé opportun d’inclure cette question dans notre étude, sa mention permettant de connaître l’existence d’une information importante qui ne figure pas sur les monnaies ébusitaines. En effet, il nous semble étonnant que les travaux publiés jusqu’à présent aient minimisé l’importance qu’a pu avoir l’absence sur ces semisses et quadrantes du toponyme latin Ebusus, déjà connu à l’époque, comme le montrent certaines sources écrites (Liv. 22.20.7), dont quelques-unes ont déjà été citées (Strab. 3.4.7, 3, 5 et 1). On connaît en effet d’autres monnaies provinciales bilingues sur lesquelles la traduction directe dans les deux alphabets était utilisée pour indiquer le nom de la ville, par exemple les bronzes frappés par ´bdr´–Abdera susmentionné, tandis que sur les exemplaires bilingues des monnaies africaines, les graphies traditionnelles étaient toujours utilisées pour mentionner le nom du centre et les italiques uniquement pour faire allusion à l’empereur199.
Compte tenu de ce qui précède, il nous semble particulièrement intéressant de souligner l’absence du mot Ebusus sur ces pièces, car cela nous permet de conclure que la formule ins aug, indépendamment de sa traduction directe, devait se référer d’une manière ou d’une autre au nom latin de la ville (ou de la région), que les magistrats monétaires avaient décidé, pour une raison quelconque, de choisir pour accompagner à la fois la légende traditionnelle et le dieu Bes, laissant ainsi de côté la toponymie italique utilisée dans le reste des sources documentaires.
Conclusion
La confrontation de toutes ces informations nous conduit à conclure notre travail en soulignant que, s’il ne peut être exclu que l’absence du toponyme latin sur les monnaies d’`ybšm-Ebusus relève du simple hasard, cette omission pourrait traduire une dimension bien plus complexe, liée, comme nous l’avons proposé, à l’idéologie identitaire de ce centre. Une idéologie qui, exprimée dans ce contexte, présente de multiples facettes puisqu’elle est à la fois liée à la toponymie de la ville, à la tradition religieuse locale de ce centre et à un message d’intégration clair dans le réseau provincial romain. Cette idéologie s’articule également de manière extrêmement duale, en associant des images à des mots issus de deux alphabets complètement différents. Par ailleurs, cette symbiose d’éléments visuels a l’avantage d’être présentée dans deux cadres différents mais complémentaires : l’avers et le revers de monnaies largement diffusées dans la société, du fait de leur faible valeur économique. L’ensemble de ces éléments est lié à une évocation tout aussi complexe, puisqu’il s’agit d’un contenu clair faisant référence au passé, mais malgré tout volontairement actualisé, présent sur les monnaies où l’on décide de représenter les empereurs Tibère, Caligula et Claude. Ce programme identitaire, en somme multilingue à bien des égards, non contradictoires et d’une efficacité redoutable, permettait aux Ébusitains de mettre en valeur le fait que leur cité hispano-romaine était l’`ybšm évoquée au revers de leurs monnaies sur lesquelles l’image du dieu protecteur de l’île ; Bès dompteur de serpents, pouvait être mise en relation avec l’idéologie impériale illustrée à travers les éléments frappés sur l’autre face de la pièce.
Abréviations
| ACIP | = Villaronga i Garriga & Benages i Olivé 2011. |
| BMC, Palestine | Catalogue of the Greek coins of Palestine of the British Museum, London, 1914. |
| CNH | = Villaronga i Garriga 1994. |
| LIMC | Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. |
| RPC I | = Burnett et al. 1992. |
| SNG Ans | Sylloge Nummorum Graecorum – América: The Collection of American Numismatic Society, New York, 1988. |
| SNG España | Sylloge Nummorum Graecorum – Museo Arqueológico Nacional de Madrid, I.1, Madrid, 1994. |
| SNG Switzerland | Sylloge Nummorum Graecorum, Bern, 1986. |
Universidad de León, helenagg@unileon.es. Cette étude a été réalisée dans le contexte du Projet de Formation Postdoctorale «Gli dei sulla moneta dell’Africa Proconsulare», dirigé par A. Ibba, supervisé par Á. Padilla Arroba, développé au Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali de l’Università degli Studi di Sassari et financé par un Contrato de Perfeccionamiento de Doctores en el extranjero, approuvé par le Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de l’Universidad de Granada (2021 et 2024). Pendant les mois de développement de ce projet, plusieurs visites de travail ont été effectuées au Departamento de Numismática del Museo Arqueológico Nacional de Madrid dans le but de consulter les pièces africaines qui y sont déposées avec les conservateurs P. Grañeda et P. Otero. Nous sommes très reconnaissants à toutes les personnes mentionnées ci-dessus pour leur soutien et leur aide.
Bibliographie
Adams, J. N. (2003): Bilingualism and the Latin Language, Cambridge.
Alfaro Asins, C. (1988): Las monedas de Gadir/Gades, Madrid.
Alfaro Asins, C. (1991): “Epigrafía monetal púnica y neo-púnica en Hispania. Ensayo de síntesis”, in: Martini, R. et Vismara, N. éd.: Ermanno A. Arslan Studia Dicata, Glaux: collana di studi e ricerche di numismatica 7, Milan, 109-150.
Alfaro Asins, C. (1994): Sylloge Nummorum Graecorum España. Volumen I. Hispania ciudades feno-púnicas. Parte 1: Gadir y Ebusus, Madrid.
Alfaro Asins, C. (1997): “Las emisiones feno-púnicas” in: Alfaro Asins, C., éd.: Historia monetaria de Hispania Antigua, Madrid, 50-115.
Alfaro Asins, C. (2004): Sylloge Nummorum Graecorum España. Volumen I. Hispania ciudades feno-púnicas. Parte 1: acuñaciones cartaginesas en Iberia y emisiones ciudadanas, Madrid.
Alfaro Asins, C., Marcos Alonso, C., Otero Morán, P. et Grañeda Mirón, P. (2009): Diccionario de Numismática, Madrid.
Alvar Ezquerra, J. (2006): “Ebusus”, in: Roldán Hervás, J. M., éd.: Diccionario Akal de la Antigüedad hispana, Madrid, 363.
Arévalo González, A. (2005): “La moneda provincial romana de Hispania en el Museo de Cádiz”, in: La colección de moneda del Museo de Cádiz, Séville, 58-68.
Arévalo González, A. (2013): “La moneda en los ritos púnicos, una primera aproximación”, in: Costa Ribas, B. et Fernández Gómez, J. H., éd.: La moneda y su papel en las sociedades fenicio-púnicas. XXVII Jornadas de Arqueología fenicio-púnica, Ibiza, 183-122.
Arévalo González, A., Campo Díaz, M., Ritoré Ponce, J., Mora Serrano, B., Fernández Gómez, J. H., Moreno Pulido, E., Costa Ribas, B., Arancibia Román, A. et Mezquida Orti, A. (2016): “Contrastación del registro numismático en los rituales funerarios ebusitanos, gadeiritas y malacitanos”, in: Arévalo González, A., éd.: Monedas para el más allá. Uso y significado de la moneda en las necrópolis tardopúnicas y romanas de Ebusus, Gades y Malaca, Monografías historia y arte, Cádiz, 251-287.
Arévalo González, A. et Mora Serrano, B. (2019): “La Numismática antigua en Hispania: una visión desde la Arqueología”, in: Sánchez López, E. et Bustamante-Álvarez, M., éd.: Arqueología romana en la Península Ibérica, Manuales Ingeniería y Arquitectura, Granada, 529-542.
Augus, P. (1983): “Il Bes di Bitia”, Rivista di Studi Fenici, 11(1), 41-47.
Baccar, A. (2008): “Traces de la Catalogne dans la Tunisie contemporaine”, in: Villanueva Alfonso, M.-L., éd.: La Méditerranée et la culture du dialogue: lieux de rencontre et de mémoire des Européens / El Mediterráneo y la cultura del diálogo: lugares de encuentro y de memoria de los Europeos / El Mediterrani i la cultura del diàleg: punts de trobada i de memòria dels Europeus, Euroclio 42, Bruxelles, 95-108.
Ballod, F. (1913): Prolegomena zur Geschichte der Zwerghaften Götter in Ägypten, Moscou, [en ligne] https://digital.iai.spk-berlin.de/viewer/image/855625473/ [consulté le 05/06/2025].
Beltrán Martínez, A. (1950): Curso de Numismática Antigua, Saragosse.
Bernardini, P. et Ibba, A. (2015): “Il santuario di Antas tra Cartagine e Roma”, in: Cabrero Piquero, J. et Montecchio, J., éd.: Sacrum Nexum. Alianzas entre el poder político y la religión en el mundo romano, Thema Mundi 7, Madrid-Salamanca, 75-138.
Bisi, A. M. (1980): “Da Bes a Herakles”, Rivista di Studi Fenici, 8, 19-42.
Black, J. et Green, A. (1992): Gods, Demons, and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated Dictionary, London.
Blanco, S. (2016): “El toro en las monedas de Ybshm/Ebusus. Una posible interpretación de su significado”, Hécate, 3, 27-34, [en ligne] http://revista-hecate.org/files/5514/8268/2253/Blanco3.pdf [consulté le 05/06/2025].
Blázquez Martínez, J. M. (2000): “Eshmún”, in: Alvar Ezquerra, J., éd.: Diccionario Espasa de Mitología Universal, Madrid, 310-311.
Bonnet, C. et Xella, P. (1995): “La Religion”, in: Krings, V., éd.: La civilisation phénicienne et punique. Manuel de recherche, Handbook of Oriental Studies. Section 1: The Near and Middle East 20, Leiden, 316-333, [en ligne] https://doi.org/10.1163/9789004293977_026 [consulté le 05/06/2025].
Bonnet, H. (1952): Reallexikon der Ägyptischen Religions-Geschichte, Berlin.
Burnett, A., Amandry, M. et Ripollès i Alegre, P. P. (1992): Roman provincial coinage, vol. I: From the death of Caesar to the death of Vitellius (44 BC-AD 69), London-Paris.
Campaner y Fuertes, A. (1879): Numismática balear, Palma.
Campo Díaz M. (1987): “La ceca de Ebusus: producción y función”, in: Depeyrot, G., Hackens, T. et Monnaie, G., éd.: Rythmes de la production monétaire de l´antiquité à nous jours, Lovaina, 119-123, [en ligne] https://www.hisoma.mom.fr/bhelly/pdf/BH053.pdf [consulté le 05/06/2025].
Campo Díaz, M. (1976a): “Las monedas de Claudio I de la ceca de Ebusus”, Nvmisma, 138-143, 159-163.
Campo Díaz, M. (1976b): Las monedas de Ebusus, Barcelone.
Campo Díaz, M. (1993): “Las monedas de Ebusus”, in: Numismática hispano-púnica. Estado actual de la investigación. VII Jornadas de Arqueología fenicio-púnica, Trabajos del Museo Arqueologico de Ibiza 31, Ibiza, 147-171.
Campo Díaz, M. (2000a): “Ebusus”, in: Ripollès i Alegre, P. P. et Abascal Palazón, J. M., éd.: Monedas hispánicas: Real Academia de la Historia, catálogo del Gabinete de Antigüedades, Madrid, 84-86.
Campo Díaz, M. (2000b): “Las producciones púnicas y la monetización en el nordeste y levante peninsulares”, in: García-Bellido, M.a P. et Callegarin, L., éd.: Los cartagineses y la monetización del Mediterráneo occidental, Madrid, 89-100.
Campo Díaz, M. (2006): “Usos rituals i valor religiós de la moneda a l’illa d’Ebusus (secle III a.C.- inici I d.C.)”, in: Campo, M., Pena, M. J. et Espluga, X., éd.: Moneda, cultes i ritus. X Curs d’Història monetària d’Hispània, Barcelone, 47-74.
Campo Díaz, M. (2013): “La moneda de Ebusus y su proyección mediterránea”, in: Arévalo González, A., Bernal Casasaola, D. et Cottica, D., éd.: Ebusus y Pompeya, ciudades marítimas: testimonios monetales de una relación, Cádiz, 61-82.
Campo Díaz, M. (2014): “La fase inicial de la ceca de YBSHM/ Ebusus (siglo IV a.C.)”, in: Ferrando Ballester, C. et Costa Ribas, B., éd.: In Amicitia. Miscellània d’estudis en homenatge a Jordi. H. Fernández, Ibiza, 133-148.
Campo Díaz, M., Costa Ribas, B., Fernández Gómez, J. H., Mezquida Orti, A. (2016): “La moneda en la necrópolis de Ebusus”, in: Arévalo González, A., éd.: Monedas para el más allá. Uso y significado de la moneda en las necrópolis tardopúnicas y romanas de Ebusus, Gades y Malaca, Cádiz, 27-74.
Capriotti Vittozzi, G. (2011): “Note su Bes. Le sculture del Metropolitan Museum of Art e del Museo Egizio di Firenze”, in: Buzi, P., Picchi, D. et Zecchi, M., éd.: Aegyptiaca et Coptica. Studi in onore di Sergio Pernigotti, BAR International Series 2264, Oxford, 69-84.
Castel, E. (2001): Gran Diccionario de Mitología Egipcia, Madrid.
Collantes Pérez-Ardá, E. (1997): Historia de las cecas de Hispania antigua, Madrid.
Costa Ribas, B. (1992): “Les Illes Pitiüses: de la prehistòria a la fin de l´època púnica”, in: Rosselló Bordoy, G., éd.: La prehistòria de les Illes de la Mediterrània Occidental. X Jornades d´estudis Històrics Locals, Palma de Majorque, 277-355.
Costa Ribas, B. (1993): “Ibiza en época arcaica (650-475 a.C.): Fundación fenicia-colonia cartaginesa. Estado actual de la cuestión”, Empúries, 48-50, 254-263, [en ligne] https://raco.cat/index.php/Empuries/article/view/118300/288252 [consulté le 05/06/2025].
Costa Ribas, B. (1994): “Ebesos, colonia de los cartagineses. Algunas consideraciones sobre la formación de la Sociedad púnico-ebusitana”, in: Fernández Gómez, J. H., éd.: Cartago, Gadir, Ebusus y la influencia púnica en los territorios hispanos. VIII Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica, Trabajos del Museo Arqueologico de Ibiza 33, Ibiza, 75-143.
Costa Ribas, B. (2000): “`Ybšm (Ibiza) en la Segunda Guerra Púnica”, in: Costa Ribas, B. et Fernández, J. H., éd.: La segunda Guerra púnica en Iberia. XIII Jornadas de Arqueología fenicio-púnica, Ibiza, 63-115.
Costa Ribas, B. (2019): “Ibiza”, in: López-Ruiz, C. et Doak, B., éd.: The Oxford Handbook of the Phoenician and Punic Mediterranean, Oxford, 569-584, [en ligne] https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190499341.013.37 [consulté le 05/06/2025].
Costa Ribas, B. et Fernández Gómez, J. H. (1988): “Les phéniciens à Ibiza. Les phéniciens à la conquéte de la Méditerranée”, Dossiers d´Histoire et Archeologie, 132, 80-81.
Costa Ribas, B. et Fernández Gómez, J. H. (1994): “YBSHM (Eivissa). Història d´un centre púnic emissor de moneda”, in: Campo Díaz, M., éd.: La moneda a l’Eivissa púnica, Palma de Majorque, 13-35.
Costa Ribas, B. et Fernández Gómez, J. H. (1997): “Ebusus Phoenissa et Poena. La isla de Ibiza en época fenicio-púnica”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie I. Prehistoria y Arqueología, 10, 391-445, [en ligne] https://revistas.uned.es/index.php/ETFI/article/view/4661/4500 [consulté le 05/06/2025].
Costa Ribas, B. et Fernández Gómez, J. H. (2006): Ibiza fenicio-púnica, Palma de Majorque.
Costa Ribas, B., Fernández Gómez, J. H. et Gómez Bellard, C. (1991): “Ibiza Fenicia: la primera fase de colonización de la isla (siglos VII y Vi a.C.)”, in: Acquaro, E., éd.: Atti del II Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, Roma, 9-14 novembre 1987, vol. II, Roma, 759-795
Delgado y Hernández, A. (1871-1876): Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España (3 vols.), Séville.
Dietler, M. (2005): “The Archaeology of Colonization and the Colonization of Archaeology: Theoretical Challenges from an Ancient Mediterranean Colonial Encounter”, in: Stein, G., éd.: The Archaeology of Colonial Encounters. Comparative Perspectives, School of American Research advanced seminar series, Santa Fe, 33-68.
Estarán Tolosa, M. J. (2012): “Bilingüismo en las leyendas monetales: una peculiaridad de la Numismática hispana y africana”, Antesteria, 1, 349-357, [en ligne] https://www.ucm.es/data/cont/docs/106-2016-03-17-Antesteria%201,%202012ISSN_347.pdf [consulté le 05/06/2025].
Estarán Tolosa, M. J. (2016): Epigrafía bilingüe del Occidente romano. El latín y las lenguas locales en las inscripciones bilingües y mixtas, Ciencias sociales 116, Saragosse.
Estarán Tolosa, M. J. (2022): “The epigraphy and civic identity of Saguntum: A historical and sociolinguistic study of a bilingual city in the Roman West (2nd century BC to early 1st century AD)”, Pyrenae, 53(1), 135-158, [en ligne] https://raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/396006/489542 [consulté le 05/06/2025].
Fernández Gómez, J. et Fuentes Estañol, M. J. (1989): “Una caja de plomo con inscripción púnica”, Rivista di Studi fenici, 18(2), 239-245.
Fernández Gómez, J. H. (1975): “Los dioses de la Ibiza cartaginesa”, Eivissa, 7, 31-37.
Fernández Gómez, J. H. (1983): Guía del Puig des Molins, Ibiza.
Fernández Gómez, J. H. (1992): Excavaciones en la necrópolis del Puig des Molins (Eivissa): Las campañas de D. Carlos Román Ferrer (1921-1929), Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza 28/29, Ibiza.
Fernández Gómez, J. H. (2004): “La incorporación de leyenda en la moneda de Ebusus: una valoración histórica”, in: Chaves Tristán, F. et García Fernández, F. J., éd.: Moneta qua scripta. La moneda como soporte de escritura: Actas del III Encuentro Peninsular de Numismática Antigua, Osuna (Sevilla), febrero-marzo 2003, Anejos de archivo español de arqueología 33, Madrid, 69-72.
Fernández Gómez, J. H. et Padró i Parcerisa, J. (1982): Escarabeos del Museo Arqueológico de Ibiza, Trabajos del Museo Arqueologico de Ibiza 7, Madrid.
Fernández Gómez, J. H. et Padró i Parcerisa, J. (1986): Amuletos de tipo egipcio del Museo Arqueológico de Ibiza, Trabajos del Museo Arqueologico de Ibiza 16, Ibiza.
Fernández Gómez, J. H., López Grande, M. J., Mezquida Orti, A. et Velázquez Brieva, F. (2009): Amuletos púnicos de hueso hallados en Ibiza, Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera 62, Ibiza.
Frankfurter, D. (2012): “Religious practice and piety”, in: Riggs, C., éd.: The Oxford Handbook of Roman Egypt, Oxford handbooks in archaeology, Oxford, 320-336, [en ligne] https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199571451.013.0021 [consulté le 05/06/2025].
Garbati, G. (2009): “L’immagine di Bes in Sardegna; appunti su un “indicatore morfologico”, in: Bonnet, C., Pirenne-Delforge, V. et Praet, D., éd.: Les religions orientales dans le monde grec et romain. Cent ans après Cumont (1906-2006), Bruxells-Rome, 293-308.
Garbati, G. (2019): “Le divinità”, in: Del Vais, C., Guirguis, M. et Stiglitz, A., éd.: Il tempo dei Fenici. Incontri in Sardegna dall’VIII al III sec. a.C., Nuoro, 340-351.
García Riaza, E. (2000): “Sobre la datación del “Foedus Ebusitano””, in: Hernández Guerra, L., Sagredo San Eustaquio, L. et Solana Sáinz, J. M., éd.: Actas del I Congreso Internacional de Historia Antigua. La Península hace 2000 años, Centro Buendía 72, Valladolid, 23-25.
García Riaza, E. et Sánchez León, M. L. (2000): Roma y la municipalización de las Baleares, Col·lecció 2000 i UIB 2, Palma de Majorque.
García y Bellido, A. (1964): “Deidades semitas de la España antigua”, Sefarad, 24, 12-40.
García y Bellido, A. (1967): Les religions orientales dans l’Espagne romaine, Etudes préliminaires aux religions orientales dans l’empire romain 5, Leiden.
García-Bellido, M. P. (1998): “Dinero y moneda indígena en la Península Ibérica”, in: Barraca de Ramos, P., éd.: Hispania: el legado de Roma en el año de Trajano, La Lonja-Zaragoza, septiembre-noviembre de 1998, Saragosse, 73-82.
García-Bellido, M. P. et Blázquez Cerrato, C. (2001): Diccionario de cecas y pueblos hispánicos con una introducción a la numismática antigua de la península Ibérica, vol. II: Catálogo de cecas y pueblos que acuñan moneda, Colleccion textos universitarios/Consejo Superior de Investigaciones Científicas 36, Madrid.
Giard, J. B. (1970) : “Pouvoir central et libertés locales. Le monnayage en bronze de Claude avant 50 après J. C.”, Revue Numismatique, 12, 33-61, [en ligne] https://www.persee.fr/doc/numi_0484-8942_1970_num_6_12_994 [consulté le 05/06/2025].
Gil Farrés, O. (1966): La moneda hispánica en la edad antigua, Madrid.
Gitler, H. et Tal, O. (2006): The Coinage of Philistia of the Fifth and Fourth Centuries BC: A Study of the Earliest Coins of Palestine, Collezioni numismatiche 6, Milan.
Gómez Bellard, C. (1984): La necrópolis del Puig des Molins (Ibiza), campañas de 1946, Excavaciones arqueológicas en España 132, Madrid.
Gómez Bellard, C. (1985): “L’île d´Ibiza à l´époque des Guerres Puniques”, in: Devijver, H. et Lipiński, E., éd.: Punic Wars. Proceedings of the Conference Held in Antwerp from the 23th to the 26th of November 1988 in Cooperation with the Department of History of the ‘Universiteit Antwerpen’ (U.F.S.I.A.), Orientalia Lovaniensia analecta 33, Lovaina, 85-97.
Gómez Bellard, C. (1990): La colonización fenicia de la isla de Ibiza, Excavaciones arqueologicas en España 157, Madrid.
Gómez Bellard, C. (1991): “Ibiza en época arcaica: estado actual de la investigación”, in: IV Jornadas de Arqueología fenicio-púnica, Trabajos del Museo Arqueologico de Ibiza 24, Ibiza, 21-28.
Gómez Bellard, C. (1993): “La colonización fenicio-púnica en Ibiza”, Hispania Antiqua, 17, 451-460.
Gómez Lucas, D. (2001-2002): “Bes y Heracles: estudio de una relación”, Estudios orientales, 5-6, 91-106, [en ligne] https://www.um.es/cepoat/estudiosorientales/wp-content/uploads/2018/01/Estudios_Orientales_n5_8.pdf [consulté le 05/06/2025].
Gómez Lucas, D. (2002): “Introducción al dios Bes: de Oriente a Occidente”, in: Ferrer Albelda, E., éd.: Ex oriente lux: las religiones orientales antiguas en la Península Ibérica, Spal monografías 2, Sévilla, 87-121.
Gómez Lucas, D. (2004): “Bes, Ptah y Ptha-Pateco”, Huelva Arqueológica, 20, 129-148, [en ligne] https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1046804.pdf [consulté le 05/06/2025].
Heiss, A. (1870): Description générale des monnaies antiques de l’Espagne, Paris.
Hermany A. (2007): “Amathonte classique et hellénistique:la question du Bès colossal de l’agora”, in: Flourentzos, P., éd.: From Evagoras I to the Ptolemies. Proceedings of the International Archaeological Conference, Nicosia 29-30 November 2002, Nicosie, 81-92.
Hermany, A. (1986): “Bes (Cypri et in Phoenicia)”, in: Ackermann, H. C., éd.: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, vol. III: Atherion-Eros, Zurich, 108-112.
Hermany, A. (1992): “Bes”, in: Lipiński, E., éd: Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, Turnhout, 69-70
Hingley, R. (2005): Globalizing Roman Culture: Unity, Diversity, and Empire, London.
Hübner, E. (1906): “Ebusus”, Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft V, 1903-1906.
Ibba, A. (2017): “Le Aquae calidae della Sardinia”, Sylloge epigraphica Barcinonensis, 15, 47-68, [en ligne] https://raco.cat/index.php/SEBarc/article/view/332195 [consulté le 05/06/2025].
Ibba, A. (2023): “In latins Punica. Termini punici in iscrizioni latine dell’Africa mediterranea”, in: Cenerini, F., Filippini, E., Mongardi, M. et Rigato, D., éd.: L’iscrizione como strumento di integrazione culturale nella società romana. In ricordo di Angela Donati. Atti del Colloquio Borghesi 2021, Bertinoro, 28-30 ottobre 2021, Epigrafia e antichità, Rome, 261-275.
Jiménez Díez, A. (2008): “La transformación de las acuñaciones hispanas en época de César”, in: García-Bellido, M. P., Mostalac Carrillo, A. et Jiménez Díez, J., éd.: Del imperium de Pompeyo a la auctoritas de Augusto. Homenaje a Michael Grant, Anejos de archivo español de arqueología 47, Madrid, 129-140.
Juan Castelló, J. (1988): Epigrafia romana de Ebusus, Trabajos del Museo Arqueologico de Ibiza 20, Ibiza.
Judas, A. (1859): “Sur quelques médailles puniques d’îles de la Méditerranée”, Revue Arqueológique, 30(2), 647-660, [en ligne] https://www.jstor.org/stable/41746567 [consulté le 05/06/2025].
Kaper, O. E. (2012): “The Western Oases”, in: Riggs, C., éd.: The Oxford Handbook of Roman Egypt, Oxford handbooks in archaeology, Oxford, 717-735, [en ligne] https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199571451.013.0044 [consulté le 05/06/2025].
Lancel, S. et Lipiński, E. (1992): “Icosium”, in: Lipiński, E., éd.: Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, Turnhout, 226.
Lipiński E. (1995): Dieux et déesses de l’univers phénicien et punique, Leuven.
Llorens Forcada, M. M. (1993): “L’emissió de Conduc.-Malleol i els problemes de la seva atribució”, Acta Numismática, 23, 219-237, [en ligne] https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000430/00000029.pdf [consulté le 05/06/2025].
Lluis y Navas, J. (1970): “La atribución a la divinidad egipcio-fenicia “Bes” del enano grotesco de las monedas de Ebusus”, Gaceta Numismática, 16, 20-24.
Loeben, C. E., éd. (2020): Bes, Aegyptiaca Kestneriana 2, Rahden.
López Castro, J. L. (1995): Hispania Poena. Los fenicios en la Hispania romana, Crítica: Arqueología, Barcelone.
Macabich Llobet, I. (1953): “Insula Augusta”, Archivo Español de Arqueología, 26, 220-224.
Macabich Llobet, I. (1966): Historia de Ibiza, vol. I, Palma de Majorque.
Machuca Prieto, F. (2019): Una forma fenicia de ser romano. Identidad e integración de las comunidades fenicias de la Península Ibérica bajo poder de Roma, Spal monografías arqueología 29, Séville.
Malaise, M. (1990): “Bes et les croyances solaires”, in: Israelit-Groll, S., éd.: Studies in Egyptology Presented to Miriam Lichtheim, Jérusalem, 680-729.
Manfredi, L. I. (1995): Monete puniche: repertorio epigrafico e numismatico delle leggende puniche, Bollettino di numismatica monografie 6, Rome.
Manfredi, L. I. (2011): “Le monete puniche e neopuniche riutilizzate nei contesti tombali di Ibiza”, in: Baldini Lippolis, I. et Morelli, A. L., éd.: Oggetti-simbolo: produzione, uso e significato nel mondo antico, Ornamenta 3, Bologne, 9-28.
Marot, T. (1993): “Introducción a la Numismática antigua”, in: Numismática hispano-púnica: estado actual de la investigación. VII Jornadas de Arqueología fenicio-púnica, Trabajos del Museo Arqueologico de Ibiza 31, Ibiza, 9-25.
Marqués Villora, J. C. (2006a): “Bes”, in: Roldán Hervás, J. M., éd.: Diccionario Akal de la Antigüedad hispana, Madrid, 148.
Masson, O. (1992): “Ibiza”, in: Lipiński, E., éd.: Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, Turnhout, 222-226.
Mastino, A. et Zucca, R. (2021): “Valerius Optatus, proc(urator) praef(ectus) provinc(iae) Sard(iniae). Un nuovo titulus di un governatore della Sardinia da ForumTraiani”, in: Antolini, S. et Marengo, S. M., éd.: Pro Merito Laborum. Miscellanea epigrapica per Gianfranco Paci, Ichnia 16, Tivoli, 417-440.
Mattingly, D. (2004): “Being Roman: Expressing identity in a provincial setting”, Journal of Roman Archaeology, 17, 5-21, [en ligne] https://doi.org/10.1017/S104775940000814X [consulté le 05/06/2025].
Meshorer, Y. et Qedar, S. (1999): Samarian Coinage, Numismatic Studies and Researches 9, Jérusalem.
Molinero Polo, M. A. (2000): “Bes”, in: Alvar Ezquerra, J., éd.: Diccionario Espasa de Mitología Universal, Madrid, 134.
Montet, P. (1952): Ptah Patèque et les orfèvres, Revue Archéologique, 40, 1-11 [en ligne] https://www.jstor.org/stable/41752336 [consulté le 05/06/2025].
Mora Serrano, B. (2012): “Divinitats poliades a les emissions de tradició feniciopúnica del sud de la península Ibèrica”, in: Campo Díaz, M., éd.: Déus i mites de l’antiguitat. L’evidència de la moneda d’Hispània, Barcelone, 26-31.
Mora Serrano, B. (2013): “Iconografía monetal fenicio-púnica como reflejo de cultos cívicos, mitos e identidades compartidas”, in: Costa, B. et Fernández, J. H., éd.: La moneda y su papel en las sociedades fenicio-púnicas. XXVII Jornadas de Arqueología fenicio-púnica, Ibiza, 143-222.
Mora Serrano, B. (2017): “Introducción a los sistemas monetarios griego y púnico en la península Ibérica: algunos ejemplos”, in: Estrada-Rius, A., éd.: De la dracma a l’euro. Sistemes i unions monetàries a l’occident d’Europa. XXI Curs d’Història monetària hispánica, Barcelone, 27-37.
Morales Rodríguez, E. (2013): La municipalización flavia de la Bética, Monográfica biblioteca de humanidades: estudios clásicos 15, Grenade.
Moscati, S. (1989): L’ancora d’argento: colonie e commerci fenici tra Oriente e Occidente, Milan.
Moscati, S. (1994): “La funzione di Ibiza”, Rivista di Studi Fenici, 12, 51-56.
Padrino Fernández, S. (2005): Una aproximación a la circulación monetaria de Ebusus en época romana, Ibiza.
Padró i Parcerisa, J. (1976): L’Egipte antic i Catalunya, Barcelone.
Padró i Parcerisa, J. (1978): “El déu Bes: introducció al seu estudi”, Fonaments, 1, 19-41.
Padró i Parcerisa, J. (1991): “Divinidades egipcias en Ibiza”, in: I-IV Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Ibiza, 1986-1989), Trabajos del Museo Arqueologico de Ibiza 24, Ibiza, 67-76.
Padró i Parcerisa, J. (1999): “La aportación egipcia a la religión fenicia en Occidente”, Treballs del Museo Arqueologic d´Eivissa e Formentera, 43, 91-102.
Padró i Parcerisa, J. (2000): “El culto a Bes en el Mediterráneo occidental”, in: Barthélemy, M. et Aubet Semmler, M. E., éd.: Actas del VI Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, Cádiz, 2 al 6 de octubre 1995, Cádiz, 643-646.
Planas Palau, A., Planas Palau, J. et Martín Mañanes, A. (1989): Las monedas de la ceca de A`bsm (Ibiza), Ibiza.
Planells Ferrer, A. (1980): La moneda antigua de Ibiza, Barcelone.
Pujol Puigvehí, A. (1977): “El Ampurdán desde la colonización griega a la conquista romana según el testimonio de los autores griegos y romanos contemporáneos”, Anales del Instituto de Estudios Empordanesos, 12, 129-214, [en ligne] https://raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/92872 [consulté le 05/06/2025].
Pujol Puigvehí, A. (1989): La población prerromana del extremo nordeste peninsular: génesis y desarrollo de la cultura ibérica en las comarcas gerundenses, vol. II, Barcelone.
Ramon Torres, J. (1996): “Las relaciones de Eivissa en época fenicia con las comunidades del Bronce Final y Hierro Antiguo de Catalunya”, in: Rovia i Port, J., éd.: Models d’ocupació, transformació i explotació del territorio entre el 1600 i el 500 a.n.e. a la Catalunya Meridional i zones limítrofes de la depressió de l’Ebre, Barcelone, 399-442.
Ramon Torres, J. (1997): FE-13: un taller alfarero de época púnica en Ses Figueretes (Eivissa), Treballs del Museo Arqueologic d´Eivissa e Formentera, 39.
Ramon Torres, J. (2000): Estudi arqueològic i històric del Castell d’Eivissa, Ibiza.
Ramon Torres, J. (2004): “La ciutat romana d’Ebusus”, in: Orfila Pons, M. et Cau Ontiveros, M. Á., éd.: Les ciutats romanes del llevant peninsular i les illes Balears, Els juliols 11, Barcelone, 261-314.
Ramon Torres, J. (2005): “Eivissa feniciopúnica vint-i-cinc anys d’investigació”, Fonaments, 12, 107-138.
Ramon Torres, J. (2010): “La ciudad púnica de Ibiza: estado de la cuestión desde una perspectiva histórico-arqueológica actual”, Mainake, 32, 837-866, [en ligne] https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3641905.pdf [consulté le 05/06/2025].
Ramon Torres, J. (2013): “Economía y comercio de la Ibiza púnica en la época de las acuñaciones de moneda (siglos IV a.C.- I d. C.)”, in: Arévalo González, A., Bernal Casasola, D. et Cottica, D., éd.: Ebusus Pompeya, ciudades marítimas: testimonios monetales de una relación, Colección CEIMAR 3, Cádiz, 83-124.
Ramon Torres, J. (2014): “Arquitectura urbana y espacio doméstico en la ciudad púnica de Ibiza”, Treballs del Museu Arqueologic d’Eivissa e Formentera, 70, 191-217.
Ramos Folqués, A. (1973): “El nivel ibero-púnico de La Alcudia de Elche”, Rivista di Studi Liguri, 2, 363-386, [en ligne] https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc474w2 [consulté le 05/06/2025].
Ribichini, S. (1975): “Divinità egiziane nelle iscrizioni fenicie d’Oriente”, in: Benigni, G., Bondi, S. F. et Coacci, G., éd.: Saggi Fenici, vol. I, Collezioni di studi fenici 6, Rome, 7-14.
Ripollès i Alegre P. P. (1997): “Las acuñaciones cívicas romanas de la Península Ibérica (44 a.C.-54 d. C.)”, in: Alfaro Asins, C., éd.: Historia monetaria de Hispania Antigua, Madrid, 335-396.
Ripollès i Alegre P. P. (2005a): “Coinage and identity in the Roman Provinces: Spain”, in: Howgego, C., Heuchert, V. et Burnett, A., éd.: Coinage and identity in the Roman Provinces, Oxford, 79-93, [en ligne] https://doi.org/10.1093/oso/9780199265268.003.0011 [consulté le 05/06/2025].
Ripollès i Alegre, P. P. (2005b): “Las acuñaciones antiguas de la Península Ibérica: dependencias e innovaciones”, in: Alfaro Asins, C., Marcos Alonso, C. et Otero Mprán, P., éd.: Actas del XIII Congreso Internacional de Numismática, vol. I., Madrid, 187-208, [en ligne] http://box.inh.cat/histocat.cat/resource/ripollesacunaciones.pdf [consulté le 05/06/2025].
Ripollès i Alegre, P. P. (2005c): Monedas hispánicas de la Bibliothèque nationale de France, Bibliotheca numismatica hispana 1, Paris.
Ripollès i Alegre P. P. (2010): Las acuñaciones provinciales de Hispania, Bibliotheca numismatica hispana 8, Madrid.
Ripollès i Alegre P. P. (2013): “Ancient Iberian Coinage”, Documentos Digitales de Arqueología, 2, 1-55
Ripollès i Alegre, P. P. et al. (2009): “La moneda en el área rural de Ebusus (siglos IV-I a.C.)”, in: Campo, M., éd.: Ús i circulació de la moneda a la Hispània Citerior. XIII Curs d’història monetària d’Hispània, Barcelone, 105-135.
Román Calvet, J. (1906): Los nombres e importancia arqueológica de las islas Pythiusas, Barcelone, [en ligne] https://bvpb.mcu.es/museos/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=276705 [consulté le 05/06/2025].
Romano, J. F. (1989): The Bes-image in Pharaonic Egypt, New York.
Romano, J. F. (1998): “The Bes-Image in Ancient Egypt”, Bulletin of the Egyptological Seminar, 9, 89-105.
Sampaolo, V. (2007): “L’iseo popeiano”, in: De Caro, S., éd.: Egittomania: Iside e il mistero, Rome, 87-120.
Sánchez León, M. L. (1999): “La tribu Quirina en Ebusus”, Mayurqa. Revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, 25, 239-244, [en ligne] https://raco.cat/index.php/Mayurqa/article/view/119130 [consulté le 05/06/2025].
Sánchez León, M. L. (2000-2001): “Municipium/ Res publica en la epigrafía latina de las Islas Baleares”, Memorias de Historia Antigua, 21-22, 123-133, [en ligne] https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1321355.pdf [consulté le 05/06/2025].
Sánchez León, M. L. (2002-2003): “Municipios flavios en las islas Baleares”, Memorias de Historia Antigua, 23-24, 103-118, [en ligne] https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2537803.pdf [consulté le 05/06/2025].
Sandmann Holmberg, M. (1946): The God Ptah, Lund.
Sola Solé, J.M. (1956): “Miscelánea púnico-hispana I”, Sefarad, 1, 27-48.
Stylow, A. U. (1993): “La Cueva Negra de Fortuna (Murcia) ¿Un Santuario púnico?”, in: Mayer Olivé, M. et Gómez Pallarés, J., éd: Religio deorum. Actas del Coloquio Internacional de Epigrafía, culto y sociedad en Occidente, Sabadell, 449-460.
Sutherland, C. H. V. (1939): Romans in Spain, Londres.
Sznycer, M. (1977): “Recherches sur les toponymes phéniciens en Méditerranée occidentale”, in: La toponymie antique. Actes du Colloque de Strasbourg, 12-14 juin 1975, Travaux du Centre de Recherche sur le Proche-Orient et la Grèce Antiques de l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg 4, Strasbourg, 163-176, [en ligne] https://doi.org/10.1163/9789004671928_011 [consulté le 05/06/2025].
Tassignon, I. (2009): “Le Baal d’Amathonte et le Bès égyptien”, in: Michaelides, D., Kassianidou, V. et Merrillees, R. S., éd.: Egypt and Cyprus in Antiquity. Proceedings of the international conference, Nicosia, 3-6 April 2003, Oxford, 118-124, [en ligne] https://doi.org/10.2307/j.ctt1cfr8vg.17 [consulté le 05/06/2025].
Tovar Llorente, A. (1974): Iberische Landeskunde: die Völker und die Städte des antiken Hispanien, vol. I: Baetica, Baden-Baden.
Tovar Llorente, A. (1989): Iberische Landeskunde II: Las tribus y las ciudades de la Antigua Hispania, vol. III: Tarraconensis, Baden-Baden.
Tran Tam Tinh, V. (1986): “Bes”, in: Ackermann, H. C., éd.: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, vol. III: Atherion-Eros, Zurich, 98- 108.
Van Dommelen, P. (2011): “Postcolonial archaeologies between discourse and practice”, World Archaeology, 43(1), 1-6, [en ligne] https://www.jstor.org/stable/41308474 [consulté le 05/06/2025].
Velázquez Brieva, F. (2002a): “Consideraciones acerca de la evolución iconográfica del Dios Bes”, Boletín de la Asociación Española de Egiptología, 12, 159-206, [en ligne] https://aedeweb.com/wp-content/uploads/13-CONSIDERACIONES-ACERCA-DE-LA-EVOLUCI%C3%93N-INCONOGR%C3%81FICA-DEL-DIOS-BES.pdf [consulté le 05/06/2025].
Velázquez Brieva, F. (2002b): “Un vaso con representación de Bes en la Península Ibérica”, Spal, 11, 107-120, [en ligne] https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/748492.pdf [consulté le 05/06/2025].
Velázquez Brieva, F. (2004): Análisis tipológico y contextual de los amuletos fenicio-púnicos en el Mediterráneo centro-occidental, thèse de doctorat, Universidad Autónoma de Madrid.
Velázquez Brieva, F. (2007): El dios Bes de Egipto a Ibiza, Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera 60, Ibiza.
Villaronga i Garriga, L. (1994): Corpus Nummum Hispaniae ante Augusti Aetatem, Madrid.
Villaronga i Garriga, L. et Benages i Olivé, J. (2011): Ancient coinage of the Iberian Peninsula: Greek, Punic, Iberian, Roman, Barcelone.
Vives y Escudero, A. (1924-1926): La moneda hispánica, Madrid.
Wilson, V. (1975): “The iconography of Bes with particular reference to the Cypriot evidence”, Levant, 7(1), 77-103, [en ligne] https://doi.org/10.1179/lev.1975.7.1.77 [consulté le 05/06/2025].
Xella, P. (2019): “Religion”, in: López-Ruiz, C. et Doak, B., éd.: The Oxford Handbook of the Phoenician and Punic Mediterranean, Oxford, 273-292, [en ligne] https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190499341.013.19 [consulté le 05/06/2025].
Zóbel de Zangróniz, J. (1878): Estudio histórico de la moneda antigua española, desde su origen hasta el imperio romano, Madrid.
Zucca, R. (1998): Insulae Baliares: le isole baleari sotto dominio romano, Collana del Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Sassari 1, Rome.
Notes
- ACIP, 607; Alfaro Asins 2004, 151; Campo Díaz 1976b, 140; Collantes Pérez-Ardá 1997, 181; Estarán Tolosa 2016, 471-473; García-Bellido & Blázquez Cerrato 2001, 119; García Riaza & Sánchez León 2000, 102; Padrino Fernández 2005, 125; Ripollès i Alegre 1997, 358; 2010, 291-292; RPC I, 144.
- Alfaro Asins 1994; Campo Díaz 1976a; 1976b; 1987; 1993; 2006; 2014; Costa Ribas & Fernández Gómez 1994; Fernández Gómez 1975; Fernández Gómez & Padró i Parcerisa 1982; 1986; Fernández Gómez et al. 2009; Planas Palau et al. 1989.
- Fernández Gómez & Padró i Parcerisa 1982; 1986; Fernández Gómez et al. 2009; Lluis y Navas 1970; Padró i Parcerisa 1991; 1999; Planells Ferrer 1980; Velázquez Brieva 2004; 2007.
- Dietler 2005; Hingley 2005; Jiménez Díez 2008; Mattingly 2004; Van Dommelen 2011.
- Vid. la introduction de L. Pérez Yarza, J. Herrera Rando et S. Bianchi Mancini dans ce volume.
- Alvar Ezquerra 2006, 363; Costa Ribas 2000, 63; Costa Ribas & Fernández Gómez 1997, 428; Estarán Tolosa 2016, 470-471; García-Bellido & Blázquez Cerrato 2001, 113; García Riaza 2000, 244; García Riaza & Sánchez León 2000, 107-108; Gómez Bellard 1985, 93; Machuca Prieto 2019; Ramon Torres 2013, 86; Ripollès i Alegre 1997, 358; Sánchez León 1999, 55; 2000-2001, 127; 2002-2003, 109; Zucca 1998, 159.
- Costa Ribas 1994, 75-76 et 97; Costa Ribas & Fernández Gómez 1986, 277-355; 1988; 1990; 1993, 254-263; 1997, 393 et 396; 2006, 30-31; Costa Ribas et al. 1991, 759-795; Gómez Bellard 1990; 1991, 22; 2002, 103; López Castro 1995, 41; Moscati 1989, 221-223; 1994, 51-52; Ramon Torres 1994; 2005, 115; 2010, 856-857; 2013, 85.
- Campo et al. 2016, 27; Costa Ribas 2019, 571; Gómez Bellard 1993, 455; 2002, 103; Padrino Fernández 2005, 15; Ramon Torres 2000; 2010, 846; 2014, 208; Ripollès i Alegre et al., 2009, 105.
- Costa Ribas & Fernández Gómez 1997, 395; Ramon Torres 1996, 408 et 412.
- Campo Díaz 1976b, 13; 1993, 147; Costa Ribas & Fernández Gómez 1997, 397; Estarán Tolosa 2016, 470; Padrino Fernández 2005, 15.
- Costa Ribas & Fernández Gómez 1997, 395; Ramon Torres 1996, 408 et 412.
- Costa Ribas & Fernández Gómez 1997, 395; García-Bellido & Blázquez Cerrato 2001, 113; López Castro 1995, 71.
- Campo Díaz 1976b, 13.
- Campo Díaz 1993, 147; Costa Ribas & Fernández Gómez 1994, 15; 1997, 392 et 397; Estarán Tolosa 2016, 470; Gómez Bellard 1993, 455; Ripollès i Alegre et al. 2009, 105.
- Alfaro Asins 1997, 68; Campo Díaz 1993, 147; Costa Ribas 1994, 98; 2000, 65; Costa Ribas & Fernández Gómez 2006, 25; Estarán Tolosa 2016, 470; García Riaza & Sánchez León 2000, 116; Gómez Bellard 2002, 107; Ramon Torres 2010, 857.
- Campo Díaz 1976b, 13.
- Gómez Bellard 2002, 108; Ramon Torres 2004, 262; 2010, 858.
- Campo et al. 2016, 27; Costa Ribas 1994, 98; Ramon Torres 2010, 864.
- Costa Ribas 1994, 75-146; Costa Ribas & Fernández Gómez 1986, 277-255; 1988, 80-81; 1990; 1993, 254-263; 1997, 393 et 413; Costa Ribas et al. 1991, 794; García-Bellido & Blázquez Cerrato 2001, 113.
- Arévalo et al. 2016, 254; Campo et al. 2016, 29-30; Costa Ribas 1994, 98-104; Costa Ribas & Fernández Gómez 1994, 412-413; Gómez Bellard 2002, 107.
- Costa Ribas & Fernández Gómez 1988, 81; 1997, 414; Costa Ribas et al. 1991, 794.
- Arévalo González 2013, 191; Arévalo González et al. 2016, 255; Arévalo González & Mora Serrano 2019, 530; Blanco 2016, 27; Campo Díaz 1993, 147-148; 2013, 61; Campo Díaz et al. 2016, 27, 46-47 et 49; Costa Ribas 2019, 579; Costa Ribas & Fernández Gómez 2006, 118; García-Bellido & Blázquez Cerrato 2001, 113; García Riaza, 2004, 69; Manfredi 2011, 11; Padrino Fernández 2005, 15; Ripollès i Alegre 2005c, 78; 2010, 291; 2013, 15; Ripollès i Alegre et al. 2009, 108.
- CNH, 91.2, 92.3, 92.5, 92.10, 94.26-33, 95.34-43 et 96.44-45.
- CNH, 91.1-2, 92.3-5, 92.7-13, 93.14-23, 94.24-33, 95.34-43, 96.44-51, 97.52-59, 98.60-67 et 99.68-73.
- CNH, 92.6.
- RPC I, 479-482.
- Costa Ribas & Fernández Gómez 1986, 342-343; Fernández Gómez 1983, 170; Gómez Bellard 1985, 85-97; Tovar Llorente 1989, 246-247.
- García Riaza 2000, 23-25; García Riaza & Sánchez León 2000, 102-116.
- García Riaza & Sánchez León 2000, 102-116.
- Morales Rodríguez 2003, 34.
- Alfaro Asins 1991, 117-118; 1994, 147; 1997, 50-115; Campo Díaz 1987; 1993, 157; 2000a, 85; García Riaza 2004, 70; García-Bellido & Blázquez Cerrato 2001, 117.
- Tovar Llorente 1989, 246-247.
- Campo Díaz 2000b, 92; Mora Serrano 2017, 27.
- ACIP, 607; Campo Díaz 1993, 159; García-Bellido & Blázquez Cerrato 2001, 113; RPC I, 144.
- Campo Díaz 1993, 159.
- RPC I, 479-480 et 482-483.
- RPC I, 481.
- RPC I, 480.a-b.
- CNH, 91.1-2, 92.3-11, 93.19-23, 94.24-33, 95.34-43, 96.44-51, 97.52-59, 98.60-67 et 99.68-73.
- Campo Díaz 2014, 136-137; Mora Serrano 2017, 29.
- CNH, 92.12-13 et 93.14-18.
- CNH, 412.1-3, 413.4-12, 414.13-21, 415.22-30, 416.31-40, 417.41-50, 418.51-57 et 419.58-66.
- C’est le cas dans les centres méridionaux de Iptuci (Prado del Rey, Cadix, Espagne) (CNH, 125.1-7 et 126.8-9), Oba (Jimena de la Frontera, Cadix, Espagne) (CNH, 127.1-2 et 128.3-4), Cerit (Jérez de la Frontera, Cadix, Espagne)(CNH, 387.1-2), Baicipo (Vejer de la Frontera, Cadix, Espagne) (CNH, 408.1), Carisa (Cortijo de Carija, Cadix, Espagne) (CNH, 408.1, 409.2-11 et 410.12), Lacipo (Casares, Malaga, Espagne) (CNH, 423.1-2), Nabrisa localisation incertaine, mais proche de celle mentionnée précédemment) (CNH, 423.1-4) e Ipses (Alvor, Portugal) (CNH, 422.1) ou l’atelier oriental de Kaio (localisation incertaine) (CNH, 173.1 et 174.2-4).
- CNH, 96.46-51, 97.52-59, 98.60-67 et 99.68-73.
- CNH, 91.1, 92.4, 92.7, 92.10, 93.19, 93.22, 94.26-33, 95.34-43 et 96.44-45.
- CNH, 91.2, 92.3, 92.5-6, 92.8-9, 92.11, 93.20-21, 93.23 et 94.24-25.
- Alfaro Asins 1988, 11.
- Campo Díaz 2000b, 92.
- ACIP, 607; Alfaro Asins 1994, 67 y 151; Arévalo González 2005, 59; Campo Díaz 1976a, 159; 1976b, 34 et 48-49; 1993, 147 et 158-159; 2006, 50; 2013, 71; Collantes Pérez-Ardá 1997, 181; Estarán Tolosa 2016, 471; García-Bellido & Blázquez Cerrato 2001, 113; Gómez Lucas 2002, 105; Llorens Forcada 1993, 77; Manfredi 1995, 390; Marot 1993,14; Mora Serrano 2012, 31; 2013, 151; Masson 1992, 225 ; Padrino Fernández 2005, 28 et 128; Planas Palau et al. 1989, nº 40; Ripollès i Alegre 1997, 358; 2005a, 93; 2005b, 202; 2005c, 311; 2010, 291; 2013, 52; RPC I, 144.
- RPC I, 482 et 482a.
- Giard 1970, 42.
- Sutherland 1939, 245.
- Bien que presque tous les ateliers de la province de Citerior aient produit des séries de semis et bien que le phénomène de la contremarque ait affecté de manière très accentuée la production de la plupart de ces centres, nous ne connaissons qu’un seul spécimen fractionnaire frappé dans ces territoires qui ait fini par être rescellé. Il s’agit d’un semi produit par Dertosa-Ilercavonia (RPC I, 209-10).
- Alfaro Asins 2004, 67; Arévalo González 2005, 63; Campo Díaz 1976b, 34; 1993, 159; García-Bellido & Blázquez Cerrato 2001, 113; Marot 1993, 21; Ripollès i Alegre 2005a, 89; 2010, 291; 2013, 47.
- Adams 2003, 208.
- Vid. la contribution de J. Herrera Rando dans ce volume.
- Néanmoins, nous connaissons des inscriptions gravées sur d’autres types de supports qui font aussi allusion au nom de la ville et de ses habitants (Costa Ribas & Fernández Gómez 2006, 16).
- Costa Ribas & Fernández Gómez 2006, 16.
- Campo Díaz 1976b, 13 et 21; Gómez Bellard 2002, 103; Padró i Parcerisa 1979, 16; Pujol Puigvehí 1989, 314.
- Alvar Ezquerra 2006, 363.
- Costa Ribas 2000, 63; 2019, 569; Costa Ribas & Fernández Gómez 1990; Gómez Bellard 2002, 103; Padró i Parcerisa 1976, 19; Padrino Fernández 2005, 15.
- Campo Díaz 1976b, 21; Collantes Pérez-Ardá 1997, 21 et 178; CNH, 90; ACIP, 114.
- Alvar Ezquerra 2006, 363; García-Bellido & Blázquez Cerrato 2001, 113; Masson 1992, 222.
- Alfaro Asins 1994, 64; 1997, 68; Arévalo González et al. 2016, 255 et 275; Baccar 2008, 96; Blanco 2016, 28; Campo Díaz 1976b, 23-24; 2000a, 84-86; 2006, 49-50; Campo et al. 2016, 49-50; Collantes Pérez-Ardá 1997, 179; Costa Ribas 2000, 93; Costa Ribas & Fernández Gómez 2006, 19, 118, 140, 160 et 167; Estarán Tolosa 2016, 471; Fernández Gómez 1975, 35; 1983, 203; 1992, 112; Fernández Gómez y Fuentes Estañol 1989, 243; Fernández Gómez et al. 2009, 197; Fernández Gómez & Padró i Parcerisa 1982, 185-186; 1986, 29-33; García-Bellido 1998, 77; García-Bellido & Blázquez Cerrato 2001, 113; García Riaza 2004, 70; García Riaza & Sánchez León 2000, 101-102; Gómez Bellard 1984, 104; 2002, 104; Gómez Lucas 2002, 106; Juan Castelló 1988; Mora Serrano 2013, 151; Padrino Fernández 2005, 125-12; Padró i Parcerisa 1999, 94; 2000, 94; Ramón Torres 1997, 62-63; Ripollès i Alegre 1997, 358; 2005c, 78-84 et 311; 2010, 291-292; Román Calvet 1906, 206; Román Ferrer 1926, 7, 28 et 30; Sola Solé 1956, 325-324; Velázquez Brieva 2004, 235; 2007, 112-114, 137 et 310; CNH, 91-99; ACIP, 114-125.
- Ibba 2023, 263-267.
- Campo Díaz 1976b, 13; Collantes Pérez-Ardá 1997, 178.
- Campo Díaz 1976b, 13; Collantes Pérez-Ardá 1997, 178; Gómez Bellard 2002, 103.
- Gómez Bellard 2002, 103.
- Fernández Gómez 1975, 34; Gómez Lucas 2001-2002, 92; 2004, 130; Romano 1989; 1998; Velázquez Brieva 2002a; 2002b, 109.
- Sampaolo 2007, 111.
- Molinero Polo 2000, 134.
- Velázquez Brieva 2002b, 109.
- Arévalo González et al. 2016, 2016, 275; Bisi 1980, 19-42; Gómez Lucas 2001-2002, 92.
- Alfaro Asins 2004, 64; Campo Díaz 2006, 49.
- CNH, 91.1-2, 92-3-5 et 92.7-11.
- CNH, 91.1-2 et 92.3.
- CNH, 92. 5-11.
- CNH, 92-12-13 et 93.14-19.
- CNH, 93.20-21.
- CNH, 93.15.
- CNH, 93.16.
- CNH, 93.17.
- CNH, 93.22-23, 94.24-33, 95.34-43 et 96.44-45.
- CNH, 93.22-23, 94.24 et 94.26.
- CNH, 94.27-33, 98.34-43 et 96.44-45.
- Campo Díaz 1976b, 44.
- CNH, 94.27-28 et 97.32-33.
- CNH, 94.29-32.
- CNH, 94.31.
- CNH, 95.35-38.
- CNH, 95.35.
- CNH, 95.40.
- CNH, 95.41.
- CNH, 95.42.
- CNH, 94.33, 95.34, 95.37-39, 95.43 et 96.44.
- Campo Díaz 1976b, 47.
- CNH, 96.46-51, 97.52-59, 98.60-67 et 99.68-73.
- ACIP, 114-125; Alfaro Asins 2004, 64-65 et 67; 1997, 81; Arévalo González et al. 2016, 2016, 255 et 275; Baccar 2008, 96; Blanco 2016, 27-28; Campo Díaz 1976b, 23-24; 2000a, 84-86; 2006, 49-50; Campo et al. 2016, 49-50; CNH, 91-99; Collantes Pérez-Ardá 1997, 180; Costa Ribas 2000, 93; Costa Ribas & Fernández Gómez 2006, 118; Estarán Tolosa 2016, 471; Fernández Gómez 1975, 34-35; García-Bellido 1998, 77; García-Bellido & Blázquez Cerrato 2001, 113-119; García y Bellido 1964, 255-256; 1967, 14; García Riaza 2004, 70; García Riaza & Sánchez León 2000, 101-102; Gil Farrés 1966, 55; Gómez Lucas 2002, 105; Juan Castelló 1988; Lipiński 1995, 325; Lluis y Navas 1970, 20-24; Macabich Llobet 1966, 17; Marot 1993, 19; Mora Serrano 2013, 151; Padrino Fernández 2005, 125-126; Padró i Parcerisa 1978, 1991; 1999, 94; Planells Ferrer 1980; Ripollès i Alegre 1997, 358; 2005c, 78-84 et 311; 2010, 291-292; Sola Solé 1956, 25-34; RPC I, 144-145.
- Campaner y Fuertes 1879, 32; Delgado y Hernández 1871-1876; Heiss 1870, 423-424; Stylow 1993, 452-453; Vives y Escudero 1926, 63.
- Beltrán Martínez 1950, 21; Ramos Folqués 1973, 368; Zóbel de Zangróniz 1878, 61.
- Garbati 2009, 298; Velázquez Brieva 2007, 45-46.
- Hermary 1986, 108-112.
- Velázquez Brieva 2007, 18.
- Castel 2001, 99; Padró i Parcerisa 1978, 23-24.
- Lipiński 1995, 325.
- Velázquez Breiva 2002a, 160,
- Ballod 1913.
- Romano 1989.
- Wilson 1975.
- Capriotti Vittozzi 2011.
- Alfaro Asins 1997, 68; 2004, 64; Baccar 2008, 96; Blanco 2016, 28; Campo Díaz 1976b, 31; 2006, 50; Collantes Pérez-Ardá 1997, 179; Costa Ribas 2019, 579; Costa Ribas & Fernández Gómez 2006, 19; Fernández Gómez 1975, 34; García-Bellido & Blázquez Cerrato 2001, 113; García Riaza & Sánchez León 2000, 101-102; Gómez Bellard 2002, 104; Juan Castelló 1988; Padró i Parcerisa 1999, 94; Solá Solé 1956, 325-334; Stylow 1993, 451.
- Judas 1859, 547.
- Ibba 2023, 263.
- Sznycer 1977, 172-173.
- En fait, Avienus (Ora 428-429) identifie cette île comme Insula Noctilucae (Lancel & Lipiński 1992, 226), c’est-à-dire avec une allusion cohérente à des éléments nocturnes tels que ces animaux.
- Alfaro Asins et al. 2009, 171.
- ACIP, 119, 121 et 123-124.
- SNG Ans, Part 5, nº 35-83, 88-89, 92-103, 110-116, 132-140 et 141-155.
- SNG Ans, Part 6, n° 39, 41 et 47-50; SNG Switzerland, Levante, n° 233.
- BMC Palestine, 182.
- Meshorer & Qedar 1999, n° 53, 153, 157, 164 et 198.
- Gitler & Tal, 2006.
- SNG Ans, Part 6, n° 41 et 47-50; SNG Switzerland, Levante, n° 233; Meshorer & Qedar 1999, n° 53, 153, 157, 164 et 198.
- Blanco 2016, 28.
- Costa Ribas 1975, 34.
- Blanco 2016, 28; Campo Díaz 2006, 49; Costa Ribas & Fernández Gómez 2006, 160; Fernández Gómez 1975, 34; Molinero Polo 2000, 134.
- Bonnet 1952, 101; Loeben 2020, 58.
- Loeben 2020, 17 et 51.
- Bisi 1980, 19-42; Bonnet 1952, 1052; Fernández Gómez 1975, 34-35; Gómez Lucas 2001-2002, 91-106; 2002, 87-97; 2004, 129-148; Malaise 1990, 680-729; Montet 1952; Padró i Parcerisa 1978, 19-41; Sandmann Homberg 1946; Wilson 1975, 77-103; Velázquez Brieva 2007, 43-75.
- Campo Díaz 2006, 49; Costa Ribas & Fernández Gómez 2006, 160; Gómez Lucas 2001-2002, 94.
- Xella 2019, 285.
- Bonnet & Xella 1995, 327-328; Ribichini 1975, 7-14.
- Bernardini & Ibba 2015, 87.
- Lipiński 1995, 329-349.
- Velázquez Brieva 2002, 107-108 et 111-114; 2004, 228.
- Augus 1983, 41-47.
- Hermary 1992; Lipiński 1995, 325.
- LIMC III, Bes, 1 et 4.
- LIMC III, Bes, 2 et 3.
- Capriotti Vittozzi 2011, 72.
- LIMC III, Bes, 16.b.
- Kaper 2012, 722.
- Frankfurter 2012, 326; Tran Tam Tinh 1986, 98.
- Hermany 1992, 69-70; 2007, 81-92.
- Garbati 2009; 2019; Ibba 2017, 54; Mastino & Zucca 2021, 422.
- Velázquez Brieva 2007, 67.
- Velázquez Brieva 2002a.
- Costa Ribas & Fernández Gómez 2006, 24.
- Frankfurter 2012, 326; Marqués Villora 2006, 148; Velázquez Brieva 2004, 217.
- Hermary 1992, 69; Marqués Villora 2006, 148.
- Capriotti Vittozzi 2011, 70; Tassignon 2009, 124.
- Arévalo González et al. 2016, 276; Black & Green 1992, 41-42; Blázquez Martínez 2000, 135; Castel 2001, 100; Hermary 1992, 69; Molinero Polo 2000, 134; Velázquez Brieva 2007, 32-33.
- Capriotti Vittozzi 2011, 70; Tassignon 2009, 124.
- Costa Ribas & Fernández Gómez 2006, 24; Marqués Villora 2006, 148.
- Costa Ribas & Fernández Gómez 2006, 24.
- Costa Ribas 1975, 34; Frankfurter 2012, 326.
- Tassignon 2009, 124.
- Capriotti Vittozzi 2011, 70; Costa Ribas 1975, 34.
- Campo Díaz 2006, 49-50; Hermary 1992, 69.
- Hermany 1986, 110.
- Costa Ribas 1975, 34.
- Campo Díaz 2006, 49-50; Costa Ribas 1975, 34; Hermary 1992, 69.
- Fernández Gómez 1975, 34-35.
- Campo Díaz 2006, 49.
- Velázquez Brieva 2007, 107-160.
- Velázquez Brieva 2002a.
- RPC I, 479-481.
- Adams 2003, 208; Alfaro Asins 2004, 67; Arévalo González 2005, 63; Campo Díaz 1976b, 34; 1993, 159; García-Bellido & Blázquez Cerrato 2001, 113; García Riaza & Sánchez León 2000, 102; Macabich Llobet 1953; Marot 1993, 22; Ripollès i Alegre 2005a, 89; 2010, 291; 2013, 47; Tovar Llorente 1974, 278-279
- Estarán Tolosa 2016, 465-616.
- Estarán Tolosa 2022.
- RPC I, 125.
- RPC I, 816-817 et 819-820.
- RPC I, 832 et 834.
- RPC I, 848.
- Estarán Tolosa 2016, 472.
- Campo Díaz 1976b, 31-33; García Riaza & Sánchez León 2000, 116.
- ACIP, 607; Alfaro Asins 2004, 151; Campo Díaz 1976b, 140; Collantes Pérez-Ardá 1997, 181; Estarán Tolosa 2016, 471-473; García-Bellido & Blázquez Cerrato 2001, 119; García Riaza & Sánchez León 2000, 102; Padrino Fernández 2005, 125; Ripollès i Alegre 1997, 358; 2010, 291-292; RPC I, 144.
- RPC I, 479.
- RPC I, 480.
- RPC I, 884-885.
- RPC I, 701-705
- RPC I, 628-633.
- RPC I, 234-258.
- Vid. la contribution d’E. Paredes Martín dans ce volume.
- RPC I, 481.
- RPC, S2-I-482A.
- RPC I, 482.
- Estarán Tolosa 2016, 471.
- RPC I, 479 et 480a.
- RPC I, 480b.
- ACIP, 607; Alfaro Asins 2004, 67; García-Bellido & Blázquez Cerrato 2001, 113; RPC I, 144.
- Estarán Tolosa 2016, 471.
- Macabich Llobet 1953, 220.
- Tóvar 1974, 278-279.
- Hübner 1906.
- García Riaza & Sánchez León 2000, 102.
- Ripollès i Alegre 1997, 358; 2013, 47.
- Costa Ribas & Fernández Gómez 2006, 24.
- Estarán Tolosa 2012, 354.