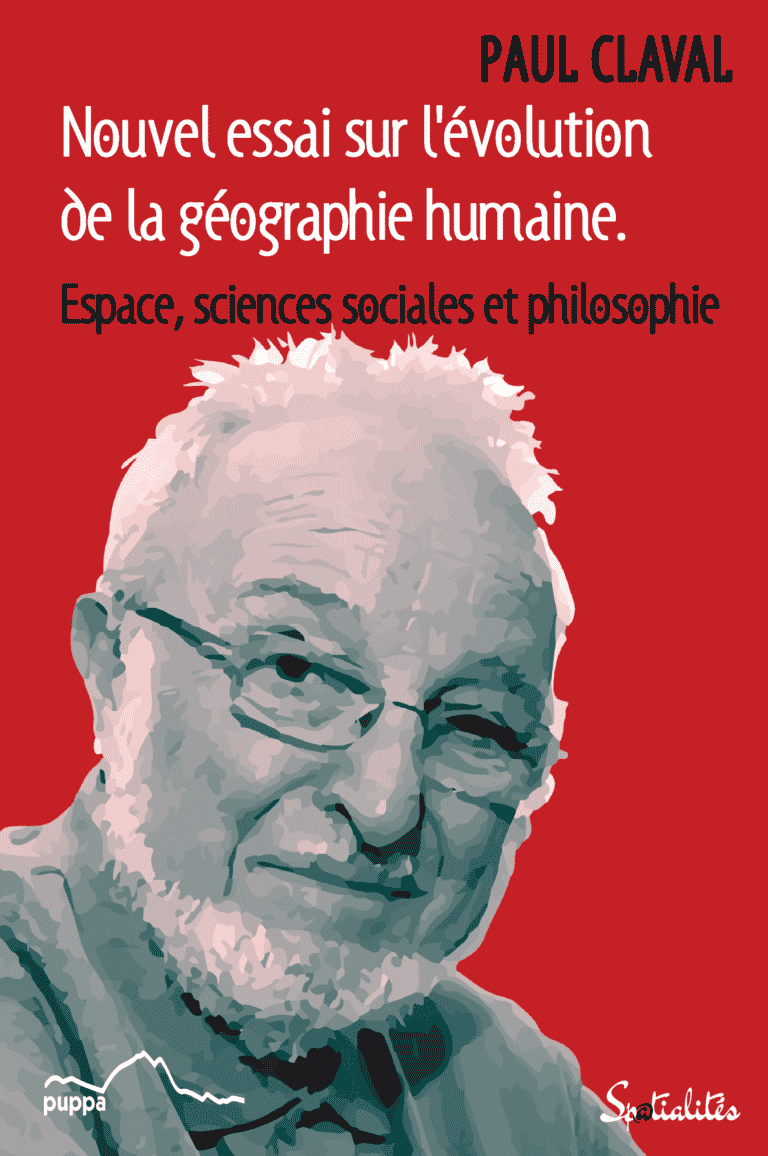La postmodernité reconfigure la géographie. Elle lui donne deux formes qui présentent des points communs, mais diffèrent par certains de leurs principes : la géographie poststructuraliste tire une partie de ses arguments de l’inconscient que charrient la vie, le langage et l’échange économique ; l’approche culturelle réfute cette interprétation et propose une lecture plus complète des imaginaires et des processus culturels.
L’ouverture des perspectives de recherche
La géographie traite aujourd’hui d’un champ démesurément élargi. L’approche fonctionnaliste s’attachait à la marche des sociétés – à leur vie économique essentiellement, mais sans expliciter ce point. Elle mettait au premier plan les activités productives. Elle tenait également compte des jeux de pouvoir – mais ne les analysait que dans le cadre des États, de leurs politiques de domination et de leurs armées.
La géographie humaine traitait surtout des hommes auxquels revenaient les tâches productives, alors que les femmes étaient largement cantonnées à celles de reproduction sur lesquelles on ne s’attardait guère. Toutes les tranches d’âge ne retenaient pas de la même façon l’attention : la production était pour l’essentiel réalisée par des adultes de sexe masculin. C’était parmi eux que se recrutaient les armées qui faisaient la force des nations.
Les géographes se focalisaient surtout sur les productions destinées à l’échange. Ils négligeaient l’économie d’autosubsistance qui restait pourtant dominante sur de larges espaces ; l’échange commercial n’était encore pleinement développé que dans les pays déjà industrialisés : les peuples de race blanche se trouvaient donc plus étudiés que les autres ; les noirs, les Indiens ou les Chinois n’intervenaient souvent que là où s’étaient implantées des économies de plantation – une petite partie du monde tropical.
La rupture avec le fonctionnalisme bouleverse la discipline. Les femmes, les enfants et les vieillards retiennent désormais autant l’attention que les hommes adultes. Une vive curiosité se développe pour les problèmes que rencontrent les classes dominées, les marginaux ou les étrangers. Le monde en développement et les pays émergents sont tout autant valorisés que les sociétés occidentales.
Intéressés au premier chef par les activités productives, la géographie s’arrêtait lorsque la vie économique était perturbée par des catastrophes climatiques, des crises cycliques ou des guerres. La géographie que l’on m’avait enseignée au lycée s’arrêtait en 1913 et n’avait guère repris avant 1921 ; elle ne parlait qu’en pointillés de la Grande Crise qui avait éclaté aux États-Unis en 1929 et avait affecté l’ensemble du monde durant la plus grande partie des années 1930. Elle s’était interrompue de nouveau en 1939 et n’avait pas encore tout à fait repris lorsque j’étais en classe terminale, en 1949.
Des guerres, il n’était question qu’en géographie politique, mais celle-ci était davantage consacrée à l’analyse de la puissance et de la construction des Empires qu’aux conflits eux-mêmes. Les crises économiques et les catastrophes naturelles étaient passées sous silence. La misère profonde de populations et de pays entiers ne retenait l’attention que comme un élément du pittoresque et de l’exotisme des mondes étrangers.
La géographie actuelle traite de la moitié féminine de l’humanité, des âges oubliés, des non-producteurs, des marginaux, des exclus et des prisonniers. Elle englobe les aires où les sociétés présentent leurs traits normaux aussi bien que les hétérotopies, ces contre-espaces dont elles ont besoin, mais dont les règles imposées partout ailleurs sont suspendues. À côté de l’abondance et de la prospérité, elle aborde la pauvreté et la misère ; aux moments de bonheur, elle oppose les périodes d’épreuve et de désespérance ; elle fait une place à la mort, à ses différents visages et aux lieux qui lui sont voués.
L’élargissement permet d’intégrer toutes les facettes de la vie et de la culture des hommes. Les aspects rationnels de la pensée ne disparaissent pas, mais une large place est parallèlement accordée à l’exploration des imaginaires, à leur variété, aux préférences qu’ils font naître et aux environnements qu’ils contribuent à façonner. À la vie productive s’ajoute l’analyse de la fête, des loisirs (déjà abordés, mais sous l’angle productif du tourisme) et de la mise en scène du monde.
Ce que nous venons de dire de la géographie, nous pourrions le reprendre, mutatis mutandis, pour chacune des sciences sociales empiriques.
La prise en compte de l’imaginaire
L’élargissement de la discipline se traduit par la place désormais réservée aux représentations. Celles qui retiennent l’attention du poststructuralisme naissent de la lecture sensible du monde qui nous entoure (Debarbieux, 2015), des images qui en circulent et des récits qui en sont faits. Les paysages nous plaisent ou nous indiffèrent ; ils évoquent d’autres lieux, d’autres moments ; nous les colorons d’allégresse, de joie de vivre, de bonheur, d’épanouissement ; ils font naître en nous de la nostalgie, nous plongent dans la mélancolie et nous inspirent crainte ou effroi. Sur les formes perçues se greffent ainsi des sentiments. Le rêve s’en empare, magnifie certains lieux et les rend désirables ou les charge de menaces et les pare du charme terrifiant du sublime. Toutes les images du même type bénéficient de ce type de promotion. La photographie d’une plage de sable blanc et de cocotiers nous fait aspirer aux vacances, au farniente, au repos. Une vue de longs versants enneigés nous appelle à chausser nos skis ou à faire usage de nos luges…
Voyageurs et écrivains décrivent le monde et le chargent de leur sensibilité. Photographes, cinéastes et vidéastes choisissent les cadrages et les lumières qui magnifient les sites qu’ils font connaître. C’est cet imaginaire que mettent en œuvre aussi bien le peintre qui représente des paysages que le romancier qui imagine le cadre où s’inscrivent ses intrigues. C’est lui qui inspire le cinéaste, le réalisateur de séries télévisées ou l’auteur de bandes dessinées. C’est lui qu’exploite l’aménageur de stations touristiques, le voyagiste soucieux de toucher de nouveaux clients et qui propose des itinéraires et des séjours adaptés aux préférences et aux rêves de chacun. C’est lui qui motive les touristes dans leur choix de destination. Ce à quoi aspirent les gens finit ainsi par se réaliser : les bandes dessinées et les dessins animés de Walt Disney ont engendré des Disneylands et Disneyworlds un peu partout dans le monde, ainsi que les lotissements qui les entourent parfois. Les Schtroumpfs du dessinateur belge Peyo ont également eu un parc en Lorraine ; les albums Astérix d’Albert Uderzo et René Goscinny ont toujours le leur en région parisienne.
Une forme essentielle d’imaginaire naît ainsi au contact du monde et mêle à ses images des réactions affectives faites d’aspirations ou de craintes. L’idée du monde en sort transfigurée. Les hommes cherchent à retrouver dans ce qu’ils découvrent ce que l’imaginaire leur fait miroiter. Les voyagistes et les promoteurs le savent, qui s’efforcent de transformer les images en réalités matérielles.
Elisée Reclus devait aux années qu’il avait passé à rédiger des Guides Joanne son intérêt précoce pour le tourisme. Les travaux que celui-ci suscita par la suite laissaient échapper ce qu’il avait de plus spécifique : la valorisation de certains lieux, de certaines atmosphères, de certains moments ou de certaines saisons. La prise en compte des imaginaires transforme le domaine : c’est parce qu’il est enfin conçu pour ce qu’il est – une manière originale de consommer de l’espace – que l’on commence vraiment à comprendre la genèse des lieux ou des aires touristiques, les effets de mode qui les affectent, et la transfiguration du réel dont il naît souvent. Un travail comme celui que Jean-François Staszak consacre aux Géographies de Gauguin (Staszak, 2003) est exemplaire en ce domaine.
Regard des autres et visibilité
Les approches fonctionnelles avaient conduit les géographes à se focaliser sur l’inégale fécondité des terres et sur l’inégale accessibilité des lieux. L’élargissement des curiosités dont le poststructuralisme est l’expression ajoute une autre perspective à celles qui avaient déjà été explorées.
La géographie humaine d’hier était conçue comme résultant de l’action rationnelle des groupes qu’elle étudiait. Grâce à son regard informé, celui qui la pratiquait mettait en évidence les distributions et les formes de structuration de l’espace que façonnait l’action rationnelle des hommes ; elles étaient parfois trop complexes pour sauter aux yeux de ceux qui avaient contribué à les faire naître ou à les entretenir. Grâce à l’acuité de sa vue, le géographe était le seul à savoir mettre en évidence l’ordre que les hommes avaient donné à l’espace et à souligner les problèmes qu’il créait : même si la place qui lui était reconnue dans la cité était relativement modeste, le rôle qu’il y jouait était essentiel, puisqu’il portait à la connaissance de l’opinion publique et des gouvernants des faits décisifs pour gérer correctement l’espace, mais qu’ils n’appréhendaient qu’imparfaitement. De leurs analyses pouvait sortir des suggestions pour porter remède aux difficultés de la vie économique et aux malfaçons de l’aménagement du territoire.
Les tournants que connaît la géographie dans les dernières décennies du XXe siècle modifient profondément cette situation. Même si la formation qu’il a reçue assure au chercheur une appréhension plus poussée du réel, on ne croit plus que son regard suffise à éclairer l’ordre du monde. Celui-ci a été fabriqué par les populations qu’il étudie, par les institutions dont elles se sont dotées et par les instances qui les gouvernent. Le géographe n’a pas le monopole de la géographie : tous les hommes sont, à des degrés divers, géographes. Ce que l’on demande aujourd’hui au chercheur, c’est qu’il s’attache au regard que les autres portent sur leur voisinage, leur pays ou la planète (Claval, 2012) ; c’est qu’il analyse les pratiques, les savoir-faire et les connaissances géographiques dont ils sont porteurs ; c’est qu’il montre quels rêves et quels projets orientent leur action, quelles stratégies ils déploient pour modifier l’espace autour d’eux, et quelles tactiques ils mettent en œuvre pour tirer parti des dispositions déjà en place.
Il ne faudrait pas croire que les géographes d’hier aient totalement ignoré ces perspectives : ils visitaient des fermes, des entreprises, administraient des questionnaires ; ils tiraient de cela des informations utiles ; ils intégraient une partie des savoirs vernaculaires qu’ils acquéraient ainsi dans leurs résultats. Ils le faisaient ouvertement, mais sans essayer de dresser un tableau systématique du regard que portaient sur leur environnement ceux qu’ils étudiaient, et sans analyser l’ensemble des connaissances qu’ils en tiraient et des projets qu’ils essayaient de mettre en œuvre. La démarche diffère aujourd’hui car elle repose sur un décentrement : ce que l’on attend du géographe, c’est qu’il parle du regard des autres et pas du sien.
Cela fait naître de nouveaux champs de recherche. Les ethnogéographies se penchent sur les savoirs vernaculaires de telle ou telle société, de tel ou tel groupe d’âge, de telle ou telles minorité. Les travaux sur l’imaginaire sont consacrés aux représentations partagées. La scène géographique cesse d’apparaître comme un simple décor, ou comme une simple dispensatrice de ressources. Elle est investie par une pluralité d’acteurs, qui y possèdent des droits différents et y conçoivent différemment leur avenir. Toute portion de l’espace terrestre, quelle que soit son échelle, est maintenant envisagée dans une perspective géopolitique comme on a appris à le faire pour les États : elle est saisie comme une scène ou comme une arène où se côtoient des hommes qui coopèrent ou qui s’opposent. Comme au théâtre, il y a des spectateurs et des coulisses qui échappent à leur regard. La scène n’est pas faite d’éléments juxtaposés au hasard. Le plateau qu’elle offre a été conçu pour l’agrément de ceux qui l’observent, ou pour leur inspirer la crainte et les faire trembler : il a été imaginé par un metteur en scène, ou par un groupe épris de mise en scène.
Ces nouvelles préoccupations ne modifient guère l’approche des grandes plaines céréalières ou des grandes zones d’élevage du monde. Leurs paysages ont été modelés pour produire et pas pour séduire des visiteurs : les approches fonctionnalistes d’hier en rendaient compte de manière satisfaisante. Il en va différemment dans les aires urbaines, dont les populations sont souvent d’origine variée, où la division du travail est très poussée et où les gens se donnent perpétuellement en spectacle les uns les autres. L’analyse des régions touristiques s’enrichit plus encore.
Ce qu’apprend cette attention nouvelle au regard des autres, c’est que l’espace ne compte pas seulement par la fécondité des étendues qui le composent et par l’attractivité de certains de ses points ou de certaines de ses aires. Il est apprécié pour la visibilité qu’il offre – au double sens de ce qu’il offre à voir, et des chances d’être vu par les autres que l’on peut y trouver. Cette visibilité, c’est ce que l’on acquiert en visitant d’autres lieux. C’est aussi ce qui est véhiculé par les écrits des voyageurs, des romanciers et des reporters, les paysages des peintres, les films des cinéastes ou des vidéastes. C’est celle qu’élargissent les médias et les moyens modernes de télécommunication ; c’est celle qui bénéficie de la mobilité accrue des hommes.
Visibilité, sentiment d’exister et statut
Du point de vue social, il ne suffit pas de vivre et d’être en bonne santé pour exister ; on n’est intégré à la société que si on attire des regards, que si les gens vous reconnaissent au passage et vous saluent, que s’ils s’inquiètent de votre santé et de votre devenir, vous écrivent, vous téléphonent ou vous appellent sur skype.
Dans le cas que nous venons d’évoquer, le sentiment d’exister naît de rencontres répétées dans un environnement stable – celui que l’on trouve au village, dans un bourg ou certains quartiers populaires. Mais la conscience d’être peut naître aussi bien dans une foule urbaine, dans un grand meeting, dans une manifestation sportive, lorsque la vie alentour rejaillit sur chacun, l’anime, le fait vivre à un rythme partagé et l’ouvre aux mêmes émotions.
Dans les deux cas, la chaleur que ressent l’individu et l’expérience de vivre vraiment qu’il éprouve résultent de relations qui se font, en gros, d’égal à égal. Saluer quelqu’un est une marque d’attention à l’égard de son prochain, mais le sentiment d’être emporté par une même émotion collective est d’autant plus fort que l’on est anonymement mêlé à la foule.
La recherche de la visibilité prend souvent une autre signification : elle n’est plus faite pour se rassurer et se fondre dans un groupe. Ce qui la motive, c’est le souci de s’en distinguer : on se différencie des autres en les dépassant. Les approches fonctionnalistes de la géographie faisaient de la quête du pouvoir et de la poursuite des richesses les moteurs de la vie sociale. Ce que montrent les approches contemporaines, c’est le rôle d’un troisième type de compétition dans la vie des groupes : celle pour le statut.
Sa prise en considération peut élargir considérablement la compréhension des mécanismes de la vie sociale. Nombre de chercheurs s’inspirent du traitement que lui donne Pierre Bourdieu dans La Distinction (Bourdieu, 1979). Une grande enquête dont il est l’inspirateur est lancée en 1962-1963. Son dépouillement et les enquêtes complémentaires qu’elle suscite font trainer son exploitation. L’analyse des correspondances, que Jean-Paul Benzecri (1932-2019) vient de mettre au point (Benzecri, 1973), est largement mobilisée pour corréler les données que l’on vient de collecter sur les goûts des Français en matière de culture – littérature, théâtre, musique, cinéma, etc. – et celles concernant leurs catégories socio-professionnelles. Les sociologues qui en exploitent les résultats ont le sentiment de posséder un outil d’une puissance inégalée : c’est comme si le nouveau procédé garantissait la rupture épistémologique sur laquelle reposait leur expertise – les géographes qui découvrent ces outils à l’époque ont la même réaction.
Les résultats de ce gigantesque travail sont publiés en 1979. Ils établissent que la recherche de la distinction ne modifie pas la structure en classes liée aux mécanismes économiques et politiques que l’on prenait seuls en compte jusqu’alors. Le capital symbolique que les gens riches et (ou) cultivés accumulent par leur culture ne fait que conforter le capital économique et politique qu’ils possèdent par ailleurs : pourquoi y sont-ils attachés ? Parce qu’il justifie leur position dominante aux yeux de tous.
Un souci de rigueur est évident tout au long de cette recherche. On peut cependant lui reprocher l’absence de recul critique vis-à-vis des conclusions que l’on peut tirer de l’analyse des correspondances. On peut également récuser la manière dont les conclusions obtenues pour la France des années 1960 ont été appliquées à d’autres sociétés et à d’autres pays. Nous reviendrons plus tard sur ces réserves. Ce qu’il nous paraît important de souligner, c’est que l’ouvrage de Bourdieu a certainement conduit la recherche poststructuraliste à sous-estimer la signification de la compétition pour la visibilité et le statut en généralisant les résultats d’une étude où elle ne fait que renforcer les hiérarchies nées d’autres facteurs.
Les processus de diffusion
À côté des processus économiques et politiques, la discipline prend désormais en compte ceux qui mettent en jeu les aspects jusque-là négligés de la culture : la transmission des acquis et la construction des identités.
Correspondant à ce qui chez l’homme n’est pas inné – l’immense majorité, en fait, de ce qu’il est capable de réaliser –, la culture résulte du transfert de générations en générations et d’individus à individus d’attitudes, de comportements, de savoir-faire, de connaissances et de croyances ; les éléments reçus sont alors internalisés (mais pas en totalité) et mémorisés.
À la suite des travaux de Nigel Thrift (Thrift, 2007) inspiré en partie par Bruno Latour (Latour, 2005; Linhardt et Muniesa, 2006), la géographie oppose le domaine non-représentationnel des pratiques qui s’acquièrent par observation aux représentations, qui impliquent l’usage de la parole et mettent en jeu des mots ou des images. Les dynamiques de transfert des éléments représentationnels de l’oralité et de l’écrit diffèrent de celles qui sont en œuvre dans le domaine non représentationnel de l’imitation.
La géographie poststructuraliste mobilise, en ce domaine, les travaux de Michel Foucault et de Pierre Bourdieu.
1. Dans Les Mots et les choses, Foucault montre, on l’a vu, comment dans les trois domaines de la folie, du langage et de l’économie, se sont élaborés des discours tour à tour dominants et dont la conjonction définit l’épistémè de chaque époque. Dans L’Archéologie du savoir, il systématise ces résultats en proposant une théorie des formations discursives. Celles-ci auraient comme trait spécifique de dépendre, dans leur construction, de ce qu’il définit comme un énoncé : il s’agit d’une clé ainsi agencée qu’elle peut être copiée et reproduite, mais pas modifiée.
Foucault formule ainsi en 1970 une théorie de l’inconscient du langage qui explique la large diffusion et acceptation de certaines représentations par la permanence de l’énoncé qui les structure. Il s’en détache par la suite, mais sans que cela affecte la réception de ses idées par un grand nombre de chercheurs.
2. Pierre Bourdieu met l’accent sur le rôle de la pratique et sur la manière dont celle-ci se transmet dans l’espace social. Constituée essentiellement d’attitudes et de comportements, elle n’est que très partiellement verbalisée. Elle se transmet essentiellement par un long processus d’imitation et d’imbibition, qui modèle l’individu en le dotant d’un ensemble de réflexes et de dispositions, son habitus. Chacun est ainsi inconsciemment doté d’un ensemble de traits acquis et qui modèlent sa vie. À travers la diffusion de leurs modes de penser, les couches dominantes de la société disposent du pouvoir d’imposer à l’ensemble de la population leurs façons d’être et leurs idéologies.
Bourdieu met ainsi en évidence l’existence d’un inconscient qui n’est plus seulement du langage ; c’est celui, plus large, qui naît de la transmission des signes.
C’est à travers les enseignements de Foucault et de Bourdieu que la géographie aborde ainsi les processus de diffusion.
Dynamique de l’identité et construction de l’autre
La seconde famille de processus que retiennent les analyses poststructuralistes concerne la construction de l’identité et celle, corrélative, de l’altérité. Le point de vue adopté est constructiviste : les chercheurs refusent de voir dans la variété des traits observés l’expression d’essences différentes. Pour eux, la réalité sociale ne comporte, au départ, que des nuances aléatoires et relativement superficielles. Les individus y sont sensibles et ont tendance à se rapprocher de ceux qui offrent les traits qui leur conviennent le mieux.
C’est au sein du groupe d’interaction ainsi formé que se construit alors l’image de l’autre. Pour prouver à ses interlocuteurs privilégiés qu’il est proche d’eux, l’individu définit celui qui diffère du modèle qu’ils offrent par des traits qu’il grossit à dessein. Une image de l’étranger comme être d’une autre essence sort ainsi des échanges réalisés au sein du groupe : le stéréotype bâti transforme l’étranger en un être totalement différent ; à la limite, son humanité est récusée.
La géographie poststructuraliste s’intéresse à la formation des opinions, mais elle n’en retient qu’une modalité : celle qui aboutit, de manière unilatérale, à bâtir des barrières entre les hommes.
Les matrices de domination
Pour les poststructuralistes, la diffusion des habitus et des formations discursives jointe à la recherche de la distinction aboutit à la création de matrices de domination. Le processus est enclenché dès que commence à se construire le stéréotype de l’autre.
Le groupe qui invente des énoncés qui donnent à ses propos leur pouvoir de s’imposer aux autres diffuse ainsi les idées et les attitudes qu’il a formatées ; aux groupes moins habiles à manier les formations discursives et à assurer la reproduction des habitus, il impose des conceptions du monde qui ne reflètent pas leurs intérêts.
La géographie n’est pas dessinée uniquement, comme dans l’approche fonctionnaliste, par le jeu de l’économie et de l’inégal développement, et par celui de la force. Elle est largement déterminée par la mise en place des matrices de domination qui inculquent à des populations qui peuvent être nombreuses des conceptions du monde qui leur font accepter comme légitimes la sujétion dans laquelle elles se trouvent placées, l’exploitation dont elles sont l’objet et les exactions dont elles sont victimes. Trois matrices de domination coexistent ainsi dans le monde actuel : celle de la classe, de la race et du genre (Staszak, Debarbieux et Piéroni, 2017).
L’espace de la géographie poststructuraliste
La géographie classique étudiait la différenciation régionale de l’espace naturel et de l’espace humanisé ; la Nouvelle Géographie mettait en évidence les réseaux et les nœuds des voies de transport et de communication comme ceux qu’arment les systèmes de relations institutionnalisée. La géographie issue du tournant poststructuraliste n’ignore pas les espaces auxquels s’étaient attachés les formes de la discipline qui l’avaient précédée, mais elle relativise leur signification : les différences que notait la géographie classique étaient primordialement liées à l’inégale prise des genres de vie sur les milieux naturels en raison de la fécondité de ceux-ci – information essentielle pour qui cherchait à gouverner les sociétés traditionnelles ; celles que retenait la Nouvelle Géographie naissaient de l’accumulation des activités de transformation et de services dans des lieux et des aires accessibles – élément-clé des politiques de développement que menaient alors les gouvernements.
Les divisions régionales que proposait la géographie classique comme la trame des aires et des lieux centraux – et donc accessibles – qu’analysait la Nouvelle Géographie répondaient aux besoins économiques et politiques des couches dominantes de la société.
La géographie poststructuraliste resitue dans leur contexte les résultats obtenus par les géographes de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe : ils répondaient largement aux demandes d’une époque où triomphaient nationalismes et impérialisme. L’appréhension du monde que mettent aujourd’hui en œuvre les chercheurs est infiniment plus large que celle de leurs prédécesseurs, mais elle montre en même temps comment les matrices de domination imposent souvent à la masse des populations des visions de la société élaborées par les couches dominantes. À la subordination politique qu’assure le monopole de la force, à la domination économique qui naît du contrôle des facteurs de production s’ajoute une mise en tutelle idéologique qui structure l’espace en grandes plages (là où la diffusion des modèles venus de haut prend place dans des milieux relativement isotropes) ou en mosaïque et isolats (là où elle se fait dans un tissu structuré en réseaux, et donc inégalement transparent).
Les lieux sont d’autre part différenciés par la visibilité dont ils jouissent. Cette piste n’est cependant qu’imparfaitement explorée dans la mesure où les recherches sur la distinction de Bourdieu soulignent que la géographie des statuts qu’assure le prestige et les regards qu’il attire ne diffère pas de celle de la richesse et du pouvoir.
Dans un autre registre, la géographie poststructuraliste est sensible au statut ontologique de l’espace qu’elle analyse ; elle y repère des différences de nature (zones sacralisées et autres hétérotopies), mais ne les explique pas.
Ce que révèle l’approche poststructuraliste, c’est ainsi un espace dont la différenciation n’est pas due primordialement à la nature et à la manière dont l’homme la maîtrise, ou à l’accessibilité qui attire les activités de transformation et de service. Elle résulte de jeux de pouvoir dont ne sont généralement pas conscients ceux qui y sont soumis. Elle donne ainsi à voir l’envers de la société, sa face cachée, pourrait-on dire. Elle dessine une géographie de l’aliénation, préambule nécessaire à toute lutte pour la désaliénation. Elle est donc particulièrement attentive aux hétérotopies, ces enclaves où les sociétés se délestent des fonctions qui leur sont nécessaires même si elles sont inavouables, et où elles parquent ceux qui les mènent. Elle les signale mais sans les expliquer.
La perspective subalterne en géographie
et les études postcoloniales
L’accent mis sur les formes de domination d’une part, et sur les hétérotopies d’autre part, conduit à un changement de perspective sur les sociétés humaines : pour les sciences sociales, et la géographie entre autres, le progrès naissait de l’action de décideurs éclairés (qu’il s’agisse de despotes informés par des philosophes ou de leaders démocratiquement élus) et des connaissances et projets mis au point par les élites. Sans que le point soit explicité, dans le couple système politique/société civile, ces approches mettaient l’accent sur le premier de ces termes partout où il avait pris les traits de l’État westphalien. À l’intérieur de la société civile, les travaux s’attachaient davantage au rôle des grandes entreprises industrielles et commerciales auxquelles on devait l’industrialisation et l’urbanisation qu’aux paysanneries misérables. Ce trait ne caractérisait pas seulement les chercheurs acquis aux idéologies libérales de la libre entreprise et du marché.
C’est ce parti-pris que remet en cause le poststructuralisme en montrant la part de préjugés qui entre dans une vision de la vie sociale où comptent surtout les initiatives venues du haut. L’attention désormais accordée aux formes de domination invite à se tourner vers les dominés. Subissent-ils passivement les formes de sujétion qui leur sont imposées ? Non ! C’est à leur inertie, à leur fatalisme, comme on le disait hier, ou plutôt à leur capacité de résistance souligne-t-on aujourd’hui, que l’on s’attache désormais ; on découvre les stratégies longtemps occultées par laquelle se traduit celle-ci. C’est à elles que se consacrent ce que l’on qualifie d’études subalternes ou de postcoloniales.
Ces études sont critiques dans la mesure où elles réfutent l’idée que les maux dont souffrent les sociétés viennent toujours et seulement de la nature. Si les tremblements de terre sont meurtriers, ce n’est pas seulement en raison de la magnitude des secousses sismiques, c’est aussi parce que des sans-ressources ont été poussés à s’installer dans des zones dont l’instabilité est connue. Si la grande famine née de la maladie de la pomme de terre dans l’Irlande des années 1840 a été si meurtrière, c’est que l’expulsion des tenants irlandais qui vivaient sur les grandes propriétés anglaises avait conduit un nombre croissant de familles sur les terres ingrates de l’ouest et du nord de l’île, où elles arrivaient à subsister avec un arpent de pommes de terre, mais n’avaient pas d’autres ressources.
Les études subalternes sont fondamentalement anti-malthusiennes. Elles révèlent la capacité d’adaptation et d’invention de groupes que l’on jugeait figés : on découvre la richesse des contre-cultures qu’ils avaient développées, la manière dont ils avaient détourné et réinterprété les croyances qu’on leur avait imposées. La géographie de l’Inde du XIXe siècle et des premières décennies du XXe n’est pas seulement modelée par le colonisateur britannique, les familles princières, les milieux commerçants et les entrepreneurs locaux ; elle l’est par les masses populaires, leur résilience, leurs initiatives. La géographie du Nordeste brésilien n’est pas seulement celle qu’ont façonnée les senhores do engenho et les plantations de sucre, c’est celle qui se crée dans les enclaves de noirs marrons qui fuient l’esclavage, et celle, syncrétique, qui se construit à la marge des institutions coloniales et de l’Église catholique, et dont témoigne le succès des cultes afro-américains.
Les études subalternes constituent sans doute l’apport le plus substantiel du courant poststructuraliste à la géographie contemporaine. C’est dans ce domaine que sa portée critique apparaît le mieux. C’est d’elles que sont nées une bonne partie des nouvelles doctrines d’aménagement qui remettent en cause le néo-libéralisme et la globalisation qu’il justifiait et qu’il avait précipitée.
Les études subalternes ont l’immense mérite de conduire à la réécriture du grand récit de l’occidentalisation du monde comme étape nécessaire de la marche de l’humanité vers sa réalisation complète. Elles analysent en profondeur les traumatismes causés par l’impérialisme et mettent en évidence l’inventivité de populations longtemps méjugées. Les études postcoloniales renouvellent notre compréhension de l’histoire du monde depuis les Grandes Découvertes.
La géographie poststructuraliste a-t-elle ainsi jetée les bases d’une discipline qui serait définitivement critique ? On peut en douter : à l’époque de Josué de Castro, le mouvement des paysans sans terre constituait sans doute une solution possible au problème des inégalités sociales au Brésil. Un pays dont l’essor récent repose dans une large mesure sur l’exportation de matières premières, minerai de fer ou soja, a besoin de repenser son économie, mais sans qu’il soit possible de revenir sur l’urbanisation de ses populations et sur la scolarisation de l’ensemble de la jeunesse. Les études subalternes privilégient les actions de résistance et l’initiative locale. Elles servent de justification à des idéologies qui prônent le communautarisme et le repli sur soi. Comme toute mobilisation de savoirs par des systèmes de pensée normatifs, ce type d’analyse doit faire l’objet d’un examen critique. La géographie poststructuraliste s’en est jusqu’à présent montrée incapable.
Oui, l’hypermobilité de la société contemporaine est à bien des égards indéfendable. Oui, la liberté de mouvement reconnue à chacun conduit à une sur-fréquentation injustifiable de certains lieux. Ce sont là des débats essentiels pour notre discipline. Elle se fourvoierait cependant si elle cautionnait sans les soumettre à examen critique certaines des actions aujourd’hui prônées par ceux qu’inspirent les études subalternes.
Un bilan
1. Le bilan de l’approche poststructuraliste en géographie est à la fois impressionnant et décevant. Du côté positif, les actifs sont de trois ordres : (i) la culture est prise en compte dans son entièreté : dans ce qu’elle contient de rationnel comme dans ce qui touche aux imaginaires ; (ii) les études géographiques s’élargissent à la totalité de l’humanité, aux femmes, aux enfants et aux vieillards comme aux hommes, au genre comme à la race, aux faits de domination idéologique comme à ceux de pouvoir et de subordination économique ; (iii) la géographie s’attache aux problèmes de justice sociale.
2. L’approche poststructuraliste séduit bon nombre de géographes par le caractère subversif que lui confère le constructivisme qu’elle professe. Les catégories de la géographie humaine qu’elle définit ne sont pas ancrées une fois pour toutes dans la nature : elles sont conçues comme conventionnelles.
À une époque où la croissance des effectifs humains et l’augmentation rapide des niveaux de consommation menacent les équilibres globaux de la planète, il est difficile d’ignorer les limites de la terre. C’est cependant dans un autre domaine que la charge subversive du poststructuralisme se manifeste surtout : celui des pratiques sociétales, des distinctions de genre et de la nébuleuse LGBT.
Le succès de ces études tient largement à l’interprétation du Foucault sulfureux des expériences du sexe et du genre. Miller signale (ce que nombre de commentateurs de Foucault lui reprochent) la dimension innovante que Foucault trouvait dans les expériences sexuelles telles que celles que l’on pouvait faire à l’époque dans les saunas gays de San Francisco :
« […] à la même époque, Foucault s’est mis à parler ‘d’une érotique de la vérité’, d’une recherche sans répit dans laquelle ‘la vérité […] est extraite du plaisir lui-même, recueilli comme expérience, analysé selon sa qualité, suivi tout au long de ses réverbérations dans le corps et dans l’âme’. Cette ‘érotique de la vérité’ engendre ce que Foucault appelle un savoir ‘quintessencié’ qui se transmet ‘sous le sceau du secret […] par initiation magistrale à ceux qui s’en sont montrés dignes et qui sauront en faire usage au niveau même de leur plaisir, pour l’intensifier et le rendre plus aigu et plus achevé’ » (Miller, 1995, p. 311).
L’exploration du champ de la sexualité peut nous révéler une part de l’humanité généralement ignorée :
« Armé de cette ‘connaissance’, une connaissance profondément nietzschéenne dans sa nature, le généalogiste de la ‘souffrance-plaisir’ sera peut-être capable d’imaginer de nouvelles combinaisons, un nouveau ‘style de vie’ et, pourquoi pas, un nouveau ‘jeu’ de vérité » (ibid., p. 320).
À travers l’étude du sexe et du genre, c’est aux forces immanentes qui permettent aux hommes d’aller au-delà d’eux-mêmes que touche la recherche. C’est sur une métaphysique de l’immanence qu’elle débouche.
Foucault s’intéressait à ces nouvelles combinaisons. C’est un aspect de sa réflexion sur lequel on fait souvent silence. Cela n’a pas empêché que se diffuse l’idée qu’il aurait trouvé, dans les communautés LGBT, de nouvelles façons de vivre le sexe – et de vivre, tout court. Le Foucault des dernières années de sa vie sert ainsi de caution, à tort peut-être, au mouvement queer, qui tend à focaliser les sciences sociales sur ces comportements extrêmes. Nul doute qu’il s’agisse là d’un champ de recherche neuf, mais l’intérêt qui lui est porté n’est-il pas excessif ?
3. Il y a aussi, hélas, un côté négatif. L’analyse des matrices de domination repose sur des bases fragiles. Comme on l’a vu, Foucault ne parle plus de formations discursives après 1976 (cf. chapitre 5, « Foucault et la critique du discours »). L’habitus inclut aussi l’aptitude à recombiner les éléments acquis et à innover : il permet ainsi de rompre avec la spirale de domination que Bourdieu estime générale (cf. chapitre 3, « Acte I ») – même s’il accorde aux chercheurs – surtout lorsqu’ils sont sociologues – le privilège d’y échapper !
La pensée radicale souffrait, jusque dans les années 1970 et chez beaucoup de ceux qui s’en réclamaient, du déterminisme dans lequel le marxisme enfermait les acteurs de la vie sociale : ceux-ci ne pouvaient échapper au carcan que leur imposait leur situation économique.
Le poststructuralisme rompt avec le fonctionnalisme et l’économisme qui dominaient les interprétations radicales d’hier, mais en bâtissant une théorie des matrices de domination qui conduit les hommes à subir des oppressions dont ils ne peuvent pas échapper, il tombe dans une ornière semblable à celles du radicalisme marxiste.
L’approche culturelle échappe, on le verra plus loin, à ce pessimisme radical.
La théorie du marxisme d’extorsion de David Harvey
Le radicalisme poststructural prend aussi d’autres formes. Après 1985, David Harvey réagit fortement aux critiques qui visent la dimension spatiale qu’il greffe sur la pensée de Marx. Dans The Condition of Postmodernity (Harvey, 1989), il défend pied à pied ses positions et conteste systématiquement les points de vue postmodernes et poststructuralistes. Il emploie une partie des années 1990 à combler les lacunes que l’on reprochait à son interprétation (Harvey, 1996) : il prend en compte les problèmes environnementaux ou ceux des minorités ou des femmes sans revenir sur la position qu’il avait dans The Limits to Capital : c’est toujours sur l’analyse de l’extraction de la plus-value qu’il greffe son analyse des spatial fixes (des indurations spatiales) qui sont à l’origine de la dynamique des implantations capitalistes.
Sa position change aux alentours de 2000. C’est toujours de Marx qu’il se réclame ; mais suivant en cela des indications qu’il trouve en particulier chez Hannah Arendt, c’est d’une autre partie de son œuvre dont il se réclame désormais (Claval, 2020a, p. 237-252). Il met au second plan la théorie de la formation de la plus-value et de son appropriation par les détenteurs du capital telle qu’elle est formulée dans le livre I du Capital. Il s’inspire désormais de l’analyse qu’offre Marx du capitalisme préindustriel, celui qui a recours à la violence et à l’esclavage pour extraire les richesses du monde que les Grandes Découvertes ont ouvert à l’entreprise européenne. Le commerce qui y est pratiqué est toujours inégal ; il y a à cela une cause géographique : les armateurs et les commerçants européens exercent un monopole sur la chaîne d’information qui va des zones productrices à celles où s’écoulent les biens qu’ils acquièrent : cela leur permet de réaliser des bénéfices considérables. C’est sur l’analyse de cette forme de détour spatial que Fernand Braudel fonde son analyse du capitalisme commercial de l’époque moderne (Claval, 2020b) – une interprétation que ne retient pas Harvey. Celui-ci ne prend en compte que l’explication fournie par Marx : le recours systématique à la violence.
La nouvelle version que propose Harvey du capitalisme est faite pour une époque où l’industrie ne constitue plus la base essentielle de la formation de la plus-value. Celle-ci provient largement de l’exploitation de plus en plus féroce que les entreprises – européennes ou américaines, mais aussi de plus en plus japonaises, coréennes et surtout chinoises – font des ressources minières, des matières premières agricoles et de la main-d’œuvre du monde en développement. C’est le tableau d’un capitalisme d’extorsion que dresse désormais Harvey.
Les interprétations radicales du monde que proposait le marxisme grâce à son analyse de la mainmise du capitalisme sur la plus-value du travail salarié ont cédé la place à une interprétation qui ne trouve plus son fondement dans l’analyse de mécanismes économiques. Les vues nouvelles n’invoquent plus que la férocité d’une exploitation fondée sur la ruse et la violence. Du point de vue théorique, la régression est évidente. Pour les tenants d’une « théorie » révolutionnaire, le gain est, en revanche, considérable : la charge émotive du procès intenté aux formes actuelles du capitalisme est infiniment plus forte que celle que l’on pouvait attendre de la mise en évidence de la face cachée du salariat et de la mainmise de la plus-value qu’il crée par les entrepreneurs. Le capitalisme d’extorsion ne s’en prend pas seulement à l’exploitation dont sont victimes les hommes. Il fait une large place au pillage des richesses naturelles et à ses conséquences sur l’équilibre écologique de la planète.
À travers sa théorie du capitalisme d’extorsion, Harvey propose une interprétation aussi critique de l’économie et de la société modernes que ne le fait le poststructuralisme, mais il y parvient en accordant plus de place à la sauvegarde des milieux.
Sous ses formes poststructuralistes ou néo-marxistes, les formulations radicales de la géographie humaine ont de quoi séduire ceux que l’évolution du monde, le maintien de fortes inégalités, l’enrichissement sans bornes d’une étroite minorité et les déséquilibres climatiques jettent dans l’inquiétude. Ces analyses du réel n’y parviennent qu’en s’appuyant sur des interprétations qui font la part belle à des mécanismes inconscients (celui de l’inconscient économique de l’extraction de la plus-value pour le marxisme orthodoxe, celui de l’inconscient linguistique des matrices de domination pour le poststructuralisme) ou au déploiement pur et simple de la violence (pour le néo-marxisme du capitalisme d’extorsion).
Dans la perspective woke que justifient les sciences sociales poststructuralistes, le monde est soumis à une minorité qui prospère sur l’exploitation éhontée de ceux qui ne sont pas blancs, des femmes, des minorités et de l’environnement. La validité scientifique de ces interprétations est souvent loin d’être établie.