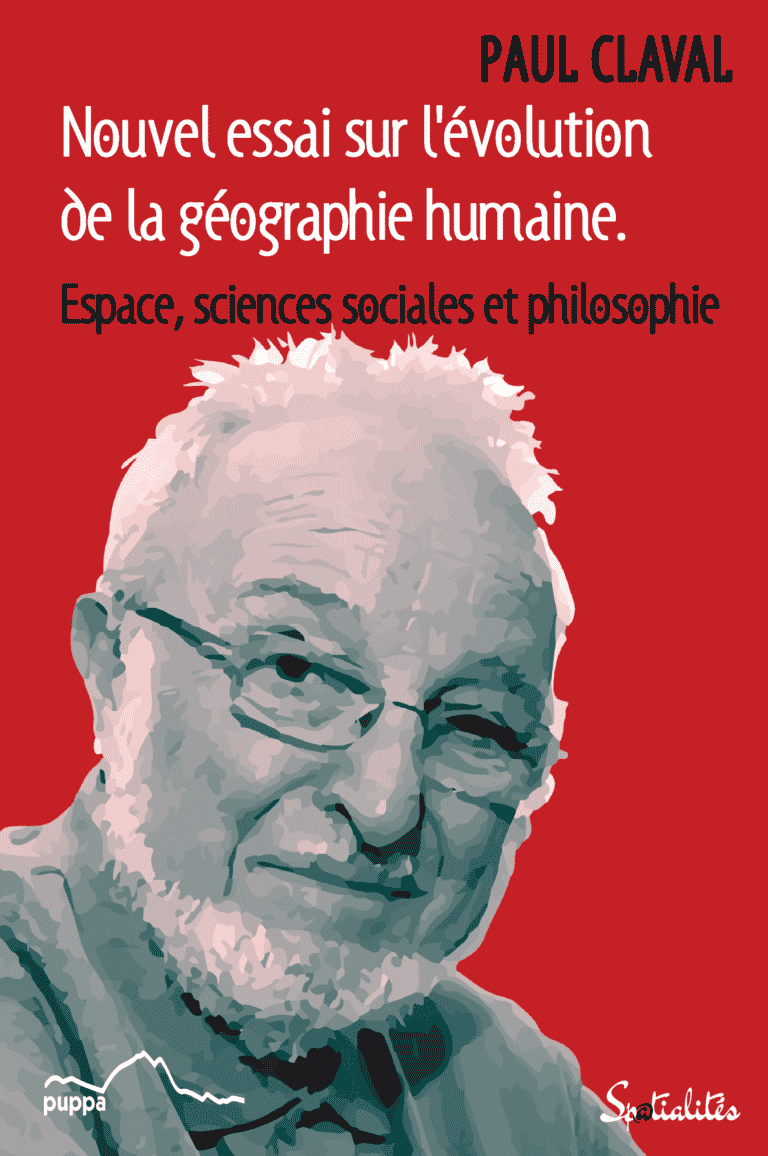Les sciences sociales empiriques traversent, à partir des années 1970, une série de mutations que l’on qualifie de tournants. Il ne s’agit pas de révolutions scientifiques au sens de Thomas Kuhn : on n’y voit pas un paradigme y succéder à un autre à la suite d’une remise en cause radicale des démarches jusque-là mobilisées. Comme le souligne le terme employé, c’est l’angle sous lequel le réel est envisagé qui change. Les géographes commencent à parler du tournant culturel que négocie leur discipline en 1996 ou 1997, mais la transformation a débuté dans le courant des années 1970.
Ces transformations ont un air de famille mais ne portent pas sur les mêmes traits. Elles ne touchent que les sciences sociales empiriques, celles qui sont nées de l’exploitation des sources documentaires variées qui s’offraient à des chercheurs désireux de comprendre la vie sociale, mais qui ne pouvaient pas l’analyser directement faute de pouvoir observer ce qui se passait dans l’esprit des gens. Le point de vue qu’impliquait le choix des documents exploités limitait l’efficacité des approches : il convenait donc de le modifier et de l’élargir pour rendre celles-ci plus efficaces. Travaillant sur les textes qui viennent du passé, les historiens s’étaient insuffisamment souciés des biais et des non-dits des grimoires ou des édits qu’ils exploitaient. S’appuyant sur les enquêtes qu’ils menaient et les statistiques qui leur étaient accessibles, les sociologues ignoraient souvent la diversité spatiale des sociétés qu’ils analysaient. Refusant de se pencher sur l’imaginaire des populations qu’ils étudiaient, les géographes rendaient mal compte des cultures qu’ils décrivaient.
Qu’il y ait eu ainsi, dans un laps de temps assez bref, une prise de conscience des limitations que connaissaient les sciences sociales empiriques n’est pas dû au hasard. Si elles ne souffraient pas des mêmes lacunes, toutes partageaient un même handicap : celui d’avoir un point de vue biaisé et limité par la nature des sources sur lesquelles elles s’appuyaient. Leur angle d’attaque était trop étroit et ne permettait pas d’embrasser la totalité de leur objet.
L’ère des tournants que connaissent les sciences sociales empiriques à la fin du XXe siècle résulte de ce qu’elles abordaient leur sujet de l’extérieur. Leurs difficultés viennent aussi des préceptes que leur a longtemps imposés une conception de la science qui n’était adaptée qu’aux sciences de la matière et de la nature.
L’ère des tournants voit donc les perspectives adoptées par chaque discipline s’élargir en intégrant des points de vue pris en compte par d’autres champs de recherche : les géographes ne commencent à maîtriser pleinement l’analyse des faits de circulation que lorsqu’ils mettent à profit les enseignements de l’économie spatiale. L’ère des tournants est ainsi celle du décloisonnement déjà entamé des diverses sciences empiriques de la société. On découvre que les points de vue retenus par les autres disciplines jettent parfois une vive lumière sur des thèmes qui sont secondaires pour elles, mais centraux pour leurs voisines.
Une autre conception de la culture
En géographie, le tournant de la discipline lui permet de développer une vue beaucoup plus large sur le rôle que joue la culture dans le façonnement par l’homme de la surface terrestre (Claval, 2020c).
La culture : collection d’artefacts ou ADN de la société ?
Fondées sur l’exploitation des manifestations observables de l’action humaine, la géographie saisissait les populations qu’elle étudiait à travers leurs façons de se nourrir, de s’habiller et de se loger, les outils qu’elles mobilisaient, les systèmes agraires qu’elles mettaient en œuvre, les paysages qu’elles modelaient, les monuments qu’elles bâtissaient ; elle les appréhendait à travers leurs comportements religieux, leurs temples ou leurs églises, leurs rituels et leurs pèlerinages, leurs moments de loisir et leurs fêtes, comme à travers leurs cérémonies funéraires et la place faite à la mort et aux morts.
La collecte de ces éléments était indispensable, mais elle passait à côté de l’essentiel. Dès l’instant où on étudie la culture en elle-même, la perspective change : étudier la culture, c’est comprendre comment elle est transmise d’un individu à l’autre et d’une génération à l’autre, et mettre l’accent sur les formes de communication ainsi mises en jeu. C’est se pencher sur ce dont la transmission ne repose que sur la vue (les processus d’imitation) et ce qui passe par la parole, par les systèmes de signes qu’elle mobilise, comme par les symboles qui font partager les émotions.
La culture cesse d’apparaître comme une collection d’objets. Elle est faite d’attitudes, de pratiques, de savoir-faire, de connaissances et de croyances. Elle est structurée par des codes que les hommes peuvent combiner et recombiner selon leurs besoins. C’est en quelque sorte l’ADN de la société. Il est présent à la fois dans l’esprit des gens et dans les automatismes et réflexes inscrits dans le corps.
L’homme est social parce que de culture
L’approche culturelle qui naît de la prise en compte des spécificités de la culture conduit à poser différemment le problème des rapports de l’individu et de la société : on ne peut plus les considérer comme des entités différentes et qui s’opposent. L’homme ne devient lui-même qu’à travers la culture qui circule autour de lui et qu’il internalise. L’individu n’est pas un absolu : il n’existerait pas sans ce qu’il a reçu des autres. Il est ainsi fait d’éléments qui le rattachent à la collectivité et au passé. Grâce à la capacité de recombinaison des codes et de création qui lui a été transmise, il a les moyens de faire face aux problèmes du présent et de se projeter dans le futur.
Quelle est la part, dans l’homme, de ce qui est transmis et donc fondamentalement social, et de ce qui exprime une autonomie véritable ? C’est un problème que posait déjà Aristote lorsqu’il soulignait le rôle de l’hexis, et que la réflexion sur l’habitus a repris de saint Thomas à Bourdieu. Deux interprétations sont possibles en ce domaine.
(i) La première reconnaît à l’individu une certaine autonomie, et ceci pour deux raisons : il n’a pas reçu de la société exactement le même bagage que ses voisins (l’argument qu’Anthony Giddens emprunte à Torstein Hägerstrand et à la time geography) ; ce qu’il y a chez lui d’inné se combine de manière originale à ce qu’il a reçu.
(ii) La seconde interprétation considère que l’habitus ne laisse aucune initiative réelle à l’individu – que la personne, au sens philosophique, n’existe pas : c’est, nous l’avons vu, la position de Bourdieu. Elle supprime tout dualisme entre l’homme et la société (en réduisant le premier aux codes transmis par la seconde), mais introduit un déterminisme sociologique dont Bourdieu s’empresse de se dédouaner en soulignant la spécificité de l’habitus que le chercheur doit à sa formation.
Deux lectures de la société sont dès lors possibles : le poststructuralisme privilégie celle qui met l’accent sur la servitude de la plus grande partie de l’humanité ; l’approche culturelle, n’ignore pas les déterminations sociales, mais estime qu’elles ne sont pas toujours totalement contraignantes.
On a souvent reproché aux études culturelles d’ignorer la dimension sociale de la vie humaine : le point de vue change avec l’approche culturelle telle qu’elle est aujourd’hui conçue : c’est parce qu’il est façonné par une culture que l’être humain est social.
Imaginaires, valeurs et institutionnalisation du social
Les sciences sociales se sont toujours montrées prudentes vis-à-vis de l’activité mentale et des représentations de ceux qu’elles étudiaient – mais des différences substantielles existaient de l’une à l’autre. S’attachant aux fortes personnalités qui marquent le destin des peuples, les historiens ne pouvaient ignorer le rôle que jouait l’éducation de ceux auxquels elle s’attachait, leur caractère, les modèles qu’ils s’étaient donnés et les rêves qui les hantaient. L’attitude était différente dans les disciplines qui s’intéressaient davantage aux groupes qu’à la personnalité de tel ou tel de leurs membres : la géographie, par exemple, refusait de se plonger dans l’esprit des gens pour éviter les pièges de la subjectivité.
C’est évidemment l’ethnologie qui allait le plus loin dans l’exploration de la culture : les réactions de ceux qu’elle étudiait répondaient visiblement à des logiques différentes des nôtres. Les catégories qu’utilisaient les peuples sur lesquels elle se penchait pour appréhender le réel et la manière dont ils concevaient le fonctionnement de leurs sociétés nous étaient étrangères. Leurs croyances religieuses, leurs interdits, leurs tabous intriguaient ou choquaient. C’est de l’ethnologie que s’inspirent les historiens de la Grèce antique lorsqu’ils essaient de comprendre la manière dont pensent les Ioniens, les Athéniens ou les Spartiates.
L’étude des mentalités devient une des marques de l’École des Annales à partir de 1950. En se systématisant, elle se transforme en analyse des imaginaires. Celle-ci s’impose vite dans tout le champ du social.
On prend également conscience de l’existence de deux types d’imaginaires : ceux qui partent du réel pour le transfigurer, le poétiser ou le dramatiser – nous les avons déjà évoqués – et ceux qui fabriquent d’autres mondes.
Des imaginaires dont la prégnance et l’autorité
naissent de l’éloignement
Ce second type d’imaginaire ne part pas du réel, mais en propose une version plus substantielle et plus authentique. Il construit des mondes plus vrais que celui que nous révèlent nos sens : nous cherchons à les faire advenir.
Les mondes qu’il met en œuvre ont la particularité d’être lointains, si bien que les informations qui en proviennent sont rares et difficiles à obtenir. Cela leur vaut d’être valorisées. En préparant Espace et pouvoir (Claval, 1978), je découvre, on l’a vu, les recherches que viennent de consacrer les sciences politiques à un processus spatial qui m’apparaît de la première importance : l’individu qui a accès à des nouvelles venues de lieux inaccessibles à la plupart en tire à la fois prestige et autorité – une autorité qui est perçue comme le reflet de celle des sources auxquelles il a accès. C’est l’essence des théories de la notabilité, qui éclairent, par exemple, les rapports entre Paris et la province (Grémion, 1976 ; Crozier et Friedberg, 1977 ; Friedberg, 1993).
C’est de l’éloignement que naissent à la fois l’autorité reconnue à la source des informations et le pouvoir de celui qui y a accès. Les chercheurs ont recours sans problème à ce type d’interprétation quand ils étudient les rouages de la politique ; ils hésitent à le faire quand il s’agit de comprendre l’origine des valeurs mises en œuvre dans d’autres registres de l’action humaine. C’est pourtant là que cette façon de voir est la plus féconde : c’est le jeu de l’autorité lointaine qui offre aux mortels les cadres éthiques et les règles morales qui guident leur action. Qu’elles aient quelque chose à voir avec la structure des espaces que conçoit l’esprit humain, le vocabulaire philosophique le rappelle, qui parle avec insistance de transcendance ou d’immanence. Que l’ordre normatif naisse de cela, nombreux sont pourtant ceux qui refusent de l’admettre, puisque c’est donner un rôle essentiel à d’autres mondes dont rien ne prouve qu’ils existent : pourquoi attacher foi aux univers de l’Immémorial, de la Révélation ou de la Raison métaphysique ? Mais a-t-on le droit d’ignorer les imaginaires sous le prétexte qu’ils sont imaginaires ?
La genèse des imaginaires de l’au-delà
(i) Plusieurs processus sont mobilisés pour dessiner, ici et ailleurs, ces aux-delàs. Dès l’instant où l’homme a su parler, la mémoire a cessé d’être individuelle ; elle a pu circuler d’un individu à l’autre. Dans un monde d’oralité, elle demeure cependant fragile. Rien ne nous assure que ce qui est advenu avant nous et avant les aînés dont nous avons reçu nos acquis a réellement eu lieu : on passe du domaine du mémoriel (ce pour lequel nous disposons de témoignages de première main) à l’immémorial (ce qui nous parvient d’un autrefois dont les dates et les protagonistes sont flous, mais qui bénéficie de l’autorité de ceux qui ont eu accès à la tradition avant nous). Ce qui nous parvient a été repris, réinterprété, reconstruit par les intermédiaires qui l’ont transmis. Il est composé de récits qui nous parlent d’un monde différent : les aborigènes australiens (Elkin, 1967) le qualifiaient de temps du rêve, une époque où évoluaient des êtres d’une autre stature et d’une autre puissance que les nôtres. C’était aussi le temps du mythe, celui de récits qui donnaient un sens au monde. On prêtait à ceux-ci une force et une consistance supérieures à celles dont jouissait ce que l’on voyait autour de soi.
Le temps de l’immémorial et du mythe est-il révolu ? Non, dans la mesure où l’imitation et l’oralité constituent toujours des composantes essentielles de la vie collective. À côté de l’histoire patiemment reconstruite à partir des témoignages que nous fournissent sur le passé l’écriture et l’archéologie, le passé mémoriel prolongé dans l’immémorial ne cesse de se recréer. Le temps du mythe n’est pas mort. Nous avons vu comment, entre le XVe et le XVIIIe siècles, les architectes puis les théoriciens du contrat social avaient tiré parti de ses propriétés pour justifier leurs interprétations. En multipliant les possibilités de transfert sans contrôle des informations, le monde postmoderne lui offre une nouvelle jeunesse : ne vivons-nous pas à une ère de post-vérité où les fake news multiplient les possibilités d’affabulation et de constructions délirantes ?
(ii) L’écriture ouvre une autre voie à la construction des imaginaires du second type. Un Dieu tout-puissant qui siège à la fois partout et dans l’au-delà du ciel fait connaître la Loi que doivent suivre les hommes et la transmet à un personnage qui la diffuse : aux religions de l’immémorial du temps du mythe se substituent celles de la Révélation que permet l’écriture. Le schéma varie quelque peu : Iaweh est le seul à graver lui-même de son doigt la loi dans la pierre. Dans le cas le plus général, le Dieu unique inspire des songes ou dicte un texte à un prophète, qui les rend publics par la parole et par l’écrit. Pour les Chrétiens, la vérité a été transmise par le Fils de Dieu fait homme ; le message a été repris par ses disciples : ceux-ci ont rédigé les Évangiles qui en portent témoignage.
Les autres mondes qui nous sont connus à travers la Révélation diffèrent en certains points de ceux qui naissent de l’immémorial. Ils prescrivent des commandements et imposent aux hommes un dogme auquel ils doivent adhérer, alors que dans les formes antérieures de religiosité, c’était à travers des récits sans cesse réinventés (des mythes) et des pratiques (des rituels) qu’était réalisé l’accès à l’autre monde qui éclairait le nôtre.
L’opposition entre les religions de l’immémorial et du mythe et celles de la Révélation recouvre en gros celle qu’établit Harvey Whitehouse (Whitehouse, 2004) entre le mode de religiosité spectaculaire et celui qui est doctrinal
(iii) La construction d’autres mondes imaginaires peut suivre des voies qui ne sont pas religieuses au sens classique du terme, même si elles aboutissent à doubler le monde réel d’un monde pensé plus profond et plus vrai.
Dans le mythe de la caverne, Platon décrit des prisonniers enchaînés dans une grotte où ils ne voient du monde que les ombres altérées et imparfaites qu’en renvoient des feux sur la paroi qui leur fait face. Tous les hommes ne sont-ils pas dans la même situation ? N’ont-ils pas l’illusion de connaître le monde, alors qu’ils n’en perçoivent qu’un reflet trompeur ? Par un effort de la pensée, les meilleurs esprits sont heureusement capables d’imaginer ce à quoi ils n’ont pas accès par l’expérience directe : le monde des idées, qui est fait de formes pures et inaltérables comme le sont les astres que nous découvrons dans le ciel.
Aristote ne retient de l’hypothèse platonicienne qu’un élément : celui selon lequel la raison humaine est capable de concevoir ce que nos sens ne nous révèlent pas ; il invente ainsi la métaphysique et ouvre à la pensée occidentale une voie nouvelle vers les espaces de Vérité – une voie rationnelle que les Pères de l’Église et la théologie médiévale combinent avec la foi chrétienne. Cela introduit dans le monde occidental un mode de religiosité inédit ailleurs, puisqu’il parle de Dieu sans s’appuyer sur la Révélation.
(iv) Nous avons vu comment, du XVe au XVIIe siècle, les Occidentaux ancrent leurs nouveaux aux-delàs dans des lieux de notre planète, mais inaccessibles : ils les situent dans un Âge d’Or du passé, dans une Terre sans Mal du présent ou dans une Utopie du futur ; ils les découvrent dans l’inconscient de l’économie, de la vie, du langage ou de la nature. Les sociétés qui y ont existé, qui y existent ou qui y verront le jour inspirent celles où nous vivons : elles sont à la base des idéologies, le nouveau système de croyances qui éclaire alors le futur (cf. supra chapitres 3).
Valeurs, institution du monde et ontologie spatiale
Les aux-delàs de l’immémorial, de la Révélation, de la Raison métaphysique ou des différentes formes qu’a revêtues l’idéologie depuis la Renaissance servent de modèles aux groupes humains et les dotent de valeurs qui guident et orientent leur action. Leur impact sur les conduites individuelles est évident – même si les recherches montrent que les hommes tirent souvent parti de la pluralité des modèles qui circulent et des interprétations qui en sont données pour se bricoler des horizons d’attente où ils concilient plus ou moins habilement les impératifs à respecter et leurs aspirations personnelles.
Ce sur quoi on insiste moins, c’est sur le rôle des valeurs au niveau des groupes eux-mêmes et de l’espace où ils vivent. C’est parce que le milieu où évoluent les hommes n’est pas un environnement neutre, mais qu’il est structuré par des valeurs partagées, qu’il est vraiment social ; aux réalités empiriques s’ajoutent celles que les sociétés instituent : elles substituent à l’être indéterminé qu’est le bébé qui vient de naître un individu social en lui donnant un nom et en lui faisant subir, à plusieurs moments de son existence, des rites de passage. Elle double l’espace empiriquement donné d’un espace social en procédant à des sacrifices ou des rituels de purification, et renouvelle ce processus lors de cérémonies qui reproduisent périodiquement les gestes inauguraux et reprennent possession de l’étendue par des rituels de déambulation. Elle socialise la nature en reconnaissant le caractère sacré des forces qui l’animent. Elle institue le temps en se dotant d’un calendrier que scandent des fêtes. Elle institue les structures collectives en donnant un statut officiel aux systèmes de relations qui unissent ses membres.
L’espace social qui est ainsi institué n’est pas uniforme : il y a des lieux où l’action humaine peut se déployer librement, et d’autres où se manifestent des forces avec lesquelles elle doit composer – celles de la nature, celles de certains êtres surnaturels, celles dont sont porteuses les âmes des morts. Il y a des lieux qui sont sacrés parce que des épisodes de l’histoire sainte s’y sont déroulés, que le Créateur s’y est manifesté, qu’il y a provoqué des miracles – ou parce que son Fils y a évolué ou que des saints y sont morts.
L’institution de l’espace superpose aux différences nées du relief, du climat et de la vie une différenciation normative qui y distingue de grandes plages uniformes, et des enceintes ou des lieux dont le statut est différent : à la différenciation naturelle s’ajoute ainsi une différenciation ontologique – celle dont parle Foucault lorsqu’il traite des hétérotopies, mais sans lui donner un nom.
Ce que révèle l’approche foucaldienne, c’est que l’institutionnalisation ne naît pas toujours de la présence en un lieu de forces supérieures qu’il faut respecter ; certaines hétérotopies sont reconnues par les sociétés instituées dans la mesure où elles constatent qu’il y a des attitudes, des façons d’être et des comportements contraires aux principes dont elles se réclament, mais qu’elles ne peuvent pas éliminer. D’autres naissent de groupes qui ne croient pas au même au-delà que la majorité – il en va ainsi des enclaves protestantes dans la société française que met en place l’Édit de Nantes. Elles peuvent également résulter de l’attrait dont bénéficient, dans une partie de la société, les forces profondes de la vie et du sexe : leur modèle n’est pas celui, kantien, d’un univers valorisé par la transcendance de l’esprit humain, mais celui, nietzschéen ou foucaldien, de collectivités ouvertes aux forces dionysiaques présentes dans la vie et le plaisir. C’est pour cela que les bourgeois vont s’y encanailler et que les artistes y puisent une inspiration qu’ils ne trouvent pas dans des milieux où l’exubérance de l’existence est bridée.
L’institution du monde et de l’espace ne se limite pas aux sociétés qui croient aux religions du mythe ou à celles de la Révélation. Les religions métaphysiques de l’Être suprême ont aussi leurs églises, leurs pèlerinages, leurs calendriers où elles célèbrent les grands hommes. Les idéologies qui structurent les États laïcs instituent leur espace en sacralisant le territoire national, les lieux où sont morts les héros qui l’ont rassemblé ou l’ont défendu, et les hommes et les femmes qui l’ont illustré. Elles doublent le baptême religieux de l’inscription à l’État civil, qui incorpore le nouveau-né à la société nationale, de la même manière que le mariage civil sacralise la cellule sociale de base qu’est la famille ainsi que le faisait, dans l’ordre religieux, l’union célébrée au temple ou à l’église.
Le refus de l’anthropologie culturelle américaine de la première moitié du XXe siècle de prendre en compte les valeurs morales des groupes l’empêchait, on le comprend, de pénétrer la logique profonde de leur organisation. L’approche culturelle rompt avec le tabou ainsi créé. L’espace, la société et l’individu sont à la fois empiriquement donnés et institutionnalisés.
Les processus culturels de communication/diffusion
Les processus que met en œuvre la culture contribuent à structurer l’étendue et le monde social. Ils sont de deux types : (i) de communication-diffusion et (ii) de distinction. Nous étudions les premiers dans ce paragraphe, les seconds dans le paragraphe suivant.
Les processus de transfert
Comme la géographie poststructuraliste, l’approche culturelle admet que l’essentiel de ce qui caractérise les comportements humains et la vie sociale n’est pas inné, mais relève de transferts. Elle présente une analyse plus fouillée du rôle des médias et de la formation de l’opinion.
La transmission des comportements, des attitudes, des savoir-faire, des connaissances et des croyances se fait par les sens et à travers les signes et les dispositifs techniques imaginés pour étendre leur domaine.
La culture est transmise d’individu à individu. Son transfert dépend à la fois des sens impliqués (la vue et l’ouïe surtout), de la place qui revient à l’imitation, de celle que prend la parole, des signes et des symboles qui servent à véhiculer les messages et des médias mobilisés pour conserver les éléments de culture et les diffuser à distance. La forme de la communication change également avec la position relative de ceux qui y participent : ils peuvent se trouver au même niveau ou occuper des rangs hiérarchiques différents.
Il faut être près des gens pour observer leurs gestes, copier leur comportement et entendre ce qu’ils disent. La transmission de la culture demeure locale tant que l’on ne dispose pas de signes pour coder les messages, les conserver et les acheminer au loin. L’invention de l’écriture modifie la situation : elle ajoute aux mémoires individuelles la mémoire objective des textes. Elle se prête bien à la transmission à distance des nouvelles, des ordres ou des connaissances abstraites, mais convient mal à celle des gestes et des savoir-faire. Les médias modernes permettent de conserver et de diffuser à toute distance la voix, l’image fixe et l’image animée aussi bien que l’écrit.
Dans les sociétés premières, c’est à travers l’observation que permet la vue et à travers l’écoute des sons, de la parole, des chants ou de la musique que se réalisent l’essentiel des transferts – auxquels s’ajoutent, mais dans une moindre mesure, l’odorat, le goût et le toucher. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne de ce que l’on observe ou que l’on écoute, les détails s’effacent, les formes deviennent floues, les sons s’atténuent puis deviennent inaudibles : il est difficile de lire un texte à plus d’un mètre, de comprendre quelqu’un qui ne force pas sa voix à plus de quelques mètres.
Dans les sociétés où domine l’oralité et en l’absence de migrations, le transfert des gestes, des attitudes et des connaissances n’est possible que sur place : la culture se transmet localement sans peine et sans déperdition, mais ne se diffuse pas d’un lieu à l’autre.
L’introduction de l’écriture ne fait pas disparaître l’oralité et les processus qui lui sont propres, mais elle permet à ceux qui maîtrisent la nouvelle technique de communiquer à distance et sans perte appréciable d’information tout ce qui peut se traduire en mots. Le texte a beaucoup de mal, en revanche, à assurer la transmission des gestes. Cela donne aux sociétés historiques (celles qui connaissent l’écrit, mais où celui-ci n’est encore maîtrisé que par des minorités) une structure duale : la plus grande partie de la population reste enfermée dans un monde d’oralité pure, fractionné en cellules locales où est assurée la transmission des attitudes, des pratiques et des savoir-faire indispensables à la vie locale et aux activités productives ; à l’inverse, la minorité qui sait écrire partage sur des surfaces très étendues les mêmes connaissances, les mêmes croyances et les mêmes techniques d’organisation sociale.
Les médias modernes bouleversent cette situation : l’enregistrement des images fixes, des images animées et des sons élargit brusquement le rayon où l’oralité et l’imitation des gestes et des attitudes deviennent possibles. La structure binaire des sociétés historiques est remise en cause, comme le signale l’apparition de sociétés de masses.
L’inertie propre aux modes d’expression
La transmission des informations met en jeu des codes, des systèmes de signes et des discours qui contribuent à donner une certaine inertie aux contenus véhiculés. Cet aspect des dynamiques des savoirs géographiques a particulièrement retenu l’attention de Vincent Berdoulay (Berdoulay, 1988 ; 2000). Pour lui, il éclaire les continuités souvent sous-estimées de l’histoire de la discipline, comme le rappelle Nicholas Entrikin :
« Berdoulay souligne la persistance des structures descriptives en géographie plutôt que des révolutions liées à la succession des paradigmes. Au lieu d’examiner la question de savoir pourquoi un point de vue devient dominant à un certain moment, il examine les qualités plus constantes du discours géographique en se demandant comment des formes spécifiques de pensée gardent leur importance en dépit des changements intervenus dans le langage de leur expression et grâce aux stratégies rhétoriques qui persuadent l’auditoire de leur signification » (Entrikin, 1991, p. 444-446).
L’inertie des modes d’expression n’atteint jamais le niveau que lui supposait Foucault lorsqu’il faisait de l’entité mystérieuse que constitue l’énoncé la pièce maîtresse des formations discursives sérieuses auxquelles il s’attachait. Mais les jeux de la domination peuvent naître aussi des dispositifs à l’œuvre dans la communication.
L’élaboration des opinions publiques
Les processus de transmission des pratiques, des savoirs et des croyances sont dans une large mesure dissymétriques : l’approche poststructuraliste les rend responsables de la formation des matrices de domination qui jouent, selon elle, un rôle essentiel dans le domaine de la communication. L’approche culturelle ne les ignore pas, mais souligne le rôle d’autres processus.
Les échanges de nouvelles ou d’informations sont, dans une large mesure, dialogués. Ce qui est transmis alimente les propos que l’on tient. D’autres personnes y répondent, acceptent ce qui vient d’être dit, le retouchent ou le contredisent. Une discussion naît ainsi. Les positions initiales des uns et des autres se modifient : une opinion publique se forme dialectiquement.
L’élaboration de l’opinion publique est active dans les sociétés d’oralité car les rencontres qu’y font les gens se déroulent souvent entre égaux. Cette possibilité demeure dans les milieux populaires des sociétés historiques, où les hommes se réunissent pour jouer, causer ou boire, et où les femmes se retrouvent au lavoir et pour accomplir d’autres tâches. Elle disparaît dans leur composante fondée sur l’écriture car la transmission y est souvent unilatérale, n’autorise pas de réponse, crée ainsi des situations inégales et diffuse surtout des règles ou des commandements : elle conduit ainsi à la mise en place de croyances standardisées plutôt qu’à la formation d’opinions publiques.
Ces dernières reparaissent, mais sous une forme nouvelle, avec l’invention de l’imprimerie et la mise en place de services postaux efficaces. Une élite de gens instruits se rencontre dans les cafés et entretient des relations avec des correspondants souvent lointains. Un dialogue oral ou écrit se développe. De la discussion naît une opinion publique – ou une pluralité d’opinions publiques. La presse en diffuse les résultats : les discussions qui ont pris place en haut lieu éclairent les simples citoyens, leur offre des choix et les conduit à se rallier à tel ou tel propos. La naissance de ces processus de formation des opinions publiques rend possible, à partir du XVIIIe siècle, le fonctionnement de démocraties dans des pays étendus et aux populations nombreuses.
Les révolutions des médias modernes, celles de l’Internet et du téléphone portable en particulier, bouleversent la situation. Il devient possible à quiconque de dialoguer avec des gens situés à l’autre bout de la planète. Aucun filtrage n’existe, aucune formation spécifique et aucune compétence reconnue ne sont requises pour participer aux discussions. Les cercles où se créent les opinions foisonnent, mais sans les garanties qui résultaient de la maîtrise de l’écrit et du contrôle de l’exactitude des informations par les éditeurs d’ouvrages ou lesf directeurs de publication. Des formes d’opinion publique élaborées sans aucun contrôle submergent le monde depuis une génération, mettent en péril le fonctionnement des démocraties et conduisent à la multiplication des fausses nouvelles, à la floraison des communautarismes, à la poussée des populismes et à l’implosion des sociétés modernes.
La lecture que l’approche culturelle donne des processus de transfert des informations est ainsi beaucoup plus riche que celle qui prévaut chez les poststructuralistes. Pour elle, trois stades se sont succédé au cours de l’histoire : l’âge du cloisonnement culturel des sociétés premières, celui de la juxtaposition oralité/écrit des sociétés historiques et celui du décloisonnement général qu’autorisent les médias.
Les processus de distinction/identification
Il existe une seconde grande famille de mécanismes culturels : ceux qui poussent certains à s’identifier à un groupe et à se différencier des autres. Souci de fusion, d’intégration, de mimésis d’un côté, volonté de se distinguer de l’autre.
Un accord existe aujourd’hui sur le fait que la construction des sentiments d’identité est un processus fondamentalement subjectif. L’humanité est diverse, mais le fait de considérer tel ou tel trait comme discriminant est un fait de culture. Pour se faire admettre dans un groupe avec lequel on a des affinités, on est amené à mettre l’accent sur ce qui le différencie des autres. Des stéréotypes se forment ainsi et finissent par faire de celui qui est différent un étranger, un ennemi parfois. Le constructivisme refuse tout autre type d’interprétation des processus de distinction.
L’approche culturelle n’ignore pas le rôle des matrices de domination auxquelles peut mener la quête d’identité et le besoin de s’opposer aux autres, mais elle souligne que ce processus est plus complexe.
La distinction comme affirmation de l’excellence
La recherche de la distinction a un versant qu’ignore le poststructuralisme : elle pousse à se différencier de l’autre pour le surpasser, et non pour s’opposer à lui ; elle instaure un processus de compétition, et pas d’exclusion. On cherche à se distinguer des autres en faisant mieux qu’eux dans le domaine qu’ils privilégient. Dans une société religieuse, la distinction résulte d’une foi plus profonde, d’un respect plus pointilleux du dogme ou d’une plus large générosité ; dans un groupe dominé par un idéal militaire, on s’affirme en pratiquant les arts martiaux, en se préparant au combat et en faisant preuve d’héroïsme ; dans un contexte qui valorise la sensibilité artistique, on ne se contente pas de communier dans l’amour du beau ; on apprend à le créer ; là où les compétences intellectuelles sont placées au-dessus de tout, il importe d’aller au-delà de la maîtrise des savoirs déjà acquis ; il convient de les élargir. La recherche de la distinction met ainsi au premier plan, et selon les cas, le saint, le héros guerrier, l’artiste ou le chercheur.
Quel but poursuit ainsi celui qui a la volonté de se distinguer ? Cherche-t-il à rompre avec les autres, à les rejeter, à les exclure ? Pas du tout ! En répondant mieux qu’eux à des critères d’excellence qu’ils partagent, il s’impose à eux par le prestige. Il n’exerce pas sur eux de pouvoir ; il jouit simplement d’un statut reconnu par les autres ; il exerce ainsi sur eux de l’influence et une certaine forme d’autorité.
Norbert Elias (Elias, 1969 ; 1974 ; 1976) a souligné, il y a déjà trois quarts de siècle, comment les sociétés qui connaissent ce type de compétition sont entraînées dans une spirale de civilisation des mœurs. Dans le même temps, elles donnent un sens à la vie des individus, qu’elles insèrent dans un processus d’accomplissement.
Comme le souligne Bernard Lahire (Lahire, 2004), les conditions dans lesquelles se développent les processus de distinction changent dans un monde contemporain où l’offre culturelle est devenue pléthorique. Les modèles qui s’offrent à l’individu sont multiples. Dans le domaine religieux, il peut rester fidèle aux formes traditionnelles des religions du mythe ou de la Révélation, opter pour leurs versions revues par les fondamentalismes, préférer les sectes qui diversifient leurs crédos ou choisir les formes de militantisme associées aux religiosités idéologiques, qu’elles soient associées à l’idée de progrès ou au respect de la nature. L’individu moderne papillonne souvent d’un itinéraire à l’autre, dans une trajectoire composite qui n’exclut pas l’accomplissement mais en associe plusieurs formes.
La distinction comme volonté de dépassement
La recherche de l’excellence peut aussi avoir un caractère subversif : elle débouche sur la construction de l’altérité, mais l’autre n’est plus celui qui rejette certaines valeurs, mais celui qui est incapable d’y adhérer complètement.
Nathalie Heinrich (Heinich, 2005) décrit ainsi comment l’élite artiste se détache de la bourgeoisie et des masses populaires dans les régimes démocratiques du XIXe siècle et du premier XXe siècle en affirmant sa capacité à renouveler les formes de l’art dans la course en avant qu’engage la modernité : ce groupe doit sa position hors du commun à sa sensibilité aux nouvelles émotions et aux nouvelles esthétiques que le progrès fait émerger dans les formes qui nous entourent. C’est parce que la démocratie de l’époque est méritocratique qu’elle fait de l’excellence un critère discriminant.
Dans le même temps, les élites intellectuelles se distinguent des masses en percevant avant elles les formes que la société est en train de prendre et en concevant les actions politiques nécessaires pour les gérer : à l’élite artiste correspond ainsi une élite intellectuelle qu’ignore la théorie des classes, mais qui joue un rôle clef dans la course au progrès.
Nathalie Heinich (Heinich, 2012) a plus récemment montré qu’un autre processus est en œuvre dans les sociétés médiatiques qui ont succédé aux sociétés méritocratiques du XIXe siècle et de la première moitié du XXe. Dans le monde actuel, ce n’est plus parce qu’il détecte de nouvelles formes du beau ou de nouvelles conceptions de l’esthétique que l’artiste s’impose, mais parce qu’il sait manipuler les institutions artistiques qui valident les œuvres et qu’il bénéficie de l’appui des médias qui les font connaître : il réussit ainsi à attirer l’attention sur son œuvre. Celle-ci ne se distingue plus des autres par son excellence, mais par sa visibilité.
La même évolution est en cours dans le domaine politique. Le temps de l’intellectuel qui domine la scène politique en décryptant les voies nouvelles que doit revêtir le pouvoir dans un monde qui change est passé. Le leader qui s’impose est un gourou qui tire parti des sensibilités populaires qui s’expriment sur les réseaux sociaux et sait manipuler les nouveaux médias pour attirer l’attention du public sur son programme. Ce n’est plus par les idées qu’il défend que s’impose le leader populiste, mais par la visibilité qu’il est capable de s’assurer.
La dynamique de la distinction n’est pas seulement responsable de la civilisation des mœurs. Qu’elle repose sur l’excellence ou sur la visibilité médiatique, elle explique mieux que les approches fonctionnalistes les dynamiques du monde contemporain. On reste formellement en régime démocratique, mais on est passé de leur variante méritocratique à leur variante populiste.
La quête de statut :
une des trois formes de la compétition sociale
Les sciences sociales ont toujours pris en considération le jeu de la compétition pour la richesse ou le pouvoir dans la vie des groupes qu’elles étudiaient. Les géographes, les économistes ou les politologues s’intéressaient peu, en revanche, à la place que tenait la quête du statut et du prestige. Il en allait autrement des anthropologues et des historiens de l’Antiquité et du Moyen Âge : dans des sociétés où l’économie n’avait pas encore conquis son autonomie vis-à-vis des autres secteurs de la vie sociale et où les jeux de la politique étaient largement symboliques, ils étaient conduits à s’attacher à la place faite à l’honneur, à la réputation, à la gloire ; le pouvoir n’était pas seulement lié à la force des armées et à la prospérité de l’économie ; il provenait largement de l’autorité que le souverain devait à la dimension symbolique de son rôle, au faste qu’il déployait et au luxe dont il s’entourait.
Ce que la recherche récente montre, c’est que les processus en jeu dans les sociétés contemporaines continuent à reposer largement sur la quête de prestige, de considération et de visibilité. Cela conduit à revoir de fond en comble l’approche de la modernité.
Compétition sociale et accomplissement
Les êtres humains parcourent des trajectoires très variées. Certains passent toute leur existence dans un même lieu, se consacrent parfois dès l’enfance aux mêmes tâches et disparaissent sans avoir disposé d’un moment de repos. D’autres sont mobiles, voyagent volontiers, changent de domiciles, migrent, glissent d’un emploi à l’autre. Tous traversent des périodes difficiles : disettes ou famines dans le monde traditionnel, catastrophes naturelles en tout temps, guerres, périodes d’insécurité…
Certains ont dès l’enfance un projet de vie qu’ils réalisent peu à peu. D’autres en changent lorsque les circonstances les y forcent ou parce que leurs croyances se modifient au contact d’autres personnes, à la lecture de textes, en écoutant des cours ou des conférences. Les trajectoires sont alors faites de segments qui se succèdent, mais qui ne sont pas orientés de la même façon et n’apportent les mêmes peines ou les mêmes satisfactions à ceux qui les vivent.
La mémoire crée cependant un lien entre tous ces moments. En se retournant sur leur passé, hommes et femmes le jugent. Ils attendent des autres qu’ils reconnaissent ce qu’ils sont et ce qu’ils ont fait. Malgré les rebonds et les changements d’orientation de leur existence, ils trouvent une certaine cohérence à leur parcours. Ils jugent de leur existence en termes d’accomplissement.
Les géographes ne peuvent rester indifférents à ces retours sur soi, à ces moments de doute, aux résolutions qui sont alors prises. Les hommes considèrent que leur vie a un sens, même si ce n’est pas toujours celui que prescrivent les règles officielles. Ils ont assimilé ce que leur offraient leurs parents, leurs proches et des cercles plus éloignés de relations. Ils ont joué les rôles qu’impliquaient leur naissance, leurs activités ou leurs responsabilités – ou se sont débrouillés pour les esquiver. Ils ont joui de ce que leur apportaient leurs sens ou ont trouvé des satisfactions d’un autre ordre dans le devoir accompli et la rigueur morale.
À leur mort, ils ont souvent le souci de laisser sur terre une trace tangible de leur passage : une tombe ou une stèle qui rappelle leur passage en ce monde, les maisons qu’ils ont construites ou des monuments qui rappellent à tous leur grandeur, leur puissance – et pour d’autres, leur sainteté ou leur œuvre artistique ou intellectuelle.
La préoccupation que partagent ainsi la plupart des hommes de vivre leur existence comme un accomplissement se traduit dans les paysages et dans l’organisation de l’espace. C’est un domaine longtemps négligé par les sciences humaines et par la géographie. Le tournant culturel le met à la mode. Il apprend aussi que, sans le théoriser, de nombreux chercheurs du passé étaient conscients de son importance et lui consacraient des travaux.
L’approche culturelle remodèle l’ensemble
de la géographie
L’approche culturelle ne se contente pas de mieux intégrer que ne le faisaient la géographie classique et la Nouvelle Géographie la dimension culturelle de la réalité humaine dans ses interprétations. Elle impose une refonde complète de la discipline.
L’optique fonctionnaliste qui prédominait jusque dans les années 1960 avait conduit à y distinguer trois grandes composantes : la géographie économique traitait de ce qui touchait à l’échange des biens et des services et à la compétition pour la richesse qui en résultait ; la géographie politique était axée sur les faits de pouvoir, mais sans en préciser toutes les modalités ; elle insistait sur les luttes qui en résultaient ; la géographie sociale soulignait enfin la place que tenait les hommes dans la stratification en classes des groupes où ils vivaient, mais elle voyait en celle-ci une conséquence des confrontations résultant de la quête de la richesse ou du pouvoir ; elle ne constituait pas un secteur autonome, à la différence des deux premiers. La géographie prenait également en considération les faits de culture, mais en ne retenant que leur traduction matérielle, si bien que ce domaine restait un parent pauvre de la géographie classique ; un certain nombre de théoriciens de la Nouvelle Géographie estimaient que la rationalisation de l’action humaine résultant du progrès finirait par la rendre inutile.
La géographie s’attachait par ailleurs à la différenciation de la surface terrestre. L’approche régionale décrivait ses dimensions naturelles et humaines. Elle mettait en évidence deux grands types de paysages humanisés, les campagnes et les villes.
L’approche culturelle bouleverse cette ordonnance. Les domaines économique et politique ne sont jamais totalement autonomes : la quête de richesse et celle de pouvoir n’ont pas uniquement pour but de dominer les autres et de les exploiter ; elles n’excluent pas le souci du statut et de la considération, qui sont au fondement de la compétition culturelle. La géographie économique doit donc prendre en compte des faits jusqu’alors négligés : les motivations de la demande ne sont jamais purement utilitaires ; elles sont toujours exprimées en termes culturels, ce qui explique en bonne partie leur élasticité ; la production est le fait d’entreprises dont la motivation ne se résume jamais totalement à la quête de profits, car ceux qui y travaillent ont également le souci de s’assurer un statut avantageux ; à partir d’un certain niveau de revenu, ils diversifient leurs objectifs et investissent les champs de l’action sociale et de la charité ou se lancent dans la compétition pour le prestige.
Dans la mesure où le pouvoir ne résulte jamais seulement de l’usage de la violence ou de la menace qu’elle fait peser, la géographie politique ne se résume pas à l’étude des jeux de la force et de la puissance : la domination naît aussi de l’exploitation économique et du jeu idéologique de l’influence. Aux civilisations dont les États souverains coiffent des sociétés civiles s’opposent celles où le pouvoir s’exerce à travers des formes décentralisées de relations institutionnalisées (Claval, 1980) : sociétés de castes (Dumont, 1966), d’ordres ou de clientèles. Comme l’a montré Pierre Clastres (1974), les sociétés premières étaient généralement construites contre l’État et les inégalités qu’il faisait naître.
La géographie sociale était la parente pauvre de la géographie classique comme de la Nouvelle Géographie, dans la mesure où on ne lui reconnaissait, au sein monde moderne, que des bases sociales et économiques, celles qui s’exprimaient à travers les structures de classes – structures qui ignoraient ceux qui assuraient la légitimité des institutions et du pouvoir ou mettaient en doute leurs bases : les clercs d’autrefois et les intellectuels d’aujourd’hui. L’approche culturelle double l’analyse socio-économique ou socio-politique qui dominait jusqu’alors d’une analyse socio-culturelle, qui souligne le rôle de la compétition pour le statut et de la recherche de la reconnaissance et du prestige dans la vie collective.
La géographie culturelle n’apparaît plus comme un fourre-tout où l’on rangeait tout ce dont ne parvenait pas à rendre compte l’approche fonctionnaliste. Elle n’est plus centrée sur les traces matérielles de l’activité humaine, mais sur les activités mentales qui la guident, qu’elles mettent en jeu la raison ou l’imagination. Elle fait le départ entre ce qui revient à ces deux domaines, s’attache aux imaginaires et souligne leur dualité. Des travaux menés jusqu’aux années 1960, elle garde, comme le souligne Jean-Marc Besse (Besse, 2018), un souci essentiel : celui de montrer comment les jeux de l’esprit humain se combinent avec les forces du vivant, avec la corporéité des femmes et des hommes et avec les pesanteurs de la matière pour modeler l’espace.
Les transformations récentes de la planète entraînent la remise en cause d’oppositions comme celle des villes et des campagnes. Elles conduisent à une nouvelle appréhension de l’espace.
L’espace de l’approche culturelle
L’approche culturelle ne réfute pas plus la dimension régionale qu’avait prise la géographie classique que l’attention portée aux réseaux et à la centralité par la Nouvelle Géographie. Elle note ce en quoi elles répondaient aux curiosités d’une époque, reflétaient les préceptes de méthode qui s’imposaient alors et répondaient aux intérêts des pouvoirs qui y étaient en œuvre. La lecture qu’elle offre du monde et de la société la conduit à réinterpréter ces acquis selon une perspective jusque-là négligée.
1. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, les élites intellectuelles dont faisaient partie les géographes se donnaient la responsabilité d’éclairer le pouvoir sur les conditions que faisait naître le progrès : la géographie classique enseignait que la mise en valeur de la terre reposait sur la connaissance et la mise en œuvre de ses ressources – sur sa fertilité. Dans le monde dont l’industrialisation et l’urbanisation s’affirmaient rapidement au milieu du XXe siècle, la Nouvelle Géographie attirait l’attention sur les réseaux, les lieux qu’ils desservaient et dont ils assuraient l’accessibilité, et les aires centrales qui attiraient par les facilités qu’elles offraient à la production et à la distribution de masse.
2. Dans sa version humaine, la Nouvelle Géographie, ajoutait à l’appréhension des réseaux de transport et de communication ceux que tissaient les hommes entre eux dans le cadre des relations qu’ils institutionnalisaient. L’approche culturelle systématise cette perspective puisqu’elle insiste sur la double nature, empirique et instituée, de l’espace social. Elle met ainsi en évidence les différences ontologiques caractéristiques de certaines familles d’espaces.
Par opposition aux étendues banales où le monde est tel que l’observateur le perçoit, les lieux ou les aires où affleurent dans notre monde des entités immanentes ou transcendantes sont perçus comme sacrés. Ils le sont de manière permanente ou de manière discontinue, à l’occasion des fêtes et de cérémonies qui font renaître des forces supérieures dans des localités qu’elles avaient désertées. Dans les sociétés de l’immémorial et du mythe, la nature, avec sa puissance renouvelée de vie et sa fondamentale immanence, se trouve totalement sacralisée et enchantée. Les religions révélées la banalisent et ne sacralisent l’espace que là où le Dieu suprême a fait connaître son message aux hommes et là où se déroulent les cérémonies qui réactualisent cet évènement ou en entretiennent la mémoire : pour les catholiques, il s’agit de l’église au moment de la consécration des espèces, le pain et le vin, qui les transforme en chair et en sang du Christ et reproduit la Cène ; chez les calvinistes, le Seigneur est parmi les fidèles lorsqu’ils sont assemblés pour prier et chanter en son nom.
Les formes de religiosité idéologique bannissent toute référence à un principe supérieur et à un ordre qui ne serait pas celui de l’empirie, mais elles en réintroduisent des équivalents en transformant en monuments les lieux où s’exercent les formes de relations institutionnalisées qui ont trait au pouvoir, à la connaissance et à l’art. Elles sacralisent le peuple dans la mesure où il est souverain, le territoire qui lui revient et les lieux où sont tombés ceux qui ont combattu pour le protéger ou le libérer.
Quelles que soient les formes de religiosité, les sociétés partagent la particularité d’institutionnaliser non seulement les formes de relations qui permettent aux valeurs qu’elles prônent d’être mises en application, mais celles aussi qui, en contradiction avec les normes officielles, sont néanmoins jugées nécessaires à leur fonctionnement – à savoir les hétérotopies que constituent les prisons, les goulags, les asiles, les quartiers réservés, mais aussi les espaces réservés à la mort.
3. L’espace est culturellement différencié par les dynamiques de transfert des informations qui le caractérisent, oralité ici, oralité plus écriture ailleurs, oralité, écriture et médias modernes pratiquement partout aujourd’hui. Les conditions de transmission des pratiques et des savoir-faire d’une part, des connaissances et des croyances de l’autre diffèrent selon que l’oralité est seule présente, que l’écriture se combine à celle-ci, où que les médias assurent enfin à certaines composantes de l’oralité une diffusion aussi facile – ou plus facile – à toute distance que ne le fait l’écriture.
L’approche culturelle admet que la transmission non verbalisée des pratiques et des savoir-faire d’une part, et celle des formations discursives de l’autre, peuvent générer des formes de domination qui uniformisent de vastes étendues ou se manifestent de manière discontinue lorsque les processus de transmission se modernisent, mais elle ne considère pas que ce soit là un cas général : ce qui est transmis contient la possibilité de recombiner les codes, de créer du neuf et d’échapper au moins par la pensée à ce qui est imposé.
L’échange d’égal à égal conduit, par confrontation, à la formation d’opinions publiques ; leur rôle, toujours important dans les sociétés d’oralité, se trouve réduit lors des premières phases de la diffusion de l’écrit. Leur importance renaît au sein des milieux cultivés à partir du XVIIIe siècle ; elles éclairent dès lors les choix de populations nombreuses et les font accéder à une première forme de vie démocratique, celle qui repose sur la méritocratie.
L’absence de tout contrôle de contenu et l’anonymat qui caractérisent les réseaux sociaux du monde contemporain démultiplient les opinions qui s’élaborent aujourd’hui ; elles mettent en péril le fonctionnement des formes traditionnelles de la démocratie occidentale et favorisent l’apparition de démocraties participatives – livrées, en fait, à des minorités agissantes – ou de régimes populistes.
4. Les processus liés à la recherche de la distinction peuvent aboutir à la construction de l’altérité et, dans nombre de cas, au rejet de l’autre. Lorsqu’ils conduisent à une compétition pour l’excellence, leurs effets sont différents. Ils mènent souvent, comme l’a montré Elias, à la civilisation des mœurs, d’une part, et à la recherche de la reconnaissance par autrui, de l’autre. Les gagnants qui s’imposent dans cette course sont respectés et jouissent d’un statut qui leur assure prestige et influence. À la compétition pour le pouvoir et pour la domination économique qui était au cœur de l’approche fonctionnelle, l’approche culturelle ajoute celle pour le statut.
Celle-ci prend une signification différente lorsqu’elle vise à l’excellence artistique ou intellectuelle dans les méritocraties, ou lorsqu’elle vise à la visibilité dans les sociétés médiatiques du monde actuel. L’élite artiste du XIXe siècle fortifie sa position en fondant son expertise sur la définition avant-gardiste de formes émergentes ; l’élite intellectuelle fait de même en définissant les règles que doit revêtir la vie politique dans le monde que transforment l’industrialisation et l’urbanisation.
Dans le monde médiatique contemporain, l’élite artiste construit sa prééminence sur la connivence avec les ministères de la culture, les musées, les mécènes, les banques et les médias pour s’assurer la première place dans la lutte pour la visibilité. Dans le domaine politique, le nouveau leader ne bâtit plus sa clientèle sur la cohérence de son programme, mais sur son aptitude à capter les formes de croyances qui s’imposent sur les réseaux sociaux et retiennent facilement l’attention des électeurs.
À travers ces transformations, l’approche culturelle met le doigt sur des processus que l’approche poststructuraliste ignore : (i) la recherche de l’influence artistique ou politique à travers la poursuite de la visibilité qu’assure l’excellence dans les méritocraties du XIXe siècle et du premier XXe siècle ; (ii) la quête de visibilité médiatique pour l’élite artiste qui joue de ses connivences pour imposer des critères arbitraires dans son domaine, comme pour les nouveaux leaders politiques qui surfent sur les croyances que véhiculent les réseaux sociaux pour bénéficier des votes populaires et saper les formes méritocratiques de la démocratie.
La géographie classique analysait l’espace dans la perspective de son inégale fécondité ; la Nouvelle Géographie mettait l’accent sur l’inégale accessibilité de ses composantes. L’approche culturelle souligne la variété qu’il doit aux processus de diffusion et à la compétition pour le statut. Elle signale, dans le monde moderne, le poids croissant de la recherche de visibilité : une visibilité assurée par les instances qui jugent de l’excellence de l’art et de la pensée pour le monde moderne; une visibilité qui réfute la sélection selon des critères de qualité, et repose sur la manipulation des réseaux sociaux dans le monde postmoderne – une manipulation inégalement facile selon les lieux, les modes qui président à leur lancement et les équipements qui facilitent la diffusion instantanée et universelle des informations ; une visibilité depuis longtemps élargie par l’écrit et qui devient planétaire avec les médias actuels.
L’approche culturelle éclaire les dynamiques sociales, leurs composantes religieuses et idéologiques aussi bien que celles qui s’ancrent dans la compétition économique et les luttes politiques. En prêtant attention aux espaces supra ou infra-terrestres des imaginaires prescriptifs, elle fait comprendre comment s’opère la différenciation ontologique de la surface terrestre, souligne le poids des représentations dans le façonnement de la terre et montre que la discipline gagne à combiner le souci scientifique de la rigueur des sources et des raisonnements, et ce que l’humanisme érudit apporte à la compréhension des sociétés humaines.