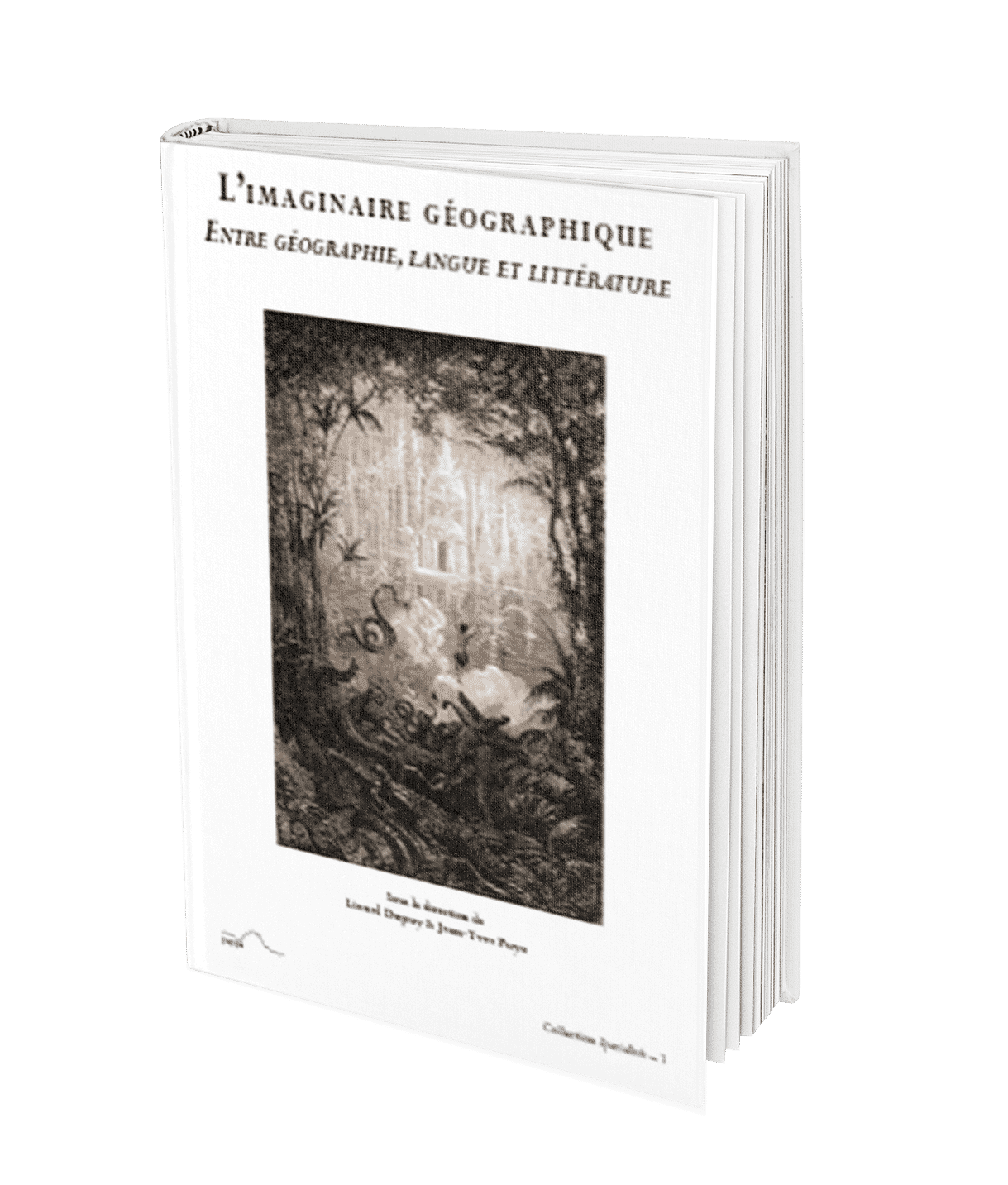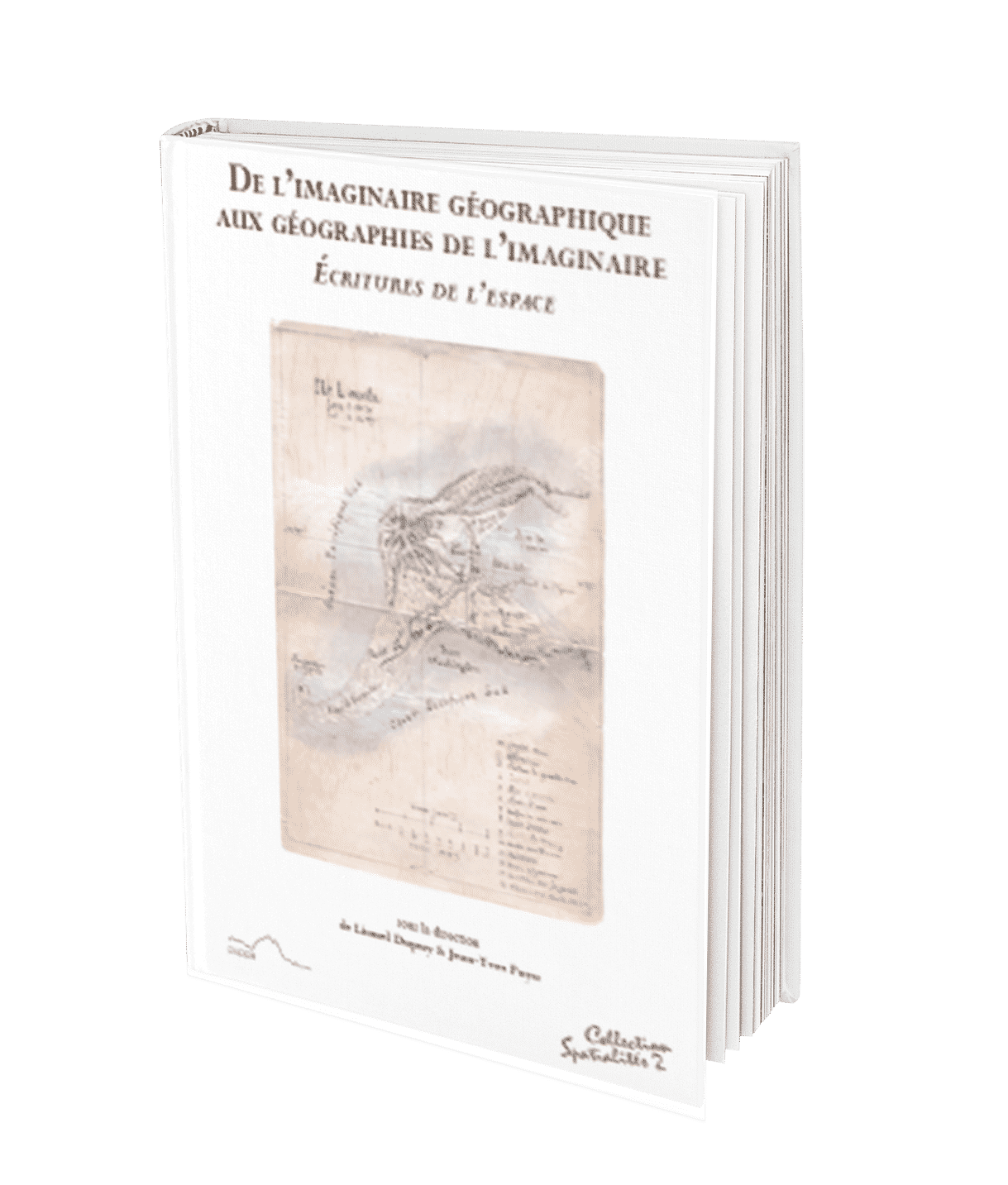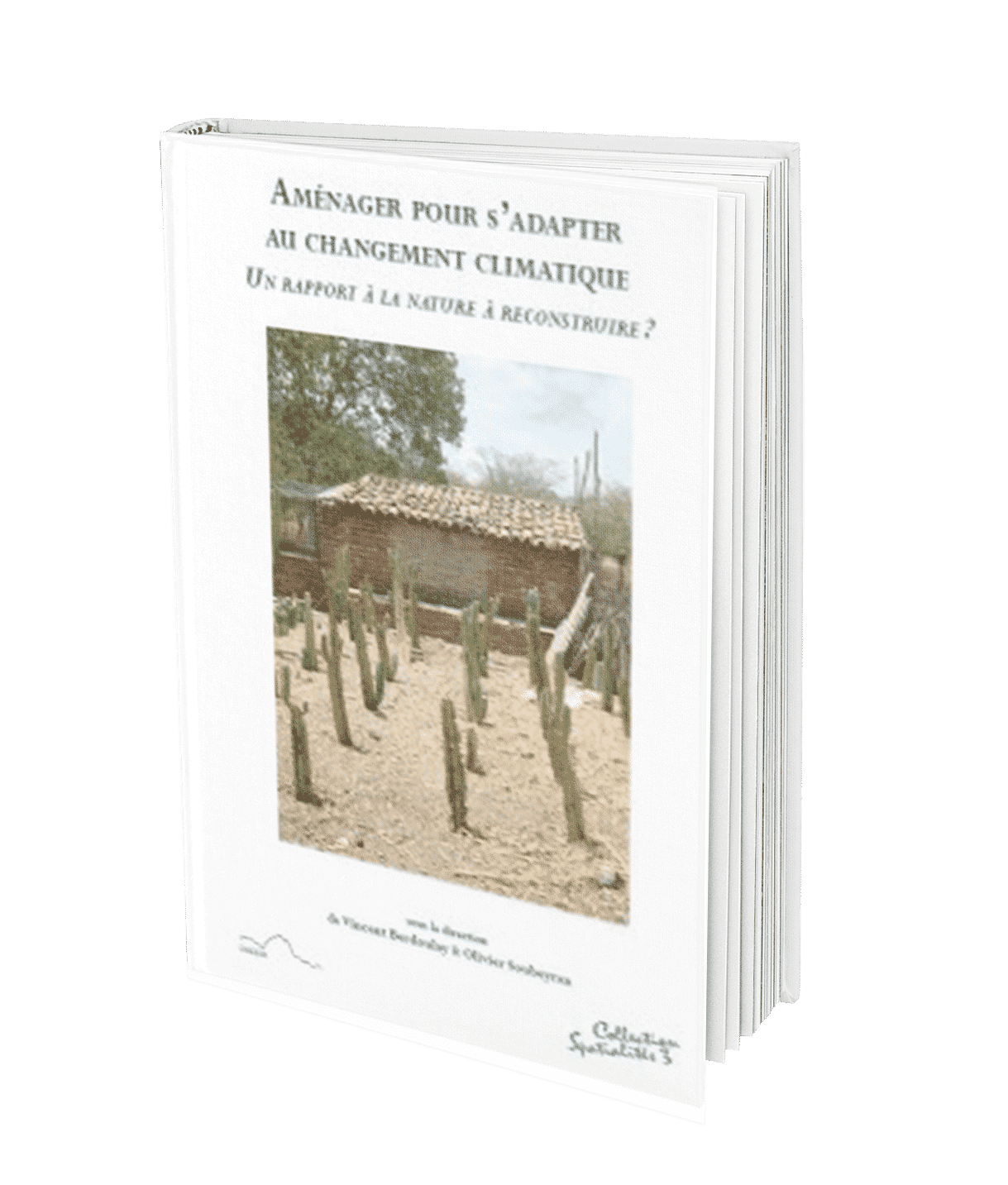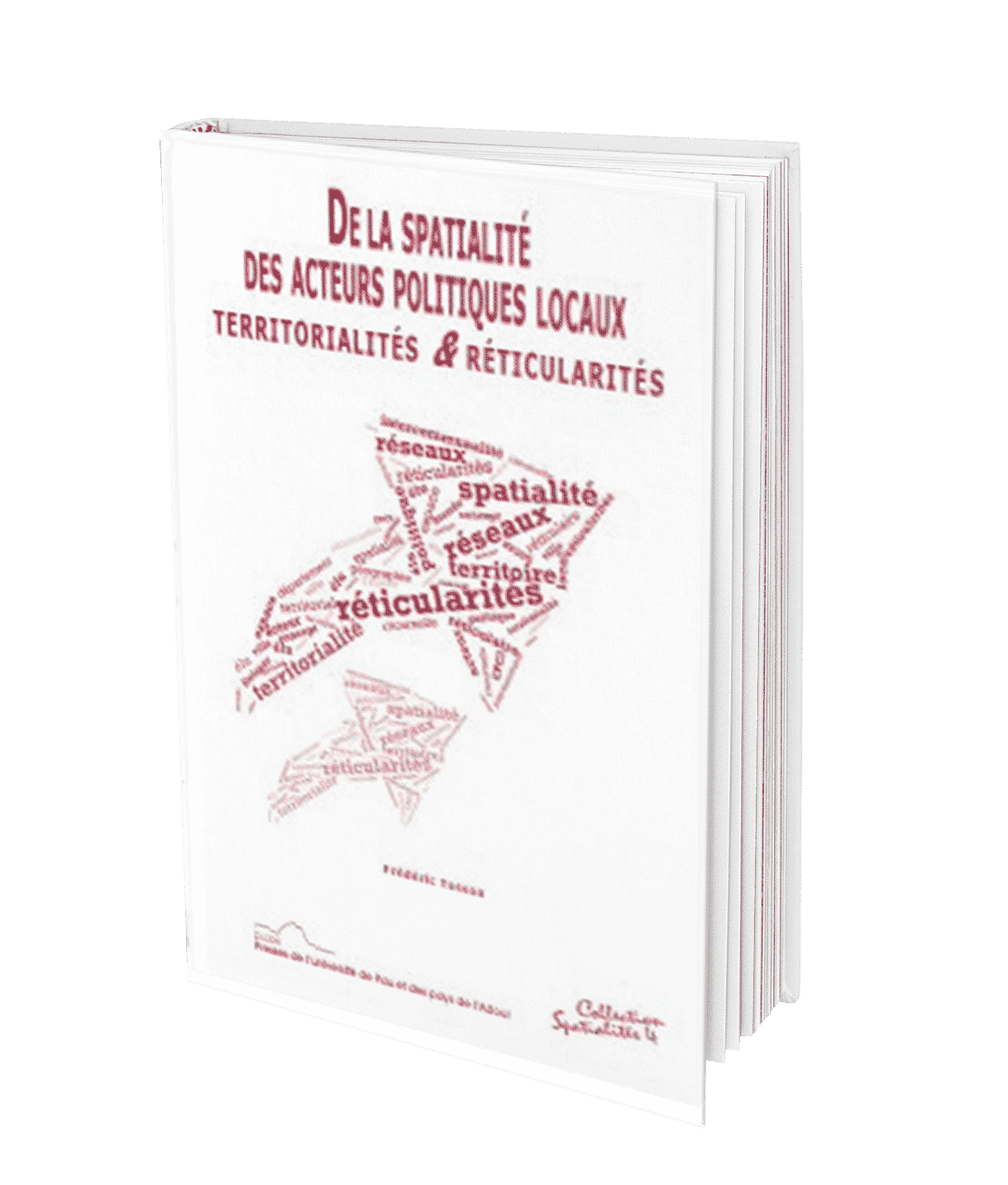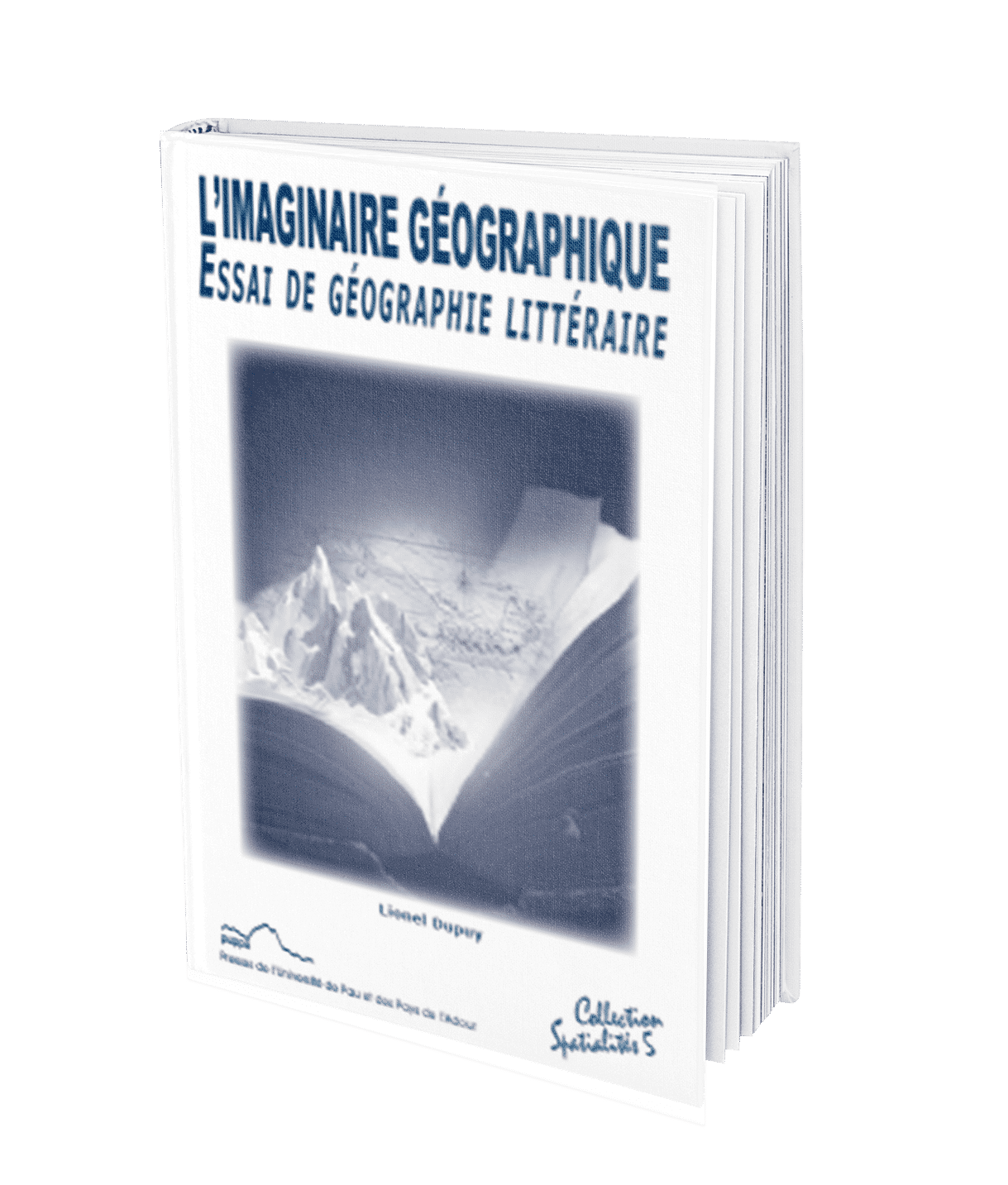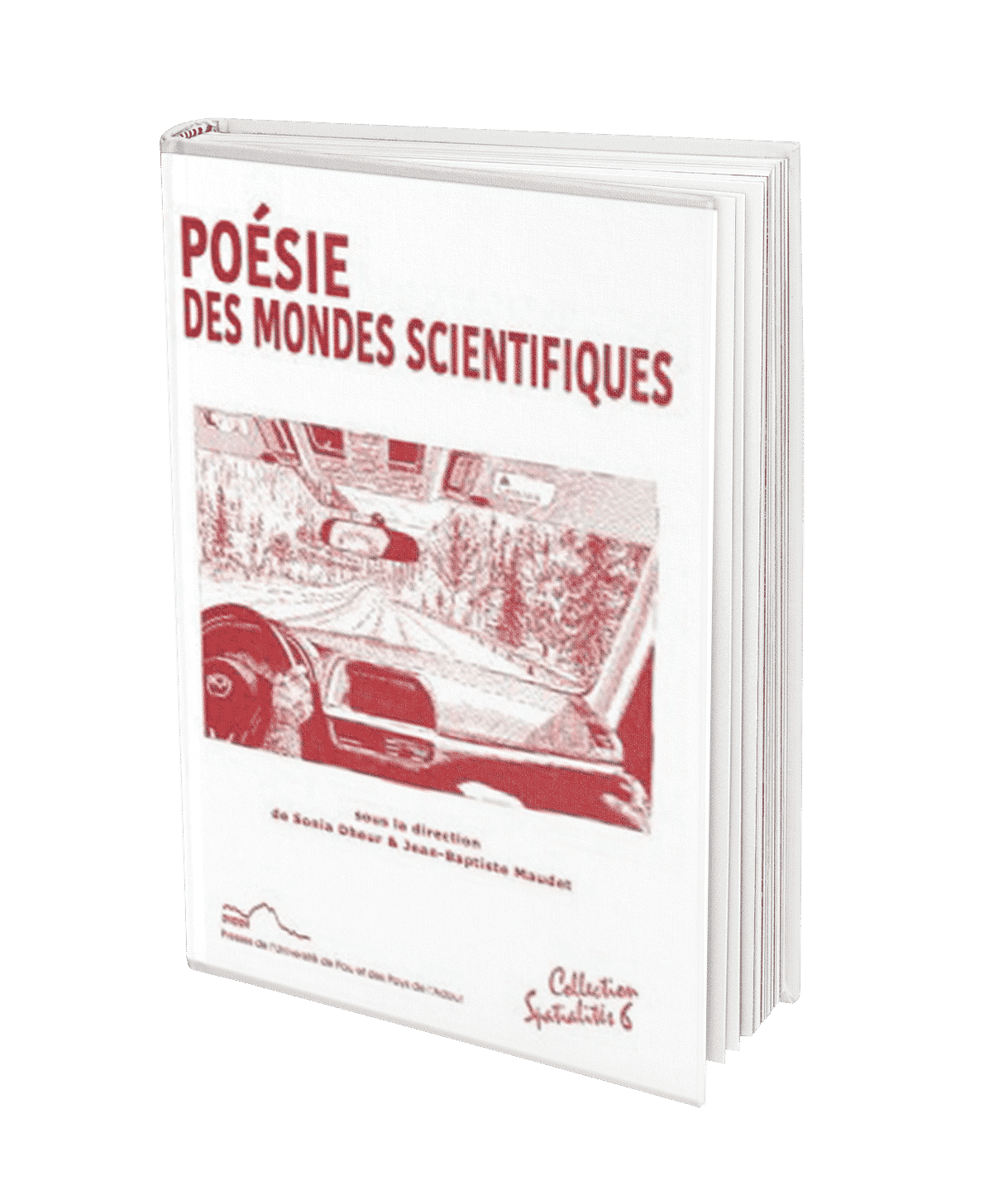Il n’est pas facile d’arriver à une conception d’un tout qui est constitué de parties dont les dimensions diffèrent. Et c’est non seulement la nature, mais l’art aussi, son image transformée, qui constituent de tels ensembles. Il est assez difficile de dresser pour soi-même un tableau de ce tout, qu’il soit naturel ou né de l’art, mais encore plus difficile d’aider quelqu’un à appréhender une telle vue complexe.
Paul Klee, On Modern Art, Londres, 1948, p. 15.
La géographie universelle est l’un des genres les plus anciens de la géographie. La plus ancienne qui ait subsisté a été écrite par Strabon au Ier siècle de notre ère. Il est clair par la description qu’il donne de son propre travail que le genre était déjà bien établi il y a deux mille ans1. Depuis lors, un nombre extraordinaire de géographies universelles a été écrit sous une variété de titres, depuis La Science de la géographie jusqu’à Un Système complet du monde. Ce que tous ces ouvrages ont en commun, c’est une tentative assumée de fournir une description à plusieurs échelles de la terre depuis celle du cosmos jusqu’à celle des peuples. La plupart décrivent la place de la terre dans le système astronomique (ou cosmologique) ; le système physique de la terre, incluant les continents, les océans, les lacs et les cours d’eau ; et le monde humain, à savoir les pays, les nations, les frontières, les peuples, les sociétés, les gouvernements, les populations, etc. Leur valeur comme distraction, pour l’éducation et pour l’administration est considérable à l’ère précédent le voyage lointain et les dictionnaires, encyclopédies et atlas aisément accessibles, pour ne rien dire d’Internet. Jusqu’à quelque part au XVIIIe siècle, avant l’explosion bibliographique, les géographies universelles constituent un genre utile, même si parfois terre à terre2.
Ces géographies universelles varient de manière significative dans leur forme physique et intellectuelle, et dans leur contenu. Physiquement, elles peuvent être aussi petites qu’un livre de poche ou aussi longues que vingt-et-un volumes que l’on a de la peine à soulever. Se présentant parfois comme une série d’essais connectés et interreliés, elles n’offrent le plus souvent que des listes de traits présentés dans un ordre ascendant ou descendant. La plupart cherchent à fournir des descriptions exhaustives de « toute chose ». Quelques rares sont cependant des traités philosophiques sur le problème de « tout » décrire d’une manière significative et cohérente, et celui d’adopter une approche holistique du cosmos dans tous les détails de sa complexité. Les solutions du problème de la description significative et les principes d’inclusion et d’exclusion qu’elle suppose ont ainsi varié, créant une diversité plus poussée. En plus, le contexte – intellectuel et politique – au sein duquel chaque géographie universelle est rédigée joue un rôle puissant dans leur structuration.
Vu la popularité maintenue depuis longtemps et la diversité du genre, il serait honnête de dire qu’il n’y avait rien de nouveau et d’innovateur dans le concept de géographie universelle au début du XIXe siècle. C’est cependant grâce à un retour à ce genre que Conrad Malte-Brun croit que la géographie française pourra trouver son salut. Né au Danemark en 1775, Malte-Brun vient d’une famille danoise confortablement à l’aise.
Son père est un militaire et un fonctionnaire de l’éducation qui envoie son fils à l’Université de Copenhague pour qu’il devienne pasteur. Conrad suit une éducation classique avec accent sur la littérature et l’histoire (au cours de laquelle il est certainement introduit à la géographie et probablement plus particulièrement à la géographie allemande). Il rejette finalement l’orientation que lui a choisie son père et commence une carrière de poète et de publiciste. En termes contemporains, Malte-Brun fonctionne comme critique littéraire, académique et social durant la première décennie et demie du XIXe siècle. Ses écrits politiques en faveur d’une réforme révolutionnaire au Danemark selon les lignes poursuivies en France depuis 1789 le mènent à être exilé de son pays. Il y est brièvement réadmis en reconnaissance de ses mérites de poète, puis de nouveau exilé à cause de ses nouvelles publications critiques sur le gouvernement. Il arrive en France en 1799, et, ses biographes nous l’apprennent, il reprend ses écrits politiques en critiquant l’usurpation du pouvoir par Napoléon le 18 Brumaire. Ses biographes jugent que le fait que ses vues politiques soient inacceptables pour Napoléon le forcent par la suite à faire retraite dans l’étude de la géographie. Il est probable, cependant, qu’il a déjà des intérêts bien développés pour cette discipline avant 1799 et il est aussi clair qu’en 1806, il dispose déjà d’une série de colonnes dans le Journal des débats, qui est généralement favorable à Napoléon, même s’il ne l’adule pas. Bien que cette combinaison frappe ce penseur moderne comme particulière, Malte-Brun est à la fois un critique social et littéraire (avec des vues politiques souples) et un géographe qui a choisi d’examiner et de critiquer son époque à partir de la perspective d’un domaine en train d’effectuer une transition maladroite vers une ère moderne où la science est fondée sur la théorie.
Malte-Brun semble avoir fait son entrée dans la géographie française grâce aux bons offices d’Edme Mentelle. C’est grâce à sa participation à la première géographie universelle de Mentelle qu’il est connu comme géographe par le public français. Le domaine qu’il trouve dans son nouveau pays est très différent de celui qu’il a connu au Danemark. La géographie française du XVIIIe siècle est beaucoup plus axée sur la cartographie et la résolution des problèmes de localisation. La géographie allemande est, au premier chef, concernée par la description historique synthétique et plus particulièrement par le recueil de statistiques descriptives sur les États. À l’époque de l’arrivée à Paris de Malte-Brun, le déclin et la perte de statut de la géographie française à orientation cartographique, qu’elle implique des levers topographiques à grande échelle ou de la compilation menée dans un bureau, sont clairs. Formé aux classiques, aux langues, à la littérature et à l’histoire, et conscient de la croissance soudaine des sciences, Malte-Brun n’a pas de raison de regretter la perte de la cartographie ou même de marquer une pause pour réfléchir à son sujet. Il prend la défense de la géographie, mais la géographie pour laquelle il se bat relègue la cartographie sur ses bords et bannit la théorie.
La géographie peut être décrite comme la constante principale de la vie professionnelle de Malte-Brun. À travers les changements de régime et le caractère fluctuant de ses vues politiques (qui lui vaut une place dans le Dictionnaire des girouettes3), il maintient son souci de la géographie et de sa place parmi les sciences. Son identification à la géographie et le rôle de défenseur qu’il adopte apparaît clairement dans beaucoup des articles qu’il écrit en tant que journaliste pour le Journal de l’Empire4. Dans des articles qui n’ont que peu à voir avec la géographie, il trouve souvent le moyen de l’introduire dans la discussion. Ainsi, rendant compte d’un livre sur la mémoire artificielle par un certain M. de Fenaigle, il se lance dans une longue discussion sur le rôle de l’érudition, de la mémoire et de la philosophie en géographie5. Dans un article défendant les campagnes de Napoléon en Prusse, Saxe et Pologne, il oppose la géographie à tous ceux qui se montrent crédules, ont des vues erronées et sont contre les guerres de Napoléon6. Plus que toute autre chose, Malte-Brun recherche l’estime des autres chercheurs pour le type de géographie qu’il désire imposer en France : après tout, « une telle science n’offre-t-elle pas autant d’intérêt, et peut-être plus encore, que la zoologie, la botanique, la chimie et tant d’autres sciences que l’on suppose aujourd’hui devoir enseigner à n’importe qui ? »7. Il semble qu’il ait été particulièrement soucieux de sauver la géographie de la réputation d’incompétence et de manque d’intérêt qu’elle avait gagnée au milieu des années 1790 à la suite des cours donnés à l’École normale et qui avaient abouti à ce que « les jeunes la rejettent, les chercheurs la négligent et les gens du monde la dédaignent »8.
En dehors de son rôle de publiciste au Journal de l’Empire, Malte-Brun répond de trois manières à ce sentiment de perte de direction et de statut. Il lance un journal, les Annales des voyages qui, il en est convaincu, démontrera l’utilité de la géographie en collectant et évaluant toute la recherche géographique menée en France et à l’étranger. Vers la fin de sa vie, il aide à fonder la « Société de géographie » en vue de lui donner une orientation et une forme particulière. Finalement, et de manière peut-être plus importante, il compose son Précis de géographie universelle (8 volumes)9. Cette œuvre peut être considérée comme l’œuvre de sa vie puisqu’il la commence un peu après 1803 et ne parvient pas à l’achever avant son décès en 1826. C’est son essai le plus délibéré, soutenu et même monumental, pour modeler la géographie et son image.
En écrivant et publiant son Précis, Malte-Brun se voit lui-même comme retournant au vrai chemin de la géographie, à la plus authentique et prometteuse tradition que possède le domaine. À ses yeux, les opportunités et en fait, le rôle historique de la géographie, se trouvent dans la description, et particulièrement dans une description littéraire accessible, c’est-à-dire dans la géographie universelle. Comme nous le verrons, Malte-Brun, comme tant de géographes de la période, est fondamentalement conservateur. Pour lui, la voie à ouvrir se situe dans une approche solidement éprouvée et adaptée du passé pour répondre aux besoins du présent. Suivant en cela le propre jugement de Malte-Brun, ses biographes ont tendu à le peindre comme le sauveur de la géographie, comme « l’un des plus grands géographes des temps modernes » et le réformateur d’un domaine qui, « jusqu’aux traités géographiques… étaient des compilations dépourvues de sens critique et sans goût »10. Ce n’est que relativement récemment qu’un géographe français a émis le commentaire quelque peu mystérieux selon lequel Malte-Brun « aurait sans doute ralenti la recherche géographique en France plus qu’il ne l’aurait stimulée »11.
La nature fondamentale de la géographie universelle :
l’approche de Strabon
La Géographie de Strabon est sans doute le plus ancien exemple qui subsiste de géographie universelle. C’est aussi un travail que Malte-Brun a lu, qu’il cite et discute dans plusieurs de ses publications les plus importantes, en particulier dans le Précis, dans ses Annales des voyages et dans un article du Journal des débats, et avec lequel il s’identifie. En fait, dans cet article, il utilise Strabon comme un allié dans sa bataille contre l’utilisation de la théorie dans les sciences géographiques et contre ce qu’il considère comme une focalisation excessive sur la mesure et sur la cartographie12. La consonance politique et disciplinaire entre Malte-Brun et Strabon, même à travers deux mille ans d’histoire, est compréhensible – même si elle est un peu surprenante. Strabon, en tant que grec et stoïcien tardif, est fondamentalement conservateur et tourné vers la gloire passée de l’Empire grec. Pour Strabon, les Romains parmi lesquels il vit, et bien que militairement et stratégiquement admirables, manquent de la profondeur culturelle des Grecs. C’est la pensée philosophique grecque qu’il admire, et il a le souci de protéger l’intégrité de la tradition intellectuelle grecque, illustrée par la poésie d’Homère, contre toute critique – même celle des écrivains grecs postérieurs13. Un Danois vivant en exil dans un État militariste français et admirant la culture de langue allemande peut avoir trouvé une âme-sœur dans l’exilé politiquement astucieux et cultivé qu’était Strabon.
Lorsqu’on compare les préoccupations de Strabon avec celles des autres auteurs de géographie générale, il est également clair que sa définition de ce genre et de la géographie elle-même saisit le ton qu’ont eu les géographies universelles jusqu’au XXe siècle. Strabon a un sentiment clair et quelque peu rigide de ce qui constitue la géographie et certainement de ce qui appartient à la géographie universelle. Strabon considère que bien que la géographie ait une signification « théorique » ou spéculative, nommément dans ses nombreuses spéculations sur la nature, la forme et les proportions mathématiques du monde physique, c’est la géographie pratique – la description utilitaire de la terre – qui définit le domaine. C’est le lien de la géographie à l’action qui lui donne sa supériorité à la fois sur la spéculation et la philosophie14. C’est de plus la géographie pratique qui définit à la fois sa tentative actuelle – la géographie universelle – et le domaine tout entier. Le plus haut idéal auquel la géographie puisse aspirer est la création d’un empire qui couvrirait l’ensemble du monde habité :
« Cela me semble un excellent encouragement pour le projet en cours de dire que la géographie est essentiellement orientée vers les besoins de la politique. En effet, la scène de nos actions est constituée par la terre et la mer que nous habitons ; pour les petites actions, de petites scènes ; pour les grandes actions, une grande scène. La plus large de toutes ces scènes est celle que nous appelons le monde habité. Et c’est la scène des plus grandes actions. Les plus grands capitaines de guerre sont ainsi ceux qui peuvent exercer leur pouvoir sur la terre et sur la mer, rassemblant les peuples et les cités dans un seul empire, contrôlé par les mêmes structures politiques. Dans ces conditions, il est clair que toute géographie est orientée vers la pratique du gouvernement… Il serait plus facile de prendre le contrôle d’un pays si nous connaissions ses dimensions, sa position relative et les particularités originales de son climat et de sa nature »15.
Ce type de description totale et utilitariste est son idéal. Strabon concède toutefois que même si un souverain, bien servi par les géographes, contrôlait l’ensemble du monde, il serait encore impossible d’en décrire toutes les régions avec un même degré de fidélité. En fin de compte, ce qui se trouverait proche serait décrit plus en détail que ce qui se trouverait loin. C’est donc une raison légitime pour adopter l’approche régionale pour étudier le monde connu.
Même avec l’approche régionale, tout ce qui est proche ne présenterait pas une signification égale. Les frontières et les limites auraient une importance particulière. Pour Strabon, le dédain d’Ératosthène pour la délimitation des frontières physiques, comme celles qui sont constitutives des péninsules et des îles, est étrange16. Mais son absence d’intérêt pour les frontières politiques est impossible17. La géographie régionale et particulièrement l’information sur les limites entre les régions, même si elle est incomplète et hautement généralisée18, offre l’un des plus importants éléments en faveur de la géographie universelle parce qu’elle améliore l’utilité politique de la géographie19.
Il y a un fort élément de conservatisme intellectuel, typique du stoïcisme tardif, dans la Géographie de Strabon, qui situe la spéculation scientifique hors des limites de la géographie20. Bien que la connaissance du monde habitable puisse encore demeurer incomplète, Strabon ne se voit pas comme un voyageur spéculant sur l’inconnu et certainement pas sur le monde inconnu. Ce qui est vraiment inconnu était presque certainement d’une valeur politique limitée. Il est capital de se focaliser sur qui est connu pour être important et « d’insister à loisir sur ces choses qui sont connues et importantes et aussi utiles à l’action, et mémorables et plaisantes ». Comme dans la fabrication d’une colossale statue, il n’y a aucun sens à se concentrer sur les détails insignifiants « parce que ceci, aussi, est un travail colossal »21. Les détails insignifiants en vertu de leur éloignement de l’action politique, tels que la configuration de l’ensemble du monde22 ou l’action des phénomènes célestes23, ne méritent pas le genre d’attention qu’Ératosthène et Posidonius leur ont donnée. Ce type de spéculation, comme la recherche causale, est au-delà du domaine de la géographie. S’interroger sur l’origine des phénomènes physiques est de la philosophie, pas de la géographie24. Il est plus simple de croire simplement dans la vérité que de partir à sa recherche25. La géographie universelle doit servir l’action politique quotidienne, et non pas encourager une spéculation occasionnelle et oisive.
Les causes des phénomènes physiques, qui requièrent l’exploration de l’essence des choses est certainement au-delà de l’enceinte de la géographie. Ce qui se trouve derrière la distribution et la variété de l’existence humaine sur la terre est cependant digne de la pensée critique. Ces faits ne sont pas la conséquence d’un plan prédéterminé, mais le produit de la contingence historique. Les caractéristiques d’un peuple – ses connaissances, son genre de vie, ses langues, ses capacités – ne sont donc pas juste le résultat de la latitude, mais de nombreuses choses : le hasard, l’habitude, les qualités des ressources autour d’eux, l’éducation, etc.26. Ces choses, le géographe peut les étudier.
Si la spéculation et la recherche causale appartiennent à la philosophie, la géographie n’en est pas pour autant une activité humble comme l’ingénierie ou la fabrication des cartes marines, qui sont si souvent pratiquées dans l’ignorance des principes basiques de la science27. Non, la géographie est parmi les entreprises les plus hautes ; c’est une science liée à la poésie ; les anciens respectaient la poésie et avaient l’habitude de l’utiliser pour enseigner mêmes aux adultes « toute chose orientée vers le social et le politique et aussi l’information historique »28. La prose, qui a été créée pour servir la philosophie et l’histoire, est une forme déchue de poésie qui a arrêté l’instruction des masses, des femmes et des enfants. La géographie est dérivée du plus grand de tous les poètes, Homère29. Ceux donc qui, comme Ératosthène et Hipparque ont cherché à bannir la poésie et la fable de la géographie en faveur de la mesure et des mathématiques, menacent le cœur même de la géographie. En ce sens, Ératosthène est un philosophe raté qui a « un type d’esprit qui le condamne à n’aller qu’à mi-chemin »30. La valeur de la poésie, et par implication, celle de la géographie, ne peuvent pas être estimées de la même façon que celle que l’on mobilise pour un charpentier ou un forgeron. La valeur de la poésie a quelque chose à voir avec la qualité de l’homme, la beauté de son expression et la sincérité de son âme31.
La géographie est plus proche de la poésie en esprit, propos et forme de pensée que de la « géométrie ». Le souci qu’a Hipparque des nombres exacts et de l’emplacement et de la configuration des lignes n’est pas géographique et montre son manque de familiarité avec le concept de proximité géographique et avec la manière dont ce qui constitue une erreur sensible varie avec l’échelle32. Ce sont des concepts centraux pour la géographie et qui la rendent non technique et inexacte. Nous voyons déjà, dans la plus ancienne des géographies universelles qui subsistent, se dessiner une ligne tranchante entre la description géographique approximative et l’expression cartographique exacte.
Alors que Strabon soutient que la géographie doit être séparée de la philosophie, la portée de la géographie requiert la force d’analyse du philosophe. La géographie est liée à la philosophie en ce que son étude elle-même requiert une vision holistique. C’est quelque chose qui touche « à des domaines si variés, à ce qui touche à la vie politique et à la pratique du gouvernement, aussi bien qu’à la connaissance des phénomènes célestes, de la terre et de la mer avec chaque chose qu’elles contiennent : êtres vivants, plantes, fruits, et aussi toutes les particularités que l’on peut trouver dans chaque pays »33. Un tel domaine ne pouvait être traité que par un individu ayant un esprit philosophique et une vision holistique34. Du divin à l’humain, toute la création entre dans le royaume descriptif et poétique de la géographie.
La plupart des lecteurs modernes de la Géographie de Strabon sont vraisemblablement quelque peu repoussés et certainement étonnés de la quantité d’espace que Strabon consacre à la critique de ses prédécesseurs. L’attention que Strabon accorde à ceux-ci a quelque chose à voir avec l’établissement de l’autorité. Dans la Géographie, Strabon se construit lui-même comme une autorité et le fait dans le cadre d’une véritable hiérarchie des autorités qu’il discute, critique et, dans le même mouvement, légitime. L’affirmation de l’autorité de Strabon est en partie basée sur sa connaissance personnelle du monde, mais plus particulièrement sur sa capacité à juger ce qui a déjà été dit35. En fait, maintient-il, nous apprenons et avons depuis longtemps appris bien plus à travers le sens de « l’ouïe » (ou à travers ce qui a été dit) que nous n’avons jamais appris à travers le sens de la « vue »36. Bien sûr, toutes les voix ne se valent pas. Quiconque est discuté dans son travail, soutient-il, peu importe à quel niveau critique, est digne de mérite37. Ceux qui ne sont pas dignes de mérite sont passés sous silence38. Pour Strabon, donc, écrire sur un auteur est reconnaître sa dignité et l’admettre dans la fraternité, le chemin de la vérité et l’histoire de la géographie. Qui citer, donc, est une des décisions les plus importantes qu’un géographe puisse prendre.
Il deviendra clair lorsque nous explorerons quelques-unes des géographies universelles les plus importantes des XVIIIe et XIXe siècles, que leur forme et leur genre sont toutes deux déjà bien établis dans la géographe de Strabon. Les traits dominants et caractéristiques du genre incluent l’accent mis sur la description pragmatique et utilitaire du monde connu, accompagné par une intolérance marquée à la discussion théorique et spéculative. La masse essentielle de la géographie de Strabon est consacrée à la description régionale avec un accent sur les limites et frontières entre les phénomènes. La description n’est pas sans but, mais est ouvertement liée au service de qui est politiquement puissant. Elle s’inscrit dans une tradition d’écriture littéraire plus que scientifique, avec peu de contenu technique. En fait, et bien que la totalité du travail soit structurée autour d’une représentation textuelle ressemblant à une carte, la cartographie elle-même et même les fondements scientifiques de la cartographie doivent être considérées comme faisant partie d’une autre entreprise. La géographie de Strabon incarne et établit le besoin d’une vision holistique unificatrice du monde connu. Le genre parle finalement avec une autorité déjà établie, l’autorité associée à la tradition, l’autorité avec laquelle une tradition de recherche est corrigée.
La dégénérescence du genre
Après Strabon, des géographies universelles sont écrites en Europe depuis au moins le XVIe siècle. Comme déjà signalé, le genre présente une considérable variété. Une description géographique cohérente et soutenue requiert néanmoins une vision unificatrice du monde connu et de tous ses habitants ; une synthèse structurée par une thèse sur la nature du monde, ses relations avec le plus large cosmos et la place des humains en son sein. En l’absence de toute sorte de synthèse ou de thèse, on verrait, et on a fréquemment vu s’installer, une tendance à la dégénérescence du genre en listes de localisations, de noms, de traits et de caractéristiques. De nombreux auteurs de géographies universelles ne comprennent pas le défi que représente le genre. Varenius, dont le génie universel est très loué par Newton39, s’arrange pour créer une synthèse partielle en bannissant la plus grande partie de la géographie humaine de sa discussion de la géographie et en remplaçant l’effort de synthèse par une sorte de réduction de la géographie à la géographie physique, à la classification de la terre selon les climats et à la cartographie. Les géographes du XVIIIe siècle, Delisle, Expilly et Mentelle, en tant qu’auteurs bien connus de géographie universelles, exagérent à la fois la tendance à une approche fragmentée et abandonnent tout-à-fait la réflexion épistémologique. Ils paraissent n’avoir guère le sentiment de l’énormité intellectuelle croissante de la tâche que demande ce cadre. Au lieu de cela, ils comprennent le problème comme de nature physique et organisationnelle plutôt qu’intellectuelle. Si nous retraçons l’histoire des géographies universelles produites entre 1652 et 1990, nous pouvons voir une tendance marquée (avec quelques exceptions) à la croissance de leur volume avec relativement peu de souci d’intégrer de nouveaux matériaux, culminant peut-être dans les dix-neuf gros volumes d’Élisée Reclus et les vingt-trois tomes de la géographie universelle de Vidal de la Blache, les deux n’ayant ni introduction générale, ni conclusion.
Des géographies universelles ont certainement été produites entre celle de Varenius et celles de Delisle, d’Expilly et de Mentelle. Mais le travail de ces derniers est symptomatique de l’état de la situation dans les géographies universelles au XVIIIe siècle. Il y a des différences entre les géographies universelles produites par Delisle, Expilly et Mentelle, nées de la diversité de leur vision, leur éducation et leur expérience. Ce sont cependant des ouvrages dont la ressemblance est frappante. À les lire, on a certainement le sentiment d’une forme, ou d’un genre bien défini. Il est à la fois surprenant et significatif que ces ouvrages soient si semblables vu les différences qui existent entre ces hommes. Delisle, comme nous l’avons vu chapitre 1, est l’un des géographes les plus respectés du XVIIIe siècle et a bâti sa réputation sur la cartographie et jusqu’à un certain point, sur l’astronomie. Comme nous l’avons vu au chapitre 2, Mentelle a fait sa carrière dans l’enseignement de la géographie ; il a enseigné à l’École de Mézières ; en 1790, il est considéré, au moins par certains, comme le meilleur représentant de la géographie. Expilly est un vulgarisateur à une époque où l’on commence à voir la géographie comme une science qui se popularise.
Le travail de tous ces hommes devait être connu de Malte-Brun. Les deux volumes de l’Introduction à la géographie avec un traité de la sphère de Delisle (publiés de façon posthume en 1746) sont très considérés à l’époque, bien que le premier volume (consacré à la géographie) ait été critiqué dans le Journal des savants. Les deux volumes d’Expilly que nous examinons ici sont sa Polychrographie en six parties (1756), qui inclut une section sur la géographie, et sa Géographie manuel (1757). Bien qu’il y ait une duplication et un recouvrement entre ces deux ouvrages, ils méritent d’être étudiés tous les deux pour avoir un tableau du sentiment d’Expilly sur les relations entre la géographie et des domaines qui, depuis au moins le XVIe siècle, sont vus soit comme faisant partie de la géographie, soit comme étant en relation étroite avec elle. Edme Mentelle produit un grand nombre de géographies universelles au cours de sa vie – la plupart au niveau de l’enseignement primaire ou secondaire. La géographie universelle qu’il publie dans les premières années du XIXe siècle avec la collaboration de Malte-Brun mérite d’être étudiée, mais elle est aussi importante pour voir ce que Mentelle écrit avant son contact avec Malte-Brun ; c’est par ce moyen que nous pouvons avoir un meilleur sentiment de ce que Malte-Brun essaie de bâtir et de réformer. Cela nous donne aussi une idée du sentiment qu’a Mentelle de la géographie avant les coupures de la Révolution. La Cosmographie élémentaire divisée en parties astronomique et géographique (1781), bien que destinée aux enfants, sert de base à ses géographies universelles ultérieures. Il vaut en outre la peine de lire sa Géographie comparée, ou Analyse de la géographe ancienne et moderne des peuples de tous les pays et de tous les âges (1778-1784) ; bien que ce travail soit une géographie comparative plutôt qu’une géographie universelle ou une cosmographie, Mentelle le considère en effet comme une discussion plus complète de la nature de la géographie que celle qui lui paraît appropriée pour le lecteur de niveau élémentaire.
Les géographies universelles de Delisle, Expilly et Mentelle partagent un certain nombre de caractéristiques, dont certaines sont déjà claires dans Strabon et jusqu’à un certain point, dans Varenius, mais qui, au XVIIIe siècle, se sont figées et de plus en plus exagérées. En particulier, toutes définissent la géographie comme étant principalement concernée par la description et la transmission de certaines connaissances. Elles regardent la « géographie scientifique » (ou la recherche) comme en quelque sorte hors du propos de la géographie universelle et incarnée soit dans la cartographie, soit dans le genre de recherche soigneuse impliquée dans la reconstruction des géographies passées (qui, depuis l’époque d’Ortelius jusqu’en gros le début du XIXe siècle, est intimement liée à la fabrication des cartes). Ils rejettent tous implicitement ou explicitement l’exclusion par Varenius de la géographie humaine de la géographie générale ou universelle. Pourtant, il n’y a pas de signe chez eux d’une quête de l’unité de la géographie. Ils ne font pas plus montre de sensibilité ou de préoccupation épistémologique. Ils font, à la place, reposer la valeur de la géographie sur son utilité. Finalement, il y a dans ces travaux, en particulier chez Mentelle, quelque chose d’une conscience de ce que la géographie est en train de tomber en défaveur, ou tout au moins en butte à une critique vraiment sévère.
Chacune de ces géographies universelles établit une connexion entre la géographie et un certain nombre d’autres sciences, et en particulier, entre la géographie et l’astronomie. Il n’y a en revanche que peu de chose dans la voie d’une discussion ouverte et claire de la relation entre ces deux domaines. La manière dont ces sujets sont introduits et discutés dans les textes suggère cependant beaucoup de choses au sujet des conceptions qu’ont les auteurs de leur propre domaine et de ses relations avec d’autres. L’exemple le plus frappant de ceci se trouve dans la Cosmographie de Mentelle. Pour lui, une partie du problème d’une géographie universelle est la présentation de connaissances recueillies dans d’autres domaines que l’on ne peut pas s’offrir d’ignorer. La première section de sa cosmographie est ainsi consacrée à l’explication des
« principales découvertes de l’esprit humain en ce qui concerne le Système du Monde. Celles pour lesquelles nous sommes endettés vis-à-vis des grands géomètres de ce siècle ont été consignées dans des mémoires savants et sont pour cette raison impénétrables à la curiosité du plus grand nombre de lecteurs. Comme résultat, en dépit du progrès considérable réalisé par l’astronomie, de nombreuses personnes instruites pensent qu’elles ont une base pour douter des vérités les plus incontestables et considérer comme inconnues les causes de nombreux phénomènes (…) pour lesquels il n’existe pas le moindre doute parmi ceux qui se consacrent à la géométrie, à la physique ou à l’astronomie. J’ai donc pensé rendre un service essentiel au public en présentant les résultats des meilleurs travaux en ce genre, débarrassés de tout l’appareil d’analyse qui mène à ces vérités sublimes. »40
Il est important de noter dans cette citation le fréquent usage de mots qui sont lestés de certitude quand ils se réfèrent aux sciences dures, l’assignation de la géographie au rôle d’éducation générale pour le public plus large et moins éduqué et, surtout, l’idée que la géographie universelle peut jouer ce rôle parce qu’elle est dispensée de calcul et d’analyse. Pour Mentelle, Delisle et d’Expilly, la géographie universelle est descriptive, limitée à la présentation des faits connus et de ce fait, concernée essentiellement par l’ordre et la forme appropriés pour permettre une claire compréhension de ces faits. Delisle définit ainsi la géographie, qu’il présente comme
« la description, ou au moins la connaissance, des différentes parties de la terre et de l’eau en relation à leur situation et à leur étendue »41.
Mentelle va un peu plus loin en décrivant sa fonction :
« Le propos de la géographie est, 1, la description de la surface de la terre, 2, la mise en évidence de ses produits et, 3, la connaissance des créatures qui l’habitent »42.
Ici comme ailleurs, les mots qu’utilise le plus Mentelle pour parler de la nature de son travail sont ceux de « description », « d’indication » et de « connaissance », bien que lui et Expilly usent aussi communément de « divisions » et de « localisation ». L’exemple le plus frappant de cette vue non réflexive et sans imagination de la géographie est exprimé par Expilly
« La géographie est la description de la terre. La terre est divisée en quatre parties… »43.
Par implication, la géographie telle qu’elle est présentée dans les géographies universelles est une science de niveau inférieur, subalterne d’une façon que Strabon n’avait jamais imaginée. Probablement sans vouloir le signifier, et en écrivant sur les développements récents de l’histoire naturelle et de la géologie, Mentelle l’exprime clairement :
« L’homme de génie peut aspirer à quelque gloire en offrant des hypothèses hardies sur la formation du globe terrestre et sur les révolutions dont il semble qu’il a souffert. Mais le géographe, dont le talent essentiel est de rendre compte des faits qui sont reconnus comme vrais, ne peut aspirer qu’à une réputation de simplicité, d’exactitude et de fidélité »44.
Quelles sont les implications de cette déclaration ? Le brillant et l’inspiré n’ont pas besoin de s’appliquer à la géographie. Ces mots ne sont pas seulement prononcés du bout des lèvres. Ces géographes restreignent en fait la partie géographique de leurs géographies universelles à la division, à la subdivision et aux explications d’une nomenclature relativement auto-évidente (par exemple : lac, cours d’eau, île, péninsule, etc.). Expilly est le plus extrême en ce domaine. Sa géographie se présente comme une série de divisions et descriptions sur un échelle toujours décroissante de taille et d’intérêt. C’est précisément le type de géographie que le Père François avait refusé d’écrire 105 ans plus tôt :
« Mon propos n’est pas d’offrir, dans ce traité, une division du globe terrestre dans toutes ses parties, en toutes les Nations par exemple, ni des Nations en toutes les Souverainetés et Royaumes, ni des royaumes en provinces, ni celles-ci en cités, ni en leur état ecclésiastique en Patriarcats, Primatures, Archevêchés, Évêchés et Paroisses »45.
Et pourtant, au XVIIIe siècle, la géographie universelle semble avoir assumé cette forme.
Chacun de nos trois auteurs reconnaît et déclare qu’il y a une autre sorte de géographie – une géographie scientifique, académique – qui mérite le respect. Nous en prenons mieux conscience chez l’éditeur de Delisle que chez Delisle lui-même. Commentant la production de cartes à partir de la comparaison critique de sources multiples, cet éditeur écrit :
« Tout ceci demande un immense détail, suffisant pour mettre à l’épreuve la patience la plus obstinée… Quelle discussion ennuyeuse et fatigante ! Il faut être né géographe pour s’y lancer »46.
Quoique Mentelle ne l’eût peut-être pas exprimé aussi directement même s’il le pensait, cela implique qu’un géographe se distingue principalement des autres savants par sa tolérance pour un travail extrêmement ennuyeux. L’éditeur de Delisle ne pense apparemment pas différemment des autres sous-domaines voués à la reconstruction des géographies du passé :
« Cette recherche profonde… ne peut être que le lot de chercheurs qui sont attachés à cette sorte d’étude soit par goût, soit par nécessité »47.
Delisle lui-même ne sépare pas les cartes de la description, argüant que, d’un côté, « les mots sont nécessaires et que, de l’autre, il en va de même de l’application », puisque sans application graphique « nous oublierions facilement la forme et la taille des pays, les distances entre les villes, la forme des mers, le cours des rivières… »48. Ses successeurs ont une approche différente de la cartographie.
Pour Expilly, les cartes portent témoignage du caractère scientifique de la géographie et suffisent à établir ses titres et sa crédibilité de géographe, mais elles n’ont pas d’impact particulier sur la géographie universelle et n’ont aucune relation avec sa méthodologie49. Mentelle tend à regarder la cartographie comme quelque-chose qui se trouve au-delà de la géographie universelle et en un sens, ne lui est pas attachée – qui lui est, en fait, supérieure. C’est dans cette veine qu’il écrit sur la géographie ancienne dans un passage où il juxtapose sa carrière et son travail en géographie à celui de d’Anville :
« L’importance de son travail ne lui permettait pas réellement de travailler pour les enfants et pour ceux qui étaient moins éduqués. Il s’engage dans la science pour elle-même : heureux sont ceux qui se penchent sur ses leçons et qui en tirent profit ! »50.
Dans la hiérarchie des activités intellectuelles en géographie selon Mentelle, la géographie universelle (qu’il associe à l’instruction de ceux qui sont relativement sans éducation) se trouve une marche au-dessous de la cartographie scientifique. Toute la géographie n’est donc pas incluse dans la géographie universelle. Liée pour sa plus grande partie à la cartographie, une géographie scientifique existe aussi. Nos auteurs la considèrent cependant comme relativement sans intérêt et inaccessible aux non-initiés, une vue qui justifie peut-être la nécessité d’une géographie universelle.
La première justification de la géographie universelle est son utilité. Non pas son utilité intellectuelle, qui a été la préoccupation de Varenius51, mais son utilité pratique. Dans l’Introduction à la géographie de Delisle, et bien qu’il ne dise pas précisément ce qu’il veut dire par utilité, son usage du terme implique un sens commercial ou politique. En se conformant entièrement aux vues de Strabon (vieilles alors de 1800 ans) sur la signification des régions sans intérêt pour les Européens, il commente la description des Amériques :
« Si le seul peuple dans cette contrée était autochtone, la connaissance que l’on pourrait en avoir ne serait pas très utile. Mais comme un certain nombre de pays européens ont étendu jusque-là leur domaine et s’y sont très fermement établis, l’Amérique doit être considérée presque comme une dépendance de l’Europe et sa connaissance est devenue presque absolument nécessaire »52.
Manquant de tout autre critère, un sens vague de l’utilité semble fournir les critères primaires d’inclusion et d’exclusion dans les descriptions de Delisle. Dans cette veine, il regrette de ne pas être capable de lister tous les fleuves du monde dans son livre même s’il sait que ce serait utile. Le propos essentiel de la Polychrographie d’Expilly et de sa Géographie est l’utilité ; ces ouvrages sont pour l’essentiel composés de descriptions et de listes de phénomènes, suivies par des tableaux présentant les routes et les distances vers Paris, les monnaies du monde, etc. – le tout présenté en format de poche pour être emporté en voyage. Expilly exprime son sens de l’utilité avec plus de grandiloquence et plus directement que Delisle en la présentant comme « le bien du Public »53. Pour Mentelle, le sens de l’utilité est directement lié à la mission éducative qu’il s’est fixée et qu’il a fixée aux géographies universelles. L’expression qui caractérise le mieux son sens de l’utilité d’une géographie universelle est qu’elle offre « un service essentiel au Public »54.
Cet accent mis sur l’utilité peut être vu comme une conséquence du manque de tout sens cohérent du liant qui tient ensemble les pièces d’une géographie universelle. Ou, dit autrement, de tout sens de l’unité fondamentale de la géographie. Que les auteurs le réalisent ou pas, l’unité de la géographie est la prémisse du genre dans lequel ils écrivent. Une géographie universelle derrière laquelle il y a une conception de la géographie comme une collection de séries de parties sans relations entre elles ou comme une collection de phénomènes qu’on n’essaie pas de relier, est intellectuellement problématique. Il n’y a aucun signe qui montre que Delisle considère cela comme un vrai problème. De ce point de vue, il semble avoir été épistémologiquement non réflexif. Il lie ainsi la géographie humaine et la géographie physique par le sol.
« La terre est cet élément sec qui ne sert pas seulement l’habitat de l’homme, mais qui supporte maisons et cités, et qui est habillé d’arbres, de fleurs et d’autres choses »55.
Il n’explore aucune des implications de ce lien. De manière semblable, et alors qu’il combine géographie et astronomie dans son livre, il considère pourtant, et sans aucune explication, que l’hydrographie est une science différente de la géographie56. Les mers, les vents et les voyages océaniques ne sont donc pas discutés avec un tant soit peu de profondeur. Expilly est plus direct encore en ce qui concerne le manque d’unité de ce que les autres appellent cosmographie ou géographie universelle, et qu’il choisit d’appeler « Polychrographie ».
« Ici, “polychrographie” signifie une description multiple qui a comme but de nombreuses connaissances distinctes, qui ne peuvent pas être rangées ensemble sous un même titre »57.
Mentelle est à la fois moins direct et plus suggestif du problème intellectuel que pose le manque apparent d’unité de la géographie. Il parle avec une gêne visible de la difficulté apparente que rencontrent toutes deux la géographie et l’histoire naturelle, en essayant de s’assurer que leurs étudiants retiennent les faits essentiels et les détails :
« … il y a tant d’autres [disciplines], qui sont plus méthodologiques, comme les mathématiques par exemple, qui sont apprises avec un tel bénéfice et qui sont bien retenues… Il en est ainsi avec elles, que les faits ont une connectivité qui les lie ; les vérités sont reliées et semblent à l’esprit former un tout »58.
À propos de l’histoire naturelle, il continue en disant que récemment, dans leurs cours, Bucquet et d’Aubenton « ont montré… comment un homme de génie peut lier les branches variées de ce domaine d’étude, et comment cela lui apporte clarté, éducation et intérêt ». La géographie, estime-t-il, attend encore le « Sauveur » qui pourrait reconnaître, découvrir ou bâtir son potentiel :
« La géographie peut avoir aussi sa manière propre d’offrir pensée et jugement et un moyen de plaire et d’intéresser. Elle attend seulement un maître qui aurait la capacité de présenter la géographie dans sa totalité, avec toute la netteté dont elle est capable. Puissent mes faibles efforts contribuer à y parvenir ! »59
Avec la géographie, il n’ose pas espérer une unité car « toute la netteté dont elle est capable » est inférieure à l’unité qui peut être trouvée dans les mathématiques ou plus récemment dans l’histoire naturelle. Il rêve seulement d’une façon de rendre la géographie plaisante et intéressante pour la réflexion et le jugement.
Parmi les auteurs de géographie universelle, un nombre croissant a le sentiment que la géographie – et particulièrement le type de géographie descriptive contenu dans les géographies universelles – est ouverte à la critique. Delisle mentionne la banalité de la tendance de certains de ses prédécesseurs à définir l’évident :
« Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’expliquer ce que sont une montagne, une vallée, une forêt et d’autres choses semblables, comme d’autres le font. Ce sont des notions communes et ceux qui n’ont pas étudié la géographie les connaissent aussi bien que les meilleurs géographes »60.
C’est, comme nous l’avons vu, Mentelle qui a le sens le plus aigu de l’inadéquation apparente de la géographie. Il s’est plaint d’avoir été, en 1760, un des tout premiers géographes à parler du système copernicien. Il souligne que la plupart des traités sur la sphère produits par les géographes sont « presque des copies les uns des autres »61. Il est aussi pleinement conscient d’une certaine territorialité parmi les sciences qui signifie qu’il y a « des détails qui appartiennent à une autre » et que les frontières du terrain de la géographie sont loin d’être évidentes62. Étant donné en particulier la nature des géographies produites par ces auteurs, ce que cela montre n’est pas une sensibilité épistémologique, mais une angoisse épistémologique.
Malte-Brun ressuscite le genre
Il y a peu de doute que Malte-Brun est conscient d’écrire son Précis de géographie universelle dans une tradition bien établie et qu’il essaie de faire directement face à la plus grande partie de la critique qui a été adressée à la géographie à la fin du XVIIIe siècle63. La géographie est superficielle, elle est mal écrite, elle déborde sur le terrain d’autres champs sans contribuer de manière significative à leur développement et sans les comprendre nécessairement et, de plus, elle est ennuyeuse. Il se réfère obliquement à ces critiques d’un bout à l’autre de son Précis en discutant de sa méthodologie et en l’expliquant. En fait, son travail dans son ensemble peut être compris comme une tentative de rajeunir la géographie, de porter secours à sa réputation et de lui délimiter un certain territoire. Ce n’est, bien sûr, pas le seul but. Avec toutes les géographies universelles discutées ici, Malte-Brun se montre également soucieux de populariser la géographie et d’offrir une éducation géographique pour les gens éduqués et informés, mais pas nécessairement pour les scientifiques. Il proclame que le public est son seul protecteur et que son but est « de faire aimer la géographie et d’étendre le goût que l’on a pour elle »64. Mais c’est à la fois le monde scientifique aussi bien que le public qu’il désire impressionner.
Lorsqu’on compare la géographie universelle de Malte-Brun à celles de Mentelle, ou d’Expilly ou même à celle de Varenius, on ne peut pas manquer d’être impressionné par l’étendue, l’ambition et l’érudition de ce travail. Le premier volume du précis est une histoire de la pensée géographique et de l’exploration (avec quelques bribes de géographie historique) de Moïse et Homère à 1809. Son second volume introduit et explore tout ce qui peut être généralisé dans la géographie mathématique, physique et humaine. Ses volumes suivants examinent, continent par continent, grande région par grande région, contrée par contrée, et puis province par province, chaque partie de la terre. Dans chacune, il commence par décrire les traits physiques généraux des continents, en y incluant les grands traits de leur relief, les fleuves principaux et les lacs, leur végétation typique, leur climat, la vie animale et le niveau de civilisation des peuples indigènes. À l’échelle de la contrée et de la province, il réexamine les traits physiques et puis se focalise sur la structure politique, la population, le commerce et le genre de vie des peuples.
L’énorme ambition de bien des géographies universelles leur confère une certaine et inévitable superficialité. Le Précis de Malte-Brun ne fait pas exception et Malte-Brun doit fréquemment terminer une section ou une discussion par un « mais ceci nous amènerait trop loin. Nous nous limiterons à quelques traits »65. Malgré cela et à bien des points de vue, le travail de Malte-Brun est exceptionnel dans le contexte de la géographie française. Alors que Mentelle se contentait de mentionner les ouvrages majeurs utilisés pour certaines parties de sa géographie, Malte-Brun cite religieusement les travaux et les idées qu’il utilise. Ses sources incluent des ouvrages français, mais aussi anglais, allemands et danois, et des publications classiques. Il comprend clairement les mécanismes internes de bien des aspects de la géographie qu’il cherche à explorer, y compris les procédés qu’implique la cartographie. Sa couverture de la littérature sur la science naturelle est large et riche, et il a un sens aigu des questions-clés qui sont posées dans ces domaines. Il met en œuvre une approche critique et profondément pensée dans la recherche qu’il prend en considération. Il censure correctement Philippe Buache et ses successeurs pour avoir construit de vains systèmes et s’y être ensuite accrochés face à l’évidence du contraire. Ses descriptions sont vivantes et écrites d’une manière agréable, et certaines de ses caractérisations de gouvernement ou de peuples montrent une prescience frappante. Cela représente un effort considérable demandant une énergie et une érudition soutenues. Mais est-ce une géographie universelle réussie ? Délimite-t-elle le territoire particulier de la géographie ? Fait-elle échapper la géographie à ses critiques, ou lance-t-elle l’effort pour y parvenir ? Et finalement, quel est son impact à long terme sur la discipline ?
La tradition à laquelle Malte-Brun s’identifie est étroitement liée à la géographie de Strabon, et comme Strabon, elle est quelque peu hostile à la tradition cartographique en géographie. Malte-Brun commence par attaquer l’antiquité supposée de la tradition cartographique, la dégageant de la tradition descriptive et suggérant qu’une vision systématique et totalisante est nécessaire à la géographie universelle.
« Les Égyptiens pouvaient tracer des méridiens ; la crue régulière du Nil pouvait avoir rendu nécessaire l’art du lever des plans topographiques. Mais cette application de la géométrie ne présuppose pas d’idées géographiques chez un peuple qui avait en horreur la mer et la navigation. Et la carte supposée de Sesostris est aussi problématique que les voyages attribués à ce héros… Nous devons admettre qu’il n’y a pas de système géographique qui mérite l’attention avant celui de Moïse »66.
La distance que Malte-Brun cherche à mettre entre la géographie et la cartographie est certainement due au sentiment qui prévaut selon lequel la cartographie à grande échelle est devenue une technologie plus voisine de l’art des levers que de la science. Ironiquement, comme nous le verrons, ce qu’il a retenu de la cartographie est un reste d’une méthodologie déjà reconnue comme démodée par la plupart des cartographes à formation mathématique. Plus important encore, Malte-Brun n’a pas de conception alternative qui lui permette de maîtriser la dimension historique du domaine, ou de répondre aux défis posés par les développements récents des sciences de la nature et des sciences sociales. Sa conception de la géographie est, à l’inverse, plutôt vague, basée sur un attachement à l’affiliation existant depuis longtemps du domaine à l’histoire et aux humanités, et hostile aux fondations mêmes de la science moderne et de la science sociale.
Malte-Brun mentionne fréquemment le globe dans son Précis. C’est pourtant pour lui un jouet éducationnel ou un gadget plus qu’un instrument d’une réelle valeur scientifique et conceptuelle67. La cartographie qui a dominé le passé de la géographie mérite certainement d’être mentionnée, mais elle est absente du sens que Malte-Brun a de l’histoire la plus récente de la géographie. En conséquence, et bien qu’il reconnaisse le rôle important joué par les cartes dans l’histoire de la géographie, il bannit substantiellement les trois derniers Cassini de cette histoire68. Malte-Brun ne nie pas ouvertement que les fabricants de carte puissent être des géographes, mais il se réfère fréquemment aux cartographes (qui ont toujours été connus comme « géographes ») en les qualifiant de « géographes-dessinateurs » ou simplement de « dessinateurs ». En dépit du fait qu’il ait placé la géographie mathématique (ou cartographie) en tête de sa discussion, dans le volume 2, La Théorie générale de la géographie, il ne voit pas la cartographie à grande échelle comme une partie importante du futur de la discipline. Selon lui, il n’y a simplement rien d’intéressant que le géographe ait à faire avec la cartographie ou dans ce domaine.
« L’élégance et l’exactitude que l’on a tant louées dans les cartes des Cassini ont été atteintes par les Russes, les Danois, les Espagnols ; mais en faisant de grands pas, les ingénieurs français surpassent tous les jours les Cassini et laissent peu d’espoir à ceux, qui, à leur tour, voudraient les surpasser »69.
Il reconnaît que les autres sciences cherchent de plus en plus à cartographier les phénomènes qui les intéressent sous la forme de cartes thématiques. Il ne voit toutefois pas, en cela, une opportunité pour la géographie ou d’une manière quelconque pour la conceptualisation géographique du monde ou de problèmes particuliers.
« … finalement, il n’y a que peu d’objets qu’ils n’aient essayé de réduire à des relations de localité sous la forme de cartes. Mais la composition de ces formes de tables ne peut être soumise à des règles constantes autres que celles résultant de sciences étrangères à la géographie »70.
Dans cette perspective, il n’y a rien de particulièrement géographique dans une carte thématique. Pour Malte-Brun, le globe ne constitue pas une image unificatrice et la cartographie ne se trouve pas au cœur de la définition de la géographie.
Il y a quelque chose d’important dans la cartographie pour le futur de la géographie, mais cela n’est ni mathématique, ni graphique. Ce que Malte-Brun emprunte à la cartographie, et qu’il respecte, c’est une méthodologie que la cartographie à grande échelle elle-même commence à rejeter au début du XIXe siècle, et dont il use massivement dans sa géographie universelle. On pourrait dire que c’est l’idée centrale de la géographie universelle de Malte-Brun. C’est la comparaison critique de sources multiples pour arriver à une peinture exacte du monde. Pour Malte-Brun, et aussi longtemps que le géographe retient cette approche, toute science et toute connaissance peuvent servir de matière première à la géographie sans mener à une confusion entre ces sciences et la géographie elle-même. La comparaison critique de morceaux et pièces d’information liés à la terre (et tirés de n’importe quel domaine), et compilés pour une description attractive de la terre, constitue la méthode géographique71. C’est la méthode qui sépare la géographie des sciences et confirme son attachement à l’histoire, puisque l’histoire recourt largement à la même méthode pour reconstruire et produire des descriptions attractives du passé72. Cela explique en partie une des particularités de l’histoire de la géographie de Malte-Brun : sa glorification de d’Anville, le géographe de la comparaison critique par excellence. Il trace une ligne avant d’Anville et qualifie toutes les cartes antérieures d’inexactes et sans valeur à cause de la révolution dans la précision des longitudes – dit-il – apportée par ce savant. Il loue la précision toponymique de d’Anville et la qualifie, de manière inexacte, de singulière. D’Anville constitue pour Malte-Brun une pierre d’angle critique de la discipline, puisque selon ses vues, c’est la comparaison des sources qui transforme un « dessinateur » ou un « copiste » en géographe. En fait, le Précis de Malte-Brun peut être vu comme la forme textuelle de la géographie de d’Anville. C’est dans cette optique que l’unique reproche que Malte-Brun adresse à l’Anville a grand sens :
« Quelle merveille ce serait si la plus saine faculté critique et une vaste érudition avaient été combinées au talent littéraire, qui seul peut passionner les gens pour une science ! »73
Si d’Anville a exprimé sa synthèse géographique sous forme littéraire plutôt que cartographique, Malte-Brun est sûr que son travail aurait valu support et affection pour la géographie.
La théorie rejetée
Comme nous le verrons, les talents littéraires de Malte-Brun et sa large base de connaissances revitalisent le genre, mais son approche de la théorie marginalise celui-ci et, dans la mesure où cette attitude est généralisée, elle marginalise aussi l’entreprise géographique dans le contexte de la science du XIXe siècle qui est de plus en plus théorique. Malte-Brun est convaincu de la valeur intellectuelle de la géographie physique mais il est profondément troublé par les prétentions et les conclusions de la théorie spéculative, spécialement dans le domaine des sciences physiques et naturelles. Sa première objection à une telle théorie est religieuse et est focalisée sur la terreur à laquelle la théorie spéculative expose l’esprit humain74. Malte-Brun est préparé à admettre que les faits individuels doivent être précédés et organisés par des principes généraux et considère qu’une combinaison de tels principes est l’équivalent d’une théorie. Il rejette néanmoins catégoriquement la théorie explicative dans les domaines de l’homme, des plantes et des animaux, et, dans les domaines physiques, il se prononce pour « l’approche purement descriptive », « la seule méthode réellement scientifique et instructive »75. À la différence des sciences naturelles, la géographie qui est centrée sur le monde naturel ou à laquelle Malte-Brun se réfère comme géographie physique, ne peut s’engager dans la classification ou dans d’autres méthodes subtiles et rigoureuses parce que « montagnes, vallées, eaux, climats, régions physiques apparaissent aux yeux d’un sincère ami de la vérité comme très complexes, très irréguliers et plus aisés à décrire qu’à définir »76. En opposition avec la théorie, que Malte-Brun considère comme infondée, « les principes généraux » sont composés d’une combinaison de faits77. Alors que la botanique peut ainsi se fonder sur la classification des plantes et sur leur description individuelle détaillée, le rôle de la géographie est de combiner la description des plantes avec celle des formes de terrain et du climat. Cela produira les principes généraux propres à la géographie botanique. La nature précise de ces principes n’est pas claire : Malte-Brun s’arrête avant d’identifier les régions botaniques. Il a à la place le sentiment qu’il est plus sûr de subordonner la description botanique à la structure politico-régionale conventionnelle de son Précis78. Il est clair qu’il ne se sent confortable qu’avec un degré très limité de généralisation à partir des faits individuels. Ceci reflète en partie son sentiment de la jeunesse du domaine de la géographie, puisque ce type de travail ne pourra qu’être « le travail des siècles et des nations »79.
Le rôle des « principes généraux en géographie » est moins clair dans la discussion par Malte-Brun de ce qui sera considéré plus tard comme la géographie humaine : les langues, les religions, les formes d’organisation de la société (famille, société civile, société politique [par exemple, monarchie, démocratie]). Il prévient le lecteur que dans le cas du monde humain, « ces principes qui, fondés dans la nature de notre être, ne varient pas avec la capricieuse volonté humaine, sont peu nombreux »80. En matière humaine il y a peu de sens à chercher des règles ou des structures. Les généralisations dans lesquelles il s’engage le mènent rapidement à un raisonnement circulaire. C’est en effet la société morale (par laquelle il signifie la religion) qui « détermine la circonscription des États et Empires que la géographie politique est en charge de décrire »81. Mais « l’état moral » d’une nation « est le résultat de toutes les relations politiques et sociales [forces militaires, classes, religion, population, richesses…] que nous venons juste de montrer »82. Au total, les remarques générales de Malte-Brun sur la société et son évolution sont si peu nombreuses et si peu connectées entre elles qu’elles ne vont jamais au-delà de quelques pensées et observations.
Le terme « principes généraux » est absent de la discussion de Malte-Brun sur la géographie physique, mais le message est identique, sinon plus catégoriquement exprimé. Pour Malte-Brun, la géographie physique est centrée sur des phénomènes caractérisés par leur régularité et leur généralité83. Des phénomènes avec des causes multiples et complexes, comme les arcs-en-ciel, les mirages et autres manifestations atmosphériques sont, par leur imprévisibilité même, non géographiques84. La régularité et la généralité ne peuvent être déterminées que par l’observation et la description. Ce qui ne peut être observé est au-delà de la science. Cela n’a donc aucun sens de parler de la nature du monde souterrain et de spéculer sur l’existence des cavernes :
« L’inconnu, banni du domaine des sciences, relève aujourd’hui exclusivement de celui du romancier »85.
Malte–Brun cherche plus que tout à distinguer et à protéger les phénomènes physiques des théories que la géologie suscite alors : les théories sur l’origine et l’évolution de la terre.
« Rien n’arrête le vol de la curiosité humaine. En nous offrant mille difficultés insolubles, la terre, les eaux et les airs nous ont en vain rappelé l’impuissance de notre esprit. Nous ne pouvons connaître qu’imparfaitement ce qui existe autour de nous, et nous osons chercher pourquoi tout a commencé à exister ! (…) quelle témérité ! Dans le cours de notre travail, nous avons vu que la géographie physique ne peut pas nous aider à lier des faits qui se produisent fréquemment ensemble et de tirer des conclusions générales à partir d’eux. On est même parfois forcé de présenter des faits de manière hypothétique parce que les observateurs ont offert leurs commentaires sous cette forme. Mais la géographie physique n’adopte ou n’affirme rien qui n’ait été prouvé par l’expérience. Les systèmes géologiques, au contraire, ont comme but avoué l’explication du cours de révolutions inconnues à partir de monuments qui sont souvent équivoques. Ils se permettent de suppléer au silence des faits par des analogies et ainsi, d’hypothèse en hypothèse, ils décomposent ce vaste corps comme s’il s’agissait d’une pièce de métal qu’un chimiste peut avoir forgé dans son creuset. Nous prouverons que cette soi-disant science, la géologie spéculative, ne promet aucun résultat à partir du moment où elle s’écarte du sentier de la géographie physique »86.
C’est le propos de la géologie d’expliquer l’inconnu et l’invisible par l’analogie et l’hypothèse, en bref, par la théorie, que Malte-Brun rejette de manière régulière et sans équivoque.
Malte-Brun comme nouveau modèle
Quelles que soient ses fautes, la géographie universelle de Malte-Brun constitue certainement un livre important et influent au sein de la géographie. Il devient en fait le point d’origine et le modèle des géographies universelles suivantes. Écrivant en 1830, l’éditeur de la maison de publication Jules Renouard contribue à faire du Précis de Malte-Brun un modèle.
« Les traités de géographie abondent en France : après Mentelle et Pinkerton, chacun fameux en son temps, est venu Malte-Brun87 ; et aujourd’hui, après Malte-Brun et en grande partie à l’aide des documents très variés réunis dans le Précis, une foule d’auteurs offrent au public des géographies, sous tous les formats et sous les titres les plus séduisants, qui proclament qu’ils sont nouveaux… Pouvons-nous répéter la plainte universelle selon laquelle celui qui réunit tous ces travaux dans sa bibliothèque manque encore d’une géographie »88.
Les géographes universitaires utilisent le Précis de la géographie universelle de Malte-Brun pour distinguer leurs travaux des nombreuses descriptions populaires du monde publiées chaque année89. En particulier et durant quelque temps, la structure de base employée par Malte-Brun est suivie : un long volume introductif intitulé « principes généraux », suivi par une description hiérarchique détaillée du monde intitulée « partie descriptive ». Une histoire de la géographie produite approximativement cinquante ans après la mort de Malte-Brun lui emprunte encore massivement90 et, apparaît-il, attribue une nouvelle géographie descriptive, une nouvelle école de géographie savante, à celui-ci et à Carl Ritter91. Ce sont les admirateurs et les successeurs de Conrad Malte-Brun à la fois à la Société de Géographie et aux Annales des voyages – en particulier Jean-Baptiste Marcellin baron de Bory de Saint-Vincent (qui devint un de ses admirateurs plus tard dans sa vie), Jean-Jacques-Nicolas Huot, Philippe François de la Renaudière, Adrien Balbi, Théophile Lavallée, Vivien de Saint-Martin et le fils de Conrad Malte-Brun, Victor – qui garantissent la réédition du Précis de la géographie universelle de Malte-Brun jusque dans les dernières décennies du XIXe siècle.
Il n’est pas facile de mesurer de quel respect le Précis de la géographie universelle de Malte-Brun jouit en dehors du cercle des géographes. Qu’est-ce que la dissociation opérée par Malte-Brun entre la géographie universelle – et en fait, la géographie – et la création de connaissances, l’explication, la recherche de la cause et la quête incertaine de sens implique-t-elle au sujet de la place des géographes parmi les sciences ? Dans une ère d’exploration internationale intense et de haut niveau où s’affirme le caractère exaltant de ce qui a été depuis connu comme « la science de la découverte », quelle place une géographie a-t-elle le bonheur d’occuper92 ? Le rejet de la théorie par Malte-Brun donne à la géographie le rôle d’entrepôt public d’information sur la terre, ou de servante et de gentille introduction aux sciences plus systématiques. Il laisse aussi à la géographie une tâche – celle de cataloguer tout ce qui est connu sur la terre – qui est, comme le suppose justement Malte-Brun, en fait trop vaste. En addition, à qui, précisément, ce résumé servirait-il ? Avec des dictionnaires et des encyclopédies généraux ou thématiques apparaissant à un rythme et sous des volumes spectaculairement croissants, et avec des journaux spécialisés remplaçant à un rythme rapide l’échange de lettres érudites comme moyen de communication entre les savants, quel chercheur ou scientifique consulterait-il une synthèse éloignée une fois ou deux fois de ses sources d’information sur la terre et ses habitants et composée par un non-spécialiste93 ? En dépit de sa rigueur, de son érudition et de son essai d’attirer une audience plus éduquée, il n’est pas facile de savoir si le travail de Malte-Brun jouissait d’une reconnaissance académique ou intellectuelle au-delà de la communauté des géographes. Les commentaires d’une paire de critiques anonymes, qui sont peut-être exceptionnellement durs et partisans, nous donnent quand même une idée de l’interprétation contemporaine de l’œuvre de Malte-Brun :
« C’est une compilation dans toute la force du terme. De toute manière, il y a tant de livres consacrés à cette étude qu’au milieu de la masse, et ayant déjà publié une géographie en seize volumes, M. Malte brun (sic) ne peut que transporter les matières d’un lieu à l’autre avec à peine de rares modifications à ce que ce type de travail demande »94.
Aussi rude que soit ce jugement, le Précis de géographie universelle est en fait une compilation dont la principale qualité réside dans la nature et le nombre de faits collectés et la qualité de l’écriture.
Une géographie universelle
riche de théorie était-elle possible ?
Si nous pouvons admettre que le Précis de la géographie universelle de Malte-Brun est plus concerné par cataloguer que par aborder les grands problèmes intellectuels de son temps, nous sommes laissés face à plusieurs questions : la mollesse intellectuelle de son Précis est-elle un trait inhérent au genre ? Reflète-t-elle plutôt les limitations du savant ? Ou est-elle en fait le produit de l’interaction du chercheur, du genre et du contexte intellectuel ? Ce sont de grandes questions, auxquelles, en fin de compte, il n’est peut-être pas possible de répondre. Cependant, si nous parvenons à identifier des géographies universelles qui jouèrent un rôle intellectuellement plus vital et à isoler et à contextualiser les sources de leur originalité et de leur puissance, il sera alors possible de répondre à au moins une partie de la question.
La Science de la géographie du Père Jean François (1652) et le Cosmos d’Alexandre de Humboldt (1849) furent tous deux intellectuellement engagés et ont beaucoup influé sur les recherches de leur temps. François décrit son travail comme une géographie, et il a la portée d’une géographie universelle. Le Cosmos de Humboldt va bien au-delà des conceptions relativement étroites de la géographie de son époque pour embrasser toutes les connaissances humaines. Humboldt ne décrit d’ailleurs pas le Cosmos comme une géographie : il considère la géographie comme une entreprise préoccupée d’énumération95. Il lie l’étude du cosmos avec celle de la géographie physique. Parlant de l’énorme portée du Cosmos, du sidéral au terrestre et prenant en compte leurs relations empiriques, Humboldt commente :
« L’idée jusqu’ici indéfinie d’une géographie physique a donc, par un projet étendu et peut-être trop hardiment imaginé, été comprise comme celle d’une description physique de l’univers, embrassant toutes les choses créées dans les régions de l’espace et de la terre »96.
Les historiens de la géographie ont longtemps traité le Cosmos comme un travail de géographie et, particulièrement, comme un manifeste géographique97. Il y a à cela deux grandes raisons. Cyniquement, la quête par la discipline de « Grands Prédécesseurs » encourage l’intégration non critique du génie de Humboldt. On peut le soutenir aussi : il est impossible d’ignorer Humboldt parce que dans son Cosmos, il se saisit d’un problème qui n’a pas encore été entièrement résolu par les géographes aujourd’hui, mais qui a empoisonné la géographie du début du XIXe siècle : comment marier les nouvelles orientations prises par la science théorique et empirique avec l’approche holistique de la terre ? Ce n’est pas impliquer une équivalence entre l’unité recherchée par Humboldt et celle assumée par les fabricants de géographies universelles. La quête d’unité de Humboldt est probablement inspirée par son association aux philosophes allemands de la nature, au milieu desquels il a étudié, qu’il a lus et avec lesquels il a correspondu et noué des liens98.
Bien que dans le cas de Humboldt, cette dimension soit tempérée par un engagement profond dans la science empirique, cette quête de l’unité de la nature, incluant les mondes organique, inorganique et social, intellectuel et perceptuel, est en contradiction avec l’esprit mécanique et classificateur de la science des Lumières. Humboldt partage le sentiment exprimé par les Romantiques et les philosophes de la nature selon lequel quelque chose s’est perdu dans une approche purement mécanique du monde. Il y a une place pour une métaphysique de la nature, à travers une physique de la nature99. Les géographes universels ici discutés, à l’exception partielle de Malte-Brun, supposaient simplement une unité au cosmos exprimée dans son ordre. Ils ne cherchaient ni à élucider cet ordre à travers l’observation ou l’expérimentation, ou à travers une recherche empirique de quelque forme que ce soit, ni à le problématiser. Ils supposaient que l’ordre qu’ils imposaient dans leurs travaux reflèterait l’ordre du cosmos, ou qu’au moins, qu’il serait utile. Au fur et à mesure que le XIXe siècle avance, les géographes ont de plus en plus de difficulté à imposer ordre, structure et cohérence aux différents règnes qui sont historiquement tombés dans leur compétence. Le fait qu’en France tout au moins100, les géographes ne se tournent pas vers Humboldt pour trouver inspiration dans ce domaine suggère une différence fondamentale de perspectives entre le Humboldt scientifique et métaphysique et les géographes énumératifs et descriptifs qui, à travers tout le XIXe siècle, semblent soucieux de classification comme modèle de recherche scientifique. Confondre Humboldt avec ces géographes, c’est ne pas discerner des traditions intellectuelles radicalement différentes. Le problème de Humboldt est cependant similaire à celui auquel est confrontée la géographie française lorsqu’elle passe de la science classique à la science moderne. Le Cosmos de Humboldt aussi bien que La Science de la géographie du Père François, malgré leurs différences considérables aussi bien dans la forme et le contenu, constituent des essais pour concevoir le cosmos comme un tout intégré, et les deux auteurs voient cette entreprise comme fondamentalement liée à la géographie dans le cas de François et à la géographie physique dans celui de Humboldt.
La science de la géographie du Père Jean François
Jean François (1582-1668) est un chercheur et professeur de philosophie et mathématiques du collège Jésuite de La Flèche. C’est un chercheur important en géographie, même s’il est aujourd’hui largement oublié. Dans le cours de sa carrière, il écrit un traité sur la géographie, un livre sur la pratique de la cartographie, un travail d’hydrographie et un traité sur la sphère. C’est peut-être parce qu’il a enseigné à René Descartes qu’il est le mieux connu101. L’argument ici n’est pas que la géographie de François est moderne ou en quelque manière correcte, mais qu’elle est intellectuellement vivante et cohérente. Sa cosmographie est ptolémaïque plutôt que copernicienne. Sa pensée est en partie téléologique, en ceci qu’il croit fondamentalement que les phénomènes reflètent la volonté et la nature de Dieu et que l’on peut ainsi considérer qu’ils ont une raison d’exister. Dans cette perspective, les chaînes de montagne ont été formées pour séparer les royaumes, pour fonctionner comme asiles pour les peuples menacés par de puissants ennemis, pour former des réservoirs d’eau sous la forme de neige, et pour arrêter les nuages, « les vapeurs et autres fumées que les vents transportent avec eux en les rendant plus épais jusqu’à ce qu’ils se transforment en pluie »102. Il comprend cependant ce que beaucoup de penseurs du XIXe siècle ne pouvaient pas assimiler : qu’il est important de ne pas mélanger les types d’explication. C’est-à-dire que lorsqu’on parle de Dieu, on peut penser en termes de miracles, mais que dire qu’un événement naturel est un miracle n’est pas l’expliquer. C’est ainsi qu’en ce qui concerne la nature potentiellement miraculeuse de la variété et de la distribution des êtres sur la terre, il commente : « Mais il n’est pas raisonnable de mettre des miracles parmi les effets qui peuvent être expliqués par des moyens naturels »103.
Un regard rapide suggère une stratégie très étrangère – et certainement pas moderne – à la base du livre. Il commence comme un traité philosophique, examinant les premiers principes, la nature de la cause et le sens du lieu, et s’étend alors par une énumération relativement évidente par elle-même de traits physiques et de caractéristiques nationales ou régionales. Entre les deux, il est facile pour un lecteur moderne de perdre le fil de ce travail. La stratégie de l’auteur est cependant directe et son souci du lecteur s’étend facilement à travers les siècles pour l’assurer, lui ou elle, qu’il y a en fait un fil central et un fort argument. Dans son livre, François entreprend cinq tâches principales :
- Une explication de la nature de la géographie et de la manière dont elle doit être approchée.
- Une discussion de ce qu’il est nécessaire de connaître pour étudier la géographie.
- Une suggestion de ce qu’il peut être profitable d’apprendre de la cosmographie et de la géométrie.
- Une exploration du sens et de l’importance du lieu dans les quatre divisions qui, considère-t-il, forment la « géographie traditionnelle » : le domaine conceptuel, ou les concepts et leur expression cartographique ; le domaine naturel ; le domaine civil ou humain ; et le domaine solaire ou céleste.
- Finalement, une description de la manière dont ces quatre divisions peuvent être peintes.
La partie la plus difficile et la plus importante du travail est la première, l’explication de la nature de la géographie. La seconde partie reflète ce qui peut être vu comme une des caractéristiques qui définissent les géographies universelles : un souci d’enseigner la géographie et de la rendre largement accessible. La troisième partie discute des propriétés de la sphère et de quelques principes géométriques importants pour l’étude de la terre en tant que globe. La quatrième partie est ce que François considère comme « la géographie traditionnelle », ou la description des différentes parties de la terre, à laquelle il apporte de la vie à travers une remise en cause de la nature de la géographie104. La cinquième partie explique comment décrire cartographiquement les divisions de la terre et y ajoute une série de problèmes cartographiques et leur solution. Ces parties ne correspondent pas nécessairement aux chapitres et aux différentes sections. Elles émergent plutôt à la lecture de l’ouvrage.
Bien que cette description offre un sens général de la forme de la discussion de François, elle ne rend pas sensible et n’explique pas la cohérence et la vitalité de sa géographie, aussi bien aujourd’hui que pour ses contemporains. C’est parce que la cohérence et la vitalité sont dérivées non pas de la structure du texte, mais de quatre idées dont François considère qu’elles sont évidentes par elles-mêmes, et qui sont présentes dans tout le livre. La première est la vue selon laquelle la géographie est une contemplation du globe et concerne donc la représentation du lieu dans toute sa variété divine, naturelle et humaine. La seconde est un fort sentiment de la connectivité – et de l’importance de cette connectivité – entre les différentes parties de la géographie en dépit de la considérable diversité présente à la surface de la terre. La troisième est une conception de la géographie comme une science concernée par l’explication, la raison, la cause et l’incertitude – ou la quête de compréhension. La quatrième est la compréhension de la place de la géographie parmi les autres sciences, qui fait que ce que la géographie emprunte ou donne peut être clairement évalué. La forme particulière de ces idées ne peut avoir été possible qu’à l’époque de François. On peut soutenir qu’elles, ou quelque chose de très voisin, détiennent, ou détient, la clef de la cohérence de toute conception universalisante de la géographie.
François commence et finit son livre à la fois par la contemplation du globe de son dérivé, la carte. Il l’ouvre en disant au lecteur qu’il a commencé ce travail parce que « quelqu’un qui commandait » lui avait demandé de lui fabriquer un « globe terrestre artificiel et un traité sur ses propriétés » :
« Afin de lui obéir et de lui plaire, je pensais seulement faire un petit livre de géographie. Mais la fécondité du sujet m’a amené insensiblement à composer une ample Cosmographie dans laquelle je déduis les raisons et le noble effet de l’art Divin et de l’habileté et l’exactitude des plus importantes pratiques du talent artistique humain »105.
Incapable de résister à la richesse du sujet, il se trouve amené du globe lui-même à une étude du monde comme créé par Dieu et utilisé par les humains. Mais l’essentiel du livre demeure, nonobstant l’explication de ce globe, l’image qu’il met en œuvre pour le lecteur tout au long du livre. François joue volontiers avec le globe comme concept ou abstraction d’un côté et réalité créée par Dieu de l’autre – conduisant ainsi le globe à tenir la place de la terre et la terre, à tenir celle du globe106. Cela force le lecteur à considérer le tout, tandis que François décrit et explore ses parties en conformité avec l’une des lois fondamentales de la géographie (plus tard, cartographie) :
« Nous pouvons arriver seulement à une connaissance totale du Globe à travers la connaissance des parties dont il est composé et celles-ci ne peuvent être acquises qu’à travers des observations faites sur la localisation »107.
Ce sont le globe et la carte qui permettent l’étude jointe et unifiée du général et du particulier à travers l’importance qu’ils donnent au lieu (on reviendra plus loin sur ce point). Les cartes et les globes sont toutefois plus que des abstractions. Ils constituent aussi une forme graphique dotée d’un grand pouvoir explicatif. François explique ceci dans des termes qui font penser à ceux des sensibilistes de la fin du XVIIIe siècle :
« Celui qui disait ceci le disait bien : le discours est une peinture parlante et la peinture est un discours muet parce que c’est à travers l’un ou l’autre de ces moyens que nous exprimons les objets de notre pensée. Et si, dans un grand nombre de sujets, le mot parlé a un avantage sur la peinture en faisant plus clairement comprendre certaines vérités, comme celles qui ont trait aux choses spirituelles, il est sûr que ce qui touche la quantité et le sujet des mathématiques est mieux représenté par ce dont nous avons discuté que par le mot seul. Et regarder au juste une figure qui est la parfaite image d’un corps la fera mieux comprendre qu’un long discours composé d’une multitude de mots et d’intervalles. La raison de ceci résulte de deux choses : 1- de l’objet lui-même qui, étant sensible, demande à être représenté selon sa propre faculté (ou sensibilité) soit immédiatement et par lui-même, ou d’une manière médiate par quelque chose qui lui est semblable mais qui est autre. 2- d’une partie de nos facultés dont l’ordre est de passer des sens à l’imagination et de celle-ci à la compréhension. C’est ainsi qu’une parfaite image est présentée à nos sens pour être transportée aux autres facultés. Et s’il y a quelque erreur, elle vient de la première représentation, et pas de celles qui suivent »108.
Les cartes et les globes sont de valeur parce que, en tant que modèles, ils reflètent mieux la nature de la terre et parce qu’ils offrent une voie plus directe à la compréhension à travers l’imagination via les sens. Au cœur de la géographie de François se trouve ce qui va être connu comme la cartographie : il s’agit à la fois du foyer conceptuel de la géographie, de sa méthode et, étroitement liés aux principes unificateurs de la géographie, du mouvement et du lieu.
Le sentiment qu’a François de l’unité de la géographie et de la connectivité fondamentale de toutes ses parties est née d’une réflexion menée avec soin. Il décrit la géographie comme traditionnellement concernée par les divisions que l’on peut trouver sur la terre – naturelles, humaines ou célestes – et par leur peinture. Il soutient aussi que le sujet de la géographie inclut plus que cela. La géographie n’est pas juste faite de divisions ; elle l’est aussi d’universalités et de particularités et ce sont celles-ci et les relations entre elles qui donnent à la géographie sa valeur scientifique.
Les universalités incluent la lumière, la chaleur, la raréfaction, le mouvement et l’échange, qu’il soit physique ou abstrait. François offre une discussion détaillée des sources et de la nature de chacune d’elles. Il y a des universalités à trouver partout dans le monde ; elles émanent, en première instance, du soleil mais incluent aussi l’action spatiale humaine. Dans un passage, il donne au lecteur une claire idée des actions des universalités :
« La lumière qui suit le soleil fait le changement entre la nuit et le jour ; la chaleur qui suit la lumière fait le changement des saisons et les bénéfices qu’apportent les saisons. Les raréfactions qui accompagnent la chaleur transforment l’eau en un millier de “météores” et transportent ceux-ci dans mille localisations différentes. Les mouvements qui viennent de la raréfaction provoquent mille transports de corps d’une localisation à l’autre »109.
La géographie, en tant qu’étude de ces universalités, inclut la prise en considération de l’action du soleil sur la terre110, la variation des saisons, la distribution des plantes et des animaux, la météorologie, l’hydrographe peut-être, et le commerce et les communications111.
Les particularités sont de trois sortes : miraculeuses (ou celles associées avec Dieu agissant en tant que Dieu, autrement dit comme cause finale), naturelles et humaines. La première catégorie appartient en vérité au domaine de la philosophie, ou, parce que Dieu est le créateur de l’univers, au domaine de la cosmologie. Les deux dernières appartiennent au domaine de la « science humaine »112. Chaque lieu sur la terre doit être ou divin, ou naturel, ou humain et tous les événements humains sont hautement particuliers, c’est-à-dire enracinés dans l’espace et dans le temps. En vue de comprendre les causes de ses particularités et de voir les relations entre les particularités et les généralités, le meilleur objet, selon François, est le lieu. L’histoire et la géographie se rencontrent dans le « lieu » et celui-ci unifie l’homme, la nature et Dieu.
Telle est ainsi la science de la géographie. Elle s’exprime par des divisions et par la cartographie et s’appuie sur elles pour organiser la pensée. Ces structures et ces méthodes ne constituent cependant pas la totalité, et c’est la totalité qui est le but de la géographie113. La totalité ne consiste pas à étudier le tout du cosmos. C’est là étudier une particularité particulière. La totalité consiste plutôt à se mouvoir constamment du particulier (tel que la ville) à l’universel (comme ses relations commerciales avec ses voisines) et entre les particularités (comme entre une ville et son emplacement), comme le ferait un cartographe, à la recherche de la peinture la plus large – à la recherche de la compréhension et de la cause efficiente (et pas finale).
La supposition naturelle d’un géographe du XIXe – ou du XXe – remarquant l’intérêt de François pour la cartographie et sa tendance périodique à l’énumération serait qu’il concevait la géographie comme au premier chef descriptive et concernée par l’enregistrement de faits connu. Rien ne saurait être plus loin de la vérité. Dans sa Science de la géographie, François rejette plusieurs fois le rôle que les géographies universelles furent si prêtes à assumer au cours des siècles suivants : celui d’enregistrer les faits connus et d’énumérer toutes les divisions et subdivisions possibles de la terre114. Les divisions et subdivisions sont importantes. Le propos de la géographie se situe cependant plus haut que ces sujets « qui appartiennent plus proprement à la mémoire et aux plus simples opérations de l’esprit qu’à la discussion et à la raison ». Comme Mentelle le découvrit plus tard, et comme François le souligne, la mémorisation, qui « revient à exprimer ce qui est déjà connu et à imprimer l’image de choses qui sont déjà conçues », est une science d’enfants et ne demande aucun maître pour l’enseigner. Pour François, le rôle réel de la géographie est double : préparer l’esprit à explorer – et à cette fin, il voit dans son texte un moyen de « libérer l’imagination, d’accélérer la conceptualisation et de raffermir la mémoire » – et de s’engager dans la création d’une compréhension « via la conquête de vérités cachées »115. La géographie est donc une entreprise d’enquête, qui n’est pas intimidée face à des questions ouvertes. En fait, son souci est de structurer son livre pour encourager de telles questions. Il choisit donc de séparer sa discussion des phénomènes naturels de celle des structures civiles comme, pense-t-il, cela aurait toute chance d’améliorer la compréhension des relations entre les phénomènes physiques (qui, l’admet-il, requiert une prise solide sur l’histoire naturelle)116. Il n’hésite pas non plus à explorer lui-même de telles questions. En géographie physique, il se demande par exemple d’où sont venus les animaux des îles lointaines. En géographie humaine, il réfléchit au rôle et à l’importance pour l’histoire du premier voyage de Christophe Colomb, et explore les raisons qui rendent un État prospère ; il se demande même ce qui fait d’une entité civile une unité (une question que sous une forme légèrement améliorée est encore posée dans l’ensemble du monde). Il situe certaines questions hors de la compétence de la géographie. C’est ainsi que les causes fondamentales ou finales (celles reliées à Dieu) doivent être étudiées par la philosophie. De la même manière, il est préférable de ne pas « creuser et chercher à travers les boyaux de la terre afin de révéler les métaux, les minerais et les divers mélanges de substances que la chaleur élémentaire a formés en des lieux variés »117. Cette activité, qui est méritoire, revient plutôt aux naturalistes. François cherche plutôt à se concentrer sur la « surface terrestre qui sert d’habitat aux hommes afin de montrer la diversité de la base, de la matière, des fruits et de la figure qu’elle a en vertu de la nature et de l’art »118. Cela laisse à la géographie plus qu’assez pour qu’elle puisse y faire face.
François a un sentiment clair de la place de la géographie parmi les sciences. Il la décrit comme l’une des sciences subalternes, c’est-à-dire comme une science qui, au lieu d’étudier les principes et les objets en eux-mêmes, étudie les effets des principes et des relations entre les objets « sur le globe de la terre comme une œuvre artificielle »119. L’étude des principes et de la nature des objets eux-mêmes revient à d’autres sciences comme la physique, l’astronomie et la géométrie et peut être abordée et utilisée par les géographes pour mieux comprendre le monde. Mais ce sont les effets de ceux-ci à la surface de la terre (toutes les créatures y étant inclues) qui constituent la géographie.
En ce qui concerne les autres sciences subalternes, François ne mentionne que l’histoire et l’histoire naturelle. La géographie, pour lui, offre un fondement à l’histoire. Dans cette veine, il a une conception très géographique de l’histoire. L’histoire enregistre les événements intervenus dans des lieux particuliers et qui sont, en partie, façonnés par eux120. De plus, l’histoire ajoute de la profondeur au lieu et peut stimuler sa mémorisation. Comme telles, l’histoire et la géographie sont inséparables, mais radicalement différentes dans leur propos. De l’histoire naturelle, il dit relativement peu, sauf qu’elle est subalterne de la chimie et qu’elle est, au premier chef, concernée par la classification des plantes et des animaux.
En ce qui va devenir un trait caractéristique des géographies universelles, François va aussi s’engager dans un petit plaidoyer géographique. La géographie, dit-il, est une noble science car :
« Elle envisage la terre d’une façon plus noble et agréable que les sciences voisines focalisées sur le même globe. Elle considère la terre comme la source de toute fécondité et la mère nourricière de tous les animaux, et la maison de l’Homme »121.
La noblesse de la géographie est ainsi une fonction de sa vision holistique de la terre. Selon François, c’est aussi un sujet plaisant et agréable grâce à la passion et au plaisir éprouvés en voyageant et découvrant le monde. Il est naturel à l’âme humaine, soutient-il, de trouver du plaisir dans de telles activités. Finalement, c’est une science intellectuellement utile : utile pour l’histoire comme déjà indiqué ; utile pour la cosmographie, qui, avec la géographie, peut commencer à explorer les différences que notre globe a avec les autres ; et utile en soi et pour soi comme « connaissance acquise à travers de très difficiles observations »122. La géographie, centrée sur la carte et composée de connaissances à la fois locales et universelles, est une science à la fois noble, plaisante et utile.
La géographie de François ne peut pas être utilisée par les géographes d’aujourd’hui pour défendre telle ou telle école ou tendance moderne. Elle appartient clairement à un âge différent et supposer des correspondances entre elle et beaucoup de traits contemporains serait prendre un risque considérable. C’est peut-être pour cela qu’elle a été condamnée à l’oubli – au moins jusqu’à ce que les géographes ne redécouvrent l’extraordinaire richesse de leur passé. Il est cependant frappant qu’en opposition avec la majorité des géographies, universelles ou autres, anciennes ou nouvelles, le lecteur qui explore la Science de la géographie puisse trouver en elle, plus de 340 ans après sa publication, des idées qui puissent exciter l’esprit et une conception de la géographie qui possède encore de la vie – en dépit du fait qu’elle ne peut exister dans le contexte de la science moderne et de la vie quotidienne.
Le Cosmos d’Alexandre de Humboldt
Approximativement 1 800 ans après Strabon, 196 ans après le Père François et 38 ans simplement après la publication du premier volume de Malte-Brun, Alexandre de Humboldt (1769-1859) commence à publier son Cosmos. C’est le point culminant d’une carrière remarquable et considérable qui a encadré et largement excédé la durée de vie de Malte-Brun. Alexandre de Humboldt est un savant d’une dimension et d’un talent inusités. Formé pour la bureaucratie d’État, il poursuit depuis tôt dans son existence son intérêt pour la nature et l’étude de celle-ci, et quittant la bureaucratie aussitôt que la mort de sa mère lui en donne les moyens de le faire. Au cours de sa vie, il mène des recherches dans des sujets que nous assignerions aujourd’hui à la linguistique, à l’art, à la botanique, à la zoologie, à l’histoire des sciences, à l’histoire politique, à la géographie, à l’anthropologie, aux langues, à la physique, à la météorologie, à la chimie, à l’astronomie et à l’optique. Formé comme ingénieur des mines et dans les sciences associées, qui ont nourri en lui un respect pour la recherche empirique, il acquiert par lui-même tout au long de sa vie les compétences dont il a besoin pour explorer les questions qui l’intéressent, ou coopère avec des chercheurs comme Aimé Bonpland, Leopold von Buch et Georg Forster, grâce auxquels il apprend celles qui lui sont nécessaires, ou correspond et échange des idées avec ceux qui sont capables de l’aider. De plus, et durant la plus grande partie de son active vie scientifique, Humboldt dispose d’une fortune qui finance sa recherche indépendamment de toute encadrement institutionnel ou étatique. C’est donc sans surprise que l’on constate qu’il est impossible d’assigner cet esprit universel à une affiliation disciplinaire unique.
Au cours de sa vie et de sa recherche, Humboldt est le témoin d’une transformation radicale de la nature de la science. Au cours des quelques soixante-dix ans débutant avec son entrée dans le domaine de la recherche empirique, les sciences naturelles se sont multipliées, ont développé des méthodologies distinctes et taillé dans la nature différents domaines disciplinaires. Humboldt joue un rôle significatif dans l’évolution de nombre de ces disciplines, particulièrement la botanique, la géographie des plantes, la zoologie, la géologie, la géodésie, la météorologie et la géophysique. Après une existence consacrée à des recherches scientifiques spécialisées, à l’écriture et à l’autoformation en sciences naturelles, Humboldt cherche à situer son travail et sa pensée dans un cadre intellectuel plus large. Cela ne veut pas dire que la croyance de Humboldt dans l’unité de la nature et son intérêt pour ses interconnexions soit apparu pour la première fois dans le Cosmos. Ils sont déjà sensibles dans son travail sur la géographie des plantes qui date, sous sa première forme, de 1793123. Son Cosmos est en partie un essai pour contrer la fragmentation intellectuelle qui prévaut dans la recherche sur la nature. C’est une tentative pour retourner à une approche holistique de la science sans abandonner les avancées dans l’étude de la nature apportées par l’évolution des sciences naturelles systématiques et théoriques. À cette fin, il tente, dans son Cosmos, de réconcilier les objectifs métaphysiques de la philosophie de la nature (Naturphilosophie) qui ont toujours guidé sa recherche et les buts plus immédiats de la science empirique, pour intégrer nature et pensée sur la nature. Autrement dit, il essaie de relier le monde naturel extérieur à l’existence humaine à travers l’imagination créative de l’homme. L’intégration de la pensée scientifique, humaniste et artistique, même si elle porte uniquement sur l’observation de la nature, est alors presqu’aussi problématique qu’elle ne l’est aujourd’hui. Humboldt, toutefois, rejette fondamentalement l’opposition et la hiérarchisation des efforts scientifiques, humanistes et artistiques. Dans le Cosmos, il cherche à réunifier la créativité humaine en présentant l’état actuel et l’évolution historique des perceptions et représentations scientifiques, humanistes et artistiques de la nature.
Le Cosmos diffère si radicalement des géographies universelles traditionnelles qu’il n’a jamais été considéré comme appartenant au même genre. Il offre cependant une ressemblance formelle considérable avec les géographies universelles de ses prédécesseurs, Malte-Brun compris, et de ses successeurs. Comme la majorité de ces publications, c’est une œuvre monumentale en plusieurs volumes – de quelques 1800 pages dans son cas. Son intention avouée, en conformité avec les objectifs des géographies universelles depuis l’époque de Strabon, est la « description » de l’univers124 plutôt que la poursuite de principes abstraits ou que l’engagement dans « les mystérieux et insolubles problèmes de l’origine et de l’existence »125. Comme les travaux de Delisle, d’Expilly et de Mentelle, il commence par situer la terre dans son contexte astronomique. Comme le Précis de Malte-Brun, il accorde une grande importance et beaucoup de place à l’évolution historique des conceptions courantes du cosmos. Humboldt insiste enfin sur le fait que son Cosmos ne doit pas être compris comme « une simple agrégation encyclopédique des résultats les plus importants et les plus généraux qui ont été réunis des branches principales du savoir »126. De tels faits individuels et leur simple agrégation
« ne sont rien d’autre que les matériaux d’un vaste édifice, et leur combinaison ne peut pas constituer l’histoire physique du globe, dont la partie élevée consiste à montrer l’action simultanée et les liens qui connectent les forces qui sont en jeu dans l’univers. La distribution de types organiques dans les différents climats et à différentes altitudes – c’est-à-dire la géographie des plantes et des animaux – diffère tout autant de la botanique ou de la zoologie descriptive, que la géologie ne le fait de la minéralogie, ainsi appelées correctement. L’histoire physique de l’univers ne doit donc pas être confondue avec les “Encyclopédies des Sciences Naturelles”, comme elles ont été compilées jusqu’ici, et dont le titre est aussi vague que leurs limites sont mal définies. Dans le travail qui est devant nous, les faits partiels ne seront pris en considération qu’en relation avec le tout. Plus haut est le point de vue, plus grande est la nécessité d’un mode systématique de traiter le sujet dans une langue à la fois animée et pittoresque »127.
Ceci saisit, en théorie, la nature de toutes les géographies universelles : historique, descriptive, intégrative et fondamentalement spatiale. En fait, peu de géographies universelles réalisent quelque chose qui ressemble à ce type de synthèse, et le Cosmos est, en ceci et en d’autres manières, distinctement différent des géographies universelles classiques et plus semblable à celle du Père François. Comme François, Humboldt rejette l’énumération des lieux comme d’un intérêt intellectuel relativement faible et, allant plus loin, exclut la classification du champ de la cosmologie. De manière similaire, alors que Humboldt, comme Malte-Brun, croit fermement en la valeur et au pouvoir de la description, comme pour François, son engagement dans la théorie et la science expérimentale est considérable. Humboldt propose en fait une réforme de la géographie physique, qui équivaut à renoncer à ses préoccupations traditionnelles en faveur d’un raisonnement, d’une méthodologie et d’une place parmi les « connaissances humaines ». Humboldt partage certainement avec Malte-Brun un goût pour l’expression littéraire, mais il adopte une approche très critique de son rôle, de sa puissance et de ses limitations dans la nouvelle géographie physique qu’est le Cosmos. Humboldt et François partagent finalement un engagement pour l’unité de la nature, né d’une conviction religieuse dans le cas de François, et d’une conviction esthétique et philosophique dans celui de Humboldt. Nous pouvons voir en fait le Cosmos de Humboldt comme le dernier ouvrage qui traite, pour plus d’un siècle, de la nature, de la culture, de la science et de l’art comme un tout intégré. De tous ces essais, celui de Humboldt est peut-être le plus grand et le plus impossible comme il cherche à englober dans le cosmos tout ce qui va du monde animé au monde inanimé et du télécospiquement lointain au microscopiquement proche en une vision cohérente unique informée par la science, la littérature et l’art.
Tel qu’il a été écrit, le Cosmos est un travail beaucoup plus limité. Les deux premiers volumes sont un discours introductif sur la valeur et le propos d’une étude interdisciplinaire et unificatrice du cosmos, un survol/plan général de l’ouvrage, une brève histoire de la description textuelle de la nature, une brève histoire de la représentation de la nature et de sa modélisation (comme dans les jardins et le jardinage) et une histoire plus longue de la contemplation scientifique du cosmos128. Les volumes 3 et 4 sont centrés sur la portion céleste du cosmos : les étoiles et les problèmes théoriques et pratiques de leur observation, et la région du système solaire. Le volume 5 retourne à la terre pour examiner sa nature physique depuis sa taille, sa forme et sa densité jusqu’à sa chaleur interne, son activité magnétique, ses tremblements, ses sources thermales et finalement ses volcans. Que le Cosmos soit un ouvrage incomplet ressort clairement de la comparaison de la vue d’ensemble des sujets couverts par le volume 1 avec la structure du travail final. Pour sa plus grande part, l’ouvrage publié suit le plan dessiné dans la vue d’ensemble, mais s’arrête brusquement aux deux-tiers du chemin qui y est tracé. Planifiés dans la vue d’ensemble mais manquant dans le travail publié se notent une discussion détaillée de la paléontologie, de la météorologie, de la climatologie, de la vie organique, du mouvement des plantes, de l’universalité de la vie animale, de la géographie des plantes et des animaux, des flores des différentes contrées, de « l’homme », des races et du langage. Le Cosmos tel qu’il a été écrit est donc très différent de celui dont Humboldt avait le projet et de celui discuté dans les deux premiers volumes. Le Cosmos projeté devait avoir l’ampleur typique d’une géographie universelle et s’étendre de l’astronomique au physique et à l’humain. Avec l’engagement de Humboldt en faveur à la fois de la science moderne et des humanités, il y avait des raisons d’espérer plus encore : une étude vraiment intégrative du cosmos avec l’humanité – en tant que perceptrice, admiratrice et imitatrice de la nature – en son centre même.
Dans son Cosmos, Humboldt établit une distinction tranchante entre la géographie et la nouvelle science que met en avant l’ouvrage, la géographie physique. La géographie à laquelle il associe l’énumération des toponymes et celle des traits physiques est, comme beaucoup de « branches de la connaissance empirique », écrasée par le poids de son passé et la nécessité de la réformer ou de la remplacer par une conception plus moderne129. Loin de rejeter toutes les frontières et structures intellectuelles, Humboldt est aussi concerné que Malte-Brun ne l’avait été par les problèmes de territoire et de statut intellectuel. Au lieu de défendre un vieux domaine tel que la géographie ou l’une des nouvelles sciences systématiques, Humboldt, ici aussi inspiré par les philosophes de la nature130, propose vraiment une reformulation radicale des champs reconnus et nommés dès l’Antiquité pour ériger des frontières autour de son étude unificatrice de la nature. Ce nouveau champ serait dévolu aux interactions et connexions plutôt qu’à l’énumération, à la classification131 et au caractère des phénomènes « indépendants des relations géographiques de l’espace »132. Au cœur de cette nouvelle étude se trouve quelque chose de voisin de la méthode comparative de Ritter133, moins centrée sur les traits physiques particuliers ou les structures humaines que sur la relation entre la compréhension humaine de la nature et la nature elle-même134.
Humboldt est aussi convaincu de l’importance, pour cette nouvelle science, de la description que Malte-Brun, Strabon ou François l’avaient été de sa centralité pour la géographie135. Une bonne description littéraire interdit la verbosité, les fioritures excessives et la poésie pastorale, mais émane d’une observation culturellement informée et attentive de la nature. Pour Humboldt, une bonne description littéraire est ainsi elle-même scientifique et ne s’oppose pas à la théorie, à l’explication ou à l’observation. Peut-être en réponse à l’influence des premiers positivistes, il voit moins d’opposition entre description et théorie qu’entre empirisme pur et science théorique. C’est le pur empirisme qui est antithétique des buts du Cosmos : son approche non réflexive et non critique de la nature peut induire en erreur136. Le Cosmos incorpore une philosophie de la nature et rien ne pourra remplacer une approche théorique et philosophique de la nature137. Comme pour François, une bonne description scientifique doit être informée par une saine investigation des particularités en conjonction avec la contemplation des universalités (bien que leurs définitions des universalités et des particularités diffèrent). En raison, en partie, des développements des sciences théoriques depuis l’époque de Malte-Brun, Humboldt est bien moins préoccupé par les dangers de la spéculation que ne l’était celui-ci. Il tient la géologie en haute estime précisément pour sa « solide fondation de déduction scientifique »138. Parlant de la contemplation de la langue, de la race, de la descendance, un domaine de spéculation beaucoup plus risqué, il commente : « ici, comme dans tous les domaines de spéculation idéale, les risques d’erreur sont étroitement liés au profit riche et certain que l’on peut en tirer »139.
Le concept central derrière le Cosmos de Humboldt est l’unité de la nature – un argument défendu aussi par François. Presque tous les autres auteurs de géographies universelles considèrent cette unité comme évidente par elle-même et l’abordent seulement à travers la structure de leurs publications. Humboldt cherche à mettre en évidence les liens physiques et idéationnels entre des phénomènes de toute sorte. Pour Humboldt, la nature inclut l’organique, l’inorganique et les domaines idéels au sein à la fois des domaines célestes et telluriques140. Il croit que l’esprit est naturellement conduit à une vision unifiée de la nature qui résulte de la tendance de l’imagination humaine à rechercher « une certaine analogie secrète »141 liant toute chose.
Humboldt considère que cette tendance est renforcée par le caractère même du paysage, « car le grand caractère d’un paysage et de toute scène imposante de la nature dépend de la simultanéité des idées et des sentiments qui se trouvent excités dans l’observateur »142. Il retourne aux périodes où la séparation entre les domaines humain et physique existait à peine : dans les histoires des Grecs anciens143 ou dans les récits de voyage médiévaux144. Mais il reconnaît que dans le monde moderne, une vision holistique qui ne veut pas être une « vaine illusion »145 doit être fondée sur la base solide des sciences spécialisées de l’observation et de l’expérience. Il en est ainsi parce que « l’effet puissant de la nature résulte, si l’on peut dire, de la connexion et de l’unité des impressions et des émotions produites ; et nous ne pouvons remonter à leurs différentes sources qu’en analysant l’individualité des objets et la diversité des forces »146. L’unité de la nature existe ainsi autant dans l’esprit humain que dans la nature elle-même. Étudier la nature, c’est ainsi étudier l’esprit humain, et étudier l’art, la science et la littérature est étudier la nature. Humboldt voit peu de différence entre les deux domaines : car le but des sciences humaines comme des sciences physiques est de rechercher et de comprendre cause et processus147. Cela ne veut pas dire que Humboldt ne reconnaisse pas de différence entre les sciences. Il semble en fait avoir conçu une hiérarchie des sciences avec les sciences expérimentales à leur base, les sciences dévolues à la description de l’univers (et dépendant des sciences expérimentales) au niveau suivant et quelque chose qu’il appelle les « plus hautes vues spéculatives » au pinacle148. Humboldt parle peu des dernières sauf lorsqu’il aborde des questions au-delà du domaine des sciences expérimentales et descriptives comme celle des origines de la vie. C’est cette vision unificatrice embrassant à la fois la nature et son étude qui a tant attiré les géographes vers le Cosmos de Humboldt et qui contraste tant avec le développement des sciences naturelles jusqu’à la montée de l’écologie. L’unité supposée par Humboldt et si éloquemment argumentée dans les deux premiers volumes de son travail est moins évidente dans les trois derniers et témoigne ainsi de la nature incomplète de la publication. Humboldt reconnaît que l’énormité même de l’étude qu’il propose signifie qu’aucun discours la présentant, quelle que soit sa longueur, ne pourra jamais être complet, mais le Cosmos est certainement plus incomplet que Humboldt ne l’avait voulu149.
Conclusion
Une lecture attentive de l’œuvre de Humboldt, à la fois du Cosmos et de son travail antérieur sur son expédition aux Amériques, révèle l’influence prépondérante du romantisme et de la philosophie de la nature sur sa pensée. Humboldt partage avec les philosophes de la nature une croyance dans l’unité de l’homme, de la nature, de l’entreprise intellectuelle qu’est la science pour comprendre la nature, de l’entreprise spirituelle qu’est aussi l’art pour comprendre celle-ci, et de l’histoire les concernant. Son Cosmos est une tentative d’exprimer et d’explorer cette unité. La nature et la saveur de cette unité est très différente de l’holisme incorporé dans les géographies universelles de Malte-Brun et de ses prédécesseurs du XVIIIe siècle. Ces géographes étaient engagés dans une géographie descriptive analogue à l’histoire naturelle descriptive, bien qu’avec une sphère bien moins délimitée et sans la logique interne du système de Linné ou de ceux de ses successeurs. Soucieux d’assimiler la connaissance établie de la terre et de l’utiliser pour arriver à une description aussi complète, aussi méthodique, aussi systématique et aussi précise que possible de la terre, leur travail semble avoir perdu, depuis l’époque de François, tout propos d’ordre supérieur ou spirituel. La pensée de Humboldt bénéficie du levain de la métaphysique et de sa croyance presque religieuse dans l’unité de la nature, de la culture, de la science et de l’art. En un sens, Humboldt est très semblable aux géographes français en ce qu’il cherche à décrire le cosmos et exprime ainsi sa croyance en son unité. Le concept d’unité de Humboldt n’est cependant pas une hypothèse clandestine. C’est une croyance profonde et fréquemment exprimée selon laquelle le cosmos est gouverné par des lois naturelles s’exerçant dans toute sphère. Cette recherche des lois naturelles motive son exploration du cosmos par le voyage, l’observation, l’expérimentation, la collecte et la comparaison de spécimens, la cartographie, l’étude et la contemplation. Humboldt intéresse de nombreux géographes modernes parce que son étude du cosmos suggère la possibilité d’une réconciliation entre l’holisme de la géographie d’un côté et de l’autre, les sciences empiriques plus spécialisées qui occupent le centre de la scène depuis 150 ans. Il est intéressant et significatif qu’une telle possibilité n’ait pas été perçue par les géographes français contemporains de Humboldt, sans doute parce que son expression métaphysique de l’unité du cosmos, l’essence de son approche, leur était si étrangère qu’ils n’y ont simplement pas prêté attention.
Le Cosmos de Humboldt représente ainsi, de bien des façons, une coupure majeure avec la tradition des géographies universelles telle qu’elle avait été écrite depuis Strabon. Son but avoué n’est pas l’utilité politique. Humboldt est en fait un des rares chercheurs de son temps qui peut se permettre de ne pas tenir compte de ces questions150. Par opposition aux géographies de Strabon, de Delisle, d’Expilly, de Mentelle et de Malte-Brun, la géographie physique de Humboldt embrasse l’étude de la cause, l’examen de l’inconnu et le centrage sur le détail typique des sciences empiriques. À une époque où la description sans lien aussi bien avec la recherche empirique qu’avec la théorie a cessé d’être en faveur, Humboldt cherche à réintégrer la description, le travail empirique et la théorie relative au cosmos. Bien que les contextes aient été radicalement différents et que François n’ait pas eu à faire face au même volume d’information ou de problèmes d’intégration interdisciplinaire, leur solution au défi de l’écriture d’une géographie universelle est remarquablement similaire. Tout comme Humboldt, François tient l’unité du globe ou du cosmos comme le point fondamental de sa démonstration. Il y parvient en mettant l’accent sur le globe, Humboldt le fait en se concentrant sur les créations de l’esprit humain. Les deux soutiennent l’importance de passer d’une étude rapprochée des parties à une appréhension du tout. Ce faisant, François reproduit la procédure cartographique alors que Humboldt cherche à contextualiser, à cataloguer et à mettre à jour tout son itinéraire de recherche empirique. Les deux embrassent chaleureusement les défis intellectuels de leur époque, mais chacun se trouve au bord d’une nouvelle conception du monde physique qui date leur travail : pour François, c’est la révolution copernicienne (depuis longtemps découverte, mais pas encore intégrée), pour Humboldt, c’est la pensée évolutionniste. Les deux font de fortes déclarations sur le rôle de leur champ d’étude dans les « connaissances humaines ». Ni l’un, ni l’autre n’altéreront profondément la manière dont les géographies universelles sont écrites, mais les deux, grâce à leur originalité et à leur préscience, retiennent particulièrement l’attention des chercheurs et des historiens de la géographie. En particulier, le travail de Humboldt, en dépit de sa très incomplète discussion du domaine vivant, sert de pierre de touche, de test, pour les géographes portés sur l’écologie à la fin du XXe siècle. Il fait cependant peu de doute que la plus remarquable des géographies universelles discutées ici est celle du Père François – à la fois pour sa cohérence et pour l’élégance de sa vision.
Il était ainsi possible d’écrire une géographie intellectuellement engagée au milieu du XVIIe siècle sans en faire le travail d’une vie. Il est difficile, en revanche, d’imaginer quelle conception de la nature aurait donné à Humboldt à la fois l’unité et la compréhension détaillée qu’il cherchait dans tous les domaines de la nature et de l’activité humaine. Il est aussi important de se rappeler que notre compréhension est le produit de l’accumulation des générations de recherches dans les sciences spécialisées, les sciences sociales et les humanités. En conséquence les visions unificatrices que nous embrassons périodiquement, comme la vision darwinienne de la nature et de la société, et peut-être plus récemment comme l’approche écologique de la nature et de la société, sont toujours seulement partielles. Nous acceptons volontiers ce fait. Peut-être ne pensons-nous plus en termes de totalité. La tentative de Humboldt était-elle ainsi vouée à l’échec, ou est-ce une conception défectueuse de l’histoire ? Et qu’en est-il des géographies universelles plus traditionnelles ? En un sens, elles remplissaient leur propos déclaré : l’éducation générale et la diffusion d’un certain savoir. Elles ne pouvaient cependant que peu faire pour gagner le respect et attirer l’attention de la communauté scientifique élargie dans un âge où la recherche empirique guidée par la théorie devenait de plus en plus rigoureuse. Une des solutions traditionnelles à la perte d’orientation et de statut de la géographie était clairement une impasse, ou à tout le moins, un marigot intellectuel.
Notes
- « En dépit du nombre de ceux qui ont entrepris ceci avant nous, si à notre tour nous entreprenons de traiter les mêmes sujets, nous ne pouvons être blâmés, à moins qu’il ne soit prouvé que nos propres développements n’apportent rien ». Strabon, Géographie, (1969), 1, p. 85.
- Lestringant a beaucoup écrit sur la tradition cosmographique durant la Renaissance. Il considère que vers la fin de la Renaissance, le genre que constituait la cosmographie était en déclin. Son argument est qu’avec les Grandes Découvertes et la croissance de la connaissance qu’elles représentaient pour la pensée occidentale, les cosmographies se heurtèrent à trois défis intellectuels principaux auxquels elles ne purent répondre. C’était : (1) comment préserver le holisme face à une connaissance en croissance rapide et hautement diverse, (2) la distance croissante entre la connaissance géographique théorique (ou de cabinet) et sa forme pratique (la navigation) et (3) son incapacité à concilier l’autorité du voir par soi-même et l’autorité textuelle (celle généralement des textes anciens) d’une manière qui corresponde à l’échelle et à la cohérence d’une cosmographie. Je suis d’accord pour considérer que le premier et le troisième dilemmes sont hautement problématiques pour la logique d’une cosmographie ou d’une géographie universelle. Il est cependant important de noter que les géographes continuèrent à écrire des géographies universelles ou des cosmographies et que celles-ci demeurèrent des genres étroitement attachés à la géographie jusqu’au XIXe siècle. Voir spécialement : Lestringant, « Le Déclin d’un savoir » (1993), p. 319-340.
- Proisy d’Eppe, Dictionnaire des girouettes (1815), p. 256-273. Ce livre fut écrit pour stigmatiser les gens puissants et prééminents qui depuis 1789 avaient changé leurs allégeances politiques. Chaque nom était suivi par une série de leurs déclarations contradictoires. Le livre connut une énorme popularité.
- Le Journal de l’Empire, connu comme le Journal des Débats de 1789 à 1805, était le journal le plus lu dans le Paris de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe. C’était un journal contre-révolutionnaire qui attaquait l’esprit et les écrits des Lumières. Après 1805, et en dépit de son soutien ouvert à Napoléon, il souffrit d’une croissante censure. Voir : André Cabanis, « Journal des Débats » (1987), p. 981-983 ; et Alfred, Histoire politique (1938).
- Journal de l’Empire (22 février 1807), p. 3.
- Conrad Malte-Brun, revue de « La Campagne des armées françaises en Saxe » (1807), p. 3-4.
- Conrad Malte-Brun, dir., Annales des voyages (1807-), 1, p. 122.
- Conrad Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 1, p. 5.
- Six volumes étaient rédigés avant sa mort en 1826. Deux volumes ont été écrits et publiés de manière posthume après celle-ci.
- Drohojowska, « Malte-Brun. Précis de la géographie universelle » (1884), p. 18-19. Vivien de Saint-Martin, dans sa table des matières, décrit Malte-Brun comme un égal de Ritter pour son importante géographie descriptive. Louis Vivien de Saint-Martin, Histoire de la géographie (1873). Adrien Balbi joua un rôle particulièrement important dans l’établissement et la construction de la réputation de Malte-Brun. Ses travaux sont pleins de références laudatives à Malte-Brun.
- Broc, « Un Bicentenaire : Malte-Brun » (1975), p. 720.
- Voir l’article où Conrad Malte-Brun rend compte de la nouvelle « Géographie de Strabon, traduite du grec dans le Journal de l’Empire » (1er novembre 1807), p. 3-4 ; Malte-Brun, Annales des voyages (1807), 1, p. 120 ; Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), volume 5 ; Malte-Brun, Précis de géographie universelle (1829), 8, p. 155.
- Les archéologues ont trouvé qu’Homère était une excellente source d’information géographique et historique, mais comme Pierre Lévêque l’expose : « L’Iliade et l’Odyssée sont d’une nature beaucoup trop composite pour que l’historien entreprenne leur étude sans précautions ». Voir Pierre Lévêque, L’Aventure grecque (1964), p. 47.
- « Si la philosophie politique est essentiellement orientée vers ceux qui gouvernent et si la géographie correspond aussi aux besoins du gouvernement, cela devrait être un avantage de la géographie. Cet avantage repose dans le domaine de l’action ». Strabon, Géographie (1969), 1, p. 80.
- Strabon, Géographie (1969), 1, p. 77-78.
- Strabon, Géographie (1969), 1, p. 171.
- « Mais c’est encore plus riche. Il affirme qu’il ne peut voir aucune valeur pratique dans l’étude des frontières » Strabon, Géographie (1969), 1, p. 172.
- Strabon, Géographie (1969), 2, p. 37-38.
- Strabon, Géographie (1969), 1, p. 78.
- Strabon tire une ligne entre les Aristotéliciens à la recherche de la cause et les Stoïciens à la recherche de clarté. Strabon, Géographie (1969), 2, p. 69.
- Strabon, Géographie (1969), 1, p. 84.
- Strabon, Géographie (1969), 1, p. 144.
- Strabon, Géographie (1969), 2, p. 118.
- Strabon, Géographie (1969), 1, p. 83.
- Ainsi, dans sa discussion sur la prise de position d’Hipparque selon laquelle l’Océan entourant le monde habité n’était pas une unité unique, Strabon écrivait : « Sur les problèmes en jeu, tout ce que nous avons besoin de dire est que, en termes d’uniformité du régime, il est meilleur de croire que plus il y a d’élément liquide répandu autour du monde, plus les étoiles seront solidement soutenues par les vapeurs qui en émanent » Strabon, Géographie (1969), 1, p. 72.
- Strabon, Géographie (1969), 2, p. 68.
- Strabon, Géographie (1969), 1, p. 84 et 153.
- Strabon, Géographie (1969), 1, p. 95.
- Strabon, Géographie (1969), 1, p. 107-108.
- Strabon, Géographie (1969), 1, p. 88.
- Strabon, Géographie (1969), 1, p. 92.
- Strabon, Géographie (1969), 2, p. 44, 50.
- Strabon, Géographie (1969), 1, p. 65.
- Strabon, Géographie (1969), 1, p. 63-65.
- Strabon, Géographie (1969), 2, p. 91-92.
- Strabon, Géographie (1969), 2, p. 92.
- Strabon, Géographie (1969), 1, p. 86-87, 141.
- Strabon, Géographie (1969), 2, p. 53.
- A Complete System of General Geography de Varenius (Londres, 1736) était sans doute une des géographies les plus respectées des XVIIe et XVIIIe siècles. Il serait juste de dire que cela est presque certainement dû au respect et à l’attention que l’ouvrage avait reçus de Sir Isaac Newton. Mais pourquoi Newton était-il aussi impressionné par ce travail ? Était-ce parce que le tableau du système solaire y était copernicien plutôt que ptolémaïque ? D’après les commentaires du traducteur de la troisième édition, la première et la seconde éditions du Complete System étaient insuffisamment coperniciennes pour Newton : « Dans la partie astronomique, nous avons renforcé les arguments en faveur de l’hypothèse copernicienne… Dans la partie philosophique et physique, nous avons rejeté les conjectures improbables des Anciens, et les suppositions injustifiables de Descartes, dont notre auteur semblait être épris ; à la place de cela, nous avons introduit (avec le savant Dr Jurin) la philosophie newtonienne pour rendre compte des phénomènes, car elle nous a semblé beaucoup plus admissible que la cartésienne par la manière agréable et géométrique de ses conclusions ». L’intérêt de ce travail pour Newton doit moins avoir résidé dans sa qualité scientifique (bien que, comme nous l’avons déjà suggéré, Varenius ait eu une plus grande propension à l’explication que ce n’était alors la norme) que dans son accessibilité ou popularité immédiates et dans l’intérêt dominant de Varenius pour les phénomènes physiques. Cela serait étayé par un autre des commentaires du traducteur : « La raison pour laquelle le Grand Homme prit tant de soin en corrigeant et en publiant notre auteur était qu’il lui paraissait nécessaire qu’il soit lu par le public des jeunes gentlemans de Cambridge, lorsqu’il délivrait des leçons sur le même sujet depuis la chaire lucasienne ». Les jeunes hommes de Cambridge avaient besoin de connaître un peu les phénomènes physiques du monde. Un Varenius corrigé leur offrirait une excellente introduction et guide.
- Mentelle, Eléments de géographie (1783), p. vij-viij.
- Delisle, Introduction à la géographie… volume 1, Géographie (1746), p. 1.
- Mentelle, Géographie comparée (1778), p. 43.
- Expilly, La Polychrographie en six parties (1756), p. 39.
- Mentelle, Géographie comparée (1778), p. 34-35.
- François, La Science de la géographie (1652), p. 1-3.
- Delisle, Introduction à la géographie (1746), 1, p. xvj-xvij.
- Delisle, Introduction à la géographie (1746), 1, p. vij.
- Delisle, Introduction à la géographie (1746), 1, p. 11.
- Expilly, La Polychrographie (1756), préface.
- Mentelle, Géographie comparée (1778), p. 51.
- Varenius, A Complete System of General Geography (1736), p. 10.
- Delisle, Introduction à la géographie (1746), 1, p. 272.
- Expilly, La Polychrographie (1756), préface.
- Mentelle, Cosmographie élémentaire (1781), p. vij-viij.
- Delisle, Introduction à la géographie (1746), 1, p. 7.
- Delisle, Introduction à la géographie (1746), 1, p. 330.
- Expilly, La Polychrographie (1756), p. 1.
- Mentelle, Géographie comparée (1778), p. 38-40.
- Mentelle, Géographie comparée (1778), p. 38-40.
- Delisle, Introduction à la géographie (1746), 1, p. 22.
- Mentelle, Géographie comparée (1778), p. 21-22.
- Mentelle, Géographie comparée (1778), p. 43-44.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 1, p. 2.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 1, p. 525.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1817), 5, p. 415, par exemple.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 1, p. 13.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 2, p. 88.
- Peut-être à cause de l’utilisation massive de l’Abrégé d’astronomie de Lalande, qui, parce qu’il n’aimait pas les Cassini, n’aurait pas insufflé un grand respect pour eux chez Malte-Brun.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 1, p. 525.
- Cette très intéressante observation vient étayer ma discussion sur l’ampleur du glissement de la carte topographique à la carte thématique à la fois dans mon « Introduction » et dans le chapitre 7. Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 2, p. 134.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 1, p. 8-10.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 1, p. 6.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 1, p. 523-524.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 2, p. 474.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 2, p. 495.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 2, p. 159.
- À strictement parler, donc, les principes généraux ne peuvent pas précéder les faits.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 2, p. 506.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 2, p. 159.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 2, p. 575.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 2, p. 592.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 2, p. 606.
- « Après avoir considéré les causes générales des vents et celles qui modifient les effets de ceux-ci, laissez-nous maintenant suivre les traces de ceux qui, par leur régularité et leur généralité, sont du plus grand intérêt pour la géographie ». Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 2, p. 392.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 2, p. 356.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 2, p. 191.
- Malte-Brun, Précis de la géographie universelle (1810), 2, p. 475.
- Pinkerton et Malte-Brun étaient contemporains et rivaux alors que l’œuvre de Mentelle appartenait à une génération et à un type antérieurs.
- « Avis de l’éditeur », dans Balbi, Abrégé de géographie (1833).
- « Plan de l’Abrégé », dans Balbi, Abrégé de géographie (1833).
- Particulièrement dans sa caractérisation de d’Anville comme n’ayant pas de prédécesseur et de modèle significatifs, et comme créant à lui seul la géographie scientifique moderne. Vivien de Saint-Martin, Histoire de la géographie (1873), p. 426.
- Il y a quelque confusion sur le point de savoir si Vivien de Saint-Martin se référait ici à Malte-Brun ou à Humboldt. Cette section de la conclusion de Vivien de Saint-Martin est décrite dans la longue table des matières résumée comme une discussion des contributions de Malte-Brun et de Ritter. Le texte se réfère toutefois aux contributions de Humboldt et de Ritter. Dans chaque cas, le nom de Malte-Brun et celui de Humboldt, respectivement, ne sont mentionnés qu’une fois. L’accent, dans le texte, sur une géographie descriptive plutôt que scientifique et la description de la contribution d’une personne mystérieuse pour aller au-delà d’une nomenclature aride et fastidieuse (c’est la phraséologie utilisée précisément par Malte-Brun) suggéreraient cependant que c’est à Malte-Brun que ce texte s’applique. Vivien de Saint-Martin, Histoire de la géographie (1873), p. 584.
- Malte-Brun met le point sur ceci en différenciant dans deux occasions différentes le travail et la vie d’un voyageur-explorateur et le travail d’un géographe. Aux pages 13-14 de sa Société de géographie (1823), il demandait à celle-ci lequel elle financerait de préférence. « Serait-ce, d’un côté, un de ces éternels naufragés du Cap Blanc, ou de l’autre, une peinture savante de la nature diverse des déserts qui peint pour vous, ici, le Sahara, si semblable au bassin de lacs desséchés, et là, les vertes savanes dépourvues de grande végétation, et qui intègre tous les phénomènes de vastes portions de notre globe sous des lois générales. Lequel de ces deux travaux conviendrait-il de publier ? Mais il est inutile de discuter une question résolue par notre règlementation. La loi fondamentale dit que nous publierons les cartes, et que serait une carte sans une analyse scientifique du matériel dont elle est composée ? » De manière similaire, dans son Précis de la géographie universelle (1810), 1, p. 525, il commentait le rôle et la tâche du géographe : « nous préférerions être loin du tumulte des factions qui divisent la république des lettres, suivant, à travers mille périls, la route glorieuse tracée par les Colomb et les Humboldt ! Combien nous vous envierions, vous qui, boussole et télescope et même armes à la main, allez à la découverte de notre monde ! C’est pour vous qu’aux cœur de ses mystérieuses Alpes, l’Asie centrale cache ses trésors anciens de savoir, nécessaires pour compléter l’histoire de notre espèce… Pour nous, comme une destinée injuste nous a refusé une partie de ce travail, nous devons chercher consolation dans l’ennuyeuse tâche de décrire ces parties du monde qui sont déjà connues ». Bien qu’ennuyeux, ce rôle vraiment indispensable et intellectuel était celui du géographe. Se référant à nouveau aux voyages de Humboldt en Amérique du Sud, Malte-Brun souligne que d’autres auraient pu mener de manière aussi profitable la recherche qu’il y a accomplie : « Un illustre membre de notre société a visité la plus grande partie [de l’Amérique du Sud] avec le soin le plus religieux, le talent le plus rare. Mais ce voyageur savant ne nous a-t-il pas dit lui-même qu’au sein des villes de Mexico ou de Caracas, il y a des gens tout à fait capables de décrire leur propre pays ? » Malte-Brun, Société de géographie (1823), p. 9.
- Green, Chasing the Sun (1996), p. 18-19 ; Meschonnic, Des mots et des mondes (1991), p. 147-50, 236-243 ; Kafker, « The Influence of the Encyclopédie » (1994), p. 389-399.
- « Géographie voyages-Dialogue entre Messieurs S… et D ….., sur le Sieur Malte-Brun, auteur du Précis de la géographie universelle, qui prit place le 2 décembre 1812 dans une sorte d’assemblée ». Bibliothèque nationale, N. A. Fr. 22186.
- Humboldt a discuté des limites de l’approche typique des géographies universelles et régionales de la terre dans son Voyage aux régions équinoxiales (1816), p. 21-23.
- Humboldt, Cosmos (1849), 1, p. x.
- Voir Hartshorne’s, The Nature of Geography (1939) and Perspective on the Nature of Geography (1959).
- Knight, « Romanticism and the Sciences » (1990), p. 13-24 ; Morgan, « Schelling and the Origins » (1990), p. 25-37 ; Engelhardt, « Historical Consciousness » (1990), p. 55-68 ; Rehbock, « Transcendental Anatomy » (1990), p. 144-160 ; Nicholson, « Alexander von Humboldt » (1990), p. 169-185 ; Rupke, « Caves, Fossils » (1990), p. 241-259 ; Snelders, « Romanticism and Naturphilosophie » (1970), p. 193-215 ; Albury et Oldroyd, « From Renaissance Mineral Studies » (1977), p. 187-215 ; Ospovat, « Romanticism and German Geology » (1982), p. 105-117 ; Dagognet, « Valentin Hauy » (1972), p. 327-236 ; Lenoir, « The Gottingen School » (1981), p. 111-205 ; Baumgartel, « von Humboldt » (1969), p. 19-35 ; Bruhns, The Life of Alexander von Humboldt (1873) ; Stevens, The Humboldt Library (1863).
- Dettelbach, « Humboldtian Science » (1996), p. 287-304.
- Mary Somerville puisa une partie de son inspiration chez Humboldt, comme il est clair dans l’introduction et dans le texte de sa Physical Geography (1846). Thomas Kuhn souligne la signification des commentaires de Mary Somerville dans sa Préface à « On the Connection of the Physical Sciences » au développement de la théorie de la conservation de l’énergie. Kuhn, « Energy Conservation » (1977), p. 66-104. Sur Mary Somerville, voir Patterson, « Mary Somerville » (1969), p. 309-339 ; Patterson, « Somerville » (1970), p. 521-525 ; Sanderson, « Mary Somerville » (1974), p. 410-420 ; et Livingstone, The Geographical Tradition (1992), p. 172-174.
- De Dainville, La Géographie des humanistes (1940), p. 213, 218-219, 276-302.
- François, La Science de la géographie (1652), p. 202-203.
- François, La Science de la géographie (1652), p. 189.
- François, La Science de la géographie (1652), p. 1-3, 5.
- François, La Science de la géographie (1652), « Avis au lecteur ».
- François, La Science de la géographie (1652), p. 1-3.
- François, La Science de la géographie (1652), p. 424-425.
- François, La Science de la géographie (1652), p. 345-346.
- François, La Science de la géographie (1652), p. 11.
- C’est une version quelque peu simplifiée de son argumentation puisque François reconnaissait aussi que la chaleur émanait de la terre elle-même.
- Le dernier de ceux-ci est peut-être moins évident d’après cette citation, mais il est clair, d’après sa discussion de ce point aux pages 10 et 11 et d’après la section consacrée au lieu et au temps aux pages 87-89, qu’il incluait la communication humaine au sein de cette catégorie.
- François, La Science de la géographie (1652), p. 24.
- François, La Science de la géographie (1652), p. 85.
- Pour une explication intéressante du souci alors prévalent d’énumérer, voir : Cormack, Charting an Empire (1997), p. 183 et 185 : « Les [C]horographes, comme les juristes en philosophie politique, se considèrent comme dotés de certains privilèges sur la nature en vertu de leur connaissance taxonomique. »
- Toutes les citations antérieures de ce paragraphe sont dans François, La Science de la géographie (1652), p. 1-3.
- François, La Science de la géographie (1652), p. 1-3 et 22-23.
- François, La Science de la géographie (1652), p. 142.
- François, La Science de la géographie (1652), p. 142.
- François, La Science de la géographie (1652), « Avis au lecteur », p. 1-3 et 31.
- François, La Science de la géographie (1652), p. 231-232.
- François, La Science de la géographie (1652), p. 33.
- François, La Science de la géographie (1652), p. 35.
- Nicholson, « Alexander von Humboldt » (1990), p. 170.
- Humboldt considérait ceci comme en conformité avec les buts de toutes les sciences expérimentales. Humboldt, Cosmos (1849), 1, 29-30.
- Humboldt, Cosmos (1849), 1, p. 360.
- Humboldt, Cosmos (1849), 1, p. 36.
- Humboldt, Cosmos (1849), 1, p. 36-37.
- Les deux premiers volumes du Cosmos peuvent être considérés comme un seul essai étant donné que les pages en sont numérotées à la suite et de manière continue.
- Humboldt, Cosmos (1849), 1, p. 39.
- Sur ceci, voir spécialement Shaffer, « Romantic Philosophy » (1990), p. 38-54.
- Humboldt, Cosmos (1849), 1, p. 42 et 2, p. 467.
- Il considérait ainsi que l’étude du caractère des roches entrait dans la compétence de la géologie alors que l’étude du cosmos avait une plus grande affinité avec la géognosie (la science de la texture et de la succession des strates terrestres) et la géographie physique (la science des formes et des grandes lignes).
- Humboldt, Cosmos (1849), 1, p. 28, 48-49.
- Humboldt, Cosmos (1849), 2, p. 467.
- Humboldt, Cosmos (1849), 2, p. 438.
- Humboldt, Cosmos (1849), 1, p. 17.
- Humboldt, Cosmos (1849), 1, p. 17.
- Humboldt, Cosmos (1849), 1, p. 147.
- Humboldt, Cosmos (1849), 1, p. 368.
- Humboldt, Cosmos (1849), Préface.
- Humboldt, Cosmos (1849), 1, p. 5.
- Humboldt, Cosmos (1849), 1, p. 6.
- Humboldt, Cosmos (1849), 1, p. 55.
- Humboldt, Cosmos (1849), 2, p. 435.
- Humboldt, Cosmos (1849), 1, Préface.
- Humboldt, Cosmos (1849), 1, p. 6.
- Humboldt, Cosmos (1849), 1, p. 22.
- Humboldt, Cosmos (1849), 1, p. 30.
- Humboldt, Cosmos (1849), 2, p. 474.
- Ce n’est pas pour suggérer que Humboldt était apolitique. Pour une discussion de l’une des dimensions politiques de la vie et de l’œuvre de Humboldt, voir Pratt, Imperial Eyes (1992).





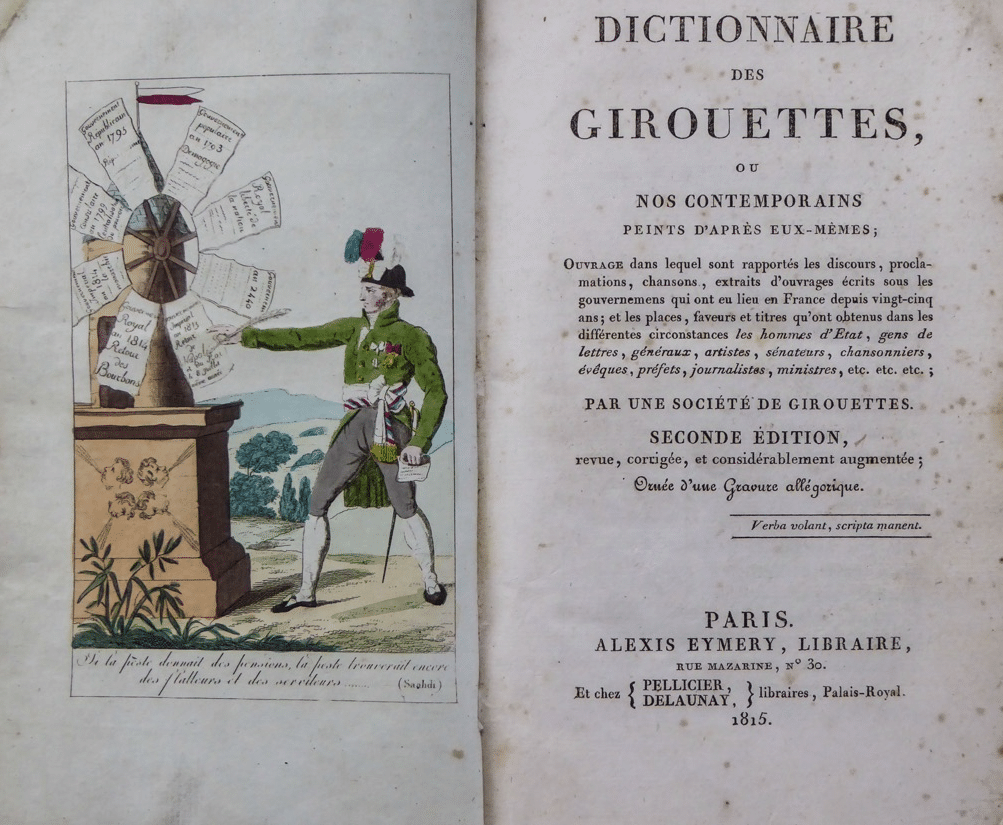
![Goethe et Alexandre de Humboldt communiquent et comparent les continents, Tableau comparatif des altitudes de l’Ancien et du Nouveau Monde, Dessin de Goethe dédié à Humboldt] Source : A. de Humboldt (1807) Essai… p. 134. Image avec l'aimable autorisation de la « Société des Lettres, sciences et arts ’La Haute-Auvergne’ ; Archives départementales du Cantal, 28 J, 1 Ai 186 »](https://journals.openedition.org/cybergeo/docannexe/image/25478/img-6.jpg)