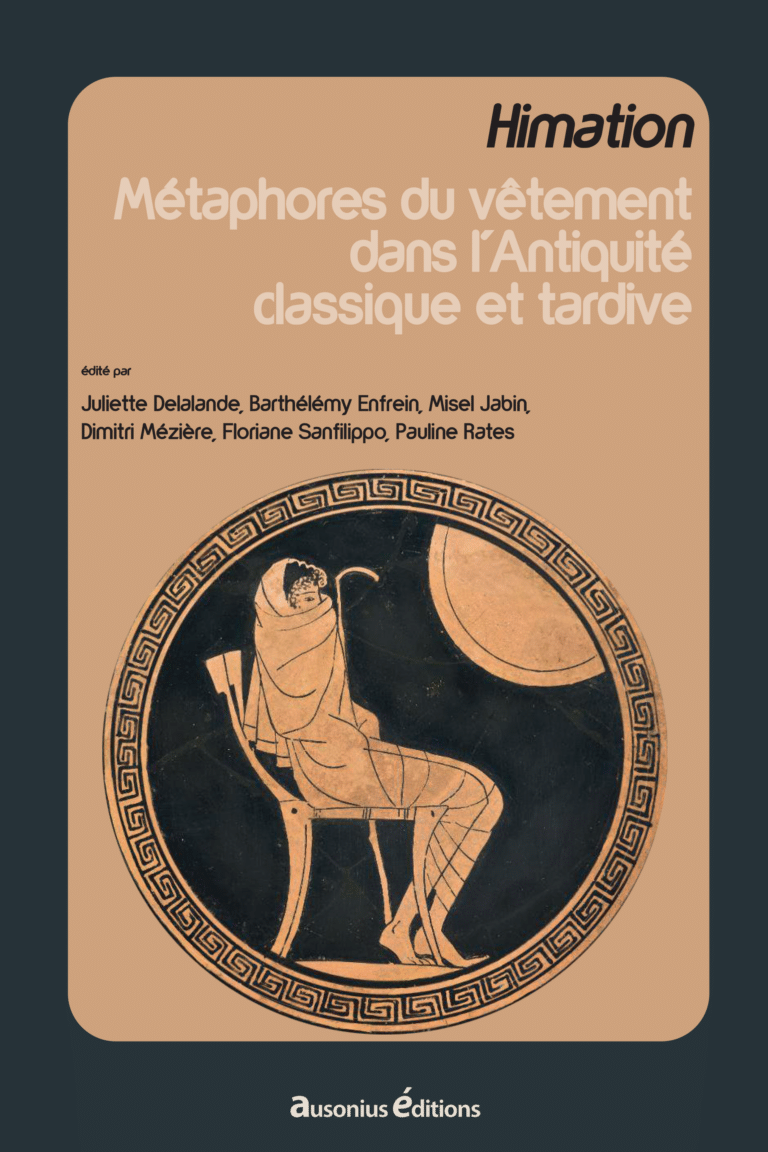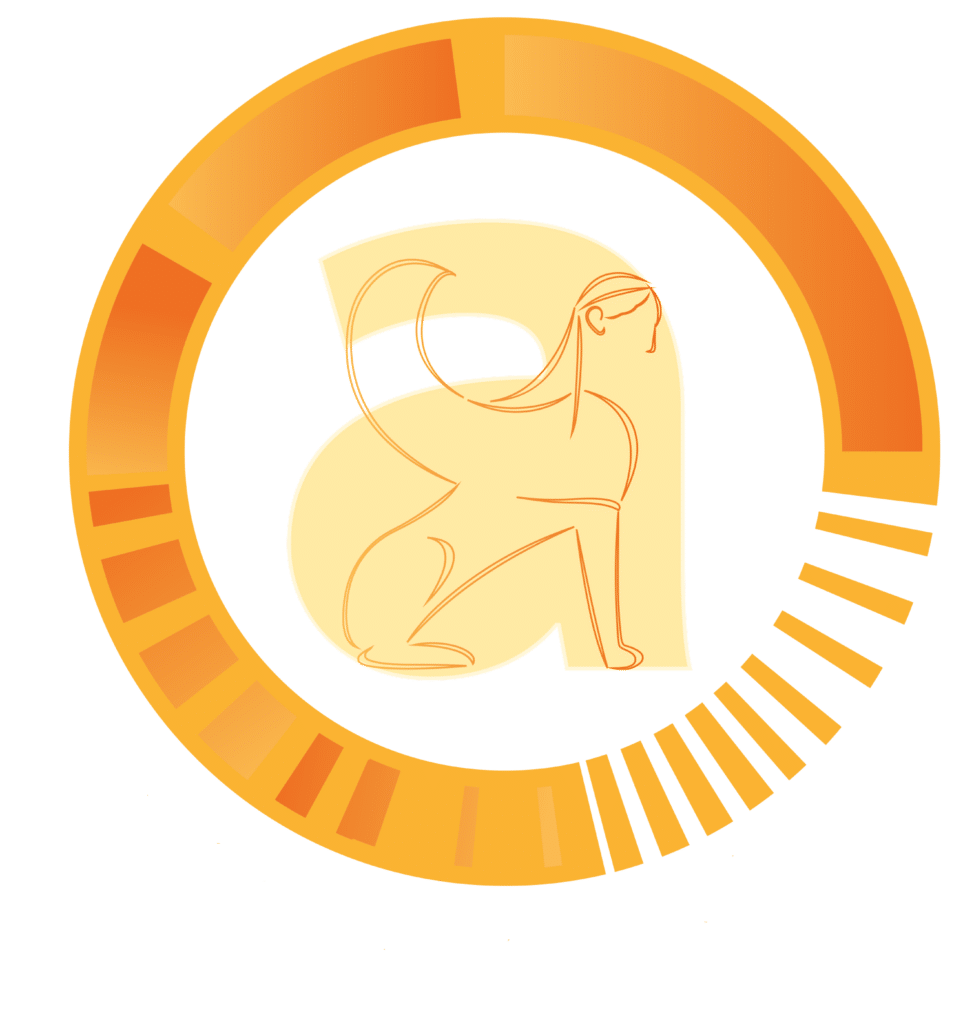Dans la dernière et la plus longue partie du Timée, consacrée à la description de la nature et de la fabrication des êtres vivants mortels (40d-92c)1 par les dieux auxiliaires du démiurge, Platon représente le corps humain à l’aide de multiples métaphores vestimentaires. Nous comprenons la métaphore vestimentaire dans un sens large : elle ne se construit pas seulement à l’aide de noms de vêtements spécifiques, mais renvoie aux images de l’enveloppement, du recouvrement et du tissage en général. En reprenant une tradition pré-socratique et hippocratique, Platon définit le corps comme un ensemble de couches enveloppantes organisées autour d’un centre, la moelle2. La peau apparaît comme un des derniers revêtements dynamiques du corps, intermédiaire entre un dedans et un dehors, protégeant le reste du corps tout en étant un tissu de communication avec le monde par le mécanisme de la respiration. De plus, la métaphore vestimentaire est mobilisée dans la description du fonctionnement de l’intérieur du corps humain où le système dynamique de la digestion, de la respiration et de la circulation système sanguine est décrit comme un tissu entrelacé d’air et de feu enveloppant la cavité abdominale. Cependant, ces métaphores vestimentaires ne désignent pas seulement le rapport entre différentes parties du corps. De manière inédite dans les dialogues platoniciens, la métaphore vestimentaire la plus aboutie concerne l’âme du monde (36d-e), enveloppe immatérielle tissée de toute part dans le corps du monde. Le motif de l’enveloppement et du tissage apparaît donc dans le Timée d’abord dans un contexte cosmologique, décliné ensuite à la corporéité humaine. Ce travail a pour objet d’étudier le rapport entre les différentes métaphores vestimentaires dans le dialogue, en analysant précisément leurs fonctions et leurs significations, en particulier le rapport à l’extériorité.
La métaphore vestimentaire du corps-enveloppe
Dans la partie du Timée consacrée à la description de la fabrication des humains, la métaphore de l’enveloppement est mobilisée pour décrire un corps constitué par des revêtements successifs se recouvrant l’un l’autre autour d’un centre. Le centre du corps est la moelle :
“Concernant les os, les chairs et toutes les substances de cette sorte, voici ce qu’il en fut. Pour toutes ces substances, l’ἀρχὴ, c’est la moelle3.”
Alors que F. M. Cornford et L. Brisson ont choisi de traduire ἀρχὴ par “point de départ” ou starting point car ils considèrent que la moelle ne peut pas être le matériau principal de la composition du reste du corps4, nous suivons J.-F. Pradeau qui préfère le terme “principe”5. Selon Pradeau, la moelle est le point de départ chronologique après lequel les dieux forment les autres organes et tissus, mais aussi le principe matériel utilisé dans la fabrication du reste du corps humain6. En effet, la moelle est la semence universelle pour tout le genre mortel, formée par une proportion régulière7 des triangles les plus exacts et polis, constituant le monde. Tout le reste des tissus corporels sont formés en se diversifiant et en se spécifiant à partir du matériau initial qu’est la moelle. Ainsi, toutes les parties du corps sont composées d’un ou de plusieurs des éléments de la moelle8. Il s’en suit donc que la moelle est le principe9 à partir duquel le reste du corps est constitué. De plus, elle est un élément médiateur, unifiant le corps divisible à l’âme indivise et immatérielle puisqu’elle est attachée par des liens ou “comme à partir d’ancres” (73d4-6)10 dans tout le corps depuis la tête et à travers la longueur des vertèbres. Le cerveau est formé en donnant une forme ronde11 à une portion de la moelle que le dieu nomme “l’encéphale” et qui contient la semence divine12. La moelle que l’on appelle communément moelle osseuse ou vertébrale reçoit une configuration arrondie, mais allongée13. On observe donc une continuité matérielle entre la moelle et la tête et entre la moelle et le reste du corps : le corps humain apparaît unifié, car sa structure présente une continuité à partir du centre du corps qu’est la moelle.
Les autres parties du corps (nous pourrions parler de tissus ou d’organes) sont forgées en tant qu’enveloppes ou revêtements successifs autour de la moelle. D’abord sont fabriqués les os comme le crâne entourant le cerveau, les vertèbres et le squelette. Les vertèbres sont un corps de protection de la moelle et sont fabriquées en mélangeant la moelle à la terre, les soumettant plusieurs fois à l’action du feu pour la cuire et de l’eau pour la refroidir14 jusqu’à ce que le matériau durcisse. Le même processus permet de fabriquer le crâne (73e6-8). Les os apparaissent ainsi comme un ensemble de couches comparées à une “enceinte de pierre”15 (λιθοειδεῖ περιβόλῳ συνέφραξεν16) ou à une couverture osseuse formée autour de la moelle par condensation (στέγασμα μὲν αὐτῷ πρῶτον συμπηγνὺς περὶ ὅλον ὀστέινον17). Bien que le terme στέγασμα puisse s’appliquer aux constructions et puisse être traduit par “toit” ou “abri”18, il a un sens plus général que nous choisissons ici, celui de “couverture” ou “revêtement”.
La prochaine étape consiste à revêtir les os par la chair et les tendons (74b-74e). On passe ici à une deuxième enveloppe de la moelle : puisque le squelette est trop rigide, inflexible et soumis à une grande variation de température qui le désintègre, les démiurges ont créé une nouvelle couche afin de protéger à la fois les os et la moelle. La chair (σάρξ) est composée d’un mélange harmonieux d’eau, de feu et de terre19, mais aussi de ferments décrits comme un “levain formé de sel et d’acide” (73b) donnant une souplesse à celle-ci. L’humeur chaude et humide interne à la chair est capable de s’expulser par pores de la peau. Il s’agit de la sueur, capable de réguler la température interne. La chair a pour fonction de protéger le corps de l’action destructrice des éléments du monde et est comparée à un “coussin de laine” (74c) capable d’amortir ces secousses externes. Ce passage contient une métaphore claire de l’enveloppe :
“Le dieu se servit de la chair et des tendons pour contenir les os et la moelle ; après avoir attaché les os les uns aux autres avec les tendons, il les a tous recouverts sous une couche de chair20.”
Brisson choisit de traduire le terme συμπεριλαβὼν par “envelopper”21, ce qui fait apparaître une métaphore vestimentaire. Or, le verbe συμπεριλαμβάνω signifie “embrasser”, “contenir” ou “renfermer”. Ce passage ne décrit pas tout à fait une action de recouvrement vestimentaire, mais insiste sur le fait que la chair et les tendons contiennent ensemble ou embrassent entièrement les os et la moelle. Ce sont plutôt les termes κατεσκίασεν et l’adverbe ἄνωθεν qui composent la métaphore du recouvrement. En effet, un des sens du verbe κατασκιάζω est le “fait de couvrir ou recouvrir quelque chose”. Il peut avoir le sens d’ensevelir quelqu’un de poussière et de terre ; cependant il nous semble maladroit de le traduire ainsi, car ce sens n’est pas courant et n’est attesté que lorsqu’il est clair que le recouvrement se fait par la terre et la poussière. Or, la chair ne fait que recouvrir la moelle et les os. Enfin, l’adverbe ἄνωθεν signifiant “depuis le haut”, on comprend que la chair est une couche recouvrant du haut et de l’extérieur le reste du corps.
Lors de cette étape, les dieux fabriquent également les tendons à partir d’un mélange d’os et de chair privée de ses ferments constitutifs. Ce mélange intermédiaire de chair et d’os s’explique par la double fonction des tendons : ils doivent être assez mous pour rendre le corps souple et mobile22, mais assez fermes pour assurer le maintien du corps.
La quantité de chair distribuée dans le corps n’est pas homogène (74e-75c) ; les parties qui contiennent le plus d’âme sont recouvertes de la plus mince couche de chair23. Cela peut sembler assez paradoxal, car il doit protéger le plus possible les parties du corps contenant le plus d’âme. Or, la chair, en plus d’être un revêtement de protection, est également un obstacle à l’acuité sensorielle ou à la mobilité du corps. C’est pourquoi les démiurges ont recouvert de chair le moins possible les parties les plus pleines en âme (ψυχή) ou en intelligence (φρόνησις), afin de permettre la pensée et la sensation (la moelle, la tête, la colonne vertébrale) et une plus grande mobilité du corps (les jointures des os). Notons le cas particulier de la tête recouverte seulement par une très mince couche d’os et de peau afin de lui garantir certes une vie plus courte et moins protégée, mais une plus grande sensibilité à la perception24. Les autres parties du corps comme les cuisses, les jambes et la région des hanches, les os du bras, ceux de l’avant-bras et les autres os sont dépourvus d’articulations et sont les parties les plus recouvertes par l’enveloppe charnelle.
Enfin, la dernière couche enveloppante fabriquée est la peau (δέρμα) et les cheveux (75e-76d). Platon explique la formation physiologique de la peau comme un dérivé de la chair. La chair desséchée, ouverte à l’air ambiant, crée un nouveau revêtement plus robuste, mais tout de même élastique25. La nécessité de la peau se comprend par un passage précisant le statut de la tête. Elle apparaît comme une solution intermédiaire entre l’absence de toute protection et la lourdeur de la chair. En effet, le corps étant soumis à la variation de températures, la tête nécessite une couche protectrice. Or, il était impossible de laisser la tête nue recouverte seulement d’os car cela l’exposerait trop au monde extérieur. Il était tout aussi impossible de recouvrir la tête d’une couche de chair qui la rendrait “stupide et insensible” (75e). Platon ne livre pas les détails de la formation de la peau, mais insiste plutôt sur sa fonction de protection. Avec les cheveux et les ongles, elle est la dernière couverture du corps humain, chaque couche enveloppant la précédente :
“Or, autour de la chair qui ne se desséchait que superficiellement, se formait une enveloppe qui était plus grande et qui s’en détachait ; c’est ce qu’on appelle maintenant la ‘peau’26.”
Le terme grec traduit par “enveloppe” est λέμμα. Ce mot ne renvoie pas directement à un vêtement, mais désigne ce que l’on pèle comme les couennes, les pelures, les pellicules ou les enveloppes. La peau n’est donc pas désignée par une métaphore vestimentaire spécifique. Cependant, ce terme renvoie à la fonction d’une enveloppe vestimentaire, qui est de recouvrir quelque chose ou quelqu’un afin de le protéger. La peau a donc une fonction de protection, elle est une couverture périphérique assurant l’unité et l’intégrité du corps humain.
Les poils et les cheveux, cette “substance filandreuse apparentée à la peau, mais plus dure et plus dense”, sont de la même espèce que la peau. Ils sont formés par le refroidissement et la compression dans les pores de la peau et partagent le même rôle que la peau : protéger le corps sans être un obstacle à la sensibilité27. Les cheveux sont par ailleurs qualifiés de couverture légère du cerveau28 à l’aide du terme στέγασμα rencontré déjà plus haut. Notons que la fin de la description anatomique des couches externes du corps est marquée par une nouvelle métaphore vestimentaire, celle du tissage. En effet, les doigts et les ongles sont faits d’une tresse ou entrelacement (καταπλοκῇ29) séché de tendons, de peau et d’os.
La fabrication du corps humain est donc décrite comme une progression continue de revêtements et de couvertures qui partent d’un centre (la moelle) vers la périphérie du corps (la peau, les cheveux, les ongles)30. La métaphore vestimentaire représente le corps-enveloppe du Timée.
La métaphore vestimentaire interne au corps
Une autre métaphore vestimentaire de l’enveloppe et du tissage est mobilisée par Platon pour décrire le système de la respiration, de la circulation sanguine et de la digestion. En effet, le corps humain vit dans un monde extérieur soumis à la nécessité et est assailli par le mouvement des éléments premiers et surtout ceux de l’air et du feu, éléments les plus mobiles et les plus fins qui dégradent sa constitution en pénétrant ses éléments internes31. Il est ainsi encerclé du dehors (περιιστάμενα ἔξωθεν) et attaqué (προσπίπτοντα) sans cesse par les éléments composant l’univers (33a-b). La vie du corps humain est donc une vie de perte et de dégradation, qui doit être restaurée pour lui assurer sa survie. Pour cela, les dieux dotent le corps humain de trois processus dynamiques assurant le maintien du corps : la nutrition, l’irrigation sanguine et la respiration (77c-sq). La dynamique de la nutrition, du mouvement du sang et de la respiration permet de restaurer les tissus en intégrant des éléments extérieurs nouveaux. Le corps humain est dès lors sujet à des échanges constants avec le monde qui l’entoure32 et sa régénération est dépendante de ce qui l’environne.
L’explication du fonctionnement de ces trois processus obéit à une règle simple : un corps plus petit peut passer dans un corps plus grand, mais l’inverse est impossible. De tous les éléments, le feu33 et l’air sont les plus petits. Doués d’un mouvement rapide, ils peuvent traverser l’eau, la terre et les corps constitués par ces derniers. Alors que la nourriture et la boisson sont formées principalement de terre et d’eau tombent dans la cavité abdominale, le feu et l’air ne sont pas retenus par les autres corps. C’est pourquoi les dieux ont utilisé ces deux éléments afin de former des voies respiratoires et sanguines secondaires du corps humain34.
Platon se sert de la métaphore vestimentaire du tissage pour expliquer le mécanisme dynamique de la respiration, de l’irrigation sanguine et de la nutrition. Il compare ce mécanisme à un κύρτος, c’est-à-dire à une nasse ou un panier de pécheurs destiné à capturer des poissons ou des animaux marins35. Cette nasse est faite d’une cavité interne36 (κύτος), correspondant au torse, mais aussi aux poumons et à l’estomac, et de deux entrées (ἐγκύρτια), correspondant au nez et à la bouche. Dans le panier de pécheurs, les poissons entrent dans une ouverture plus large, puis dans une autre plus serrée pour enfin rester piégés dans la cavité37. Enfin, Platon identifie dans le corps humain une cavité délimitée par une πλέγμα, c’est-à-dire un ensemble de tissages. De même que le panier du pêcheur est formé de tresses, ainsi le corps humain est composé d’une tresse faite de feu et d’air. Selon certains commentateurs, les tresses du panier renvoient aux canaux reliant la bouche et le nez à l’abdomen38, tandis que selon d’autres, que nous suivons, ces tresses peuvent renvoyer également aux rayons de feu et d’air39.
“C’est donc de feu et d’air que s’est servi le dieu pour assurer l’irrigation de la cavité vers les vaisseaux, tressant, à la manière des nasses, un treillis d’air et de feu, qui présentait à l’entrée deux entonnoirs, dont l’un à son tour était tressé de façon à se terminer en fourche ; et, depuis les entonnoirs, il a étendu en quelque sorte des joncs en cercle sur toute la longueur du treillis, jusqu’à ses extrémités. Tout l’intérieur de cette vannerie était constitué de feu, alors que les entonnoirs et la cage il les a faits d’air40.”
La métaphore du tissage est construite par les trois termes πλέγμα, συνυφηνάμενος et τοῦ πλοκάνου. Le terme πλέγμα signifie “ce qui est tissé, tressé ou torsadé” en général et renvoie en particulier à une toile, natte ou tresse. Le verbe συνυφαίνω désigne le fait de tisser ensemble ou fabriquer un tissu et le terme τοῦ πλοκάνου désigne quelque chose qui est tressé, du verbe πλέκω signifiant “tresser, entrelacer”. On comprend qu’il y a à l’intérieur du corps une tresse (πλέγμα) tissée par les rayons d’air et le feu. L’intérieur de la nasse est appelé par un autre terme évoquant le tissu, τοῦ πλοκάνου (ce qui est tressé ou entrelacé).
L’oscillation de cette nasse explique le mouvement des éléments dans le corps : l’air et le feu rentrent par les deux entrées de la nasse et par les pores de la peau, circulent dans le corps par les treillis décrits plus haut, jusqu’au système digestif et sanguin. Il y a dans le corps un feu intérieur41 qui digère ou la nourriture puis la monte dans le sang vers les canaux et le reste du corps. Le ventre fond (79a), décompose et divise d’abord ce qui est ingéré grâce au feu ; ces nutriments sont ensuite distribués dans le corps par la circulation du sang et d’air et les canaux qui leur sont appropriés (80d). Enfin, la respiration42 consiste en des mouvements ou des courants d’air et de feu. Lors de l’expiration43, la nasse se contracte et expulse l’air et le feu vers le monde extérieur. Or, tout élément étant mû par le mouvement spontané du semblable vers son semblable, le feu chaud interne tend à rejoindre son semblable externe, à savoir le feu présent dans le monde qui s’étend vers la limite de l’univers44. Il faut noter que la respiration se fait à la fois par la bouche et le nez, mais aussi par les pores de la peau. Le souffle sort du corps par une exhalaison chaude et se refroidit, car les polyèdres qui le composent se séparent. Or, puisqu’il n’y a pas de vide dans l’univers platonicien45, le souffle expiré déplace l’air extérieur avoisinant par une “poussée circulaire”46. L’expiration produit un déplacement de l’air environnant jusqu’à ce qu’une portion d’air avoisinant s’introduise dans le corps par l’inspiration. L’air rentre alors dans le corps par inhalation, s’approche du feu interne et le corps est alors réchauffé par contact. Ce type de mouvement des éléments en l’absence de vide est appelé περίωσις47 par Platon et a lieu de manière cyclique48 durant toute la vie de l’homme. Le mouvement de l’air et du feu explique non seulement la respiration, mais aussi la digestion et la circulation sanguine.
Le système dynamique de la digestion, de la respiration et du système sanguin est rendu possible grâce à un mécanisme comparé à un ensemble de matériaux tissés constitués d’air et de feu. Cette structure tissée est l’enveloppe d’une cavité abdominale ouverte par deux entrées. L’intérieur du corps apparaît ainsi comme un tissu d’air et de feu, un vêtement fait d’éléments premiers. Platon mobilise donc une métaphore vestimentaire complexe pour rendre compte de la physiologie interne du corps.
Il faut noter que Platon dote la peau de pores49 ou de “trous” rendant possible la respiration cutanée50. La peau n’est pas seulement une enveloppe protectrice contre les attaques des éléments externes. Elle est également un revêtement de communication, un intermédiaire entre le dedans et le dehors grâce au rôle central des pores de la peau dans la respiration. Cependant, le statut de la peau et son rapport au tissage interne du corps sont peu clairs. Puisqu’il s’agit d’un élément clé dans la respiration, il faudrait qu’elle soit incluse dans cette nasse qui explique la respiration, la digestion et la circulation de sang dans le corps. Or, elle ne peut correspondre à une entrée de la nasse, puisque les entonnoirs sont explicitement identifiés à la bouche et au nez. Notre hypothèse est la suivante : la peau ne serait pas l’une des ouvertures de la tresse, mais serait l’enveloppe du tissage décrit dans ces passages. En effet, Platon note explicitement que la nasse, malgré sa grande mobilité, reste à l’intérieur du corps51. Il s’ensuit donc que la peau est un vêtement poreux recouvrant un autre tissu interne. Par conséquent, la peau n’est pas une simple enveloppe protégeant le corps contre les attaques des éléments extérieurs. Puisqu’elle intervient en tant que partie du système respiratoire, elle est ce qu’on pourrait appeler un revêtement dynamique, participant à la communication entre l’intérieur du corps et le monde externe.
La métaphore vestimentaire est omniprésente dans la dernière partie du Timée consacrée à l’exposition de la fabrication du corps humain. Platon mobilise la métaphore de la couverture pour décrire un corps formé de plusieurs couches à partir d’un centre qu’est la moelle. Le corps-enveloppe présente une continuité et une unité puisque toutes ses parties sont des variétés de la moelle, chaque couche étant la source matérielle et structurelle de l’enveloppe suivante. Enfin, la métaphore de l’enveloppe se double d’une autre métaphore vestimentaire du tissage interne dont la peau constitue le revêtement le plus externe52.
Cependant, la métaphore vestimentaire n’est pas propre à la conception du corps dans le Timée. La métaphore du recouvrement se retrouve également à un niveau cosmologique et définit le rapport entre l’âme du monde et le corps du monde et non plus le rapport entre les couches de matière du corps du monde seulement. Est-ce que la métaphore vestimentaire du corps humain se fonde sur la métaphore cosmologique ? Quelles sont les spécificités de chaque métaphore ? En effet, les réalités humaines ou mortelles ont dans le Timée un fondement cosmologique. Le dialogue commence par ailleurs par exposer la manière dont le démiurge a créé le monde pour ensuite passer à la fabrication de l’espèce mortelle en particulier, car c’est le paradigme cosmologique qui permet de fonder et de comprendre la réalité de ce qui devient. Tout ce qui est à l’œuvre dans le monde s’explique par des raisons cosmologiques. Par exemple, l’espèce immortelle de l’âme humaine est composée des mêmes ingrédients, mais moins purs (ἀκήρατα) que ceux de l’âme du monde, principe organisateur, moteur et cognitif de l’univers dans son ensemble. Faut-il en conclure que la métaphore vestimentaire à l’échelle cosmologique fonde la métaphore vestimentaire à l’échelle humaine ?
La métaphore vestimentaire cosmologique
Dans le Timée, les éléments et les principes d’organisation du corps humain se fondent sur les principes fondateurs du corps du monde décrits au début du dialogue. En effet, le démiurge fabrique à partir d’un modèle intelligible qu’est le Vivant en soi un monde à son image, c’est-à-dire un vivant, doté d’un principe de vie qu’est l’âme du monde et d’un corps du monde53. Platon note explicitement que le corps humain est une modalité particulière du corps du monde : il est en effet créé par les aides du démiurge à partir des mêmes éléments que le corps du monde qu’il lui emprunte :
“Ayant reçu le principe immortel du vivant mortel et imitant le démiurge, ils empruntaient au monde des portions de feu et de terre, des portions d’eau et d’air, en reconnaissant que ces portions devaient lui être rendues un jour54.”
Le corps humain est donc fait des mêmes éléments que le reste de l’univers et est défini par une dépendance matérielle vis-à-vis du corps du monde. La matière empruntée au tout va devoir lui être rendue. Ainsi, le corps humain sera dissous dans l’ensemble du monde lors de sa mort.
Ce sont également les principes d’organisation qui sont les mêmes entre le corps humain et le corps du monde, dans la mesure du possible. Ainsi, les dieux ont donné à l’âme immortelle humaine une enveloppe sphérique, une tête circulaire d’après l’imitation de la forme sphérique55 du corps du monde. Platon explique en 32c-34b les raisons qui ont poussé le démiurge à choisir cette forme pour le corps du monde. Cette forme fut choisie pour le corps du monde parce qu’elle est la plus convenable et la plus appropriée56 à pouvoir contenir tous les autres vivants. Puisque la sphère est une figure dont le centre est équidistant de tous les points de la périphérie, elle peut contenir toutes les autres figures57 et toutes les autres choses. Enfin, elle apparaît comme la plus parfaite et la plus semblable à elle-même, donc la plus belle58. On pourrait par ailleurs ajouter que la forme du corps du monde répond à la composition de l’âme du monde en deux cercles également59.
Le corps humain est donc fondé sur les mêmes principes matériels et formels que le corps du monde. Cependant, malgré des similitudes de composition et d’organisation entre les deux, le corps humain présente des différences fondamentales. Alors que le corps du monde contient en lui la totalité de la matière de l’univers60, le corps humain est seulement une partie du corps du monde. Les deux entités sont créées par des dieux différents. Le corps du monde a été créé par un démiurge bon61, père et fabricant de l’univers62, en respectant le plus parfaitement possible un modèle intelligible qu’il contemplait63, tandis que la fabrication et le gouvernement du corps humain et de tout ce qui concerne l’espèce mortelle de l’âme humaine ont été légués aux jeunes dieux auxiliaires, aides du démiurge64. Le corps du monde et tout ce que le démiurge a fabriqué sert de modèle65 à ses aides. Il y a en ce sens une différence axiologique fondamentale entre les deux types de déités qui se traduit comme une différence axiologique entre les produits de la fabrication des dieux. Ce qui est immortel et divin est l’œuvre du démiurge, père de l’univers, tandis que ce qui est mortel et pris dans le devenir est l’œuvre des dieux inférieurs66. Le corps humain mortel a donc une valeur axiologique négative par rapport à ce dont il est parti, le corps du monde. Cet écart a des conséquences sur la vie des deux corps : ils sont dotés de mouvements différents, ont des formes différentes et ont des manières de subsister différentes67.
Or, si les éléments et les principes d’organisation du corps humain se fondent sur le corps du monde, peut-on dire de manière analogique que l’enveloppement caractérisant le corps humain se fonde sur un enveloppement cosmologique ?
Dans la partie cosmologique du Timée, le Vivant achevé et le corps du monde semblent être décrits comme des enveloppes des réalités dont ils sont principes. À propos du corps du monde, on lit qu’il enveloppe en lui-même l’ensemble des autres corps :
“Comme figure, il lui donna celle qui lui convenait et qui lui était apparentée. Au vivant qui doit envelopper en lui-même tous les vivants, la figure qui pourrait convenir, c’était celle où s’inscrivent toutes les autres figures. Aussi est-ce la figure d’une sphère, dont le centre est équidistant de tous les points de la périphérie, une figure circulaire, qu’il lui donna comme s’il travaillait sur un tour – figure qui entre toutes est la plus parfaite et la plus semblable à elle-même –, convaincu qu’il y a mille fois plus de beauté dans le semblable que dans le dissemblable68.”
La forme sphérique du corps du monde découle de la nécessité de contenir toute la matière disponible69. Puisque la sphère est une figure où tous les points de ses extrémités sont équidistants de son centre, elle peut contenir toutes les autres formes possibles70. Peut-on pour autant affirmer que le corps du monde est le revêtement de tous les autres corps ? Ce n’est pas la métaphore de l’enveloppe vestimentaire qui est à l’œuvre dans ce passage, mais une métaphore spatiale. Le verbe περιέχειν qui a été traduit par Brisson par “envelopper” signifie entourer, contenir, comprendre. Le corps du monde est ce qui contient les autres corps et non ce qui les enveloppe comme une couverture. L’image mobilisée est celle de l’inscription des parties dans une totalité et non pas d’une enveloppe qui limiterait le dedans et le dehors.
Plus haut, Platon décrit un rapport similaire entre le Vivant en soi et les autres réalités intelligibles :
“Effectivement, tous les vivants intelligibles, ce vivant les tient enveloppés en lui-même, de la même façon que notre monde nous contient nous et toutes les autres créatures visibles. Car, comme c’est au plus beau des êtres intelligibles, c’est-à-dire à un être parfait entre tous, que le dieu a précisément souhaité le faire ressembler, il a façonné un vivant unique, visible, ayant à l’intérieur de lui tous les vivants qui lui sont apparentés par nature71.”
Le verbe traduit par “enveloppés” est περιλαμβάνειν signifiant entourer ou embrasser. La métaphore utilisée n’est pas celle de la couverture ou de l’enveloppe. Ce qui est à l’œuvre dans ce passage est un paradigme spatial qui marque un rapport entre un contenant et un contenu : le Vivant en soi est l’intelligible qui embrasse ou contient tous les autres intelligibles. Un peu plus loin, en 31a, Platon utilise à nouveau le verbe περιέχειν pour rappeler l’éminence du Vivant en soi : “En effet, ce qui enveloppe (περιέχον) tout ce qu’il y a de vivants intelligibles ne saurait jamais venir après un autre au second rang.”
La seule autre métaphore vestimentaire cosmologique est celle de l’âme du monde décrite comme enveloppe du corps du monde. On lit en effet en 36d7-e5 qu’une fois l’âme et le corps du monde fabriqués, le démiurge a ajusté l’âme du monde de telle manière à ce qu’elle soit tissée au corps du monde, tout en l’enveloppant de l’extérieur. Elle apparaît donc ici comme le revêtement du corps du monde, tout en étant confondue à lui :
“Une fois l’âme entièrement constituée conformément à l’idée de celui qui la constitua, ce dernier passa à l’assemblage de tout ce qu’il y a de matériel à l’intérieur de cette âme et, faisant coïncider le milieu de celui-ci avec le milieu de celle-là, il les ajusta. Alors, l’âme, entrelacée depuis le milieu jusqu’à la périphérie du ciel qu’elle enveloppait circulairement de l’extérieur, commença, à la façon d’une divinité, en tournant en cercle sur elle-même, une vie inextinguible et raisonnable pour toute la durée des temps72.”
Trois expressions construisent la métaphore vestimentaire. L’expression τῆς ψυχῆς σύστασις a été traduite par Betegh comme “the fabric of the soul”73. Ce choix pourrait être intéressant pour notre étude, mais la traduction n’est pas tout à fait juste. En effet, le terme σύστασις renvoie à une composition, à l’union de quelque chose, sans que cette composition soit particulièrement vestimentaire. Cette expression a pour fonction de montrer que l’âme est un mélange de quelque chose. Le deuxième terme est διαπλακεῖσα, forme passive du verbe διαπλέκω qui sert à décrire le rapport entre l’âme du monde et le corps du monde. Le terme signifie “être entrelacé, tissé ensemble”. L’âme du monde apparaît donc comme tissée au corps du monde à partir de son centre jusqu’à sa périphérie. Enfin, l’expression ἔξωθεν περικαλύψασα construit la métaphore vestimentaire. Le verbe περικαλύπτω dans sa forme passive signifie “être enveloppé, être couvert tout autour de quelque chose”. Le verbe étant accompagné de l’adverbe ἔξωθεν, l’expression signifie “être enveloppé de l’extérieur”. On remarque par ailleurs que le verbe περικαλύπτω est souvent associé dans la langue grecque à l’himation : on se couvre tout autour d’une tunique, d’un manteau, d’un vêtement. L’auteur hippocratique des Aphorismes associe les deux termes et décrit ainsi une des techniques permettant de savoir si une femme est fertile :
“Quand une femme ne conçoit pas, et que vous voulez savoir si elle peut concevoir, enveloppez-là de couvertures, et brûlez sous elle des parfums : si l’odeur semble arriver à travers le corps jusqu’aux narines et à la bouche, sachez qu’elle n’est pas stérile de son fait74.”
De même que les différentes couches du corps humain recouvrent le couches précédentes, l’âme du monde est une enveloppe du corps du monde, le couvrant tout entier de l’extérieur et autour de sa superficie à la manière d’un tissu75.
Cependant, la métaphore vestimentaire cosmologique ne met pas en relation deux entités corporelles (une couche matérielle revêtant d’autres couches corporelles) mais une âme, principe vital, affectif et cognitif immatériel et un corps du monde matériel. Or, comment une réalité immatérielle peut-elle être entrelacée et envelopper une réalité corporelle ? L’âme du monde a-t-elle une dimension, une extension ? Autrement dit, comporte-t-elle une certaine matérialité qui lui permettrait de revêtir le corps du monde ou s’agit-il d’une métaphore dont le sens est à élucider ? Ce passage a conduit la tradition platonicienne à s’interroger sur les modalités précises de l’enveloppement de l’âme du monde.
Dans le chapitre 3 du premier livre du De Anima, Aristote propose une critique de la mobilité de l’âme en général et de la conception platonicienne de la motricité de l’âme en particulier76. L’enjeu de ces pages est de montrer qu’il n’est pas juste de considérer l’âme comme un principe de mouvement elle-même en mouvement. Aristote cite explicitement le passage étudié :
“Pourtant, c’est de la même manière (que Démocrite) que le personnage du Timée, dans son récit sur la nature, décrit l’action motrice de l’âme sur le corps. Il explique qu’elle est elle-même en mouvement et meut le corps parce qu’elle se trouve ‘entrelacée’ avec lui (διὰ τὸ συμπεπλέχθαι πρὸς αὐτό)77.”
Le Stagirite se réfère implicitement à l’âme du monde enveloppée au corps du monde et la prend à juste titre pour paradigme de toute âme. Timée (à comprendre le personnage du dialogue) donne selon Aristote un récit à la manière des physiologues et décrit un mouvement physique de l’âme du monde. Or, ce mouvement n’est possible que si l’on considère l’âme comme comportant une dimension (μέγεθος). En effet, l’âme du monde est décrite dans la Timée comme étant constituée d’un mélange d’ingrédients divisés en proportion mathématiques en deux bandes prenant la forme de la lettre khi, que le démiurge recourbe afin de former deux cercles qui s’entrecroisent en deux points et qui meuvent d’une part le monde entier (le cercle du Même) d’autre part les planètes et les astres (le cercle de l’Autre, divisé en sept parties). C’est bien la preuve pour Aristote que Platon considère l’âme comme une grandeur physique et mathématique. Or, une telle grandeur ne peut exister au-delà du sensible pour Aristote : “Eh bien, la première incorrection est de dire que l’âme est une grandeur.”78. Le philosophe choisit79 d’ignorer la possibilité d’une grandeur mathématique de l’âme du monde et comprend le passage littéralement. Platon aurait donc donné corps à l’âme du monde en lui donnant une proportion géométrique et mathématique. En effet, pour pouvoir diviser quelque chose selon des proportions numériques, il faut que cette chose ait des parties divisibles, ce qui équivaut à avoir une dimension pour Aristote. En décrivant l’âme comme un ensemble de deux cercles, Platon lui aurait une dimension physique. Or, puisque ces deux éléments du Timée permettent selon Aristote de définir l’âme comme principe de mouvement, la faute de Platon aurait été d’accorder à l’âme un mouvement afin de représenter le mouvement de la pensée. Cette thèse conduit à une multitude de contradictions qu’Aristote démontre dans la suite du chapitre. L’impossibilité principale concerne l’intellect (νοῦς) qui, bien qu’il comporte une unité et continuité, ne peut être une grandeur80. Paradoxalement, l’âme du monde n’enveloppe le corps du monde que parce qu’elle présente une étendue et une nature corporelle. Cette lecture littérale aristotélicienne est partagée par certains commentateurs modernes comme Sedley et Johansen81 à partir de la même remarque aristotélicienne selon laquelle sans une représentation spatiale des mouvements des cercles de l’âme, on ne peut comprendre le Timée82. Notons la thèse particulière de Johansen pour qui l’âme du monde a nécessairement une étendue, car elle possède un mouvement et enveloppe le corps du monde, mais manque de profondeur et se différencie en cela du corps du monde. Elle envelopperait le corps d’une toute mince couche sans troisième dimension.
Or, nous soutenons qu’il faut lire ce passage du Timée comme principalement métaphorique. Dire que l’âme du monde enveloppe le corps du monde ne suppose pas une thèse sur la corporéité ou la dimension de celle-ci. Platon écrit explicitement, juste après le passage analysé, que l’âme n’est pas une réalité corporelle, puisqu’elle est invisible (ἀόρατος), contrairement au corps du monde visible (ὁρατὸν) du ciel :
“Voilà donc comment furent engendrés, d’une part le corps visible du ciel, et de l’autre l’âme, qui est invisible et qui participe à la raison et à l’harmonie, l’âme qui est la meilleure des choses qu’engendra le meilleur d’entre les êtres qui sont rationnels et qui toujours subsistent83.”
De plus, d’après le passage expliquant la fabrication de l’âme du monde par le démiurge, l’âme apparaît comme une réalité intermédiaire entre le sensible et l’intelligible. Rappelons que l’âme du monde est composée d’un double mélange à partir de l’être, du même, de l’autre, et du divisible et de l’indivisible. D’abord, le démiurge fabrique l’Être intermédiaire, composé par mélange de l’Être indivisible et inchangeable, et de l’Être divisible et qui “devient dans les corps” (35a1-3). Ensuite, il fabrique le Même intermédiaire, composé selon le même principe que l’Être intermédiaire, par mélange du Même indivisible et du Même qui devient dans les corps. (35a4-6). Troisièmement, le démiurge fait l’Autre intermédiaire, composé de même façon, par mélange de l’Autre indivisible et de l’Autre qui devient dans les corps (ibid.). Enfin, le démiurge procède à un dernier mélange des trois ingrédients intermédiaires (l’Être, le Même et l’Autre intermédiaire) en une unité qu’est l’âme du monde84. Or, le divisible et l’indivisible, mais aussi l’Autre et le Même85 renvoient précisément à l’être corporel et l’être intelligible. Tandis que l’intelligible est incomposé, indivisible et inengendré, le sensible est divisible, composé et engendré. L’âme, ni divisible ni indivisible, ou plutôt divisible et indivisible à la fois, est ce médiateur entre le sensible et l’intelligible. Elle serait en ce sens une troisième forme d’être comme le remarque Cornford86, une entité immatérielle capable d’intervenir dans le monde sensible. L’âme du monde ne semble donc pas pouvoir comporter une extension lui permettant d’être une couverture corporelle du monde. Les commentateurs platoniciens du Timée ont proposé diverses solutions intéressantes aux problèmes de l’enveloppement par l’âme du monde du corps du monde87. Dans son commentaire au Timée, Proclus a par exemple insisté sur la nature intermédiaire de l’âme du monde, constitué d’être, de même et d’autre divisible (renvoyant aux réalités corporelles) et d’être, de même et d’autre indivisible (renvoyant aux réalités intelligibles). Elle partagerait donc quelque chose de la corporéité, sans pour autant être étendue88. Il y aurait donc des raisons cosmologiques qui expliqueraient l’interaction enveloppante et tissante de l’âme du monde au corps du monde. Ces raisons sont la composition de l’âme du monde qui lui confère donc un statut intermédiaire. Par ailleurs, Platon a lui-même qualifié le discours portant sur le monde de métaphorique, ou plus précisément d’εἰκὼς μῦθος ou de mythe vraisemblable à plusieurs reprises89 ou d’εἰκὼς λόγος (discours vraisemblable)90, sans pour autant le réduire à un discours illusoire ou faux91. Cette remarque métalittéraire nous porte à privilégier une lecture métaphorique92 du passage.
La métaphore de l’âme du monde enveloppe du corps du monde est inédite chez Platon, puisque dans ses dialogues93 comme dans la tradition platonicienne, l’image habituelle décrivant le rapport entre le corps et l’âme est une image contraire : le corps est représenté comme enveloppe, vêtement, manteau ou tunique94 de l’âme. La signification de cette métaphore nouvelle doit être comprise à partir de la description du corps du monde :
“Or, de ces quatre éléments pris un à un, la constitution du monde a absorbé la totalité. C’est en effet tout le feu, toute l’eau, tout l’air et toute la terre qu’utilisa celui qui constitua le monde pour le constituer, ne laissant hors du monde aucune parcelle, aucune propriété de quoi que ce soit. Voici quel était son dessein. Il souhaitait en premier lieu que le monde fût avant tout un vivant parfait, constitué de parties parfaites ; que de plus il fût unique, dans la mesure où il ne restait rien à partir de quoi un autre vivant de même nature pût venir à l’être ; et qu’enfin il fût exempt de vieillesse et de maladie, car le démiurge était bien conscient du fait que, si un corps est quelque chose de composé, la chaleur, le froid et tous les autres phénomènes qui présentent des propriétés énergétiques arrivent, lorsqu’ils l’environnent de l’extérieur et l’affectent de façon intempestive, à le dissoudre et à y introduire maladies et vieillesse qui le font dépérir. Voilà en vertu de quelle cause et en vertu de quel raisonnement le dieu a construit un ensemble qui, formé à partir de tous ces ensembles, réalise une unité, un être parfait, exempt de vieillesse et de maladie95.”
Le corps du monde embrasse tous les éléments de l’univers sans qu’aucun puisse exister ou avoir une capacité (δύναμις) en dehors de lui. Or, d’après le Parménide, (137c7) est un être entier, celui à qui ne manque aucune partie. Il s’ensuit que le corps est complet, ne comportant aucune réalité en dehors de lui. La deuxième propriété du corps du monde est son unicité : puisque toute la matière a été utilisée pour le faire, et puisqu’il n’a pas d’extériorité, il ne peut y avoir une autre organisation qui donnerait un autre monde. Enfin, le corps du monde est éternel en ceci qu’il ne peut être objet de maladie ou de vieillesse. En effet, puisque rien de lui n’est extérieur, aucun élément ne peut détruire sa constitution. Selon la fin du Timée96, une des causes des maladies et de la mort est la décomposition du corps suite à l’attaque du feu et de l’air externes. Or, contrairement au corps humain, le corps du monde est indissoluble. En réalité, le démiurge seul pourrait le dissoudre, mais ne le fait pas par bonté97. Le corps du monde n’a donc pas besoin d’organes ou de membres et se nourrit par lui-même. Il est en ce sens αὐτάρκης :
“Car rien ne sortait du monde et rien n’y entrait d’où que ce soit, puisqu’il n’y avait rien hors de lui. En effet le monde a été fabriqué de façon qu’il puisse se procurer sa nourriture en se consommant lui-même, et à ce que toute action, dont il prend l’initiative ou qu’il subit, se produise en lui et soit incitée par lui. En effet, celui qui l’a constitué a considéré que le monde serait bien meilleur s’il se suffisait à lui-même plutôt que s’il était dépendant de quoi que ce soit98.”
Un peu plus loin, Platon affirme à nouveau le caractère autarcique de l’univers, en insistant sur le fait qu’il n’a “besoin de quoi que ce soit d’autre (οὐδενὸς ἑτέρου προσδεόμενον) , se suffisant à lui-même comme connaissance et comme ami (γνώριμον δὲ καὶ φίλον ἱκανῶς αὐτὸν αὐτῷ)” (34b). Au contraire, le corps humain a besoin du corps du monde pour sa survie car il est soumis à la dégradation par les éléments externes, à la vieilesse, la maladie et la mort. De plus, il est soumis aux mouvements de réplétion (plerôsis) et déplétion (kenosis, 81a) des éléments constituant l’univers. C’est pour cela qu’il a besoin d’une peau-enveloppe qui assure une fonction de protection. La dépréciation ontologique du corps de l’homme suppose donc la nécessité d’une peau. Cependant, le corps du monde, puisqu’il est une réalité complète, unique et exempte de dégradation, n’a pas le besoin ontologique d’un revêtement externe protecteur. L’enveloppement de l’âme du monde est donc métaphorique et elle ne pourrait être une couche matérielle ou un manteau couvrant le corps du monde. Dans le contexte cosmologique, la métaphore vestimentaire vise donc à exprimer la supériorité de l’âme du monde sur le corps du monde : elle est un principe causal, ordonnateur, moteur et cognitif du corps du monde. Elle vise également à exprimer l’unification du corps du monde, qui n’est pas un ensemble de parties disparates, mais un tout enveloppé par un principe organisateur qui le couvre et le dirige, qu’est l’âme du monde. On peut trouver par ailleurs une raison matérielle à cet enveloppement : puisque le corps du monde est un ensemble de tous les éléments, et puisque les éléments ont une tendance à se séparer les uns des autres ou du moins dans la nécessité99, l’âme du monde est celle qui tient ensemble la matière du monde et qui constitue le corps en une unité unifiée.
La métaphore vestimentaire cosmologique est complexe, car, en plus de suggérer l’idée d’un recouvrement elle renvoie à l’image du tissage. L’âme du monde est une enveloppe pour ainsi dire intérieure car, tout en enveloppant le corps du monde comme un manteau, elle se tisse et s’entrelace à cette réalité corporelle. Cette double image vestimentaire exprime la fonction de l’âme du monde : elle n’est pas seulement le principe moteur et principe organisateur d’un corps ou de certains corps (les planètes ou astres), mais de la totalité corporelle qu’est le corps du monde et de toutes ses parties ou, pourrait-on dire, fils. Enfin, rappelons que l’âme du monde possède une fonction cognitive et connaît tous les sensibles et les intelligibles par contact (ἐφάπτηται) entre ses cercles constitutifs et les réalités à connaître :
“Puis donc que l’âme a été constituée à partir d’un mélange de trois ingrédients, qui proviennent du Même, de l’Autre et de l’Être, qu’elle a été divisée et liée suivant des proportions et qu’en outre elle se meut en cercle elle-même en revenant sur elle-même, chaque fois qu’elle entre en contact avec quelque chose dont l’être est divisible ou avec quelque chose dont l’être est indivisible, un mouvement la traverse tout entière, et elle dit à quoi un tel objet est identique et de quoi il est différent, et relativement à quoi surtout et sous quel aspect et comment et à quel moment il arrive que chacun, eu égard à l’autre, soit et pâtisse à la fois chez les êtres en devenir et par rapport aux êtres qui restent toujours les mêmes. Or, ce discours est dans le vrai tout autant quand il concerne une identité que quand il porte sur une différence. Chaque fois que, emporté sans son articulé ni bruit dans ce qui se meut par soi-même, il porte sur le sensible et que c’est le cercle de l’Autre, qui est régulier, qui transmet l’information à l’âme tout entière, se forment des opinions et des croyances, fermes et vraies ; et, chaque fois qu’il s’applique à ce qui se rapporte à la raison, et que c’est le cercle du Même, qui est parfaitement rond, qui révèle ces choses, le résultat en est nécessairement l’intellection et la science. Mais ces deux processus cognitifs, en quoi se produisent-ils ? Quelqu’un qui répondrait que c’est en autre chose qu’en l’âme, celui-là dirait tout sauf la vérité100.”
L’activité cognitive de l’âme du monde est une activité prédicative et comparative et consiste à dire que x est le même qu’un y ou/et que x est différent de y. Ses objets de connaissance sont les sensibles ayant leur être divisible et changeant et et les Formes intelligibles indivisibles et restant toujours les mêmes. Puisque l’âme est prise par un mouvement “toute entière” (λέγει κινουμένη διὰ πάσης ἑαυτῆς), cela suppose que sa relation avec les choses avec lesquelles elle entre en contact, en les connaissant, est une activité de l’ensemble de l’âme. On peut en ce sens déduire le fait que l’âme, en entrant en contact avec les objets sensibles et intelligibles, et en comparant les choses, met en rapport un terme x à comparer avec tous les autres objets de sa connaissance, sensibles ou intelligibles. Pour savoir en effet qu’un terme x n’est pas le même qu’un y, il faut d’une certaine façon passer en revue tous les objets du monde et les comparer à x. Cet acte de comparaison suppose en ce sens la totalité de l’âme mais aussi la totalité de choses qu’elle doit appréhender pour saisir l’altérité et la différence d’une chose. L’usage de la métaphore vestimentaire déjà analysée représentant l’âme du monde en une enveloppe interne au corps du monde permettrait à Platon d’enrichir la métaphore du contact entre l’âme et les objets de connaissance mais aussi d’insister sur le rapport extensif et total de l’âme à tous les objets cognitifs possibles. Dès lors, la métaphore vestimentaire permet de penser la puissance cognitive de l’âme du monde.
Conclusion
Malgré quelques similitudes, les métaphores vestimentaires appliquées au corps humain et au cosmos présentent des différences importantes. Dans le cas des enveloppes successives corporelles, dont la peau et l’une des enveloppes les plus externes, le recouvrement a une dimension et une corporéité absente dans la métaphore vestimentaire cosmologique. De plus, alors que les couches corporelles sont faites des mêmes ingrédients que ce qu’elles enveloppent, l’âme du monde n’est constituée ni d’éléments premiers ni de triangles primitifs. On note ainsi une différence de nature et non plus de degré entre le vêtement et ce qu’il recouvre dans le cas de la métaphore cosmologique. Enfin, ce qui les distingue est aussi le rapport à l’extériorité et le statut de l’enveloppe. Alors que les différents revêtements corporels sont des couches temporaires faisant limite avec les autres corps et assurant une fonction de protection et de communication avec le monde extérieur dans le cas particulier de la peau, l’âme du monde est une enveloppe originale qui ne comporte pas d’extérieur. Tandis que l’enveloppe de la peau est une simple limite dynamique, l’âme du monde ne peut être un tissu de protection et est définie paradoxalement par un enveloppement intérieur tenant ensemble et organisant la corporéité. Les métaphores vestimentaires similaires ont donc des fonctions différentes dans le Timée : tantôt elles donnent à penser une frontière externe, protectrice et dynamique dans le cas des enveloppes corporelles, tantôt elles représentent un principe ordonnateur, causal, moteur et cognitif d’une totalité unifiée dans le cas de l’âme du monde enveloppante. Ainsi, à cause de ces différences conceptuelles et fonctionnelles, il nous semble difficile de pouvoir affirmer que la métaphore vestimentaire corporelle se fonde sur la métaphore vestimentaire cosmologique. Le Timée est tissé de part et d’autre par des métaphores du revêtement et du tissu aux distinctions fortes, mais qui permettent d’unifier101 le texte par un motif imagé omniprésent et complexe.
Bibliographie
- Betegh, G. (2020) : “Plato on Illness in the Phaedo, the Republic, and the Timaeus”, in : Jorgenson, C., Karfík, F et Špinka, S., éd. : Plato’s Timaeus, Boston, 228-258.
- Bolens, G. (1999) : ‘Homeric joints and the marrow in Plato’s Timaeus: Two logics of the body’, Multilingua, 18, 149-158.
- Bolens, G. (2015) : La logique du corps articulaire : Les articulations du corps humain dans la littérature occidentale, Rennes.
- Bollack, J., éd. (1992) : Empédocle, Paris.
- Brisson, L. (1974) : Le Même et l’autre dans la structure ontologique du Timée de Platon : un commentaire systématique du Timée de Platon, Paris.
- Burnyeat, M. (2005) : “ΕΙΚΩΣ ΜΥΘΟΣ”, , Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy and Science, 2, 143-165.
- Carter, J. (2017) : “Aristotle’s Critique of Timaean Psychology”, Rhizomata, 5, 51-78.
- Cornford, F. (1935) : Plato’s Cosmology: The Timaeus of Plato, Indianapolis.
- Cherniss, H. (1944) : Aristotle’s Criticism of Plato and the Academy, New-York.
- Johansen, T. (2004) : Plato’s Natural Philosophy: A Study of the Timaeus-Critias, Cambridge.
- Joubaud, C. (1991) : Le corps humain dans la philosophie platonicienne : étude à partir du Timée, Paris.
- Karfik, F. (2012) : “The Constitution of the Human Body in Plato’s Timaeus”, Croatian Journal of Philosophy, 12, 2, 167-181.
- Pelavski, A. (2014) : “Physiology in Plato’s Timaeus”, The Cambridge Classical Journal, 61-74.
- Pradeau, J.-F. (1998) : “L’âme et la moelle : Les conditions psychiques et physiologiques de l’anthropologie dans le Timée de Platon”, Archives de Philosophie, 61, 3, 489-518.
- Reydams-Schils, G. (2020) : Calcidius on Plato’s Timaeus. Greek Philosophy, Latin Reception and Christian Contexts, Cambridge.
- Rutherford, R. B. (1995) : The art of Plato: ten essays in Platonic interpretation, Harvard.
- Sedley, D. (1997) : “ ‘Becoming Like God’ in the Timaeus and Aristotle”, in Calvo, T. et Brisson L., éd. : Interpreting the Timaeus – Critias. Proceedings of the IV Symposium Platonicum. Selected papers, Sankt Augustin, 327-39.
- Taylor, A. (1928) : A commentary on Plato’s Timaeus, Oxford.
Notes
- Les deux parties sont liées, car les principes décrits au début du dialogue servent pour expliquer et comprendre ce qui se joue dans la nature humaine. Karfik 2012, 167-168 a noté par ailleurs que la partie du dialogue traitant de la nature humaine commence par une digression décrivant les principes cosmologiques à l’œuvre dans la fabrication de l’âme et du corps humain comme les quatre éléments et leurs mélanges (44d-47e).
- Bolens 1999 et 2015 distingue deux types de schémas pensant une cohérence du corps : le corps articulaire et le corps-enveloppe. Tandis que le corps est organisé chez Homère selon une logique de la jonction ou disjonction des articulations, la chercheuse voit chez Platon l’apparition d’un corps-enveloppe organisé autour d’un centre par couches successives. Ce qui détermine la logique du corps-enveloppe est la dialectique de l’interne et de l’externe.
- Tim., 73b3 : Τὸ δὲ ὀστῶν καὶ σαρκῶν καὶ τῆς τοιαύτης φύσεως πέρι πάσης ὧδε ἔσχεν. Τούτοις σύμπασιν ἀρχὴ μὲν ἡ τοῦ μυελοῦ γένεσις.
- Cornford, 1937, n. 1, 293 : ἀρχὴ does not mean that marrow is the fundamental stuff in the composition of all the other tissues. Ainsi, la chair n’est pas faite de moelle selon lui. Cette interprétation est suivie par Brisson 1974, n. 639, 269.
- Pradeau 1998, 507.
- Pradeau 1998, 508 suit davantage Taylor 1928 selon lequel la moelle est le centre du corps non seulement parce qu’elle supplée le matériau des autres tissus, mais aussi parce que l’âme y est attachée par des liens. Cependant, Pradeau note qu’“il existe une autre arche qui, dans ces mêmes pages du Timée, vient précisément s’attacher au corps, c’est l’âme.”
- Tim., 73c1 : μειγνὺς δὲ ἀλλήλοις σύμμετρα. Cela rappelle les proportions de l’âme du monde.
- Cela n’empêche pas que le mélange des tissus ne soit formé que par quelques éléments présents dans la moelle.
- Joubaud 1991, 54 appelle la moelle la “substance mère” pour cette raison.
- Le vocabulaire du lien et de l’attache rappelle l’eschatologie du Gorgias (493a-b), du Phèdre (246d-249d) et du Phédon (81e2-4).
- La forme sphérique de la moelle et du cerveau est motivée par le mouvement de révolution circulaire de l’âme immortelle et divine.
- Tim., 73c7 : τὸ θεῖον σπέρμα.
- Voir le schéma géométrique de l’encéphale sphérique et des disques oblongs des vertèbres (Pradeau 1998, 510).
- Joubaud 1991, 57 note que cette fabrication rappelle la métallurgie où l’on utilise la chaleur et l’eau pour respectivement fondre et refroidir le métal.
- Ou une “armure pierreuse” selon Joubaud 1991, 58.
- La métaphore n’est pas vestimentaire ici, mais géographique et militaire. Le verbe συμφράσσω signifie “enfermer”, “enclore”, tandis que le nom περίβολος renvoie aux remparts, murs ou enceintes de protection d’une ville, d’une maison ou d’un temple.
- Tim., 73e1.
- Par exemple en Pol., 279d.
- Notons que la chair ne contient que trois des quatre éléments. Elle est donc moins parfaite que la moelle, mais ce n’est pas pour autant qu’elle n’a pas la moelle pour principe.
- Tim., 74d-e : οἷς συμπεριλαβὼν ὁ θεὸς ὀστᾶ καὶ μυελόν, δήσας πρὸς ἄλληλα νεύροις, μετὰ ταῦτα σαρξὶν πάντα αὐτὰ κατεσκίασεν ἄνωθεν. (trad. Brisson).
- “Le dieu se servit de la chair et des tendons pour envelopper les os et la moelle ; après avoir attaché les os les uns aux autres avec les tendons, il les a tous ensevelis sous une couche de chair.”
- Tim., 74b : “Comme les tendons se tendent et se relâchent tour à tour autour des articulations, il a pu rendre ainsi le corps capable de se plier et de s’allonger” (trad. Brisson). Toutes les traductions suivantes sont, sauf mention contraire, celles de Brisson 2008.
- Tim., 74e “Ceux de ces os qui renfermaient le plus d’âme, il les a enveloppés de chairs moins abondantes ; ceux qui en renfermaient le moins, il les a entourés des chairs les plus abondantes et les plus épaisses.” (trad. Joubaud).
- Tim., 75c-d “(…) à une vie plus durable, mais pire, une vie plus brève, mais meilleure était préférable pour tous et à tous égards. C’est pourquoi ils ont recouvert la tête d’un os mince ; mais ils n’y ont mis ni chair ni tendons, puisque d’ailleurs elle ne fait aucune flexion. Pour toutes ces raisons, une tête, douée d’une sensibilité plus fine, plus intelligente que le corps, mais beaucoup plus faible a été ajoutée à chaque corps humain.” (trad. Joubaud).
- Tim., 75e. Voir la suite.
- Tim., 76a : τῆς δὴ [76a] σαρκοειδοῦς φύσεως οὐ καταξηραινομένης λέμμα μεῖζον περιγιγνόμενον ἐχωρίζετο, δέρμα τὸ νῦν λεγόμενον.
- Tim., 76d.
- Ibid. : στέγασμα τῆς περὶ τὸν ἐγκέφαλον.
- Ibid.
- Phaed., 98c–98d reprend les mêmes étapes de la fabrication des couches corporelles.
- Tim., 77a2–3 ὑπὸ τούτων τηκόμενον κενούμενόν τ’ ἔφθινεν, βοήθειαν αὐτῷ θεοὶ μηχανῶνται.
- Karfik 2012, 170.
- Le feu est plus petit que l’air, mais nous ignorons le degré de comparaison entre les deux. Voir Tim., 78 a : πῦρ δὲ πάντων γενῶν σμικρομερέστατον “Or, de tous les éléments, le feu est le plus petit.”
- Il existe en effet des vaisseaux ou des canaux physiques creusés sous la peau, longeant la colonne vertébrale et ramifiant les extrémités du corps à la tête décrits en 77c-d, permettant la digestion et la circulation sanguine.
- Brisson 1974, 24.
- Cornford 1937, 313 l’identifie à l’air extérieur enveloppant le torse. Pour une critique de cette interprétation, voir Pelavski 2014, 67-sq.
- Cornford 1937, 308-309 : The weel, like our lobster-pot, is a basket (πλόκανον), with a wide opening at the top. Stretching down inside and below the opening there is passage in the form of a truncated cone, narrowing down to a hole just large enough to admit the fish. Galien et Taylor comprennent qu’il y a une grande nasse, divisée en deux pièges plus petits. Voir Gal., in Pl. Ti. 9 ; Taylor 1928, 549–50.
- Karfik 2012, 174.
- Joubaud 1991, 67 parle d’un “réseau gazeux invisible et imperceptible à l’œil nu” redoublant les canaux physiques du système respiratoire. Voir Tim., 78e2 et 79d4 : ἐκ πυρὸς πεπλέχθαι πᾶν.
- Tim. 78b2–c1 : [ὁ θεὸς] πλέγμα ἐξ ἀέρος καὶ πυρὸς οἷον οἱ κύρτοι συνυφηνάμενος, διπλᾶ κατὰ τὴν εἴσοδον ἐγκύρτια ἔχον, ὧν θάτερον αὖ πάλιν διέπλεξεν δίκρουν· καὶ ἀπὸ τῶν ἐγκυρτίων δὴ διετείνατο οἷον σχοίνους κύκλῳ διὰ παντὸς πρὸς τὰ ἔσχατα τοῦ πλέγματος. Τὰ μὲν οὖν ἔνδον ἐκ πυρὸς συνεστήσατο τοῦ πλοκάνου ἅπαντα, τὰ δ᾽ ἐγκύρτια καὶ τὸ κύτος ἀεροειδῆ (…).
- Tim., 79d : “(…) en tout être vivant, les parties internes qui entourent le sang et les vaisseaux sont les plus chaudes, comme s’il y avait en lui une source de feu”.
- Son fonctionnement est décrit en 78e4-79a4. Pour différentes interprétations de ce passage, voir Cornford 1937, 308-313 ; Joubaud 1991, 67-71 ; Pelavski 2014, 68-73.
- Joubaud 1991, 71 note que “l’expiration est première dans le mécanisme de la respiration, ce qui va à l’encontre de l’expérience et de la logique”, mais sert l’explication rationnelle platonicienne.
- Tim., 79d6 : κατὰ wύσιν εἰς τὴν αὑτοῦ χώραν… πρὸς τὸ συγγενὲς ὁμολογητέον ἰέναι, Voir aussi Tim. 79d5–6, e6, 52e5–53a7. Joubaud 1991, 69 soutient que Platon développe une théorie du lieu naturel du feu à l’œuvre dans ce passage.
- Tim., 58a, 79b.
- Joubaud 1991, 70.
- Tim., 79c6, e2. Platon fait de la periosis un principe général de mouvement corporel en donnant plusieurs exemples en 79a5-80c8.
- Tim., 79e7–d9 : κύκλον οὕτω σαλευόμενον ἕνθα καὶ ἕνθα.
- Tim., 76b : “Toute cette peau donc, la divinité la piquait de trous à l’aide du feu”.
- La thèse d’une respiration par tout le corps est héritière des philosophies socratiques. Empédocle par exemple décrit une double respiration pulmonaire et cutanée des vivants dans le fragment dit de la “clepsydre” (Empédocle B 1000 D. K., trad. Reymond). Comme chez Platon, la peau est percée de pores et est le lieu principal de la respiration : “Ainsi toutes choses inspirent le souffle et l’expirent. Toutes ont des tuyaux de chair, dépourvus de sang, étendus sur la surface de leurs corps ; et à leurs embouchures, la surface extrême de la peau est percée partout de pores étroitement serrés, de sorte qu’ils retiennent le sang, mais laissent libre passage à l’air. Quand donc le sang clair s’en retire, l’air bouillonnant s’y précipite en flots impétueux, pour être expiré de nouveau quand le sang revient. De même, quand une jeune fille, jouant avec une clepsydre d’airain brillant, place l’orifice du tuyau sur sa gracieuse main, et plonge la clepsydre dans le flot argentin de (…)”. Cette image est probablement liée à une représentation commune aux cosmologies présocratiques d’une respiration cosmique. Voir Bollack 1992, 474. Le premier témoignage médical de la respiration par tout le corps se trouve chez Philistion de Locres. Selon Anonyme de Londres XX, 45-47, ce médecin contemporain de Platon aurait donné un rôle important à la respiration “par tout le corps” dans la définition de la santé. Un corps en bonne santé est celui qui respire bien et sans obstruction.
- Tim., 78d : “s’enfonce à travers le corps jusqu’à l’intérieur”.
- La description de la fabrication du corps met en scène un grand nombre de métaphores comme la métaphore artisanale (74c : “Voilà ce qu’avait en vue celui qui, à la façon d’un modeleur de cire, fabriqua notre corps”), celle du travail du pain (73c-d : “Avec de l’eau, du feu et de la terre il fit un mélange, un arrangement harmonieux, auquel il ajouta un levain composé d’acide et de sel et il constitua la chair”) et d’autres étudiées dans le détail par Brisson 1974.
- Tim., 30b.
- Ibid., 42e8–43a4.
- Ibid., 33b4 : σφαιροειδές. b5 : κυκλοτερές. 44d4 : περιφερές.
- Ibid., 33b1–2 πρέπον καὶ … συγγενές.
- Ibid., 33b2–5.
- Ibid., 32d1, 33d1–3, 33b5–7.
- Ibid., 36b5–d7, e3–4, 37a6–7, b5, 44d3–6, 73c3–d2.
- Ibid., 32c5–33a2.
- Ibid., 28a6–b2, 29a2–3, 29e1–3, 30a6-7.
- Ibid., 28c3-4.
- Ibid., 28a1, 28a6-7, 39e7-9.
- Ibid., 42d-42e : “Et, après ces semailles, il abandonna aux dieux jeunes le soin de façonner les corps mortels et tout ce qu’il restait encore à ajouter à l’âme humaine ; et, une fois que les dieux jeunes eurent fabriqué cela [42e] ainsi que tout ce qui allait avec, le démiurge leur abandonna le soin d’en prendre la direction et de gouverner ce vivant mortel, dans la mesure où ils le pouvaient, avec le plus de beauté et de bonté possible, pour éviter que le vivant mortel ne devînt cause de son propre malheur.”
- Ibid., 69c : “Ces derniers, à son imitation, entreprirent, après qu’ils eurent reçu le principe immortel de l’âme, de façonner au tour pour lui un corps mortel (…)”.
- Ibid., 69b7-c5 : “Et, des vivants divins, il devient lui-même le démiurge, tandis qu’il a confié le soin d’engendrer les vivants mortels à ceux qui étaient nés de lui.”
- Le corps du monde est doté d’un mouvement circulaire sur lui-même, alors que le corps humain partage les autres six types de locomotion (Tim., 34a). En ce qui concerne leur forme, le corps du monde est une sphère. Les dieux ont ajouté un tronc et des membres à la tête sphérique humaine pour pouvoir se mouvoir dans le monde. Voir la suite. Enfin, le corps humain et mortel est dépendant des éléments du corps du monde, essentiels à la restauration de son métabolisme. Pour cela, voir la suite et Karfik 2012, 169-sq.
- Tim., 33b-c : “Σχῆμα δὲ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ πρέπον καὶ τὸ συγγενές. Τῷ δὲ τὰ πάντα ἐν αὑτῷ ζῷα περιέχειν μέλλοντι ζῴῳ πρέπον ἂν εἴη σχῆμα τὸ περιειληφὸς ἐν αὑτῷ πάντα ὁπόσα σχήματα· διὸ καὶ σφαιροειδές, ἐκ μέσου πάντῃ πρὸς τὰς τελευτὰς ἴσον ἀπέχον, κυκλοτερὲς αὐτὸ ἐτορνεύσατο, πάντων τελεώτατον ὁμοιότατόν τε αὐτὸ ἑαυτῷ σχημάτων, νομίσας μυρίῳ κάλλιον ὅμοιον ἀνομοίου. Λεῖον δὲ δὴ κύκλῳ πᾶν ἔξωθεν αὐτὸ ἀπηκριβοῦτο πολλῶν χάριν.”
- Parménide déjà pense un lien entre le caractère achevé de l’être et sa forme sphérique. Voir DK B 8.42-43.
- Cet argument semble être fondé sur les développements ultérieurs de Platon sur la géométrie des formes décrites en 53c4–55c6.
- Tim., 30c7-31a1 : Τὰ γὰρ δὴ νοητὰ ζῷα πάντα ἐκεῖνο ἐν ἑαυτῷ περιλαβὸν ἔχει, καθάπερ ὅδε ὁ κόσμος ἡμᾶς ὅσα τε ἄλλα θρέμματα συνέστηκεν ὁρατά. Τῷ γὰρ τῶν νοουμένων καλλίστῳ καὶ κατὰ πάντα τελέῳ μάλιστα αὐτὸν ὁ θεὸς ὁμοιῶσαι βουληθεὶς ζῷον ἓν ὁρατόν, πάνθ᾽ ὅσα αὐτοῦ κατὰ φύσιν συγγενῆ ζῷα ἐντὸς ἔχον ἑαυτοῦ, συνέστησε.
- Tim., 36d-e : ᾿Επεὶ δὲ κατὰ νοῦν τῷ συνιστάντι πᾶσα ἡ τῆς ψυχῆς σύστασις ἐγεγένητο, μετὰ τοῦτο πᾶν τὸ σωματοειδὲς ἐντὸς αὐτῆς ἐτεκταίνετο καὶ μέσον μέσῃ συναγαγὼν προσήρμοττεν· ἡ δ’ ἐκ μέσου πρὸς τὸν ἔσχατον οὐρανὸν πάντῃ διαπλακεῖσα κύκλῳ τε αὐτὸν ἔξωθεν περικαλύψασα, αὐτὴ ἐν αὑτῇ στρεφομένη, θείαν ἀρχὴν ἤρξατο ἀπαύστου καὶ ἔμφρονος βίου πρὸς τὸν σύμπαντα χρόνον. (trad. Brisson modifiée).
- Betegh 2020, 240 : “When the whole fabric of the soul had been finished to its maker’s mind, he next began to fashion within the soul all that is bodily, and brought the two together, fitting them centre to centre. And the soul, being everywhere interwoven from the centre to the outermost heaven and enveloping the heaven all round on the outside, revolving within its own limit, made a divine beginning of ceaseless and intelligent life for all time.”
- Corp. Hipp., Aph., 5.59, traduction Littré.
- Cette métaphore est reprise par Plotin en Traité 14 (II, 2), 3.1-3 avec une légère modification : ce n’est plus toute l’âme du monde qui enveloppe et est tissée au corps du monde, mais seulement la puissance la plus basse de l’âme du monde.
- Aristot., De An., 406b25-407b25.
- Aristot., De An. 406B26-29 : Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ὁ Τίμαιος φυσιολογεῖ τὴν ψυχὴν κινεῖν τὸ σῶμα· τῷ γὰρ κινεῖσθαι αὐτὴν καὶ τὸ σῶμα κινεῖν διὰ τὸ συμπεπλέχθαι πρὸς αὐτό. (trad. Bodéüs).
- Aristot., De An. 1.3.406b3.
- Cherniss 1944, 410-11 : Aristotle’s disregard of this ‘intermediacy’ of the soul has resulted in a fundamental misunderstanding or misrepresentation of Plato’s theory, with the inevitable consequence that his criticism of the theory is largely irrelevant.
- Voir Carter 2017 pour un exposé détaillé de la critique aristotélicienne du Timée de Platon en De An.,1.3-5.
- Sedley 1997, 329-330, Johansen 2004, 140-142.
- Johansen 2004, 140 […] unless we take the circular motions of the soul literally we have no way of understanding how the soul moves round with the planets.
- Tim., 36e-37 a : Καὶ τὸ μὲν δὴ σῶμα ὁρατὸν οὐρανοῦ γέγονεν, αὐτὴ δὲ ἀόρατος μέν, λογισμοῦ δὲ μετέχουσα καὶ ἁρμονίας ψυχή, τῶν νοητῶν ἀεί τε ὄντων ὑπὸ τοῦ ἀρίστου ἀρίστη γενομένη τῶν γεννηθέντων.
- Nous adoptons ici l’interprétation de Proclus (Pr. 2.117).
- Platon distingue en 28a ce qui reste toujours identique, qui peut être appréhendé par l’intellect et faire l’objet d’une explication rationnelle (les Idées), et ce qui devient toujours, qui naît et se corrompt, mais qui n’est jamais réellement, et qui est objet d’une opinion au terme d’une perception sensible (les choses sensibles).
- Corford, op.cit., p. 63.
- Calcidius dans son commentaire au Timée soutient que le passage en question ne suppose pas une corporéité de l’âme, mais plutôt des pouvoirs similaires entre l’âme et les dimensions (chapitre 33) ou une similitude entre l’âme et le corps (chapitre 92 : ut esset in animae textu corporis similitudo, inter animam corpusque similitudo). Cette similitude prend la forme d’une inspiration (inspiration animae, chapitre 26) que l’âme du monde donne aux corps. Voir Reydams-Schils 2020, 69-70.
- Pr. 2.117.
- Tim., 29b1-d3. Voir aussi 59c5-d3 et 69d2.
- Par exemple, Tim., 30b4-c1. Le discours est qualifié davantage d’eikos logos (13 occurrences) plutôt que d’eikos muthos (3 occurrences).
- À ce sujet, voir Tim., 53d-e et l’interprétation de Burnyeat 2005.
- Tout comme Taylor 1928 ; Cornford 1937 ; Cherniss 1944, 425-431 ; Brisson 1974.
- Gorg., 523c5-6, Phaed. 73d.
- Par exemple, Procl., Théol., 209. Voir à ce sujet les articles de Baudroux, Krafft, Lavaud, Lozier, Macé dans ce volume.
- Tim., 32c-33a : Τῶν δὲ δὴ τεττάρων ἓν ὅλον ἕκαστον εἴληφεν ἡ τοῦ κόσμου σύστασις. Ἐκ γὰρ πυρὸς παντὸς ὕδατός τε καὶ ἀέρος καὶ γῆς συνέστησεν αὐτὸν ὁ συνιστάς, μέρος οὐδὲν οὐδενὸς οὐδὲ δύναμιν ἔξωθεν ὑπολιπών, τάδε διανοηθείς, πρῶτον μὲν ἵνα ὅλον ὅτι μάλιστα ζῷον τέλεον ἐκ τελέων τῶν μερῶν εἴη, πρὸς δὲ τούτοις ἕν, ἅτε οὐχ ὑπολελειμμένων ἐξ ὧν ἄλλο τοιοῦτον γένοιτ᾽ ἄν, ἔτι δὲ ἵν᾽ ἀγήρων καὶ ἄνοσον ᾖ, κατανοῶν ὡς συστάτῳ σώματι θερμὰ καὶ ψυχρὰ καὶ πάνθ᾽ ὅσα δυνάμεις ἰσχυρὰς ἔχει περιιστάμενα ἔξωθεν καὶ προσπίπτοντα ἀκαίρως λύει καὶ νόσους γῆράς τε ἐπάγοντα φθίνειν ποιεῖ.
- Id., 81a–87a
- Ibid., 32c3-4 “il ne peut être dissout par personne d’autre que par celui qui a établi ces liens.”
- Ibid., 33c-d : ἀπῄει τε γὰρ οὐδὲν οὐδὲ προσῄειν αὐτῷ ποθέν· οὐδὲ γὰρ ἦν. αὐτὸ γὰρ ἑαυτῷ τροφὴν τὴν ἑαυτοῦ φθίσιν παρέχον καὶ πάντα ἐν ἑαυτῷ καὶ ὑφ᾿ ἑαυτοῦ πάσχον καὶ δρῶν ἐκ τέχνης γέγονεν· ἡγήσατο γὰρ αὐτὸ ὁ ξυνθεὶς αὔταρκες ὂν ἄμεινον ἔσεσθαι μᾶλλον ἢ προσδεὲς ἄλλων.
- Ibid., 52e5–53a7.
- Ibid., 37a-38c.
- Rutherford 1995, 266 considère que les motifs, images et symboles répétés permettent d’unifier un dialogue platonicien.