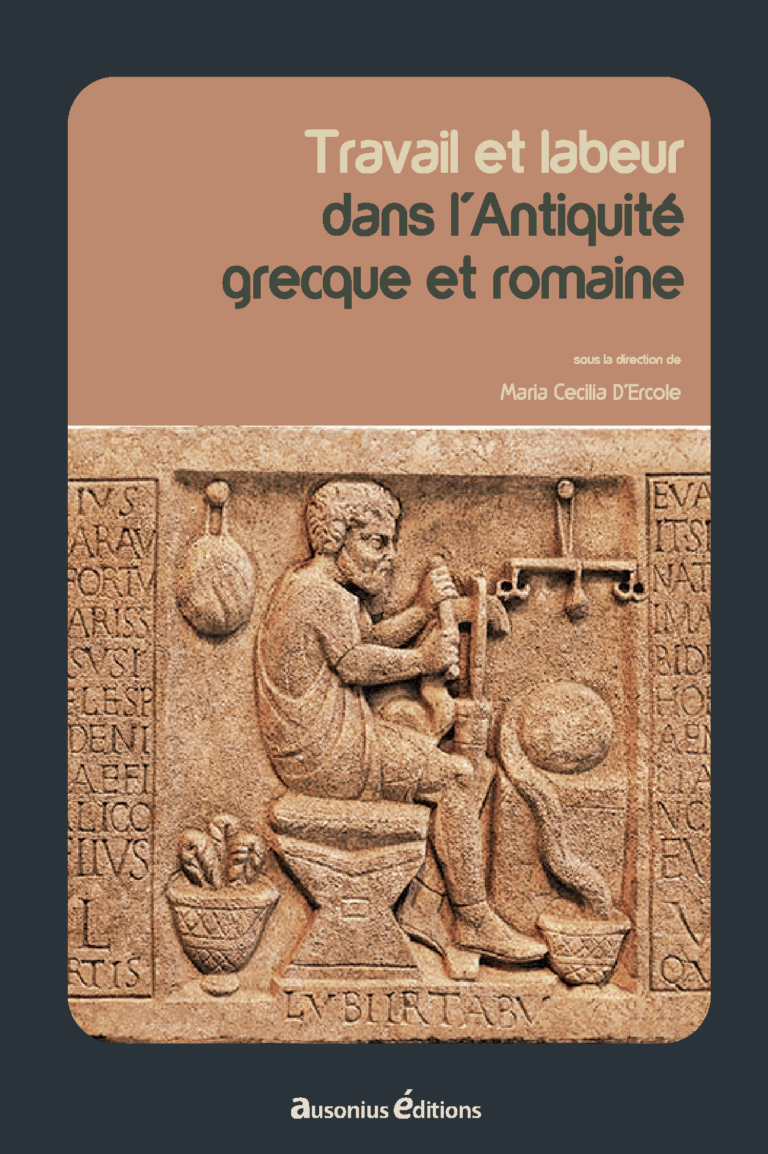1.
Je suis persuadé1 que les changements historiographiques – une vraie rupture – corrélés, entre le XXe et le XXIe siècle, à l’étude du travail humain dans les sociétés de l’Occident antique sont un exemple parfait de la manière dont, dans toute recherche historique, c’est toujours le présent qui conditionne de façon déterminante notre approche du passé. Entre les années 1960 et 1990, le thème du travail (ses formes historiques, les résultats de ses performances, la culture liée à sa socialité) semblait être la clé pour pénétrer dans la structure profonde des sociétés antiques, pour en donner enfin une description appropriée et pour construire une théorie de leur fonctionnement économique2. Lorsqu’en 1982 les “Annales” ont organisé à Turin, avec l’Istituto Gramsci, un séminaire italo-français sur “Travail, mentalité, culture”3, nous étions tous convaincus d’être au cœur d’un grand nœud historique et interprétatif : autour du travail, c’était le parcours entier de l’Occident qui, à notre avis, prenait corps et forme.
La question du travail se connectait inévitablement, dans la Méditerranée antique, à celle de l’esclavage, qui avait à son tour soulevé un débat long et passionné4 : selon un point de vue largement partagé à cette époque, aucune connaissance historique sérieuse de cette réalité n’aurait été possible sans une évaluation nouvelle et correcte de la place occupée par la main-d’œuvre des esclaves dans l’ensemble de ces systèmes sociaux. L’histoire économique de l’Antiquité se révélait toutefois un exercice difficile5 ; mais cet obstacle n’arrêta pas l’enthousiasme des chercheurs et, en effet, des avancées importantes furent accomplies.
Par la suite cependant, presque soudainement (dès la fin des années 1990), un grand silence s’est fait sur ces problèmes. Certes, quelques études particulières sur l’histoire du travail antique, dans les différents contextes où il était possible de retrouver ses traces, avaient eu lieu, surtout grâce à une recherche archéologique de plus en plus poussée et à une histoire sociale de moins en moins frêle. Pourtant on ne note alors aucun essor comparable aux efforts des décennies précédentes pour construire des modèles généraux, interprétations globales susceptibles de relier les paradigmes théoriques et la recherche de terrain. Cette voie ne semblait plus mener nulle part.
On estime souvent que cet obscurcissement soudain a été l’une des conséquences de la crise du marxisme européen, qui avait réussi les années précédentes à imposer son agenda théorique et historiographique. Il y a certainement du vrai dans cette explication, sur laquelle je ne veux pas m’attarder pour l’instant, même si le thème promet d’être utile et intéressant. Cela dit, je ne pense pas que cela suffise à expliquer ce qui s’est passé ces dernières années.
Je crois que, si l’on en est revenu à attribuer une valeur interprétative bien moins importante et moins générale au thème du travail antique, cela n’est pas uniquement dû à un bouleversement dans l’histoire des idées, et ne concerne pas uniquement la crise du marxisme (même si je serais le dernier à vouloir sous-estimer cette sortie de scène). À mon avis, il y a autre chose, et je pense que le coup d’arrêt a été aussi l’effet d’une mutation plus vaste, qui a concerné la forme même des sociétés contemporaines, le cadre systémique de notre présent : à savoir, la fin de la grande civilisation du travail – du travail matériel producteur de richesse sociale – dans les sociétés occidentales, résultat direct de la révolution technologique que nous traversons. Si l’image du travail s’est faite moins déterminante dans notre représentation de l’Antiquité, c’est parce qu’à nos yeux sa consistance s’est brouillée dans la réalité de notre époque. Nous sommes dans le flot d’une transition dont nous commençons à peine à mesurer l’ampleur, qui a profondément bouleversé la structure même de la relation entre technique et capital, au cœur de l’histoire de l’Occident moderne.
Ainsi s’est produit une sorte de glissement de l’axe de notre regard, passé de la réalité contemporaine du travail au marché, des rapports de production aux rapports d’échange, des forces de travail à la consommation, à la technologie, au système d’entreprise, à la finance. Ce changement de perspective s’est reflété d’une manière forte et reconnaissable sur le plan historiographique 6.
Bien évidemment, je ne veux pas dire que tout soit arrivé de façon directe et automatique. Quand nous parlons des effets culturels des grandes modifications structurelles, nous devons toujours supposer des interactions complexes, diluées dans le temps. Néanmoins, la révolution que nous sommes en train de vivre a eu des effets idéologiques et politiques énormes et rapides, visibles aux yeux de tous, et a aussi eu des conséquences sur la recherche historique, en transformant ses principales orientations. Encore un fois, c’est le présent qui explique ce que nous croyons voir dans le passé, et non pas le contraire.
2.
Pendant environ deux siècles, entre le dix-huitième et le vingtième, le travail humain productif de richesse matérielle, surtout dans la forme liée au développement de la grande industrie manufacturière (le “travail abstrait” des économistes classiques et de Marx) a été au centre de la construction de la modernité et de sa représentation. Les idéologies politiques ont parfois cherché à masquer ce fait établi, mais sa force finissait tout de même par s’imposer.
Nous pouvons considérer un célèbre texte d’Hegel, dans la seconde section de la Phénomenologie, comme la consécration d’une telle suprématie, perçue même avant la réflexion de Marx :
(…) le travail forme. Le rapport négatif à l’objet devient forme de cet objet même, il devient quelque chose de permanent, puisque justement, à l’égard du travailleur, l’objet se présente comme indépendant7.
Nous sommes ici face à une sorte d’apothéose précoce du travail ouvrier, qui renversait littéralement l’ancienne conception aristotélique des pages d’ouverture de la Politique8 ayant dominé dans toute l’Antiquité gréco-romaine. L’idée du travail en tant que moteur de libération et d’émancipation s’affirmait contre l’idée du travail comme coercition et comme esclavage.
Hegel, avant Marx, avait compris que le travail moderne, en se libérant des contraintes antiques et médiévales grâce aux innovations technologiques et grâce à l’organisation capitalistique de la production dans le sillage d’une révolution industrielle fondée sur le marché de la force de travail (sur le travail comme marchandise) transformait toute la société européenne. À certains égards, on peut affirmer que la naissance même d’une “société civile” au sens propre du terme est une conséquence de la pleine affirmation du nouveau travail. Il n’y a pas de liberté des Modernes – ni politique, ni juridique, ni économique – qui ne renvoie en quelque sorte à la construction et au développement de cette nouvelle figure, qu’elle prenne la forme du travail agricole ou se situe au sein du système de l’usine, en partant donc de la dialectique entre classes productrices et capital, et de ses contradictions. Dans ce sens, nous pouvons considérer l’histoire du travail moderne comme l’histoire généalogique des libertés des Modernes. Je crois que l’utopie même d’une société communiste, et avec elle une grande partie de la pensée de Marx, peut s’inscrire à l’intérieur de ce processus9.
Cependant, à la fin du XXe siècle, l’explosion de la troisième révolution technologique de l’histoire humaine – après l’agricole et l’industrielle – est en train d’apporter une transformation peut-être plus profonde encore que celles qui suivirent les deux premières, et beaucoup plus rapide. Le grand système de l’industrie – sidérurgique, chimique, textile –, qui a constitué pendant deux siècles l’ossature de la modernité, est en train de disparaître presque partout en Occident. Cette fin a mis en crise, dans nos sociétés, la centralité du travail, ou du moins du travail producteur de la richesse matérielle. Il s’agit d’un changement qui est en train de modifier la forme du monde, avec des conséquences que nous ne réussissons pas encore à prévoir.
Marx lui-même, par ailleurs, dans un texte extraordinairement prophétique dont on pourrait dire qu’il va au-delà du marxisme, nous parle de l’arrivée d’un moment historique – qu’il ne croyait pas éloigné de son époque – où “la création de la richesse réelle dépend beaucoup moins du temps de travail et de la quantité de travail employé, que de la puissance des forces activées durant le temps de travail, qui à son tour […] dépendent des conditions générales de la science et du progrès de la technique, et de leur application à la production”10. Il fallait peu de choses, me semble-t-il, pour deviner la fracture qui allait s’ouvrir juste après. S’il en allait ainsi, le travail ouvrier ne pouvait être considéré comme le pilier inébranlable autour duquel faire tourner l’histoire humaine, mais au contraire, comme une forme sociale qui dans un futur plus ou moins proche, risquait littéralement de disparaître.
Cependant Marx, à ce point, s’arrête. Il savait très bien que la hausse croissante du seuil technologique réussirait à faire du travail vivant des ouvriers (exalté par Hegel dans le texte que nous venons de citer) un simple aspect marginal, secondaire dans le processus de création de la richesse sociale. Il en tirait cependant une conclusion totalement infondée, une espèce d’auto-illusion réconfortante : à savoir que l’augmentation de la productivité du travail au-delà d’une certaine limite aurait été le point final du mode de production capitaliste, et que toute croissance ultérieure n’aurait pu s’obtenir qu’en dépassant sa frontière, sans toutefois jamais douter de la permanence non modifiable d’une structure industrielle complétement similaire à celle qu’il avait devant les yeux lorsqu’il contemplait l’Angleterre de la deuxième moitié du XIXe siècle. Les conditions de vie matérielle déterminées par la grande industrie mécanique étaient projetées dans un halo d’irrévocabilité et de nécessité irréversibles, comme une sorte d’aboutissement de la civilisation humaine.
Ce n’était pas le cas, comme l’histoire allait bientôt le démontrer. La grande industrie était une forme historique du capital, et non l’inverse. Le capital du XXIe siècle a non seulement survécu à la fin du monde industriel, mais il a mis en marche la nouvelle révolution technologique, et, à travers ses transformations, il la détermine.
C’est le travail, au contraire, qui ne survit pas au changement, si ce n’est par une mutation complète, en perdant son caractère abstrait, sériel, infiniment quantifiable (le travail par excellence de la classe ouvrière du système classique de l’usine) et en redevenant un travail dominé par le qualitatif, par l’individuel, par le fragmenté, par le compétitif : le travail dans les sociétés à haute densité technologique. Cela pourrait ressembler à un retour en arrière, vers un passé précapitaliste et dans tous les cas, préindustriel : mais c’est, tout simplement, notre futur11.
3.
Cette transformation – un vrai changement d’époque – est en train de modifier aussi nos pratiques historiographiques. Après avoir créé dans nos sociétés une fracture entre capital et travail de masse, qui jette ce dernier dans une marginalité sans issue, elle risque de nous faire perdre quelque chose de fondamental : le rapport entre travail et modernité, et peut-être même entre travail et civilisation. Mais cela nous offre aussi une perspective totalement nouvelle, qui peut devenir précieuse du point de vue de la connaissance historique. Cela nous fait en effet comprendre que le travail dominé par le modèle de la grande industrie et par la culture sociale qui en est dérivée n’est pas une forme acquise pour toujours dans l’organisation des sociétés humaines, une espèce de point de non-retour, mais seulement l’une des variantes possibles le long d’un parcours dont nous ne pouvons prévoir la trajectoire.
Je crois que cette relativisation de la forme industrielle de la production capitaliste est un résultat d’importance considérable, rendu possible par les développements de notre présent (Marx historicisait le capital, mais il a longtemps considéré la production industrielle comme une acquisition non modifiable). Cette relativisation permet une vision plus correcte des sociétés antiques, car elle ouvre la voie à une historicisation complète de certaines catégories de notre analyse sociale, dont nous avons fait usage de manière pas toujours théoriquement surveillée.
Je pense avant tout au paradigme des “classes”, de leur lutte et de leurs formes de conscience, dont l’application a été arbitrairement dilatée par une partie significative de l’historiographie du XXe siècle, pas nécessairement strictement marxiste, au point d’en faire une clé universelle de l’interprétation historique. Il s’agit là, à mon avis, de l’une des pires formes de pollution de l’étude du passé jamais produite par la culture européenne pendant les XIXe et XXe siècles. Nous nous rendons de mieux en mieux compte, en effet, que la division des sociétés en classes – sauf si nous prenons le mot dans un sens trés général et métaphorique, qui dépasse toute définition scientifique en termes d’analyse sociale – est un phénomène qui ne concerne que les sociétés nées autour de la révolution industrielle, et donc strictement limité à leur histoire. La “lutte des classes”, qui est un épisode grandiose et générateur de la modernité pour un bonne partie de l’Occident, est un modèle spécifique de conflit et de subjectivité collective qui ne peut guère se transposer hors de son temps historique : ni dans le passé pour expliquer Rome et la Grèce, ni dans notre présent post-industriel – comme nous le voyons aujourd’hui avec une clarté de plus en plus grande.
Dans l’histoire d’Athènes et de Rome, il n’a jamais existé non plus une forme de “conscience de classe”, pour la simple raison que dans les sociétés antiques on ne saurait trouver la trace de réelles “classes” au sens moderne et fort du mot, mais seulement des stratifications sociales, même très articulées, dont la dynamique et les conflits n’ont jamais donné lieu à de véritables structures comparables à celles de la modernité capitaliste européenne. Autrement dit, le travail antique ne déterminait pas l’ossature de la société : il aurait fallu pour cela des conditions jamais réalisées dans ce contexte, comme l’instauration à grande échelle d’un rapport juridiquement paritaire entre propriétaires de terres et d’ateliers d’un côté et paysans et travailleurs de l’autre, comme cela se produira dans l’Europe moderne entre détenteurs des moyens de production et détenteurs (libres) de la force de travail. Une telle relation n’émergera jamais dans les sociétés antiques, du moins comme forme dominante du cadre social, pas même dans la Rome du Ier s. a.C. : la voie était bloquée par la diffusion de l’esclavage, dont le caractère intrinsèquement coercitif empêchait que le travail prît, de façon générale, la forme de marchandise à vendre par des travailleurs libres, et que par cela se constitue une structure de classes12.
En effet, cette dernière présuppose toujours l’existence d’un marché de la force travail (avec les tensions qui peuvent historiquement surgir entre l’égalité formelle des contractants et l’inégalité réelle de leur pouvoir social et économique) et en même temps la présence d’un modèle unitaire de travail de masse, standardisé et reproductible à l’infini, comme celui des ouvriers dans le système moderne de l’usine. C’est pourquoi la Rome de la fin de la République ou bien l’Athènes du Ve siècle, malgré leur extraordinaire développement économique et civil, ne ressemblent guère ni à Londres ou au Paris du XVIIe siècle, ni même à Florence ou à Naples au Bas Moyen Âge 13.
Dans l’Antiquité classique, au contraire, c’était la personne même de l’esclave, et pas seulement sa force de travail, qui était une marchandise. Le lien de dépendance personnelle, en réduisant les hommes à des choses, annihilait la distinction – qui est l’essence même de la modernité – entre la personne du travailleur et la vente de sa force travail. Dès lors, ce lien empêchait que la scission intrinsèque au rapport de classe s’opère, comme si l’exercice du travail dépendant, dans sa forme esclavagiste, finissait par effacer la différence entre personnes et choses, assimilant la personne du travailleur à la chose du travail. Même dans le cas, surtout dans les campagnes ou dans les activités de construction des bâtiments urbains à Rome de la fin de la République jusqu’au IIe s. p.C., où se réalisaient des mécanismes d’intégration entre travail servile et travail dépendant effectué par une main-d’œuvre libre (par exemple à travers la forme juridique de la locatio operarum), les conditions matérielles dans lesquelles se réalisaient ces prestations, et la pression également physique exercée par les employeurs pour maximiser les profits, finissaient par attirer les travailleurs libres, du point de vue de leur protection, de l’effectivité de leurs droits et de leur statut social, dans le champ magnétique du travail servile. C’était une sorte de damnation qui établissait un lien insurmontable entre travail manuel et violence, entre travail manuel et soumission personnelle. Travailler physiquement pour un autre portait en soi une telle charge de discrimination et d’oppression que cela pouvait bien difficilement être compatible avec la formation d’une personnalité moralement et civilement appréciable, avec le statut politique et social d’un véritable citoyen.
Seul le travail effectué par le paysan libre, maître de la terre sur laquelle il se trouvait, réussissait à échapper à cette dégradation, dans un paradigme d’autarcie propriétaire qui avait été un élément essentiel dans la constitution de la démocratie athénienne ainsi que de la république romaine. C’était l’exemple vertueux du paysan-citoyen-soldat chez qui les aspects les plus étroitement économiques restaient au second plan, alors que l’accent était mis sur la construction d’un type moral particulier, forgé par une relation quotidienne avec la terre, et proposé comme point de référence éthique et civile14.
4.
Les historiens modernes ont tenté, à plusieurs reprises, de quantifier de façon plus précise – malgré les difficultés que nous retrouvons dans les sources antiques – le rapport entre travail servile et travail libre à des époques et des lieux donnés. Je suis convaincu que la présence massive d’esclaves dans l’Athènes du Ve siècle, comme dans l’Italie romaine à la fin de la République, ne peut en aucun cas être sous-estimée. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas seulement d’un problème de quantité, mais aussi de qualité sociale, non pas de nombres, mais de mentalité et de culture. Dans toute l’Antiquité classique, l’idée que la zone de contact entre la nature et le travail humain organisé (lieu où se créait, dans la campagne ou dans les ateliers, la grande partie de la richesse sociale destinée à entrer dans le réseau des marchés) était une sorte d’espace mort – sans vie et sans histoire – de la civilisation humaine, entourée d’ombres déterminées par la présence du travail servile, s’est toujours présentée avec la force d’une évidence indiscutable.
Cependant, l’origine entièrement extra-économique du lien de dépendance de l’esclave, c’est-à-dire du rapport entre esclave et maître, représentait un obstacle insurmontable à la formation des classes, car jamais les travailleurs et les propriétaires de terres ou d’ateliers ne réussissaient à se retrouver face à face. Il n’y avait de place que pour une seule figure : celui qui était à la fois propriétaire de terre (plus rarement d’ateliers) et maître d’esclaves. Cela ne permettait de développer ni une structure sociale de classe, ni cet auto-dynamisme du processus productif qui caractérise les systèmes économiques capitalistes de la modernité : alors que l’ouvrier libre est, en quelque sorte, “créé”, dans sa condition d’ouvrier, par l’usine, la production et le contrat, l’esclave n’était pas “créé”, en tant qu’esclave, par les latifundia ou par le “villæ”, mais pour des raisons externes au cycle économique, comme la capture de guerre ou le razzias de la traite ; il pouvait être acheté et vendu, mais pas “produit”, en tant qu’esclave, par le processus économique. Le latin, comme le grec, n’avait même pas de mot pour exprimer la notion – inexistante alors – de travail humain abstrait, qui ne naîtra, en Europe, qu’avec la révolution industrielle.
La société romano-italique du dernier siècle a.C., comme l’Athènes de Périclès, était certes un ensemble très structuré et nuancé, allant de l’ordre sénatorial à grande rente agraire à l’ordre équestre (commerçants, usuriers, adjudicateurs d’impôts, propriétaires d’ateliers et de navires), en passant par ce qui avait survécu des anciennes couches de petits paysans-propriétaires et jusqu’à à la plèbe urbaine, aux masses d’esclaves, aux marginaux des campagnes. Elle était aussi traversée par des affrontements politiques féroces. Elle resta toutefois une société “d’ordres” et de “statuts”, et non pas de classes : un univers dans lequel l’économie jouait un rôle important, mais non décisif pour la formation des hiérarchies sociales, au regard du poids d’autres éléments : les liens de parenté, la politique et les charges publiques, la carrière militaire, la citoyenneté, la condition d’homme libre ou d’esclave. Surtout, cette société n’arriva jamais à déclencher une véritable accumulation de capitaux en mesure de donner vie à quelque chose de similaire à un décollage techno-industriel, et moins encore à faire naître une authentique bourgeoisie qui aurait placé au cœur de ses objectifs la productivité et le réinvestissement, plutôt que la rente, ou bien le travail intellectuel comme profession et comme vocation.
Au contraire, il s’agissait d’un système social que nous pourrions définir unilinéaire, à orientation uniquement aristocratique, ayant à la base des masses plébéiennes rendues amorphes par l’absence des liens internes ainsi que par le manque de toute forme de socialisation de leur vie autre que les spectacles et la distribution de subventions publiques15, avec plus bas encore d’énormes quantités d’esclaves auxquels était confiée presque totalement la production de la richesse. Ce n’est pas un hasard, du reste, si sur tout le territoire de l’Empire, du Rhin à l’Euphrate, il n’y a pas trace (archéologique ou autre) d’un site permettant de supposer l’existence d’une seule zone avec une densité d’usines comparable à celles des temps modernes, même antérieur à la révolution industrielle.
5.
La métamorphose du travail (ce changement même du rapport entre technologie et travail que Marx avait précocement pressenti) qui nous pousse vers une nouvelle ère de l’histoire humaine, nous enseigne autre chose sur la spécificité historique du travail antique et du système économique dans lequel il s’inscrit.
À certains égards, le syndrome que nous traversons est le renversement spéculaire de celui qu’a subi l’Antiquité classique. Jadis, ce fut la technique qui stagna, par rapport au bond accompli par d’autres savoirs et d’autres talents : la philosophie, la politique, le droit, l’éthique, l’art, la religion, dont les constructions (l’idée de démocratie, la grammaire des formes de gouvernement, l’invention de la raison juridique avec la capacité disciplinante de son formalisme, la relation entre être et temps, l’élaboration de la loi morale, l’architecture d’un monothéisme d’un attrait exceptionnel, l’éducation littéraire et visuelle à la beauté) ont orienté notre civilisation.
Aujourd’hui, nous sommes écrasés par un déséquilibre inverse : une poussée technologique qui ne réussit pas encore à trouver un cadre culturel, politique, juridique, moral capable d’en soutenir le poids. L’histoire de l’humanité, comme celle de l’univers, ne dédaigne pas les symétries. Dans les deux cas – antique et moderne – l’élément qui provoque le décalage est le même qui permet d’accomplir l’avancée : ainsi, dans le monde classique, la coercition inséparable de tout travail matériel, avec ses conséquences allant jusqu’à l’esclavage, fut indispensable pour rendre possible le développement de ces formes de pensée que nous considérons encore comme précieuses ; de façon analogue, dans le monde contemporain, la force de la relation entre technique et marché, si elle peut créer et répandre la démesure et l’inégalité, en mettant en mouvement des dynamiques que nous ne pouvons pas contrôler, est en revanche un moteur dont nous ne pouvons pas nous passer.
Maintenant que nous pouvons le regarder rétrospectivement, du moins en Occident, nous nous rendons mieux compte que la potentialité d’émancipation du travail manuel moderne – bien entrevue par Hegel, puis analysée par Marx, et démontrée par deux siècles des luttes ouvrières – se trouvait dans le fait d’être un travail de masse, un travail social : le résultat d’un processus de coopération entre les travailleurs aux dimensions jamais expérimentées auparavant, et rendu possible par la mécanisation ; un énorme cumul de travail humain, sériel, continu, rythmé par une division rigoureuse des temps et des tâches, reproductible à l’infini, concentré autour de l’usage des machines, dans des lieux spécifiques destinés à les contenir : l’usine moderne. En somme, un cumul de travail social qui, grâce à la médiation du capital sous sa forme industrielle, se reversait sur les choses en les transformant, et en déterminant leur valeur en tant que marchandises.
Quand ce processus d’accumulation a commencé, le travail humain disponible se présentait historiquement, dans l’Europe au début de la modernité, sous la forme de travail libre, c’est-à-dire de force de travail fournie par des hommes libres qui la vendaient sur le marché tout en restant, avant et après la vente, des personnes libres. C’est ainsi que celui-ci entra dans la production industrielle, en figurant sous trois formes différentes dans tout le cycle économique : comme travail-marchandise qui permettait au travailleur d’acquérir un salaire ; comme travail productif rendu possible par une coopération sociale sans précédent, qui réalisait l’élaboration matérielle des choses sur lesquelles il s’exerçait, en les transformant en marchandises ; et enfin comme travail-valeur, déposé dans les marchandises. Cette triple présence, bien que contrainte dans la forme des rapports de production capitaliste, avait un potentiel d’émancipation inouï en faveur de la figure centrale de tout le processus : celui qui, par son activité, mettait en marche toute la séquence.
L’économie du XXIe siècle nous a toutefois appris que cette rencontre entre capital et travail de masse n’est pas la condition nécessaire pour toute forme de développement du capital ; que le nouveau capital financier et informationnel (comme Castells propose d’appeler l’entrecroisement entre finance et révolution technologique)16 peut aussi réduire sa propre dépendance du travail de masse sans compromettre sa croissance, et qu’en tout cas, quand la rencontre se fait, la combinaison peut prendre des voies différentes, loin de la formation des grandes masses de travail social. On semble être face à une nouvelle loi de tendance du processus économique : plus le capital resserre sa connexion avec la technologie, plus il devient capital techno-financier, plus il semble s’éloigner du monde du travail.
En réalité, il ne s’agit pas d’une fuite de tout travail, mais simplement d’une distance concernant l’une de ses formes historiques précises : celle du travail “abstrait” et de masse, propre au système de l’usine. C’est ce travail – celui qui a créé notre modernité – que le nouveau capital fuit, car il n’en a plus besoin. Il y a toutefois un autre travail, non sériel, non répétitif, non réductible à la pure quantité, capable d’intégrer des parts croissantes de connaissance technologique, par lequel le capital du XXIe siècle est fortement attiré, parce qu’il le reconnaît comme l’un de ses produits, exactement comme le capital industriel reconnaissait comme son produit l’ancien travail abstrait. Ce travail post-industriel est désintégré, moléculaire, ponctuel, et il crée beaucoup plus de compétition que de solidarité ; il sépare, beaucoup plus qu’il n’unit. Il ressemble plus au travail des systèmes précapitalistes qu’à celui qui est spécifique de la modernité.
Mais comment fonctionne une société, quand elle n’est pas maintenue par de fortes trames de travail social ? Comment fonctionne une organisation humaine dans laquelle le travail productif de richesse matérielle n’est plus la colonne vertébrale de toute la collectivité ?
De façon totalement inattendue, ces questions, qui sont pour nous de l’actualité la plus stricte, semblent relier notre présent à des époques éloignées dans le temps. Elles font réapparaître chez nous des blocs de passé que nous croyions perdus pour toujours et proposent à nouveau des thèmes et des catégories que nous considérions comme ne nous appartenant plus : d’où le problème crucial de la croissance exponentielle des inégalités à l’intérieur d’une structure économique qui écarte des plus en plus ses pôles, ou bien la question de l’individuation de formes d’émancipation, soit individuelles, soit collectives, qui ne passent plus ni à travers le travail de masse, ni à travers la lutte des classes.
Avec cela, je ne veux pas suggérer, évidemment, des associations impensables. Je veux seulement observer que les transformations contemporaines du travail mettent en crise, définitivement peut-être, une idée unilinéaire et progressive de l’histoire, à laquelle nous nous sommes à plusieurs reprises laissés aller avec trop de confiance, en la remplaçant par un paradigme fondé sur la discontinuité et le manque d’homogénéité dans la relation entre le passé et le présent. Le passé ne disparaît pas d’un seul coup, mais par blocs, et quelquefois certaines de ses parties refont surface dans les déchirements du présent. La liaison entre capital et travail social de masse à l’intérieur du système d’usine ne constitue pas un point de non-retour en fonction duquel mesurer passé et futur. Il a seulement représenté une possibilité historique, réalisée dans un lieu et à un moment donné, tout au long d’un parcours qui connaît une pluralité de voies et de variantes. Nous ne sommes qu’au début d’une longue exploration, sur une trajectoire dont nous n’arrivons même pas à imaginer la complexité.
Dans les sociétés de la Méditerranée antique – et en particulier dans l’Athènes démocratique et dans la Rome de la république impériale – le travail libre sous forme de travail pour d’autres, même quand il apparaissait de manière non sporadique, ne réussissait jamais à prendre un vrai caractère de masse, ni à amorcer des formes de coopération entre les travailleurs susceptibles de développer leur conscience, et ne réussissait donc pas à créer des liens sociaux de quelque importance que ce soit. Surtout, il ne fut jamais capable de devenir le modèle culturellement dominant de travail dépendant : ce dernier fut toujours représenté par l’esclavage.
En d’autres termes, le travail salarié ne fut jamais en mesure de s’auto-valoriser comme cela allait se passer en revanche dans la modernité. Il n’a jamais créé cette culture du travail et de l’égalité à travers le travail qui allait constituer la structure porteuse des sociétés formées par le capital industriel, aussi bien dans sa version ouvrière, que dans sa version bourgeoise : Simone Weil et Thomas Mann le savaient bien.
Cette impuissance a une double explication. La première – et la plus connue – est liée à la présence invasive de l’esclavage, qui écrasait le travail libre, en empêchant de fait qu’un marché se crée et en déversant dans les campagnes et dans les grands centres urbains des millions d’esclaves, masses à leur tour désagrégées et hétérogènes, souvent soumises à la coercition terrible, qui accompagnait, jour après jour, leur existence.
La seconde est moins étudiée, mais tout aussi importante que la première : elle concerne les conditions technologiques dans lesquelles le travail dépendant était effectué. Pour engager un processus d’auto-valorisation, il n’a en effet pas suffi d’éliminer, dans l’Europe moderne, la contrainte de l’esclavage, mais il a également fallu que celui-ci soit exercé sous un régime technologique particulier (typique de l’industrie mécanique, et seulement de celle-là) connecté à des formes des coopération et de répétitivité de masse qui ont considérablement poussé au renforcement des liens sociaux entre travailleurs et à la naissance d’une conscience commune, véritablement “de classe”. L’abstraction du travail industriel n’a pas seulement été une productrice extraordinaire de marchandises matérielles ; elle a aussi été un moteur d’égalité, d’émancipation et de culture sociale.
Si ces conditions ne se réalisent pas, soit parce qu’elles n’ont pas encore été atteintes, comme dans le monde préindustriel, soit parce qu’elles ont déjà été dépassées par des technologies plus avancées, comme dans notre présent post-industriel, alors le travail manuel n’est plus en mesure de s’autovaloriser et de s’auto-émanciper, et encore moins de produire et de répandre de l’égalité. Sa place est prise par un modèle de travail moins abstrait, dans lequel l’aspect qualitatif et compétitif prédomine, et le rapport entre travail, liberté et égalité – qui a mis en forme le monde moderne – vient à se briser d’un façon catastrophique et définitive.
En ce sens, nous pouvons aujourd’hui de plus en plus mesurer que ce que nous appelons modernité n’a été qu’une parenthèse relativement brève, durant laquelle le travail dépendant, manuel et de masse, dans sa forme la plus abstraite, c’est-à-dire la plus égale et quantitative, a célébré son triomphe, en construisant autour de lui un univers social tout entier. Cela n’était pas arrivé dans les sociétés antiques et ne se passe pas dans les sociétés de l’Occident contemporain, par manque de technologie à l’époque, par sa redondance aujourd’hui. La découverte de cette espèce de symétrie ne sert pas à établir une comparaison mais à nous faire réaliser combien la fenêtre à travers laquelle est passée l’histoire de l’Europe et de l’Occident a été étroite, et jusqu’à quel point les cas grec et romain – sociétés non capitalistes, et non construites autour du travail – est loin d’être exceptionnel, ou seulement pré-moderne, sur la carte de l’histoire. C’est bien plutôt la solution opposée, celle dont nous sortons, qui a été exceptionnelle : une conscience que nous n’aurions jamais acquise sans la fin du monde industriel, dont la disparition semble marquer une autre métamorphose du capital. Mais ce dernier, à son tour, n’est qu’une forme historique, et les transformations interne à son cycle ne sont pas illimitées.
6.
Concernant les esclaves romains (le discours serait différent pour la Grèce), tant de coercition dans le régime auquel ils étaient soumis n’empêcha pas à nombre d’entre eux, surtout dans les villes, de s’intégrer dans la société impériale, et pas forcément dans ses couches les plus basses, et d’y être accueillis non pas comme un corps étranger mais comme un élément actif et vital. C’est là que se révèle le talent des Romains – inégalé dans l’histoire – d’assimiler sans préjugés des cultures et des peuples différents, à condition qu’ils participent d’une façon ou d’une autre aux grands processus d’unification de l’Empire. À travers la pratique des manumissions, chaque maître, de son propre chef, sans aucune intervention de l’autorité politique, pouvait accorder la liberté à son esclave, en faire un “affranchi”, ce qui lui conférait en même temps la citoyenneté romaine. Durant les dernières années de la République, cette tendance se répandit avec une grande intensité : beaucoup de maîtres préféraient avoir des citoyens libres liés à eux par des obligations juridiques et économiques, comme justement les affranchis, plutôt que de conserver des esclaves qui tôt ou tard seraient devenus vieux et inutiles. Ces années-là, à Rome, des centaines de milliers de citoyens étaient d’origine servile. Plus tard, à l’époque de Néron, Tacite rapporte qu’au Sénat le bruit courait que la plupart des chevaliers, sans parler du nombre des sénateurs eux-mêmes, avaient du sang d’affranchis.
Ainsi prenait forme tout un espace, à géométrie variable et multiforme, de croisements culturels, de pratiques sociales et de pouvoir, de relations et d’échanges, partagé entre le monde des hommes libres et celui des esclaves. C’étaient les formes d’assimilation – à ne pas sous-évaluer – d’une société dure, fortement structurée par ordres, pour laquelle le travail dépendant était seulement soumission, peine et exploitation, mais qui était aussi capable d’exprimer une rapidité de changement et de mobilité sociale, non négligeable. Le monde antique était aussi cela.
Bibliographie
Andreau, J. (1988) : “Introduction” in : Rostovtseff, M., Histoire économique et sociale de l’empire romain, Paris, I-LXXXIV.
Bowman, A. et Wilson, A., éd. (20132) : Quantifying the Roman Economy. Methods and Problems, Oxford.
Castells, M. (20102) : The Information Age, vol. I, The Rise of the Network Society, Malden – Oxford.
Dari-Mattiacci, G. et Kohoe D.P., éd. (2020) : Roman Law and Economics, 2 vol., Oxford.
Erdkamp, P., Verboven, K. et Zuiderhoek, A., éd. (2020) : Capital, Investment, and Innovation in the Roman Economy, Oxford.
Finley, M.I. [1973] (19852) : The Ancient Economy, Berkeley – Los Angeles.
Finley, M.I, [1980] (1998) : Ancient Slavery and Modern Ideology, Princeton.
Giardina, A. et Schiavone, A., éd. (1981) : Società romana e produzione schiavistica, 3 vol., Rome – Bari.
Haklai, M. (2025) : Money in Imperial Rome. Legal Diversity and Systemic Complexity, Oxford.
Hegel, G.W.F. (1952) [1807] : Phaenomenologie des Geistes, Hamburg (trad. fr. Hyppolite, J. Paris 1970).
Marx, K. [1857-1859] (1974) : Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie (1857-59), Berlin, (trad. fr. R. Dangeville, Fondaments de la critique de l’économie politique, t. II, Paris 1967).
Schiavone, A., éd. (1989) : Storia di Roma. vol. 4. Caratteri e morfologie, Turin.
Schiavone, A. (1999) : I conti del comunismo, Turin.
Schiavone, A. [2003] (20092) : L’histoire brisée. La Rome antique et l’Occident moderne (trad. de l’éd. it. La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno, Rome – Bari [1996], 20202 ), Paris.
Schiavone, A. (2004) : “Piccolo esperimento mentale in tre sequenze”, Studi Storici, 45, 1, 37-40.
Schiavone, A. (2017) : “Le travail des anciens et des modernes”, QS, 86, 21-39.
Schiavone, A. (2020) : Une histoire de l’égalité. Leçons pour le XXIe siècle (trad. de l’éd. it. Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia, Turin, 2019), Paris.
Schiavone, A. (2022) : L’Occidente e la nascita di una civiltà planetaria, Bologne.
Temin, P. (2013) : The Roman Market Economy, Princeton – Oxford.
Veyne, P. (1976) : Le Pain et le cirque. Sociologie historique d’un pluralisme politique, Paris.
Veyne, P. (1979) : “Mythe et réalité de l’autarchie à Rome”, REA, 81, 3-4, 261-280.
Notes
- Ce petit essai a été écrit durant l’été 2014, à la suite de la journée organisée à Paris par l’AFHE et l’Ehess, et il a paru dans Quaderni di Storia (Schiavone 2017). Depuis, il semble qu’une époque entière se soit écoulée, car la révolution que nous vivons accélère les temps historiques d’une manière jamais connue auparavant, en rendant évident et acquis ce qui semblait encore il y a peu tout à fait nouveau. Cependant, les tendances fondamentales que j’avais entrevues paraissent toutes se confirmer après une décennie, même si c’est par des voies que nous étions loin de prévoir. Je me suis donc limité à quelques petits ajustements et à quelques intégrations bibliographiques, notamment en référence à mes contributions postérieures à la parution de l’article.
- Je me borne à rappeler ici le livre de Finley [1973], 19852, qui fut à son époque au cœur d’un vif débat, ainsi que le long essai de Jean Andreau, en introduction à l’édition française de The Social and Economic History of the Roman Empire de Michail Rostovtseff (Andreau 1988, p. I-LXXXIV).
- Les actes de cette Rencontre n’ont malheureusement pas été publiés.
- Je rappelle seulement encore un livre de Finley [1980], 1998, ainsi que les volumes du séminaire d’études de l’Antiquité de l’Istituto Gramsci (Giardina & Schiavone, éd. 1981), et le quatrième volume de la Storia di Roma Einaudi, sur les Caratteri e morfologie (Schiavone 1989).
- Je peux renvoyer à mon livre sur L’histoire brisée (Schiavone [1996] 20202, trad. fr. Schiavone [2003], 20092, notamment aux chapitres III et IV.
- Il suffit de penser, parmi les nombreux exemples que l’on pourrait rappeler, au livre de Temin 2013, ou à plusieurs des “Oxford Studies on the Roman Economy” : entre autres, à Erdkamp, Verboven & Zuiderhoek, éd. 2020, à Bowman & Wilson, éd. 20132, à Haklai 2025 et enfin à presque toutes les études comprises dans les deux volumes de Dari-Mattiacci & Kohoe, éd. 2020.
- Hegel [1807] 1952, 149, trad. fr. Hyppolite 1970, 164-165.
- Aristote, Politique, 1.4. 1254a, 9-17 (“…c’est pourquoi, tandis que le maître est simplement maître de l’esclave, mais ne lui appartient pas, l’esclave, lui, non seulement est l’esclave du maître, mais encore lui appartient entièrement…”). Cf. aussi Éthique à Nicomaque, V. 10.1134b, 8-18.
- J’ai développé ailleurs ce concept : Schiavone 1999, notamment 18 sq. Je peux aussi faire référence à mon livre sur l’égalité : Schiavone 2020, 203 sq. (éd.it. Schiavone 2019, 183 sq.).
- Marx [1857-1859] 1974, 592, trad. fr. Dangeville 1967, 221.
- Schiavone 2020, 230 sq., et Schiavone 2022, 39 sq.
- Schiavone [2003], 20092, 129 sq., 199 sq.
- Schiavone 2004, 37-38.
- Veyne 1979, 261 sq.
- Veyne 1976, notamment 67 sq. et 84 sq.
- Castells 20102.