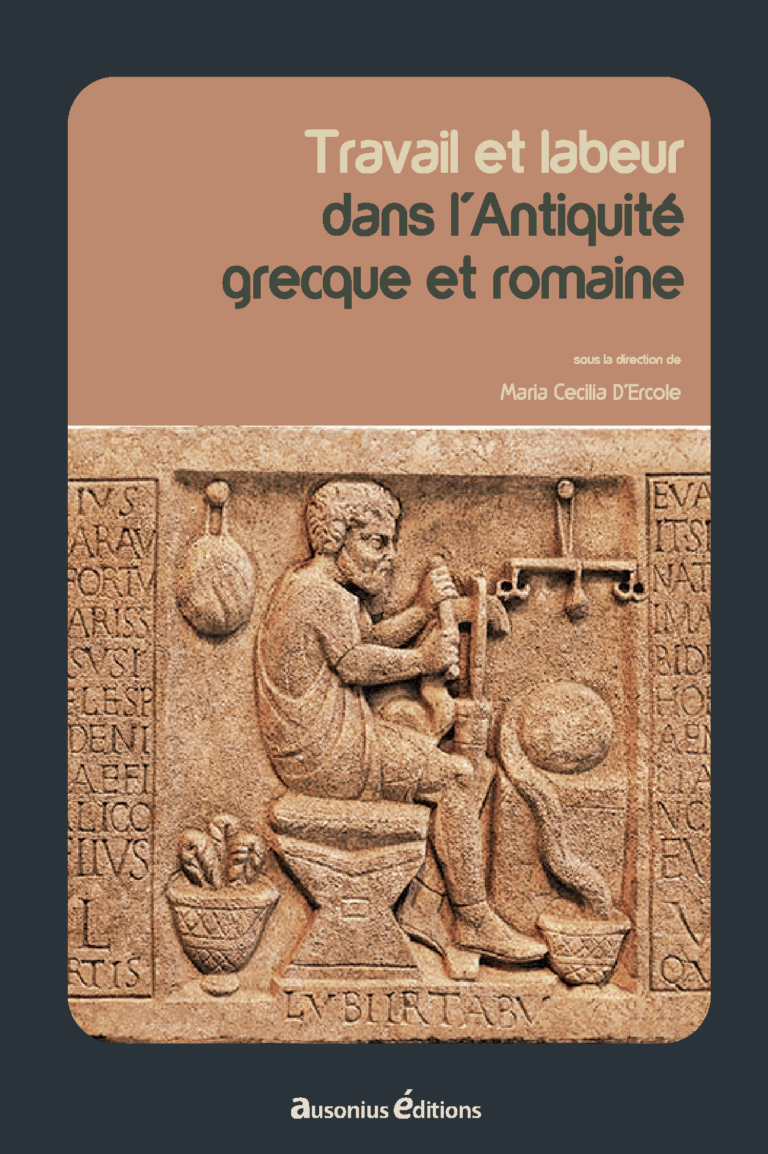Le travail et la cité grecque ne font pas bon ménage dans l’historiographie. La tradition érudite s’est nourrie, génération après génération, des thèmes du dédain du travail manuel, de la servitude du travailleur, de la célébration du loisir intellectuel et du détachement profond face aux choses économiques. Il est vrai que les Grecs y ont mis du leur dans les textes classiques qui nous sont parvenus où reviennent en boucle la hiérarchie justifiée des tâches et la mise à l’écart des gains matériels. Tout concourt donc en apparence à définir la société grecque comme un effort pour construire un cadre politique unique en mettant le plus possible le travail à la périphérie de la cité. Un monde du travail à peine visible dans le monde de la cité, voilà où aboutirait le fait grec. Au mieux le travailleur ou l’artisan sont des “héros secrets de l’histoire grecque” comme l’avait écrit dans une formule célèbre Pierre Vidal-Naquet1. La cité vivrait ainsi avec l’ombre de l’atelier et l’éloignement des champs.
Est-ce légitime de s’opposer à cette situation souvent décrite et qui semble justifier une position de principe de l’historien ? Ma réponse, positive, sera la suivante : il n’est pas aisé de se débarrasser du travail et je ne sais même s’il est sérieux de faire l’histoire d’une société sans le travail. Plutôt qu’une conclusion claire, je vois donc la forme grecque du travail comme une aporie provisoire, une probable incompréhension de ce qui se passe réellement dans l’histoire grecque, une situation bizarre qui doit être vécue comme un point de départ. Comme il ne s’agit d’aucune façon dans le cadre d’un article de refaire complètement une histoire, je tenterai ici seulement de replacer le travail en Grèce dans un contexte général qui implique à la fois analyses sur nos sources et comparaisons avec d’autres sociétés.
Deux idées simples tout d’abord. Comme toute idéologie (en prenant le mot au sens le plus large), l’idéologie du travail est historique et évolue en permanence (avec des rythmes forcément différents selon les moments), malgré ce sentiment d’évidence que décrivait très bien K. Marx dans une formule célèbre : “Le travail est, semble-t-il, une catégorie toute simple et l’idée de travail en général est vieille comme le monde. Conçu sous l’angle économique, dans toute sa simplicité, le ‘travail’ est cependant une catégorie aussi moderne que les rapports qui engendrent cette abstraction, pure et simple”2.
La deuxième idée découle de la précédente. Nous savons que pour les Anciens et les Grecs dont je parlerai particulièrement, le travail n’est pas ressenti à la façon du travail moderne. Comme le disait Jean-Pierre Vernant au seuil d’articles fondateurs sur l’aspect psychologique du travail : “Nous envisageons le travail en tant que forme particulière d’activité humaine. Nous nous interrogeons sur sa place à l’intérieur de l’homme, ses significations, son contenu psychologique, notre perspective n’en est pas moins historique. De même qu’on n’a pas le droit d’appliquer au monde grec les catégories économiques du capitalisme moderne, on ne peut projeter sur l’homme de la cité ancienne la fonction psychologique du travail telle qu’elle est aujourd’hui dessinée”3.
La question historique de grande importance qui n’a pas toujours été posée comme il le fallait est de dire que dans le monde grec aussi le travail est une catégorie historique qui peut se modifier et qui s’est parfois modifiée avec le temps. Il ne suffit donc pas d’affirmer que le travail en Grèce ancienne n’est pas de l’économique pour tout en dire. Les mots et les notions évoluent et révèlent les mouvements qui agitent la société et l’économie grecques de l’époque archaïque à l’époque hellénistique. Il est naturel pour un observateur du monde moderne d’admettre le rôle central de l’industrialisation au XIXe siècle ou de la mondialisation au XXIe et les nouveautés qui y sont liées. Je voudrais que du côté antique on tire aussi toutes les conséquences de l’historicité. L’une des plus grandes erreurs que l’on puisse faire quand on aborde les comportements et pratiques du monde antique est d’avoir une vision par trop anhistorique et essentialiste.
Mais les bonnes dispositions qui poussent à faire de l’histoire du travail se heurtent à une réalité terrible pour l’historien. Aborder le travail dans la société grecque archaïque ou classique, c’est reconnaître un certain nombre de contraintes redoutables. On ne sait rien du travail au sens d’une réalité sociale ou économique, rien du temps, très peu de la rémunération et des conditions sociales qui y sont liées. On n’a aucun contrat complet, on ne connaît aucun salaire dans le privé avant la fin du IVe siècle a.C., on ne sait pas ce que recèlent les noms de statuts de “travailleurs” mentionnés dans des textes depuis Homère.
Est-on pour autant complétement désarmé et incapable de saisir les choses ? Je ne crois pas. On notera que ce n’est pas la seule période de l’histoire où les travailleurs ne parlent pas d’eux-mêmes et que l’on parle pour eux ou plus souvent contre eux. C’est une remarque que l’on peut faire sur le monde médiéval sur lequel nous reviendrons. Comme au Moyen Âge, nous avons quelques témoignages qui viennent de la littérature, ce qui n’est pas rien car c’est un domaine qui alors se construit et qui se transforme en profondeur lui-même. La littérature de ce temps n’est pas un refuge de l’individu mais le reflet d’une position dans la société, du fait du rôle social de l’auteur et de la performance (aède, banquets, etc..) et, au même temps, une interrogation sur elle. Elle pose la question centrale du comportement et des normes, de l’ordre du monde où le travail se retrouve bien quelque part ; ajoutons que l’on entre d’emblée dans du complexe et de l’historique car il y a des changements dans le sens donné aux mots, dès le début de notre documentation. On a même l’impression que les textes sont là pour donner aux mots un sens nouveau ou pour en rappeler l’ancien et que ces changements jouent un rôle essentiel aussi dans l’émergence de la diversité des genres littéraires4.
La sémantique du travail grec
Donc la connaissance du travail est d’abord affaire de mots. Il n’y a pas de terme unique pour véhiculer l’idée de travail en Grèce. Le travail que nous étudions ici (disons, pour faire vite, tous les actes qui ont rapport avec la production), à la différence du concept de travail producteur moderne qui isole d’emblée le travail des autres comportements, est au contraire englobé dans une structure plus large qui est celle de l’acte ou de l’action, ce qui explique le besoin de recourir à plusieurs termes pour exprimer l’ensemble de la notion5.
Dès les poèmes homériques, l’essentiel de la représentation du travail en Grèce tourne autour de deux grandes familles de mots, l’une autour du substantif ergon et des verbes dérivés comme ergazesthai qui devient le plus courant, et l’autre autour du ponos. Le premier est le plus proche de notre traduction de travail mais il représente en réalité toutes les formes de l’action, le second renvoie plus clairement à la notion d’effort. La première impression est de penser qu’ergon indique la position sociale et ponos l’aspect individuel6 mais en réalité, même si cette impression n’est pas fausse, nous ne retrouvons jamais une différence aussi nette entre le “privé” et le “public”, puisque dans les deux termes sont mêlées la contrainte sociale et l’action personnelle.
L’ergon signifie le travail, non pas considéré dans un procès d’élaboration ou de production, mais sous la forme la plus objectivisée, le résultat. On préfèrera à cause de cela le rapprochement avec l’idée d’acte plutôt que d’œuvre parce que l’action ainsi décrite n’est jamais très individualisée. L’ergon prend l’aspect d’une fonction qui s’exprime avec une utilisation dominante au pluriel, les erga, qui reflète davantage la variété des tâches non équivalentes : les contextes sémantiques distinguent les tâches des femmes de celles des hommes ou celles de l’élite de celles des pauvres. Les traits caractéristiques de cette notion sont :
- l’aspect acquis, exprimé par la place des verbes du savoir (on sait, on a appris des erga), indice d’un apport pour l’individu venant de l’extérieur de sa personne.
- la place de la contrainte. L’ergon est ce que l’on doit faire selon la condition dans laquelle on se trouve, selon la part (moira) que tout être humain reçoit et a donc un lien très fort avec l’expression d’une fonction.
- le résultat est toujours davantage l’expression d’une position sociale que d’une œuvre réalisée. L’acte accompli n’est pas une production individuelle, mais une mise en œuvre d’actes fonctionnels, efficaces déclencheurs à terme de l’effet social recherché. C’est moins un procès productif qu’un enclenchement de l’efficace dont le lien avec l’action du pouvoir est parfois net, ce dernier représentant un idéal à suivre (concept de la mètis7).
On voit bien la nécessité d’une notion complémentaire de l’ergon, celle du ponos. Elle sert en effet à exprimer d’une certaine façon l’adhésion de l’individu au cadre général fonctionnel. C’est le ponos qui est une sorte de « mise en œuvre » nécessaire qui se traduit par les notions d’effort ou de peine dans l’accomplissement de la tâche. Cela se réalise toujours à travers un ensemble de règles, de devoirs ou de nécessités. La notion de ponos dénote certes l’effort individuel mais place avant tout au premier plan l’idée de ce qui doit être fait pour arriver à l’efficacité voulue.
Or ce système sémantique cohérent qui ne disparaît jamais se transforme sur plusieurs points dès le haut archaïsme. Dans des textes qui vont de Hésiode à Solon, des VIIe-VIe siècles a.C., on voit des modifications sensibles. Si la structure duale (ergon-ponos) va se maintenir et marquer toute l’expérience grecque du travail, elle se transforme néanmoins profondément dès Hésiode au VIIe siècle a.C. On peut décrire cette évolution de la façon suivante. Le travail perd peu à peu son caractère fonctionnel, le vocabulaire « intellectualiste » disparaît, la notion d’ergon devient plus utilisée au singulier exprimant un concept qui s’unifie. C’est un comportement moins appris et plus personnel, au sens où la personne apparaît peu à peu comme une source et non plus comme un Kraftfeld, un “champ de force”8. Les différents travaux se ressemblent davantage dans le sens où il y a perte des traits fonctionnels qui les séparaient les uns des autres, comme le dit un passage de l’Élégie aux Muses de Solon (v. 43-58) qui insiste sur la ressemblance de tous les travaux :
Chacun agit de son côté : l’un pour amasser quelque gain, parcourt la mer poissonneuse…, un autre pour labourer la terre, se loue à l’année… ; un autre gagne sa vie avec ses mains.., d’autres comme médecins… ; un autre, le seigneur qui frappe au loin, Apollon, l’a fait devin (Fr. 13 W).
L’énumération de différentes occupations n’est pas laissée au hasard et la progression est régulière en avançant vers les tâches démiurgiques qui étaient jusque-là les plus valorisées et les plus savantes.
Se met en place ainsi une conception du travail qui marquera par la suite conceptuellement tout le monde grec de la cité9. Pour cela, je voudrais partir d’un passage très célèbre des Travaux et les jours d’Hésiode, les vers 308 et 309. Ils résument bien ce qu’on a pu définir comme l’aspect valorisant du travail chez Hésiode, en particulier au regard de la dimension religieuse dont l’acte est porteur dans la pensée des anciens Grecs. Le travail devient, comme le disait à juste titre Marcel Detienne, une pratique religieuse10. Pourquoi l’expérience religieuse est-elle si importante quand Hésiode envisage le travail ? Cela ressort de ces vers 308-309, qui forment comme une conclusion : “C’est par leurs travaux que les hommes sont riches en troupeaux et en or ; rien qu’en travaillant, ils deviennent mille fois plus chers aux immortels”. Cette phrase est tout à fait remarquable parce qu’elle associe avec la plus grande clarté et la plus grande simplicité deux aspects solidaires qui désormais resteront centraux dans l’expérience de l’acte productif chez les Grecs : d’une part, l’idée que le travail a une efficience directe qui se mesure concrètement par la réussite matérielle (les troupeaux, l’or…) mais aussi et surtout l’idée que cette forme d’acte a une fonction relationnelle, de service, qui rattache directement le travailleur aux immortels, ce qui lui donne l’efficience nécessaire. En travaillant, vous gagnez donc quelque chose, des troupeaux, des biens, mais en même temps vous resserrez les liens de philia qui vous unissent aux dieux ; ces deux éléments sont désormais consubstantiels à cette notion d’acte et ce qu’il y a peut-être de plus novateur chez Hésiode, c’est précisément ce que j’appellerais sa volonté de réfléchir sur la notion de service dans sa double dimension. Je précise : Hésiode construit un discours normatif en distinguant les bonnes actions des mauvaises, définies les unes par rapport aux autres. En face donc de l’ergon – le travail, l’acte –, il place l’argia, qui en est le contraire. L’analyse d’Hésiode consiste précisément à éclairer selon ce point de vue normatif ce qui se passe dans sa société qui est en train de subir des mutations majeures. Par exemple, une action de service qui traditionnellement était liée aux puissants, qui était donc légitime en vertu de cette hiérarchie, perdra de son efficacité si ces puissants (les rois, les basileis), qui dirigent la cité, se conduisent mal. Dès lors, l’action de service n’est plus légitimée par ce cadre de subordination ; elle doit se transformer, s’allier directement à ceux qui forment vraiment la communauté puisque les rois trahissent leur mission de représentants de la collectivité pour défendre leurs intérêts personnels. Cela explique que l’ergon s’adresse désormais directement aux dieux en tant que garants de la communauté : une équivalence s’établit entre les différents types d’actes à une échelle beaucoup plus large et mieux fondée puisque, en passant en quelque sorte par-dessus les garants humains qui ne sont plus dignes de confiance, on fait des dieux eux-mêmes les destinataires de la relation de service qu’implique l’acte. Il est clair qu’Hésiode donne une valeur considérable au travail humain en rapport étroit avec les transformations de la société.
Si d’une manière générale, l’on constate donc que beaucoup de choses se transforment sur le plan des idées, on ne doit pas en rester là et avancer des idées pour l’interprétation de ces formes et mutations sémantiques.
Des sociétés de la dette partagée
La représentation du travail en Grèce a donc une base cohérente dont l’interprétation ultime ne s’explique pas seulement par sa différence avec le monde moderne et donc par son ancienneté. Il y a une autre approche possible qui repose sur un fait qui n’a pas été suffisamment mis en lumière et jamais traité de manière systématique, ce qu’on ne peut non plus faire ici, mais dont je voudrais signaler la grande caractéristique : cette représentation n’a rien d’original dans les sociétés humaines. Probablement est-elle plutôt banale et tant qu’une étude complète et comparative avec le matériel ethnographique n’a pas été faite, le hasard des rencontres servira de socle d’argumentation.
C’est pour cela que je prends un exemple dans les sociétés mélanésiennes. Chez le peuple des Maenge de la Nouvelle Bretagne (Papouasie-Nouvelle-Guinée) étudié par M. Panoff11, on retrouve aussi une même variété de mots et la domination de deux formes verbales. Lege désigne le plus grand nombre de types d’activité mais aussi toute forme d’action en fonction de la situation institutionnelle et de l’ordre social – le dieu ou le chef colonial qui “agissent” – pour une activité qui peut être bien évidemment intellectuelle ou pratique. Kuma indique un effort et le kumanga est l’action d’un homme qui montre une dépense d’énergie, valeur positive nécessaire en particulier à l’ambition d’un futur homme de pouvoir, le big man. “Autrement dit”, résume M. Panoff, “dans ceux des contextes où lege et kuma reçoivent des emplois distincts, voire opposés, il semble que le premier exprime ou suggère l’idée d’ordre, de conformité à la norme, et le second l’idée de dépense d’énergie”. On reconnaît bien la dualité d’ergon et de ponos et la nécessaire complémentarité entre les deux.
La Grèce homérique est plus proche de la Nouvelle Bretagne que de l’Europe industrielle : ce ne doit pas être un constat surprenant et il ne tient pas seulement aux mots du travail. On notera au moins deux points semblables à la société grecque dans les sociétés mélanésiennes voisines des Maenge. Le rôle de l’échange y est fondamental ; les Mélanésiens placent l’art des échanges au centre de la vie collective12. La notion d’efficace y est aussi capitale, ce qui explique des croyances religieuses modernes comme le cargo cult apparu précisément quand l’abondance des produits apportés avec eux par les Occidentaux ou les Japonais, que l’on ne voyait jamais travailler, ne pouvait signifier qu’une efficacité maximale due à leur proximité avec le divin.
Les mots du travail s’intègrent donc en Grèce et en Mélanésie dans un monde qui met au premier plan les relations et de ce fait forge l’efficace des actions. L’homme doit faire ce qu’il a à faire et prendre de la peine à cela pour le rendre efficace. Cette emprise du devoir faire est au cœur du système social. Le point commun, on va le chercher nécessairement sur un plan général mais qui n’en est pas moins pertinent car c’est une catégorie anthropologique essentielle qui mériterait une description plus étoffée mais dont il suffit ici de noter l’existence. Grèce et Mélanésie – et elles ne sont pas les seules dans l’histoire humaine – sont des sociétés de la dette. Certes cette notion reste trop générale et gomme les différences existantes. On en a une impression nette avec l’Inde védique qui en est un exemple très fort puisque “l’homme dès qu’il naît, naît à l’état de dette”, écrit Charles Malamoud13.
Quelle que soit la nature profonde de la structuration sociale et de ses différences, chacun dans la société n’a sa place que parce qu’il a une dette vis-à-vis des autres. Il doit quelque chose de manière plus ou moins marquée et plus ou moins métaphorique, ce qu’on peut appeler une dette sociale, une dette “partagée” selon les termes de Bernard Hours et Pepita Ould Ahmed : “La dette sociale est inextinguible, par nature, son extinction signifierait l’ostracisme social, la perte du lien social ou une désaffiliation radicale”. Autour de cela gravitent toutes les notions de réciprocité, de don, de pouvoir avec leur lot de contraintes collectives et d’apparentes libertés, celles de donner, de recevoir, de gouverner : “la dette apparaît in fine plus systémique qu’interpersonnelle bien que personnalisée”14.
Les sociétés de la dette partagée ne sont pas à rechercher uniquement dans les sociétés dites “primitives”. Même une économie de marché dans certaines limites ne les exclut pas, comme le souligne bien Laurence Fontaine15, fait que rappelle cette phrase de Rabelais choisie en exergue d’un chapitre : “car nature n’a créé l’homme que pour prêter et emprunter” (F. Rabelais, Tiers Livre des faictz, et dictz héroïques du noble Pantagruel, chap. 4, 47, Paris, 1546). Mais dans toute société de la dette il n’y a pas que la dette métaphorique ou idéale générale, il y a aussi les “vraies” dettes au milieu, des dettes qui s’expriment avec des biens matériels et produits et échangés. La dette du chef envers la communauté peut en être une, au moins dans les sociétés “contre l’État” chères à Pierre Clastres, mais les dettes des moins puissants auprès des puissants en sont un exemple beaucoup plus courant ; ainsi “la dette est tout à la fois partagée, imposée, politique et sexuée”16. Ce qui ouvre ensuite sur l’étude du fonctionnement des sociétés. Nous pouvons quitter là le comparatisme ethnologique. Sans méconnaître l’historicité des sociétés de Nouvelle Bretagne, elles ne semblent pas connaître, hors le contact avec les Occidentaux qui les fait disparaître, de mobilités historiques comparables à ce que va connaître la société grecque, disons pour faire simple, après Homère.
Le travail au cœur du changement social archaïque
Il est à peine besoin de rappeler que l’époque archaïque est le moment d’un profond changement dans le monde grec presque unanimement présenté comme un véritable début, la naissance institutionnelle de la cité. Rappelons cependant toujours que cela se passe dans une grave crise sociale qu’il faut bien considérer pour ce qu’elle est, non une simple mutation politique mais un ensemble de bouleversements très durs à supporter pour beaucoup. C’est le moment où le désordre social, la stasis, qui peut conduire à la vraie guerre civile est pour la première fois bien présente dans le monde grec ; même si, à la différence de beaucoup de conflits postérieurs, elle se déroule alors sans menace ou domination d’un pouvoir extérieur mais bien à l’intérieur de la structure civique elle-même.
Les différents aspects de cette crise sont depuis longtemps au centre des interrogations historiques mais on assiste à l’heure actuelle à un renouveau de la réflexion17. La connaissance de la “crise archaïque” a donc beaucoup progressé, ce qui entraîne l’idée que plusieurs choses ont joué ensemble, faits fonciers, pression démographique, lutte pour le pouvoir, opposition des pauvres et des riches etc. Mais dans ce contexte, quand on lit les textes on a l’impression que les causes touchent au fond même des relations sociales. Hésiode en est toujours le meilleur témoin qui insiste sur les nouveautés : les rois sont devenus des “mangeurs de présents” (Hes., Op., v. 264) et les pauvres tombés dans la misère vendront ce qu’ils ont (Hes., Op., v. 341). On ne peut penser qu’il s’agisse seulement d’images littéraires. Les nombreux cas bien réels en attestent, les droits et devoirs de chacun dans la communauté se modifient, les hectémores athéniens doivent des dettes et s’ils ne peuvent payer ils quittent la communauté, en sont exclus et deviennent esclaves : issue inévitable, sauf s’ils se révoltent. Finalement c’est clair, la révolte l’emportera presque partout, avec des temps, des intensités et des résultats différents.
Certaines pratiques sociales ont changé, une nouvelle signification est donnée à des pratiques de dette généralisée qui étaient au cœur des sociétés et dans lesquelles se situait le travail. Des indices existent sur les transformations des formes de relations et d’échange matériel, en particulier l’émergence de formes nouvelles en contact avec un monde oriental avec lequel les relations commerciales se font plus intenses. On a souvent insisté sur l’impact des modifications dues à l’orientalisation du monde grec comme s’il s’agissait seulement d’un enjeu culturel, alors que l’enjeu est socialement souvent plus crucial. Ainsi la transformation de l’échange qui se fait avec l’argent pesé, créant de nouveaux besoins et de nouvelles opportunités, provoque aussi de nouvelles tensions18. Ce qui est en jeu et qui est apparu au centre des mécontentements, voire des révoltes, c’est que le système de la dette généralisée est mis à mal pour une raison très simple : la dette n’est plus remboursable parce qu’elle doit désormais être réellement remboursée. Les endettés quittent la communauté, ils deviennent esclaves ou s’enfuient. La société connaît une rupture de la confiance (pistis) qui était moins une confiance morale qu’une fidélité à des cadres anciens. On est frappé par l’aspect général de ce phénomène (qui se produit aussi à Rome19), de ce moment où une société de la dette partagée implose.
L’enjeu du travail se situe exactement là où est le problème et où les solutions de réforme seront choisies, l’intégration de l’individu à la communauté qui doit être plus affirmée et repensée. On voit la pensée du travail dans nos textes des VIIe-VIe s. a.C. prendre une forme qu’on peut appeler plus “abstraite”, mais il s’agit moins d’une d’abstraction que d’une détermination par une cause unique. Ce n’est pas la réussite matérielle, c’est la place dans la communauté qui en est l’objectif central, c’est ce que dit Hésiode avec le travail qui renforce les liens avec les dieux, les garants de tout. Ce que la pensée grecque va désormais développer c’est cette forme de comportement particulier que l’on appelle oikonomia, fondée sur l’oikos, qu’on a toujours eu tort de prendre pour de l’économie pure et simple et donc dans ce cas là d’une pauvre banalité20. Il s’agit de faire que le travail retrouve une totale efficacité et son but est d’abord le bios, la vie, la survie qui ne peuvent se faire que dans le cadre de la communauté : “ayez d’abord un oikos” dit toujours Hésiode, “une femme et un bœuf” (Op., v. 405). Dans une opposition nette avec la servitude, la douleia qui rejette en dehors de la cité, la liberté (eleutheria) du citoyen signifie par-dessus tout le droit de vivre dans la communauté assortie des règles nouvelles : suppression des dettes anciennes, affirmation de la propriété redevable directement à la communauté.
La cité reconstruite se fonde sur le statut de celui qui sera désormais clairement et de manière intangible un citoyen avec deux piliers indispensables, l’esclavage maintenant défini, résultat des nouvelles formes d’échange mais qui n’est plus une menace pour le membre de la communauté et l’intervention de la communauté dans les échanges, c’est-à-dire le point qui a été le lieu des bouleversements sociaux au moment de la crise de la dette. La cité fait de l’agora l’espace surveillé des relations marchandes21.
Le travail et la “croissance imperceptible” du monde grec
Tout se passe comme si la mise en place de ce nouveau cadre mental où le travail se trouve au cœur du changement se produisait au milieu d’une Grèce plus peuplée et plus riche. Abordons donc les mêmes choses sous un angle un peu différent. Cette période de création d’une société plus “civique” au cours des VIIe-VIe s. a.C. n’est pas seulement un fait institutionnel, c’est aussi un fait qui touche un problème essentiel qui reste encore en marge de la réflexion historique, la question de savoir s’il a existé un vrai développement démographique et économique du monde grec.
La réflexion sur une éventuelle croissance du monde grec est à ses débuts. Si on l’avait posée du temps de Moses I. Finley (ou du temps où la pensée de Finley n’était pas discutée), la réponse aurait été claire : l’économie antique est une économie sans croissance. Parler de croissance était se ranger ouvertement du côté moderniste et d’emblée dévalorisé. Or cette question, même si elle n’est pas encore traitée de front, est redevenue très actuelle ces dernières années, sur l’initiative des archéologues, comme en témoigne un article de Ian Morris22.
On ne peut pas dire qu’il s’agisse d’un retour aux vues modernistes. L’idée de I. Morris est plutôt d’intégrer dans l’étude de la Grèce une réflexion sur la performance de l’économie grecque, sur ses résultats, dans l’esprit de la NIE (New Institutional Economics). Il rappelle à ce propos une phrase de D. North : la tâche de l’histoire économique est d’expliquer “la structure et la performance”. Or pour l’Antiquité le résultat est étrange, dit Morris : “it is all structure and no performance”23. Mais cela conduit Morris à soutenir l’inverse de ce que pensait Finley (pour qui il n’y avait pas de “sustained growth”) et donc un accroissement en agrégat et par tête. Il propose pour cela une approche archéologique des standards de vie, le corps, âge de la mort, santé, nutrition, habitat. Il reconnaît lui-même qu’il y a “few high-quality data”24 mais conclut sans hésiter que “sur 500 ans (entre 800 et 300 a.C.) il y a eu une augmentation du niveau de vie de 0,07-0,14 % an, comparable aux 0,2 de la Hollande entre 1580 et 1820 et aux chiffres du Royaume-Uni entre 1820 et 1920”25. Il y a dans la même période une augmentation de la population de 0,4 % par an, chiffre très important et au final l’augmentation de la consommation en moyenne est de 0,3-0,5 % par an, comparable à l’âge d’or de la Hollande. Le “miracle grec” est bien fondé sur un “economic miracle”. Les causes de cette croissance économique ne sont pas une révolution technologique (pour la NIE la technologie est d’ailleurs plutôt une conséquence qu’une cause de la croissance) mais sont à rechercher dans l’affermissement des droits de propriété (et la baisse afférente des coûts de transaction) par le développement de la citoyenneté depuis Solon : “ideology was very important in the development of the city-state”26. Le plus important n’est d’ailleurs pas une constitution formellement démocratique, mais l’institution d’un égalitarisme de droits entre les citoyens. I. Morris ajouterait aussi le rôle d’un encouragement d’un commerce entre États mais cette option ne dure pas et n’est pas toujours de mise.
Dans le même courant d’idées, certains historiens ont amplifié le trait. Josiah Ober est très sensible aux recherches quantitatives en histoire économique romaine et en appliquant pour l’essentiel les chiffres de I. Morris considère que l’économie grecque de 800-300 a.C. est plus performante que l’économie romaine de 100 a.C. à 200 p.C. 27. Il insiste bien sur une coupure ou rupture à la fin de l’époque classique et s’emporte contre l’image d’Hérodote (7.102) sur la “pauvreté de la Grèce”. Il faut comparer avec les économies modernes et donc toujours avec la Hollande ou l’Angleterre des XVIIe-XIXe siècles. Les raisons de cette croissance remarquable sont non seulement institutionnelles mais réellement politiques, de ce fait en rapport direct avec la démocratie triomphante – ce qui peut expliquer la date curieuse de c. 300 a.C. pour la fin du “cycle”.
Le problème posé est essentiel, mais il faut bien en préciser le cadre pour qu’il ne passe pas pour une caricature. Je ne reviens pas sur la faiblesse des données, que personne ne conteste réellement et dont on peut espérer qu’elle se modifiera avec un plus grand nombre d’études quantitatives. Au cœur de la démarche se situe une comparaison, mais comparer avec la Hollande ou l’Angleterre de l’époque moderne engagées dans ce que l’on appelle maintenant la “révolution industrieuse”28 qui devient, sans solution de continuité, ce phénomène de “croissance continue” si caractéristique de la révolution industrielle n’est certainement pas pertinent29. Qu’est-ce que devient l’économie grecque après 300 a.C. selon la chronologie choisie dans les deux articles ? Rien de tel. C’est donc là où la structure reprend ses droits. La différence historique entre Amsterdam en 1600 et Athènes en 430 a.C. n’est peut-être pas dans le bilan calorique ou l’espérance de vie (encore faudrait-il être certain de ces points) mais dans des faits comme ceux-ci : y-a-t-il à Athènes un nombre approchant les 6 000 navires présents dans le port d’Amsterdam ? et existe-t-il un équivalent de la VOC (Compagnie des Indes Orientales) ? La réponse est chaque fois négative. Il est donc étrange que l’on compare aussi facilement des économies historiques qui n’ont pas le même processus d’évolution.
Si l’on ne se préoccupe plus stricto sensu d’une comparaison avec l’Europe moderne, il faut quand même se poser la question de la performance évoquée par I. Morris. Les outils historiques pour penser cela existent ; si la croissance “industrieuse” n’est sans doute pas pour notre cas le terme le plus adéquat, on peut parler avec un mot plus neutre de croissance “lente” ou “imperceptible”30. La question centrale reste celle-ci : peut-il y avoir une croissance de l’économie sans impact d’un progrès technologique originel (ce qui n’exclut pas par la suite du procès les dits progrès techniques) mais qui repose sur les transformations du travail humain. De ce point de vue, faisons jouer encore une fois le comparatisme mais sur le plan historique en s’inspirant du livre de Mathieu Arnoux sur l’Europe des XIe-XIVe siècles31. La croissance médiévale sur le long terme ne s’obtint pas par un progrès technologique mais “résulta d’une augmentation massive et de long terme de l’offre de travail paysan”32. L’accroissement du travail humain n’est pas un donné naturel et immanent ; il faut des conditions et des raisons pour “travailler plus”. Pour le Moyen Âge, les conditions sont les suivantes : suppression du statut de l’esclavage et libération du peuple, libération des obligations militaires et reconnaissance idéologique d’un ordre propre (ordo laboratorum) avec une vision valorisante du travail sous l’égide de la doctrine chrétienne et avec une Église qui joue un rôle capital dans la rationalisation de l’accès aux ressources par l’instauration d’une dîme, qui sert à l’origine à fournir une réserve et à réguler la consommation.
Cette hypothèse éclaire à mon sens ce qui se passe en Grèce à l’époque archaïque et au début de l’époque classique. Les points communs sont bien la libération individuelle de l’esclavage et l’intervention de la communauté (cité, institutions religieuses) dans une forme de régulation de l’accès aux produits. Les chemins sont en revanche divergents sur deux autres points : la libération du citoyen en Grèce passe par un renforcement du devoir militaire et l’esclavage est établi de manière institutionnelle pour des non-citoyens. Le travail a changé de sens et est indiscutablement valorisé mais comme on l’a vu, il prend la forme d’un lien consubstantiel au-delà de l’individu avec l’oikos et la cité. Je propose donc de voir dans cet ensemble de faits la base indispensable de cette “croissance imperceptible” qu’il faut bien imaginer à quelque moment quand on constate le dynamisme du monde grec. Toutefois compte tenu des différences il y a toute chance pour que l’évolution des deux économies n’ait pas été identique.
Le travail et la cité : une évolution
Ce qui se passe ensuite peut renvoyer en effet au grand problème posé au XIXe siècle par K. Marx et M. Weber : pourquoi le capitalisme ne s’est pas créé dans l’Antiquité ? La comparaison avec le monde médiéval s’arrête. Sur les deux points qui précisément marquent bien la différence entre les deux sociétés, le lien avec la communauté civique et l’existence d’un esclavage, une évolution de la société grecque est sensible, dont l’étude est à faire plus en détail et que je ne ferai qu’esquisser ici.
Le rapport privilégié du travail de l’oikos et de la cité ne va pas se poursuivre sans quelques difficultés. Au Ve s. a.C., à l’origine d’un genre philosophique appelé à un certain succès, le logos oikonomikos, le comportement de l’individu dans son oikos est en parfaite harmonie avec la gestion de la cité. C’est ce qu’on dit de Périclès : “il avait imaginé une façon d’administrer sa maison qui lui avait paru la plus commode et la plus exacte. Il faisait vendre en une fois toute sa récolte de l’année, puis acheter au marché tout ce qui lui était nécessaire : tel était son genre de vie”. Une gestion nouvelle que les membres de sa famille regrettent : “Mais ce régime ne plaisait guère à ses enfants, devenus adultes, et les femmes de sa maison trouvaient qu’il les rationnait peu généreusement : tous se plaignaient de cette dépense calculée jour par jour et si strictement réduite qu’il n’y avait chez lui aucun superflu, comme on en voit dans les grandes maisons où les affaires sont prospères : toutes les dépenses et toutes les recettes étaient exactement comptées et mesurées” (Plu., Per., 16). Elle montre un accord et une complémentarité parfaite de l’oikos et de la cité créant un marché33. Cette coordination exemplaire trouvera sa limite au fur et à mesure que se développent les contraintes, en particulier financières, qui pèsent sur la cité et qui ont des conséquences sur le travail personnel. Xénophon dans son Économique au début du IVe s. a.C. s’en fait l’écho quand il déplore la difficulté de gérer ses biens car la cité demande des contributions importantes en monnaie (Oec., 2.6), ce qui nécessite d’adapter constamment sa gestion pour avoir des réserves financières, ce qui n’est pas facile (ni habituel) dans le contexte encore chaotique de l’économie marchande du monde grec classique. Le sentiment d’une divergence entre le comportement personnel et ce que demande la cité se fait jour. On en voit l’apparition dans le texte d’un auteur appelé par convention le Pseudo-Jamblique qui écrit probablement dans la première moitié du IVe s. a.C.34, qui coïncide à Athènes avec les périodes difficiles de l’après-guerre du Péloponnèse et des mesures de redressement financier prises au tournant du premier quart du siècle. On peut y lire en effet ceci :
De plus, grâce à l’eunomie, le temps s’écoule en laissant les hommes négliger les affaires (publiques) et s’appliquer aux tâches de la vie (quotidienne). L’eunomie libère les hommes du souci le plus ingrat, elle les fait vivre avec le plus agréable ; car le souci des affaires (publiques) est le moins agréable, celui des tâches (quotidiennes) l’est au plus haut point. (Pseudo-Jamblique, Protreptique, 20.101)
L’auteur souligne comme on s’y attend les rapports étroits entre l’établissement d’un bon régime politique, appelé ici l’eunomie, et la vie quotidienne. Mais la conclusion du passage va loin car elle ouvre l’idée que, malgré les rapprochements faits, il existe un fossé entre la sphère publique et la vie quotidienne et c’est clairement un fait nouveau par rapport à l’époque de Périclès. On ne peut connaître la popularité de ce sentiment, qui est peut-être ou non le fait d’une minorité de penseurs. N’allons pas trop vite pour considérer que c’est un désintérêt de la politique ou une contradiction profonde entre fait privé et fait public, mais du moins retenons que c’est une étape importante dans une réflexion qui voit le comportement politique diverger de la simple oikonomia. Cela aboutit dans la réflexion philosophique du IVe s. a.C. et du début de l’époque hellénistique à dégager la possibilité de genres de vie différents. La réflexion de l’ethikos logos, à l’image de l’Éthique à Nicomaque d’Aristote servira à cela : justifier l’existence de plusieurs formes différentes d’action et de vie (dont celui organisé autour de l’intérêt personnel) mais la hiérarchie des objectifs est très claire ; la conceptualisation nouvelle des genres de vie va se retrouver dans la préséance du politique et des formes d’action qui y sont liées.
Le second point concerne les transformations des rapports de travail induites par le développement de l’esclavage à l’époque classique, soutenu par une acquisition marchande d’esclaves à bon compte. L’esclavage ouvre une complète réorientation du travail, qui n’est pas à voir uniquement au prisme de la dévalorisation comme on le privilégiait dans la tradition érudite mais dans la création d’une nouvelle échelle de l’espace et du temps de travail :
- l’esclave est transférable commodément d’un domaine d’activité à l’autre, ce qui joue un grand rôle dans une cité comme Athènes qui a de multiples possibilités d’investissement du travail (mines et commerce à côté de la terre). Une même personne peut être ainsi mineur, marin et cultivateur.
- son travail peut être aisément parcellisé et divisé dans le temps. Dans la fameuse question de la concurrence entre travail libre et servile héritée du XIXe siècle, le premier atteint par le second, je renverserai plutôt les données. C’est l’esclavage en permettant l’utilisation facile à la journée (pratique de la location d’esclaves) pour des travaux très courts qui a encouragé une parcellisation possible et probablement le développement du travail “salarié”, pour ce qu’on en peut saisir.
L’esclavage pénètre tous les aspects du travail et l’on peut dire que s’amorce ainsi une domination d’un modèle servile qui va à la fois accentuer une différenciation plus forte entre “travaux du corps” et de “l’esprit” et une assimilation du travail libre au travail servile. À l’époque archaïque le salaire, le misthos, est le signe de la liberté du travailleur puisqu’il est donné à la fin du contrat de travail. Chez le Pseudo-Aristote à la fin du IVe s. a.C. les choses ont complètement changé et le salaire est valable pour l’esclave :
reste donc qu’il faut donner du travail et la nourriture en conséquence, car on ne peut pas se faire obéir de gens à qui l’on refuse le salaire, et le salaire (misthos) de l’esclave, c’est sa nourriture. (Oec., 1.5.3)
On aboutit ainsi à la conception stoïcienne qui est vraiment l’idéologie officielle du travail dans le monde antique unifié par Rome. On est tous, sauf le philosophe-roi, esclave de quelque chose ou de quelqu’un : “la liberté est le pouvoir de décider de sa propre action, l’esclavage la privation de ce pouvoir de décision. Il existe un autre esclavage, la subordination, et un troisième qui réside dans l’appartenance et la subordination” (Diogène Laërce, Vies des Philos., 7.121.2). Symboliquement, une société de la dette s’est formée à nouveau.
Le travail doit avoir toute sa place dans l’histoire de la cité grecque. La construction au cours de l’époque archaïque de la notion de travail qui est décrite plus haut a été un élément capital de l’affirmation de la nouvelle structure civique et très probablement de l’essor d’un développement humain et matériel du monde grec. J’ai insisté sur les deux aspects qui en sont les plus clairs, le lien étroit entre le travail et la cité d’un côté et l’affirmation de l’esclavage de l’autre. Les sources permettent de suivre l’évolution jusqu’au début de l’époque hellénistique. La pensée du travail s’adapte aux nouveautés, en particulier aux deux plus importantes, le coût financier et social de la cité et le triomphe de l’esclavage. Elle a le mérite de produire une notion ouverte et modifiable qui aboutit à s’accommoder des tensions et de créer un équilibre qui permet à la cité antique de fonctionner sur des bases qui semblent inchangées, ce qui en soi est déjà un résultat non négligeable. Mais le pouvoir libérateur qui a existé plus tôt dans l’histoire de la cité est perdu. Pour que les équilibres bougent de nouveau, il faut des conditions qui se profilent à la fin de l’Antiquité : il faudra penser à la fois la fin de la communauté civique et celle de l’esclavage.
Bibliographie
Arnoux, M. (2012) : Le temps des laboureurs. Travail, ordre social et croissance en Europe (XIe-XIVe s.), Paris.
Bergougnan, E. (1940) : Poètes élégiaques et moralistes de la Grèce, Paris.
Cartier, M., éd. (1984) : Le travail et ses représentations, Londres.
De Vries, J. (2008) : The Industrious Revolution, Cambridge.
D’Ercole, M. C. (2017) : “Archéologie et histoire économique : entre complicités et mésentente”, in : Boissinot, P., éd., Archéologie et sciences sociales, Université Toulouse Jean Jaurès, P@lethnologie, 9, 63-75, [URL] https://journals.openedition.org/palethnologie/304.
Descat, R. (1986) : L’Acte et l’effort. Une idéologie du travail en Grèce ancienne, Besançon.
Descat, R. (1999) : “La représentation du travail dans la société grecque”, in : Annequin, J., Geny, E. et Smadja, E., éd., Le Travail. Recherches historiques, Besançon, 9-22, [URL] https://www.persee.fr/doc/ista_0000-0000_1986_mon_339_1.
Descat, R. (2000) : “L’État et les marchés dans le monde grec”, in : Lo Cascio, E., éd., Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano, Bari, 13-29.
Descat, R. (2006) : “ARGYRÔNETOS : Les transformations de l’échange dans la Grèce archaïque”, in : Van Alfen, P., G., éd., Agoranomia, Studies in money and exchange presented to J.Kroll, New York, 21-36.
Descat, R. (2009) : “Idéologie antique du travail et pratiques économiques”, Europe, 964-5, 354-365.
Descat, R. (2010) : “Thucydide et l’économie, aux origines du logos oikonomikos”, in : Fromentin, V., Gotteland, S. et Payen, P., éd., Ombres de Thucydide. La réception de l’historien depuis l’Antiquité jusqu’au début du XXe siècle, Bordeaux, 403-409, [URL] https://books.openedition.org/ausonius/2495.
Descat, R. (2018) : “Le travail et la cité grecque : matériaux pour une histoire”, QS, 88, 81-112.
Detienne, M. (1963) : Crise agraire et attitude religieuse chez Hésiode, Bruxelles.
Fontaine, L. (2008) : L’Économie Morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe pré-industrielle, Paris.
Fränkel, H. [1951] (2006) : Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums, Munich.
Helmer, E. (2021) : Oikonomia. Philosophie grecque de l’économie, Paris, [URL] https://shs.cairn.info/revue-de-philosophie-ancienne-2022-2-page-273.
Hose, M. et Schenker, D., éd. (2015) : A Companion to Greek Literature, Londres.
Hours, B. et Ould-Ahmed, P., éd. (2013) : Dette de qui, dette de quoi ? Une économie anthropologique de la dette, Paris.
Jeudy-Ballini, M. (2004) : L’Art des échanges : penser le lien social chez les Sulka (Papouasie Nouvelle-Guinée), Lausanne.
Johnston, S. (1994) : “Virtuous toil, vicious work : Xenophon on aristocratic style”, CPh, 89, 219-240.
Lerouxel, F. (2015) : “Bronze pesé, dette et travail contraint (nexum) dans la Rome archaïque (VIe -IVe s. a.C.)”, in : Zurbach, J., éd., La main-d’œuvre agricole en Méditerranée archaïque. Statuts et dynamiques économiques, Ausonius Scripta antiqua 73, Bordeaux, 109-152.
Malamoud, C. (1988) : “Dette et devoir dans le vocabulaire sanscrit et dans la pensée brahmanique”, in : Malamoud, C., éd., Lien de vie, nœud mortel. Les représentations de la dette en Chine, au Japon et dans le monde indien, Paris, 187-205.
Mari, M. (2003) : Anonimo di Giamblico. La pace e il benessere, Milan.
Marx, K. [1857-1858] (1967) : Fondements de la critique de l’économie politique, trad. fr., Paris.
Masson, A. (2009) : Des liens et des transferts entre générations, Paris, [URL] https://books.openedition.org/editionsehess/47686.
Morris, I. (2004) : “Economic growth in ancient Greece”, Journ.Institut.Theoret.Economics, 160, 709-742.
Ober, J. (2010) : “Wealthy Hellas”, Transact.Americ.Philol.Assoc, 140, 241-286.
Panoff, M. (1984) : “Energie et vertu : le travail et ses représentations en Nouvelle-Bretagne”, L’Homme, XVII (2-3), 7-21 ; version abrégée in : Cartier 1984, 21-37, [URL] https://www.persee.fr/doc/hom_0439-4216_1977_num_17_2_367748.
Seurot, F. (2010) : “Croissance imperceptible en Europe du IXe et au XIVe siècle. Approches qualitatives et repères quantitatifs”, [URL] https://web.archive.org/web/20070810191025/http://afhe.ehess.fr/docannexe.php?id=323.
Vernant, J.-P. (1965) : Mythe et pensée chez les Grecs, Paris.
Vernant, J.-P. et Detienne, M. (1974) : Les ruses de l’intelligence. La métis des Grecs, Paris.
Vidal-Naquet, P. (1981) : Le Chasseur Noir. Formes de pensée et formes de société dans le monde grec, Paris.
Zurbach, J. (2013) : “La formation des cités grecques. Statuts, classes et systèmes fonciers”, Annales (HSS), 4, 957-998, [URL] https://shs.cairn.info/revue-annales-2013-4-page-957.
Notes
* Cet article représente la version mise à jour et remaniée de mon intervention à la journée sur le travail (Ehess-AFHE) parue dans la revue Quaderni di Storia (Descat 2018). Les traductions des auteurs grecs sont issue des éditions de la Collection Universitaire de France (CUF), sauf le passage de Solon, repris depuis la traduction de Bergougnan 1940.
- Vidal-Naquet 1981, 31.
- Marx [1857-1858] 1967, 64.
- Vernant 1965, 219.
- Sur ces vastes questions je renvoie par commodité à la synthèse de Hose & Schenker 2015.
- Sur ce qui suit, avec les exemples précis, Descat 1986 et 1999.
- Johnston 1994.
- Vernant & Detienne 1974.
- Selon l’expression de Fränkel 2006, 88.
- Descat 2009.
- Detienne 1963, 63.
- Panoff 1984.
- Jeudy-Ballini 2004.
- Malamoud 1998.
- Hours & Ould-Ahmed 2013, 10-11.
- Fontaine 2008 ; sur la dette comme fondatrice du lien social et inter-générations : Masson 2009.
- Hours & Ould-Ahmed 2013, 12.
- Lire Zurbach 2013.
- Descat 2006.
- Lerouxel 2015.
- L’oikonomia est un thème à reprendre complètement car son étude chez les historiens a été trop marquée par la pensée de J. Schumpeter et la naissance de l’économie moderne “scientifique”. Sur la philosophie grecque et l’oikonomia, signaler les travaux d’E. Helmer (dont Helmer 2021) qui toutefois n’abordent pas toutes les questions.
- Descat 2000, 13-29.
- Morris 2004.
- Morris 2004, 709.
- Morris 2004, 719.
- Morris 2004, 726.
- Morris 2004, 731.
- Ober 2010, 247.
- De Vries 2008.
- Une critique de ce modèle chez D’Ercole 2017.
- Seurot 2010. Cf. aussi dans ce volume la contribution d’A. Marcone pour le monde romain.
- Arnoux 2012.
- Arnoux 2012, 13.
- Descat 2010.
- Mari 2003.