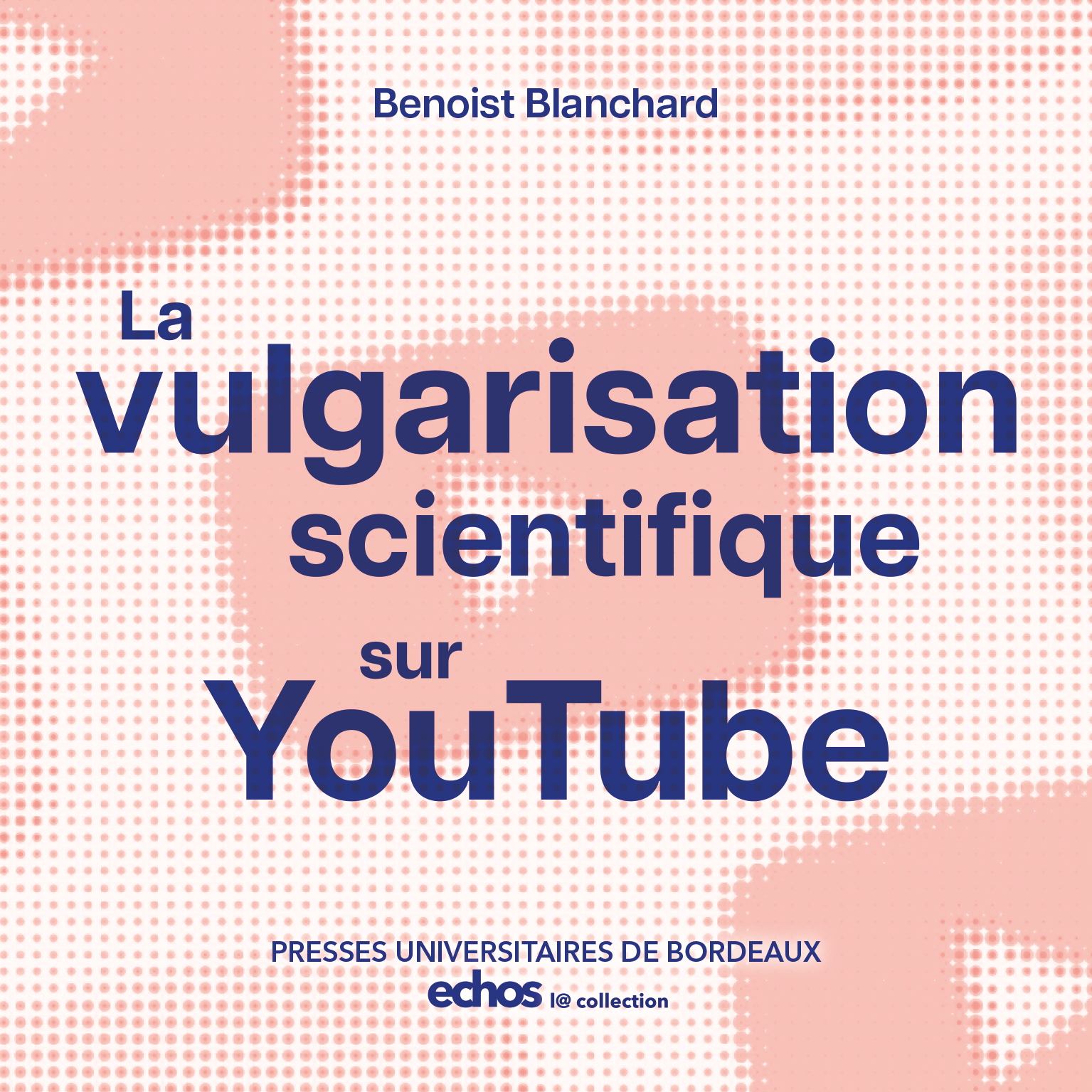• Au milieu du XXe siècle, le linguiste Roman Jakobson a proposé un modèle pour mieux comprendre comment fonctionne la communication entre une personne « émettrice » (celle qui parle ou écrit) et une personne « réceptrice » (celle qui écoute ou lit). Selon Roman Jakobson, toute situation de communication repose sur six éléments : un émetteur ou une émettrice, un ou une destinataire, un message (les mots utilisés), un contexte (le sujet auquel le message renvoie), un code (la langue utilisée) et un canal de transmission (le support, comme la voix, le papier, l’écran, etc.).
• Au milieu du XXe siècle, le linguiste Roman Jakobson a proposé un modèle pour mieux comprendre comment fonctionne la communication entre une personne « émettrice » (celle qui parle ou écrit) et une personne « réceptrice » (celle qui écoute ou lit). Selon Roman Jakobson, toute situation de communication repose sur six éléments : un émetteur ou une émettrice, un ou une destinataire, un message (les mots utilisés), un contexte (le sujet auquel le message renvoie), un code (la langue utilisée) et un canal de transmission (le support, comme la voix, le papier, l’écran, etc.).
À partir de ces six éléments, Roman Jakobson a identifié six fonctions principales du langage. Chaque fonction met l’accent sur un de ces éléments, même si, dans la réalité, elles coexistent souvent dans un même message :
1. La fonction référentielle centrée sur le contexte, c’est-à-dire sur le contenu de l’information transmise. Cette fonction vise à informer, à décrire ou à expliquer.
« La Terre tourne autour du Soleil. »
2. La fonction expressive (ou émotive) met l’accent sur l’émetteur ou l’émettrice, sur ce qu’iel ressent, sur ce qu’iel pense ou sur ce qu’iel veut faire ressentir. Cette fonction traduit l’attitude personnelle de la personne qui parle.
« J’ai vraiment peur de cet examen. »
3. La fonction conative se concentre sur le ou la destinataire. Le langage cherche ici à produire un effet sur l’autre, souvent à travers des ordres, des questions ou des appels.
« Peux-tu m’aider ? »
4. La fonction phatique est liée au canal de communication. Elle sert à établir, à maintenir ou à interrompre le contact.
« Allô ? », « Tu m’entends ? », « D’accord ? »
5. La fonction métalinguistique concerne le code. Elle sert à expliquer ou à clarifier la langue elle-même.
« Un adjectif qualifie un nom. » ou « Que signifie ce mot ? »
6. La fonction poétique porte sur la forme du message lui-même. Elle attire l’attention sur la manière dont le message est construit, souvent dans une intention esthétique ou ludique. On la trouve surtout dans la poésie, les slogans, les jeux de mots.
Pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans nos quartiers ! ».
 • Un procédé pathémique est un moyen, ici rhétorique, pour engendrer une émotion chez l’auditoire.
• Un procédé pathémique est un moyen, ici rhétorique, pour engendrer une émotion chez l’auditoire.
 • Au cinéma, ou dans les contenus audiovisuels en général, la caméra peut se rapprocher ou s’éloigner des personnages et des objets pour montrer différentes choses. Ces choix s’appellent les « valeurs de plan ». Elles aident à raconter l’histoire et à faire ressentir des émotions. Voici quelques exemples :
• Au cinéma, ou dans les contenus audiovisuels en général, la caméra peut se rapprocher ou s’éloigner des personnages et des objets pour montrer différentes choses. Ces choix s’appellent les « valeurs de plan ». Elles aident à raconter l’histoire et à faire ressentir des émotions. Voici quelques exemples :
– Plan large ou général : C’est comme regarder un grand paysage. Ce plan montre un grand espace pour situer l’action. Par exemple, une vue d’une ville ou d’une forêt.
– Plan d’ensemble : Un peu comme le plan large, mais un peu plus près. On voit toujours le paysage, mais on commence aussi à voir les personnages dedans.
Par exemple, des enfants qui jouent dans un parc.
– Plan moyen ou plan pied : Ici, on voit un personnage de la tête aux pieds, utile pour voir tout ce qu’il fait. Par exemple, quelqu’un qui court ou qui danse.
– Plan américain : Ce plan montre un personnage à partir de mi–cuisses. C’est souvent utilisé pour le montrer en train de marcher ou de faire une activité.
– Plan rapproché taille : On voit le personnage de la tête à la taille. Ce plan est souvent utilisé pour les scènes de dialogue et montrer les expressions et les gestes.
– Plan rapproché poitrine : Ce plan cadre un personnage de la tête à la poitrine. Il est souvent utilisé pour les conversations et montrer les expressions du visage.
– Gros plan : La caméra se rapproche beaucoup pour montrer un détail, comme le visage d’un personnage. Ce type de plan est utilisé pour montrer des émotions fortes.
– Très gros plan : La caméra se rapproche encore plus pour montrer un tout petit détail, comme les yeux ou un petit objet. Ce type de plan attire l’attention sur quelque chose de très important.
Ces différentes valeurs de plan aident à montrer ce qui est important dans une scène et à faire ressentir ce que les personnages ressentent. C’est un peu comme si la caméra était votre œil et qu’elle vous guidait pour bien comprendre l’histoire !
 • La subjectivité c’est le fait de devenir un « sujet » sur YouTube. Elle s’inscrit dans un système qui pousse les vidéastes à se montrer, à raconter, à performer pour exister sur la plateforme, notamment pour créer un effet de proximité très fort avec le public. Cette subjectivité est une mise en scène qui ne consiste pas à être juste « soi », mais à « fabriquer un soi » qui colle à ce que YouTube attend (Gomez-Mejia et al., 2019).
• La subjectivité c’est le fait de devenir un « sujet » sur YouTube. Elle s’inscrit dans un système qui pousse les vidéastes à se montrer, à raconter, à performer pour exister sur la plateforme, notamment pour créer un effet de proximité très fort avec le public. Cette subjectivité est une mise en scène qui ne consiste pas à être juste « soi », mais à « fabriquer un soi » qui colle à ce que YouTube attend (Gomez-Mejia et al., 2019).
La communication scientifique a longtemps été perçue comme un domaine réservé aux échanges d’informations factuelles et objectives, souvent dépourvues d’émotions. Cependant, avec l’avènement des plateformes numériques comme YouTube, cette perception évolue. Les émotions semblent jouer un rôle central dans la manière dont le savoir scientifique est partagé et reçu. YouTube offre aux vidéastes la possibilité d’intégrer des éléments émotionnels pour capter l’attention de leur public et le fidéliser. Qu’elles soient exprimées à travers le ton de la voix, les expressions faciales, les récits personnels ou les effets visuels, les émotions permettent de rendre le contenu scientifique plus accessible et semblent résonner autrement chez l’auditoire que dans une version plus académique, plus distante.
Communication scientifique, médiation, médiatisation, vulgarisation… Il est compliqué de s’y retrouver. Pour y voir plus clair, voici un tableau synthétique qui fait le point sur les principales différences.
| Notion | Publicisation | Communication | Vulgarisation | Médiatisation | Médiation |
| Définitions | Diffusion de la science dans l’espace public, englobant tous les efforts pour la rendre visible et accessible | Processus bidirectionnel d’échange de savoirs entre scientifiques et aussi vers divers publics | Transmission verticale de concepts scientifiques simplifiés pour les rendre compréhensibles à un large public sans expertise scientifique supposée | Processus par lequel les sciences sont présentées et relayées par les médias de masse (journaux, télévision, réseaux sociaux) | Transmission horizontale de connaissances scientifiques via des échanges ou des dispositifs pédagogiques et interactifs |
| Objectifs | Rendre la science plus accessible à la société dans son ensemble | Promouvoir la compréhension mutuelle entre scientifiques et non-scientifiques | Rendre la science compréhensible et intéressante pour le grand public | Rendre la science visible dans l’espace médiatique, souvent en réponse à l’actualité | Favoriser l’engagement et l’appropriation active de la science par le public |
| Public visé | Grand public, politiques, médias | Scientifiques, public spécifique (politiques, industries) et grand public | Grand public, non-spécialistes | Grand public, auditoire, public de médias | Grand public, scolaires, public des musées |
| Supports | Médias traditionnels, réseaux sociaux, conférences publiques, publications | Articles, conférences, discussions en ligne, événements scientifiques | Livres, vidéos, blogs, expositions, podcasts | Médias de masse (télévision, radio, presse écrite, internet) | Ateliers interactifs, musées, centres de sciences, jeux pédagogiques |
| Distinctions | Processus global qui inclut la vulgarisation, la médiatisation et la communication scientifique | Vise un dialogue | Se concentre sur la simplification du contenu pour faciliter la compréhension sans perdre l’essence des concepts scientifiques | Souvent orientée vers la couverture des découvertes scientifiques dans un contexte d’actualité | Implique souvent une dimension éducative, où l’interaction et l’accompagnement sont essentiels |
Dans cette troisième partie, nous allons voir comment les émotions sont intégrées dans les contenus de vulgarisation scientifique sur YouTube, les différences entre la communication scientifique académique traditionnelle et la vulgarisation sur YouTube, ainsi que les conséquences de l’intégration des émotions sur la perception de la science. Enfin, nous allons parler du concept d’« hybridation discursive » (Gambier et Suomela-Salmi, 2011) et le rôle des émotions et de l’incarnation dans la médiation du savoir scientifique.
Les émotions dans la science sur YouTube
Parce que YouTube mélange les modes d’expression, l’immédiateté et la proximité relationnelle, la plateforme contribue à transformer la réception des savoirs en une expérience émotionnelle. Ce qui la rend particulièrement adaptée à la vulgarisation scientifique. L’émotion, dans ce contexte, ne se réduit pas à un simple ornement, mais elle constitue un levier puissant d’engagement intellectuel et affectif. Cette intégration émotionnelle se structure autour d’un double effet de séduction et de persuasion. En s’appuyant sur la « fonction émotive » telle que définie par le linguiste Roman Jakobson (1960), les vidéastes orientent leur message en focalisant l’attention sur leur propre état émotionnel, réel ou simulé. De cette manière, iels provoquent une résonance affective sur l’auditoire, stimulant son intérêt et favorisant son adhésion aux contenus présentés.
Les vidéastes sur YouTube utilisent toute une palette d’outils expressifs – intonation de la voix, expressions faciales, rythme des gestes – qui permettent d’illustrer et d’amplifier l’impact émotionnel des contenus. Ce recours à l’émotion est d’autant plus essentiel que le public, en situation d’asymétrie cognitive (c’est-à-dire qu’il en sait moins que le ou la vidéaste à cet instant de la vidéo), doit s’appuyer sur des repères affectifs pour filtrer et interpréter l’information. Ainsi, l’état émotionnel du public sélectionne certaines informations du discours, les rendant plus visibles, mémorables et susceptibles d’influencer son jugement et son comportement.
Enfin, pour aller plus loin, les émotions intégrées au discours ne sont pas uniquement des outils de motivation ; elles participent également à la construction d’une relation de confiance entre vidéaste et audience. Par exemple, une vidéaste qui partage un savoir avec enthousiasme ou exprime une inquiétude palpable face à un enjeu de santé publique engage non seulement le cerveau, mais aussi le cœur de son public. Cette posture émotionnelle humanise le discours, dissipe la distance entre le savoir scientifique et le grand public et elle facilite la réception critique tout en suscitant un engagement émotionnel profond.
Analyse de séquences vidéo où les émotions
jouent un rôle clé
Pour illustrer cette intégration émotionnelle dans le discours de vulgarisation scientifique sur YouTube, l’analyse de séquences révèle comment la combinaison d’émotions et d’éléments cognitifs construit une expérience audiovisuelle immersive, propre à transmettre un savoir.
Dans une séquence typique d’une vidéo de vulgarisation scientifique, nous observons d’abord une mise en scène émotionnelle avec un ton enthousiaste, voire dramatique, au moment d’introduire une découverte ou un problème majeur. Cette modulation vocale et gestuelle agit comme un déclencheur émotionnel, captant l’attention du public et préparant son esprit à recevoir un message important. Par exemple, lors de l’explication d’une avancée génétique, l’expression d’émerveillement ou d’inquiétude peut précéder une explication didactique.
Ensuite, les contenus sont simplifiés et illustrés par des métaphores visuelles ou analogies, associées à des indices émotionnels implicites ou explicites – un sourire, un regard inquiet, une pause dramatique. Ces signaux affectifs jouent un rôle fondamental dans l’organisation et la hiérarchisation des informations transmises, favorisant la mémorisation et la compréhension. L’interaction entre émotion et cognition dans ces séquences permet aussi d’orienter les prises de position du public.
Enfin, les séquences vidéo incluent fréquemment des appels à l’action, qui reposent largement sur la charge émotionnelle accumulée au fil de la vidéo. Qu’il s’agisse d’inviter à la réflexion, de partager la vidéo, de s’abonner ou de modifier un comportement, ces moments exploitent la fonction persuasive de l’émotion pour renforcer l’adhésion et l’engagement actif.
Ainsi, les émotions intégrées dans ces séquences ne sont pas accessoires : elles sont constitutives de la structure argumentative du discours. Elles transforment la simple transmission d’informations en une expérience sensorielle et affective où l’auditoire est émotionnellement impliqué dans la construction du savoir.
Valentine Delattre, vidéaste de la chaîne Science de Comptoir, l’assume entièrement : pour elle, faire rire est aussi important (voire plus) que de transmettre du savoir scientifique.
Prenons l’exemple de la vidéo intitulée « 🌴🐒 Le MYSTèRE de la BIODIVERSITé MALGACHE enfin RéSOLU… par des GéOLOGUES ?! 🦎🐘 » mise en ligne le 10 janvier 2025 sur la chaîne « Science de Comptoir ». L’introduction rend bien compte de l’outillage expressif qu’utilise la vidéaste. Elle intercale les plans d’illustration, les exemples, les interviews (exemple de multimodalité) avec des plans classiques d’incarnation et elle insère régulièrement des blagues, des effets humoristiques, de manière à garder le public actif et à proposer une expérience émotionnelle riche.
La place des émotions dans la science académique
La communication scientifique académique repose traditionnellement sur une exigence de neutralité émotionnelle et de rigueur formelle. Dans ce cadre, l’émotion est souvent perçue comme un facteur de perturbation ou de biais cognitif, susceptible de compromettre l’objectivité des énoncés scientifiques. L’émotion, lorsqu’elle apparaît, est généralement contenue dans le registre du « méta-discours », c’est-à-dire un discours inclus dans le discours, mais elle n’est jamais revendiquée comme un outil rhétorique central. Par exemple, une chercheuse peut parler avec émotion de ses recherches, car elle est passionnée, mais cette émotion n’est pas un procédé rhétorique conscient et volontaire pour atteindre un objectif de transmission de savoirs. À l’inverse, la vulgarisation scientifique sur YouTube, revendique une place importante accordée à l’émotion. Ce type de discours mobilise des « procédés pathémiques » destinés à attirer l’attention, favoriser l’adhésion et stimuler la mémorisation des contenus.
La « fonction émotive » devient un levier essentiel de la communication où la personne qui parle se met dans l’état émotionnel qu’elle souhaite transmettre à son public, en structurant son propos autour d’un récit captivant, amplifié par des procédés linguistiques et visuels susceptibles de produire un effet affectif sur l’auditoire. Cette stratégie repose sur l’orientation du message vers le ou la destinataire, comme l’a défini Roman Jakobson, qui vise à mobiliser les affects pour provoquer réaction, adhésion, voire identification. C’est ce qui renvoie à la fonction expressive du langage.
La différence majeure réside donc dans le statut de l’émotion selon le contexte. Dans la sphère académique, elle reste à la périphérie du discours, parfois même volontairement écartée. Dans les formats vulgarisés comme ceux proposés sur YouTube, elle devient structurante et stratégique. L’émotion y est conçue comme un vecteur d’intelligibilité, permettant d’accrocher un public non spécialisé, souvent guidé par des attentes pratiques ou affectives plus que par une quête théorique de vérité, l’un n’empêchant pas l’autre.
Les conséquences des émotions
sur la perception de la science
L’intégration d’éléments émotionnels dans la communication scientifique vulgarisée a des conséquences sur la réception et la perception de la science par le public. En effet, les émotions influencent les processus d’apprentissage et d’appropriation à plusieurs niveaux. Elles orientent la pensée, modifient l’évaluation des informations et peuvent altérer les jugements initiaux qui les ont suscitées, par exemple, en déconstruisant une information que nous tenions pour vraie et qui se révèle inexacte. Le public ne reçoit pas l’information de manière passive. Il la traite selon une grille interprétative façonnée par son émotion, ses croyances, son histoire affective, etc. Nous ne sommes pas tous et toutes les mêmes face à une information. Notre identité et tout ce qui nous façonne viennent interférer dans le processus de réception et d’appropriation. Ainsi, l’émotion devient un filtre sélectif qui rend certains éléments du discours plus saillants, plus accessibles et donc plus mémorables. Elle conditionne également l’adhésion aux contenus : un message est d’autant plus crédible qu’il entre en résonance avec les valeurs de la communauté des spectateurs et des spectatrices.
Imaginez qu’une enseignante vous parle pendant dix minutes des dangers du harcèlement scolaire avec des chiffres, des lois, des statistiques. C’est important, vous pouvez même concevoir intellectuellement l’ampleur du phénomène, mais ce n’est pas forcément ce que vous retiendrez le plus. Maintenant, imaginez qu’une élève de votre lycée vienne témoigner devant toute la classe, la voix un peu tremblante. Elle vous raconte comment elle a été harcelée, ce qu’elle a ressenti chaque matin avant d’aller en cours, comment elle a perdu confiance en elle et a développé de la phobie scolaire… Vous vous souviendrez de ses mots, de son visage, de ce qu’elle a dit. Elle n’aura certainement pas utilisé de chiffres, de données tangibles, mais vous croirez profondément en ce qu’elle raconte. Pourquoi ? Parce que son témoignage a provoqué une émotion en vous.
Cette dynamique peut renforcer la confiance accordée à la personne qui prend la parole, à condition que son discours ne soit pas perçu comme excessivement manipulateur. Elle peut aussi, en retour, reconfigurer la manière dont le public perçoit la science elle-même, non plus comme une sphère froide et détachée, mais comme un domaine incarné, proche, concerné par les affects humains.
Cependant, cette implication émotionnelle peut aussi conduire à une réception biaisée, où nous acceptons ou rejetons des arguments non en fonction de leur validité scientifique, mais selon leur charge affective ou leur conformité à des attentes subjectives. La science devient alors un discours parmi d’autres, concurrencé par d’autres récits tout aussi « pathémiques », mais moins rigoureux dans leur construction épistémique. C’est ce qu’il peut se passer, par exemple, avec certains contenus relayant de fausses informations qui sont des « pièges à clics » (ou clickbaits en anglais), où la charge émotionnelle est si importante, qu’elle supplante tout esprit critique, toute rationalité. C’est un équilibre délicat à trouver !
Ainsi, cette médiation émotionnelle n’est pas sans limites. Elle implique une responsabilité éthique accrue, dans la mesure où la mise en récit peut conduire à simplifier, à dramatiser ou à sélectionner les contenus en fonction de leur potentiel « pathémique ». Le risque réside alors dans une esthétisation du savoir, où la forme l’emporte sur la rigueur. C’est dans cet équilibre instable – entre engagement affectif et exigence de vérité – que se jouent la puissance, mais aussi la fragilité de la vulgarisation scientifique contemporaine.
Fusion des genres au profit de la médiation
Nous l’avons vu précédemment, la vulgarisation scientifique sur YouTube emprunte simultanément à des registres académiques, médiatiques, narratifs, voire intimes ou humoristiques. C’est ce qui est nommé l’« hybridation discursive », c’est-à-dire la fusion de genres, de codes et de registres de discours distincts au sein d’un même espace de communication. Nous assistons ainsi à une déconstruction des frontières traditionnelles qui séparent le discours savant du discours ordinaire, dans un souci de rendre le savoir plus accessible, mais aussi plus incarné.
Cette fusion des genres se manifeste à plusieurs niveaux :
- Lexical (le vocabulaire employé) par l’alternance entre un jargon technique et un langage courant.
- Énonciatif (la manière de s’exprimer) avec l’alternance entre une posture professorale et un tutoiement complice.
- Générique (le format du contenu vidéo) par l’entrecroisement du cours magistral, du vlog, du documentaire, du sketch.
- Visuel et sonore avec l’alternance de ton de la voix, de musiques, d’animations, de valeurs de plan, le montage, etc.
Cette hybridation discursive permet de construire une sorte de contrat de communication spécifique, qui repose non plus sur l’autorité académique seule, comme c’est le cas avec une conférence académique, mais sur la proximité, l’émotion et la scénarisation du discours. Ce processus ne marque pas une perte de scientificité en soi, mais plutôt une mutation des formes de légitimation du savoir.
La personne qui prend la parole gagne en crédibilité non seulement par sa compétence à vulgariser un contenu scientifique pointu, mais aussi par sa capacité à établir une relation affective et narrative avec son public. Le discours se construit dès lors dans un entre-deux mouvant, à la fois didactique et affectif, informatif et expressif, savant et populaire.
Émotions et incarnation, deux piliers indispensables
Dans cet espace discursif hybride, l’émotion et l’incarnation jouent donc un rôle central dans la transmission du savoir scientifique. La personne qui produit des contenus de vulgarisation scientifique n’est plus une instance abstraite énonçant des vérités universelles, mais une personne située, avec une voix, un corps, une histoire, et souvent une subjectivité assumée. Ce processus d’incarnation permet une reconfiguration du contrat de communication, où la transmission de savoir s’effectue autant par le contenu que par l’identité narrative et émotionnelle du locuteur ou de la locutrice.
L’émotion réduit la distance cognitive – c’est-à-dire l’écart entre ce qu’on connaît déjà et ce qu’on doit apprendre, entre le savoir scientifique et l’expérience quotidienne. En mobilisant des affects, des anecdotes personnelles, des gestes expressifs, des regards caméra ou des traits d’humour, les vidéastes donnent au savoir une épaisseur humaine, susceptible de renforcer l’identification et la capacité des publics à retenir l’information.
Cette dimension incarnée du discours transforme la relation au savoir. Les vidéastes font vivre la science, la rendent sensible et émotionnellement impactante. Iels sont aussi des personnes médiatisées : leur crédibilité n’est plus uniquement associée à leur savoir acquis, mais à la manière dont iels le donnent à voir et à ressentir. C’est d’ailleurs ici que se situe toute leur expertise !
Cette « subjectivité » du discours scientifique, peut certes en compromettre la rigueur scientifique comme nous l’avons vu, mais elle peut aussi en augmenter la portée sociale, en suscitant l’adhésion de publics plus larges, moins familiers des codes académiques. Cela reste néanmoins à démontrer (mes études sur le sujet semblent indiquer que ce n’est pas aussi évident que cela). Le simple fait de consulter ces vidéos nécessite un bagage scientifique et un capital symbolique qui n’est pas propre à tout le monde. Bien que cela soit tentant à croire, la vulgarisation scientifique sur YouTube n’échappe pas à une forme d’entre-soi – c’est-à-dire à une homogénéisation de son public, qui serait plutôt bien pourvu en capital scientifique, masculin et issu des classes intermédiaires. Bref, ce n’est pas tout le monde qui s’y intéresse !
En bref
1. L’émotion pour capter l’attention et donner du sens
Sur YouTube, les émotions ne sont pas seulement un ajout au discours scientifique : elles jouent un rôle central. Elles attirent l’attention, donnent envie d’écouter, éveillent la curiosité. Elles ne sont pas opposées au savoir mais permettent souvent de mieux le comprendre. En combinant émotions et explications, les vidéastes rendent les sujets scientifiques plus vivants et plus proches. L’important n’est plus seulement ce qui est dit, mais la manière dont est ressenti et transmis le contenu pour une meilleure appropriation et mémorisation.
2. Une nouvelle façon de parler de science
Si YouTube est un très bon outil pour diffuser la science, c’est aussi un lieu où la manière de parler de science change. L’émotion devient une partie du langage. Elle marque les moments importants, change le ton, rend les idées plus claires. Joie, peur, étonnement, surprise : toutes ces émotions servent à expliquer, à donner du relief. Chaque vidéaste crée son propre style, mêlant contenu rigoureux et expressions personnelles à travers l’incarnation. L’émotion aide à simplifier, mais aussi à faire passer des idées plus complexes, sans que cela soit trop exigeant pour le public.
3. Les risques de la vulgarisation scientifique
Cette place donnée aux émotions pose aussi des questions.
Un surplus d’émotions peut parfois éloigner le public du contenu scientifique. À vouloir rendre les choses toujours plus spectaculaires, pour gagner des vues par exemple ou fidéliser leur audience, les vidéastes risquent de s’éloigner de la référence scientifique. Il faut donc trouver un équilibre : ne pas cacher l’émotion, mais ne pas oublier l’exactitude du savoir. Ce n’est pas un problème propre à YouTube, c’est une question plus large qui concerne l’avenir même de la manière dont nous communiquons la science.